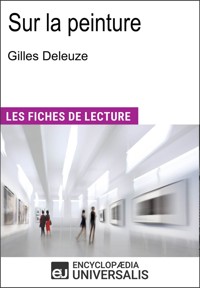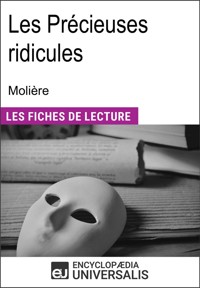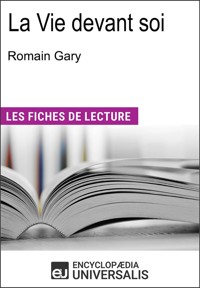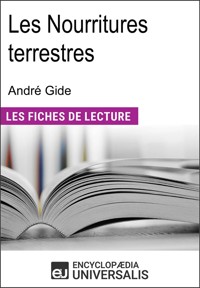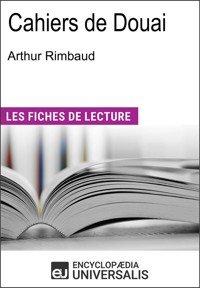Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Alors que la Chine est devenue un acteur économique majeur et prend place au premier rang des grandes puissances mondiales, ce Dictionnaire de la Pensée chinoise traditionnelle publié par Encyclopaedia Universalis explore les fondations de la civilisation millénaire sur laquelle s’est construite cette réussite. Quelques dizaines d’articles consacrés aux œuvres et à leurs auteurs ou commentateurs (Confucius, Laozi), aux concepts (Mandat céleste, Feng), aux doctrines (Taoïsme) proposent une plongée dans un univers où, entre le ciel, tian, et la terre, di, l’homme est régi au-dedans de lui par le même ordonnancement qui convient à l’extérieur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 536
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852291461
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Tarapong Siri/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans le Dictionnaire de la Pensée chinoise traditionnelle, publié par Encyclopædia Universalis.
Vous pouvez accéder simplement aux articles du Dictionnaire à partir de la Table des matières.Pour une recherche plus ciblée, utilisez l’Index, qui analyse avec précision le contenu des articles et multiplie les accès aux sujets traités.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
CHENG HAO [TCH’ENG HAO] (1032-1085) ET CHENG YI [TCH’ENG YI] (1033-1108)
Les deux frères Cheng sont, avec Zhu Xi, les penseurs les plus importants du néo-confucianisme. Élevés dans le milieu des philosophes de l’époque (ils sont élèves de Zhou Dunyi, amis de Shao Yong et neveux de Zhang Zai), ils reprennent les enseignements de ces sages pour les organiser en un système philosophique ; ainsi est-ce avec eux que le néo-confucianisme commence en tant qu’école. La pensée des deux frères est fondée sur les mêmes principes. Tous deux admettent, après Zhang Zai, que la Raison universelle (Li) est le principe transcendant et immanent de toute chose. Selon cette acception, le Li est synonyme du Dao des penseurs taoïstes classiques. Ce point de départ identique fait que les discours et propos des deux Cheng sont souvent cités ensemble ou même confondus et que leurs œuvres ont été réunies en un livre unique, Er Cheng Quan Qi. Mais les conclusions de chacun d’eux quant à l’application de ces principes cosmologiques à la morale générale et à l’éthique sociale, les principales questions qui occupent les confucianistes, sont très différentes. Cheng Hao, l’aîné, élève la bienfaisance, c’est-à-dire l’amour (Ren), au niveau d’une vertu universelle. C’est le Ren qui caractérise l’action génératrice du Ciel et de la Terre, action à laquelle l’homme participe. Le principe de vie, Xing (Nature innée), que l’homme renferme dans son cœur, se manifeste par le Ren. Cet idéalisme fondé sur les bons sentiments innés de chaque être, cette primauté donnée au cœur plutôt qu’à la raison font de Cheng Hao le fondateur, dans le néo-confucianisme, du courant dit de l’école du Cœur (Xinxue).
Le cadet, Cheng Yi, au contraire, reprend la théorie de Zhang Zai concernant les deux Natures, l’une universelle, originelle et foncièrement bonne mais immatérielle, l’autre matérielle, dans laquelle le bien et le mal se trouvent mêlés. Son approche est beaucoup plus intellectuelle. Il insiste sur l’objectivité, l’étude approfondie et la connaissance livresque. C’est de Cheng Yi que Zhu Xi s’inspira directement en développant son système, qu’on appellera dès lors l’école de la Raison (Lixue).
Kristofer SCHIPPER
CHINOISE (CIVILISATION) - La médecine en Chine
Depuis le début des années 1980, plusieurs facteurs ont conduit historiens et anthropologues à développer et renouveler le champ des études sur la médecine chinoise. D’une part, les travaux menés par les historiens ou philosophes, comme Foucault, sur la médecine européenne ont montré combien la médecine était un champ fécond pour l’histoire intellectuelle, sociale et politique d’une société donnée et ont ouvert des vocations. D’autre part, à la fin des années 1970, la reprise des activités de recherche dans les institutions intellectuelles chinoises et l’ouverture de la Chine et de ses bibliothèques aux chercheurs étrangers ont facilité le développement de la recherche. L’essor des publications tant en Chine qu’ailleurs s’est accompagné de problématiques nouvelles. En effet, il ne s’agissait plus pour les historiens de déceler dans la tradition médicale chinoise quelques éléments précurseurs pour une histoire compétitive des sciences, ni pour les médecins de promouvoir une médecine par rapport à une autre, comme ce fut souvent le cas des études menées jusqu’aux années 1970. L’objectif est désormais de comprendre, sur la base d’une analyse rigoureuse des textes ou grâce aux études ethnologiques de terrain, en quoi consistait la médecine pratiquée en Chine dans les temps anciens et ce qu’elle est dans la société contemporaine.
Les études historiques, philosophiques et anthropologiques qui ont donc vu le jour depuis le début des années 1980 ont contribué à lever le voile sur l’art médical en Chine, tel qu’il fut pensé, défini, enseigné et pratiqué depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Ce faisant, elles ont également mis en lumière les malentendus provoqués par la persistance en Chine d’une médecine « indigène », désignée de surcroît « médecine traditionnelle chinoise » (M.T.C., ou T.M.C. en anglais) depuis le milieu des années 1950. Cette dénomination, vraisemblablement choisie pour promouvoir en Chine mais aussi à l’étranger une certaine forme de la médecine, a longtemps contribué à diffuser l’image d’une médecine multimillénaire, sans rupture ni changement. Les nouvelles études ont mis en garde contre les effets illusoires de cet écrasement chronologique. La médecine, en Chine comme ailleurs, est un corpus de doctrines et de pratiques à la confluence des hommes, des maladies, du politique et de la culture. En Chine comme ailleurs, la médecine n’a jamais constitué un tunnel clos sur lui-même qui aurait traversé, intact, les âges, mais elle est un ensemble de doctrines et de pratiques soumises à des dynamiques internes et externes qui en modifient sans cesse les limites. Ce qui, à certaines époques, est hissé au rang de connaissances et de pratiques médicales officielles, peut être relégué, à d’autres époques dans la sphère de l’hétérodoxie et inversement. Le soutien que reçurent de la part des élites, à différentes périodes, les systèmes philosophiques en Chine – confucianisme, légisme, taoïsme, bouddhisme –, les modèles d’ordre social que celles-ci voulurent ériger ont considérablement influencé et façonné les représentations liées à la maladie et à ses traitements.
1. Maladies et thérapeutiques dans l’Antiquité chinoise : du modèle explicatif divin aux lois de la nature
Les plus anciens témoignages que nous ayons sur les conceptions des maladies et de leurs traitements sont des inscriptions sur carapaces de tortue, issues des divinations, pratiquées du XIe au VIIIe siècle avant J.-C., dans la vallée du cours moyen du Huanghe (fleuve Jaune), au nord-est de l’actuelle province du Henan. L’examen de ces sources archéologiques laisse entrevoir une certaine forme de culture de la santé et de la maladie. La maladie y est comprise comme la vengeance d’ancêtres défunts mal honorés, les morts et les vivants constituant alors une communauté unique fondée sur des liens de dépendance réciproque. À cette représentation des maladies répondent les pratiques sacrificielles destinées à rétablir l’harmonie entre morts et vivants. « Sévères maux de dents ? Faut-il tuer un chien et l’offrir au père Keng défunt et sacrifier un mouton ? », peut-on lire sur un oracle inscrit sur carapace de tortue.
Les conceptions de l’origine des maladies changent au milieu du 1er millénaire avant notre ère, sous la dynastie des Zhou (XIIe-IIIe s. av. J.-C.). Si les ancêtres défunts sont toujours perçus comme les acteurs essentiels de l’heureuse ou de la mauvaise fortune des vivants, ceux-ci avoisinent désormais tout un monde de démons dangereux, responsables, entre autres, des maladies. L’origine démoniaque des maladies est peut-être liée à la croyance qui prend forme à cette époque selon laquelle l’homme est habité par deux sortes d’âmes, les trois âmes hun et les sept âmes po. Quand arrive l’heure de la mort, ces âmes se séparent. Les âmes po restent auprès du corps tandis que les âmes hun s’en échappent et peuvent errer sur terre, devenant des sortes d’âmes mendiantes capables de s’attaquer aux vivants. Mais la croyance en l’attaque de démons, et donc d’éléments extérieurs à la communauté des hommes, reflète aussi sûrement le climat d’insécurité qui prévaut dans les derniers siècles des Zhou, marqués par le morcellement du pouvoir royal et l’émergence de royaumes concurrents se livrant à des guerres incessantes. Dans cette période, dite des Royaumes combattants, les individus comme les États sont soumis aux agressions extérieures. Cette conception nouvelle de l’origine de la maladie a pour corollaire des pratiques destinées désormais à exorciser le malade, comme les incantations. Elles sont l’apanage du wu, sorte de chaman supposé détenir des pouvoirs magiques lui permettant de modifier le cours des choses, comme apporter la pluie, arrêter le vent ou écarter les démons pathogènes.
Tandis que les guerres incessantes s’estompent et que s’établit un empire, sous l’égide de royaumes plus puissants que les autres, les Qin (221-206 av. J.-C.) puis les Han (206 av. J.-C.-220 apr. J.-C.), l’origine démoniaque de la maladie perd progressivement sa place au profit d’une compréhension nouvelle. Les textes écrits alors témoignent de l’émergence d’une culture de la santé différente, laquelle s’inscrit dans une perception nouvelle du monde. Les hommes sont convaincus que le monde qui les entoure est pénétré et gouverné par des lois naturelles compréhensibles. Ces lois qui régulent la génération, la transformation, la disparition des choses comme leurs interactions sont, aux yeux des Chinois, fondées sur des principes allant par deux ou par cinq qu’ils ont appelés Yin et Yang et Wuxing (Cinq Agents). Bientôt unis en un seul paradigme, le Yinyang wuxing sera largement et durablement utilisé par les Chinois pour rendre compte des phénomènes visibles et invisibles qui les entourent, du fonctionnement régulier de l’univers et de l’un de ses composants, l’homme.
2. « Yin », « Yang », « Wuxing », naissance d’une cosmologie liant l’homme à l’univers
Yin et Yang, dans leurs premiers emplois, servaient à désigner les aspects contraires du temps et de l’espace. Aux IVe et IIIe siècles avant notre ère, en plus de leur capacité à évoquer, de façon abstraite et générale, tous les contrastes de l’univers, Yin et Yang sont perçus comme des entités cosmogoniques, opposées mais complémentaires, à l’origine de toute existence et garantes de l’équilibre de l’univers. Issus du Yuanqi ou souffle originel primordial et unique, le Yang, souffle pur et léger, est monté et a fait le Ciel, et le Yin, souffle opaque et lourd, est descendu et a formé la Terre. Entre ces deux pôles, se situe le monde humain, constitué de la réunion du Yin et du Yang, dont le propre est de s’emmêler, de s’engendrer ou de s’annuler. Dans ce monde, en effet, Yang et Yin sont solidaires et complémentaires : le déclin de l’un signifie le développement de l’autre, le paroxysme de l’un donne naissance à l’autre. Par leurs subtiles alternances et combinaisons, Yin et Yang animent le principe vital de tout être, le Qi, et président à la totalité des changements des phénomènes naturels.
L’alternance des principes efficients Yin et Yang se trouve combinée avec celle des Cinq Agents (Bois, Feu, Terre, Métal, Eau), au IIIe siècle avant J.-C. Les Cinq Agents, qui, comme le Yin et le Yang à leur début, ont pu servir à classer l’ensemble des êtres et des objets concevables dans l’univers, ont été envisagés non pas dans le sens grec des éléments de base constituant toute chose, mais sous un angle essentiellement fonctionnel, pour rendre compte des processus de changements continus au sein du cosmos. On doit à Zou Yan (305-240 av. J.-C.) l’initiative d’avoir corrélé les Cinq Agents à la dynamique Yin-Yang, au point d’en faire un courant de pensée connu, dès le IIe siècle avant notre ère, sous le nom de Yinyang wuxing jia (école du Yin-Yang et des Cinq Agents). Au Yang croissant correspondent le Bois et le Feu, au Yang qui cède la place correspond la Terre, au Yin croissant correspondent le Métal et l’Eau. Les Cinq Agents sont donc des symboles capables d’évoquer tous les phénomènes naturels et leur dynamique propre. Cette dynamique qui fait passer d’une saison à l’autre, d’un état à l’autre, les Chinois l’expliquent par l’idée que les Cinq Agents entretiennent des relations, les plus connues étant celle de destruction (Eau→Feu→Métal→Bois→Terre) et celle d’engendrement (Eau→Bois→Feu→Terre→Métal) [fig.1]. L’interaction dynamique entre les Cinq Agents et tous les phénomènes qu’ils regroupent explique la régulation et le maintien de l’univers en équilibre.
Relations d'engendrement et de conquête des Cinq Agents. Les Cinq Agents sont des symboles capables d'évoquer tous les phénomènes naturels et leur dynamique propre.
Le Yin, le Yang et les Cinq Agents fournissent les fondements à l’élaboration d’une cosmologie qui, en dépit de quelques opposants, s’impose durablement comme modèle intellectuel, d’autant qu’il est validé par la doctrine confucéenne, élevée elle-même au rang d’orthodoxie sociale et politique sous l’empereur Wu des Han (Wudi, 141-87 av. J.-C.). Ce paradigme, qui rend compte des changements réguliers dans l’univers, s’est étendu à tous les domaines de l’existence, y compris à celui de la santé et des maladies de l’homme, médiateur hybride entre ciel et terre, composé de Yin et de Yang. Les manuscrits de Mawangdui, datés du IIe siècle avant l’ère chrétienne, le Huangdi neijing (Canon interne de l’Empereur Jaune), composé de deux parties (Lingshu et Suwen), rédigées entre le IIe siècle avant J.-C. et le IIe siècle après J.-C., et le Nanjing (Canon des difficultés), daté du Ier ou du IIe siècle après J.-C., en portent la trace. L’analyse de ces premiers textes médicaux indique un cheminement dans l’élaboration du système conceptuel de la médecine chinoise que nous avons pris l’habitude de désigner « médecine des correspondances systématiques ». Entre les manuscrits de Mawangdui et le Nanjing, la médecine qui prend appui sur le paradigme Yin-Yang-Cinq Agents s’est imposée et rationalisée. Elle a aussi fait des choix conformément à l’éthique du moment, dominée par le légisme et le confucianisme. Cette littérature marque le début de la médecine, si on considère la médecine comme la tentative d’expliquer la santé et les maladies sur la base de lois naturelles.
3. Les fondements de la médecine des correspondances systématiques (Qin, Han)
À la fin des Zhou, une partie de l’élite a donc perdu la foi dans le modèle explicatif divin et voit désormais l’existence humaine comme dépendante des lois naturelles qui pénètrent l’univers. Ce nouveau style de raisonnement apporte des choses différentes. Pour la première fois, une image de l’intérieur du corps est verbalisée, une recherche des causes des maladies comme des traitements est exposée, même si de nombreuses contradictions existent entre les différents textes de cette époque, voire à l’intérieur d’un même texte.
• Le corps : un microcosme hiérarchisé à l’image du macrocosme
Selon ces textes, le corps humain est composé d’unités anatomiques-fonctionnelles parcourues par un réseau de canaux liant toutes les parties entre elles et acheminant des substances, en particulier le sang et le Qi. Douze canaux (« canal » est aujourd’hui préféré à « méridien » car il rend mieux compte de l’idée d’acheminement qui sous-tend les termes chinois) sont reliés aux onze ou douze entités anatomiques, classées en deux catégories : les Zang, dont l’étymologie évoque l’idée de stockage, localisés en profondeur du corps, comptent les reins, les poumons, le foie, la rate, le cœur et le péricarde, souvent associés en une seule unité ; les Fu, dont l’étymologie évoque à la fois l’idée de stockage mais aussi de centre administratif, sont en superficie et comptent l’estomac, l’intestin grêle, le gros intestin, la vessie, la vésicule biliaire et le triple réchauffeur. Il est clair qu’à cette époque une connaissance anatomique est disponible. Le Nanjing, en particulier, donne la taille et le volume de chacune de ces entités. Zang et Fu correspondent donc pour l’essentiel aux organes et viscères identifiés par l’anatomie moderne. Mais la fonction qui leur est alors attribuée leur confère un sens particulier. Les Zang, d’une façon générale, gouvernent ; les Fu sont les palais des Zang, à l’image du gouverneur qui exerce à partir d’un palais. Le corps est donc perçu comme un organisme fondé sur un système d’entités anatomiques et fonctionnelles premières et secondaires reliées les unes aux autres non seulement morphologiquement, par le biais des canaux, mais aussi fonctionnellement. En effet, chaque unité anatomique est dotée de fonctions propres en étroite relation de subordination ou de commanderie avec les fonctions des autres parties du corps. À titre d’exemple, l’estomac est le palais de la rate ; par ailleurs, la rate gouverne les muscles et la chair (tabl. 1).
Fu et Zang : leurs liens, leurs fonctions, leurs ouvertures. Les Zang sont des organes qui emmagasinent, les Fu assurent les transformations. L'ensemble représente une anatomie fonctionnelle du corps.
Toutes les parties, y compris l’esprit, sont solidaires et coopèrent, formant un microcosme dynamique relié au macrocosme. Ce lien est fourni par l’association des parties du corps aux lignes de correspondances du Yin, du Yang et des Cinq Agents. Toutes peuvent être classées en fonction de leurs caractéristiques Yin ou Yang. Les parties supérieures, gauches, extérieures du corps, sont Yang ; les parties inférieures, droites, intérieures, sont Yin. En aucun cas, cependant, la qualification Yin ou Yang d’un élément corporel n’équivaut à une essentialisation de l’élément en question qui n’est Yin que par rapport à un autre qui est Yang dans une perspective donnée. Chaque partie du corps – entités anatomiques fonctionnelles Zang et Fu, canaux, âmes Hun et Po, émotions – est également liée à l’un des Cinq Agents et à tous les phénomènes naturels qui lui sont associés : le cœur au Feu, la rate à la Terre, les poumons au Métal, les reins à l’Eau et le foie au Bois. Ainsi, le cœur est en relation, dans le corps, avec l’intestin grêle, la langue, les vaisseaux, la sueur, la joie, le rire, et, dans le monde naturel, le cœur est associé avec le sud, le rouge, la canicule, l’été, midi ou l’amertume (tabl. 2). Chaque unité contrôle et régénère une autre unité, selon les cycles de conquête et d’engendrement des Cinq Agents. Ainsi, le cœur (Feu) est contrôlé par les reins (Eau) et régénère la rate (Terre). Les éléments du corps forment un microcosme, dans lequel, à l’image du macrocosme, les jeux alternés du Yin, du Yang et les relations d’engendrement et de contrôle, entre autres, des Cinq Agents instaurent un équilibre autocorrecteur.
Correspondances des Cinq Agents dans la nature et le corps. Le déséquilibre entre Yin, Yang et les Cinq Agents est à l'origine des maladies.
À l’intérieur de ce corps, beaucoup d’éléments circulent, notamment le Qi et le Xue. Si le Xue identifié dans la littérature chinoise ne pose pas de problèmes majeurs de compréhension et peut être assimilé au haima de la médecine grecque et au sang d’aujourd’hui, le Qi, à l’inverse, est difficile à définir tant les images qui lui sont associées et les processus qui en assurent la production sont nombreux. La sémantique du Qi est en effet complexe, tout comme celle du pneuma grec avec lequel le Qi partage, à l’évidence, certaines notions. L’un comme l’autre sont associés à la respiration ainsi qu’à la notion de vapeurs raffinées émanant de l’ingestion d’aliments. Néanmoins, dans la tradition chinoise, ces vapeurs semblent recouvrir une notion très abstraite qu’il est difficile de faire coïncider avec le pneuma grec. Pour résumer, dans la littérature produite sous les Qin et les Han, le Qi est un terme commun qui fait référence à une substance volatile en mouvement perpétuel dans le corps, produite à partir des substances de l’univers ingérées et raffinées, mais aussi par les entités anatomiques-fonctionnelles du corps. Cette substance volatile qui parcourt le corps, selon un sens régulier, est susceptible, dans son cheminement, d’être altérée, blessée, contrariée ou bloquée ; enfin, elle est liée aux émotions par une relation à double sens : le Qi produit les émotions qui, à leur tour, influencent la qualité du Qi. Le Qi, en somme, est responsable de tout ce qui se passe dans le corps. Ajoutons enfin que les textes fondateurs de la médecine chinoise n’évoquent pas qu’un seul Qi. Les substances ingérées donnent naissance au Qi de garnison Yingqi et au Qi défensif Weiqi, circulant, l’un dans les canaux et les entités anatomiques-fonctionnelles, l’autre sous la peau. C’est en raison d’une polysémie si étendue que les historiens ont finalement opté pour la translittération.
Le Qi comme le sang sont transportés dans toutes les parties du corps par les canaux. Dans les manuscrits de Mawangdui, on compte onze canaux indépendants les uns des autres. Dans le Huangdi Neijing, on trouve douze canaux principaux jing qui s’interconnectent et sont rejoints par d’autres canaux secondaires, les luomai et les Sunmai (tabl. 3). Au travers de tout ce système de conduites, liant le bas, le haut, l’intérieur et l’extérieur du corps, coule un flux incessant de Qi, alimenté par l’extérieur mais aussi par l’intérieur de l’organisme, et de sang. Ce flux régulé par la dynamique des Cinq Agents et irriguant toutes les parties du corps assure la bonne santé.
Les douze canaux (méridiens) principaux. Les canaux yin de la main (shou) partent de la poitrine vers la main ; ils rejoignent les canaux yang de la main qui remontent vers la tête où ils s'unissent aux canaux yang des pieds (zu) qui descendent jusqu'aux pieds où ils rejoignent les canaux yin des pieds qui remontent vers la poitrine, et ainsi de suite.
• Les maladies : dérégulations internes et attaques extérieures
Cet équilibre peut être rompu, notamment parce que ces canaux peuvent être empruntés par des intrus. Ces intrus pathogènes ne sont plus les démons de l’Antiquité ni même les insectes qu’on trouve mentionnés dans les manuscrits de Mawangdui, mais des agents prélevés dans l’environnement, comme le vent, le froid, la chaleur, l’humidité. La croyance en la capacité des agents naturels à causer des maladies est universelle. Dans la médecine hippocratique, la santé et la maladie des hommes dépendent, entre autres, des influences climatiques. Et si la théorie des germes est aujourd’hui connue de tous, il est encore fréquent d’entendre associer froid et grippe ou rhume. L’originalité de la médecine chinoise est d’associer ces influences environnementales aux lignes de correspondances du Yin, du Yang et des Cinq Agents : froid, vent, chaleur, humidité et sécheresse sont caractéristiques des saisons hiver, printemps, été, été prolongé et automne, et donc associés à l’un des Cinq Agents. Ils sont le Qi saisonnier régulier de chaque saison, typique de chacun des agents (chaleur = Été = Feu ; humidité = Été prolongé = Terre ; sécheresse = Automne = Métal ; froid = Hiver = Eau ; vent = Printemps = Bois). L’arrivée massive de l’une de ces influences saisonnières peut blesser l’homme. C’est l’unité anatomique fonctionnelle associée à ce même agent qui, en priorité, est atteinte. Le vent blesse le foie, la chaleur le cœur, l’humidité les reins, le froid les poumons. Outre les agents prélevés dans l’environnement naturel, l’absorption de mets et de boissons inadaptés peut porter atteinte à l’organisme en frappant en priorité la rate. Tels sont les cinq types d’agents pathogènes Xie définis dans le Nanjing qui blessent en priorité les cinq unités fonctionnelles premières, les Zang. En vertu des liens morphologiques et fonctionnels unissant les parties du corps, l’atteinte d’une unité particulière ne reste pas sans conséquence sur les autres espaces : une maladie dans une unité « gouverneur » Zang affecte les subordonnées et inversement. Ici, déficit de Yin ou de Yang, là, surplus d’élément pathogène, là encore, obstructions, telles sont les premières conséquences d’une atteinte corporelle que le médecin se devra d’identifier. Il reviendra également au médecin de définir si l’atteinte d’une entité anatomique est une atteinte première ou si elle est la conséquence d’une perturbation de la dynamique des Cinq Agents au sein de l’organisme.
L’existence d’agents environnementaux potentiellement pathogènes ne signifie pas que l’homme tombe inexorablement malade. Les textes de cette époque recèlent d’abondantes mesures préventives et avisent notamment le lecteur qu’un comportement en accord avec le cours naturel de l’univers lui garantira une longue vie. L’homme est donc en partie responsable de sa santé. Il lui suffit de bien connaître les phénomènes de l’univers et se mettre au diapason en adoptant un style de vie réglé par des normes bien définies et bien documentées. Par son observation des lois naturelles et morales, intrinsèquement liées dans la cosmologie des Han, l’homme peut conserver soigneusement ses matériaux de base, spirituels ou matériels. Une vie sans excès ni dans l’action, la réflexion, l’alimentation, les émotions ou l’activité sexuelle lui garantit cet équilibre interne nécessaire pour déjouer les attaques extérieures d’influences pathogènes.
• Le diagnostic : voir, écouter-sentir, interroger et ausculter
En vertu de l’idée que toutes les parties enfouies et invisibles du corps correspondent à des parties externes, visibles – les organes sensoriels, la couleur et la texture de la peau, les parties du visage –, l’observation médicale s’est développée sur un mode holistique, ne s’attachant pas au symptôme, détail isolé et manifestation localisée dans le temps et dans l’espace d’un déséquilibre général, mais à l’ensemble des manifestations psychophysiologiques recueillies au cours d’un examen fondé sur l’évaluation de l’apparence physique, du son de la voix, de la respiration et de la palpation. Les changements dans la théorie des canaux qui ont pris place entre les différents textes de cette époque se répercutent dans la façon de procéder. Dans le Huangdi Nejing, il était conseillé de palper les canaux en différentes parties du corps. Le Nanjing, s’appuyant sur l’idée que tous les canaux sont reliés, assurant un flux continu de Qi et de sang, propose de concentrer l’examen à un seul endroit, le poignet. Et il décrit une quarantaine de type de pouls (prises à différents endroits et en différentes profondeurs du poignet) qui permettent, en suivant la doctrine des correspondances systématiques, d’évaluer les mouvements de Qi et de sang dans toutes les parties du corps, de localiser une maladie, d’en identifier la nature (excès, déficit, obstruction) et de faire un pronostic. Le médecin doit donc utiliser ses yeux, ses oreilles pour recueillir l’histoire du malade et ses doigts pour palper le pouls. Il doit savoir comparer et en ajoutant les signes les uns aux autres, dresser un tableau spécifique de façon à prescrire un traitement.
• Les thérapies : la prévention et l’acuponcture
Contrairement aux manuscrits de Manwangdui qui proposaient un large éventail de pratiques préventives et curatives dont la pharmacopée, le Huangdi Neijing et le Nanjing négligent les approches pharmaceutiques et mettent l’accent sur la saignée et l’acuponcture. L’origine de l’acuponcture comme des points d’acuponcture du Huangdi Neijing est inconnue. Mais il semble que des outils pointus aient d’abord été utilisés pour la petite chirurgie puis pour drainer des surplus de sang et de Qi, le but ultime étant de diriger le flot de Qi et de sang dans les canaux conduisant aux unités anatomiques fonctionnelles et de restaurer un système compliqué d’échanges entre les centres de stockage et de consommation. Si l’absorption de remèdes était fréquente dans l’Antiquité, la médecine des correspondances systématiques, telle qu’on la trouve exposée dans les textes fondateurs des Qin et des Han, a majoritairement exclu de son arsenal thérapeutique cette possibilité, préférant remédier aux maladies en manipulant le Qi par l’acuponcture et imposer, pour la prévention, le seul respect des règles naturelles et morales.
Les textes fondateurs de la médecine chinoise permettent de reconstituer comment les théoriciens de cette époque comprennent le corps, son fonctionnement, les causes possibles des maladies et leur processus. L’étiologie des maladies combine désormais les notions d’attaque extérieure et celle de dérégulation intérieure. La médecine des correspondances systématiques ne renonce pas, en effet, à la notion, développée dans l’Antiquité, de maladie comme attaque extérieure, mais elle remplace les démons par les influences environnementales. En parallèle, elle développe l’idée de dérégulation interne. Ce nouveau système combine donc une approche ontique et fonctionnelle de la maladie. La manière dont celle-ci se développe et se transforme fait l’objet d’une grande attention. Les textes fondateurs de la médecine chinoise témoignent d’une connaissance anatomique du corps. Mais voir permet rarement de comprendre un processus. La compréhension des processus physiologiques et pathologiques s’élabore, pour l’essentiel, sur la base d’analogies avec le monde naturel et avec le monde social, politique et économique de l’empire nouvellement établi auquel la médecine emprunte de très nombreux termes. Comme l’a montré Paul Unschuld, l’organisme reflète la structure bureaucratique de l’empire avec, au sommet, un gouverneur responsable déléguant une foule de devoirs à ses nombreux ministres. La configuration du corps reproduit la configuration sociale et économique de la Chine après la réunification des Qin : tous les éléments qui garantissent l’unité de la Chine – lieux de stockages, lieux de transformation et surtout canaux qui assurent les échanges de biens – y sont représentés. Enfin, de même que la stabilité sociale et politique n’est obtenue qu’à la condition que les habitants de l’empire observent les lois et la morale, l’équilibre corporel est maintenu tant que la personne observe les règles naturelles et morales. En somme, et comme souvent, les théoriciens de la médecine projettent sur le corps et son fonctionnement les idées sociales et politiques qui sous-tendent le fonctionnement de la société, qui, au début de l’empire, sont issues majoritairement du légisme et du confucianisme.
4. Des fondements aux diverses traditions savantes
• Résurgence de la maladie démoniaque : incantations et charmes au sein du curriculum médical officiel
Les conceptions du corps, de la maladie et des traitements élaborées au début de l’empire vont imprégner durablement la médecine chinoise. Mais elles ne constituent pas un système définitivement clos. D’abord, à la fin des Han et au cours des Six Dynasties (220-589), lorsque s’effondrent l’empire et le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme font de plus en plus d’adeptes. L’idée que les maladies sont envoyées comme châtiments par des puissances divines sous la forme de démons épidémiques gagne du terrain. Ainsi refait surface la notion de maladie démoniaque et, avec elle, toutes les pratiques d’exorcisme, comme en témoigne par exemple le traité des Prescriptions valant mille pièces d’or de Sun Simiao (581-682), un médecin proche de la cour, qui réserve deux chapitres aux incantations. En fait, la suspicion de démons pathogènes perdure tout au long de l’histoire de la médecine. Les pratiques censées les dompter, charmes et incantations, sont par ailleurs hissées au rang de discipline officielle dans le cursus médical impérial défini par le Bureau impérial de médecine, depuis sa fondation sous la dynastie des Sui (581-618) jusqu’à la fin des Ming (1368-1644). Ainsi, l’émergence du paradigme Yin-Yang-Wuxing n’a pas mis un terme définitif au modèle explicatif divin qui, nous y reviendrons, sera, tout au long de l’histoire chinoise, au cœur de pratiques préventives et curatives extrêmement répandues.
• Innovations, transformations : exemple de la thérapeutique et de l’étiologie
Par ailleurs, la médecine des correspondances systématiques façonnée au début de l’empire n’est pas restée étanche aux changements politiques, sociaux et intellectuels qui avaient cours en Chine. Le taoïsme et le bouddhisme qui, pendant six siècles, remplacent le confucianisme comme pensée officielle, puis le rapprochement des trois doctrines en ce que l’usage appelle le néo-confucianisme des Song, ont apporté des changements à ce corpus de doctrines et de pratiques. Du taoïsme, par exemple, la médecine des correspondances systématiques reprend non seulement les pratiques incantatoires mais aussi la pharmacopée. Ainsi, la science des remèdes qui avait été exclue des textes fondateurs et s’était, au cours du Ier millénaire, essentiellement développée dans les milieux taoïstes est réintégrée dans la médecine des correspondances par le truchement d’une réinterprétation de son fonctionnement. On doit à quelques théoriciens des Song (960-1271) et des Yuan (1271-1368) le développement d’une pharmacologie entièrement fondée sur le paradigme des correspondances systématiques. Jusqu’alors, il était convenu qu’une plante, un minéral ou une partie d’animal possédaient une qualité thermique et une saveur particulière permettant de soigner ou d’alléger des symptômes précis. Le raisonnement qui s’élabore à partir des Song et qui s’attache à comprendre le fonctionnement des remèdes est le suivant : les remèdes, dotés de qualités thermiques et de saveurs précises, plus ou moins Yin et Yang et correspondant à l’un des Cinq Agents, développent, une fois qu’ils sont absorbés, des propriétés particulières – purgatives, pénétrantes, réchauffantes, dissipantes, etc. – elles-mêmes en correspondance avec les Cinq Agents et donc capables, en modifiant la dynamique interne, d’agir sur les symptômes des maladies. Cette réinterprétation des drogues qui offre un cadre théorique légitime aux observations empiriques et au pragmatisme des praticiens va donner une place de premier choix à la phytothérapie au cours du IIe millénaire. Dès la fin du XVIe siècle, les traités de médecine relèguent l’acuponcture dans le champ des pratiques thérapeutiques populaires ou seulement d’urgence. La cour impériale la bannira en 1822. Cette époque voit, en contrepartie, la publication de l’immense compendium sur la nature des plantes réalisé par Li Shizhen (1518-1593), le Bencao Gangmu, comptant plus de onze mille prescriptions et des descriptions techniques de plus de mille huit cents substances minérales, végétales et animales.
Plus généralement, au cours de l’histoire chinoise, certains points de la médecine – anatomie, acuponcture, science du pouls, étiologie – font l’objet de nouvelles recherches dont les résultats remettent parfois en cause les certitudes du passé et provoquent des polémiques. Ainsi, la résurgence, sous les Song, d’un texte écrit sous les Han, le Shanghan lun (Traité des maladies causées par le froid) qui soulignait l’importance du froid comme facteur pathogène donne naissance, dans les siècles qui suivent, à une réflexion importante sur l’étiologie débouchant sur des doctrines et des écoles thérapeutiques différentes, les unes prônant le froid et le rafraîchissement, les autres, les purgatifs, d’autres encore, les remèdes fortifiant la rate et l’estomac.
• Spécialisation et démocratisation de la médecine : des praticiens en concurrence
La médecine en Chine ne constitue donc pas un corpus de savoirs et de pratiques transmis depuis les Han de façon figée et immobile. Les évolutions de la thérapeutique comme celles qui sont liées à l’étiologie des maladies, sommairement évoquées ici, en sont la preuve. Mais bien d’autres changements et innovations sont apportés aux idées et pratiques définies dans les textes fondateurs, d’autant que la médecine, au fil des siècles, se spécialise. Le premier texte consacré aux enfants voit le jour au IIIe ou IVe siècle après J.-C., tandis qu’émerge, sous les Song, une science médicale pour les femmes. La spécialisation en médecine pédiatrique, gynécologique, ophtalmique, etc., se trouve confortée par le Bureau impérial de médecine qui, régulièrement, redéfinit le curriculum médical officiel. Sous les Song et sous les Ming, treize spécialités médicales y seront enseignées. La médecine se spécialise, elle se démocratise également. Au cours des deux dernières dynasties Ming (1368-1644) et Qing (1644-1911), sous l’influence de l’accroissement démographique, de la réduction du nombre de postes de fonctionnaire incitant une grande partie des lettrés à se tourner vers la médecine, du développement de l’imprimerie commerciale, la population de médecins et d’auteurs de textes médicaux s’accroît considérablement. Au travers de cette littérature gigantesque et encore en grande partie méconnue – le Catalogue des livres de médecine chinoise détenus par les bibliothèques chinoises recense 11 129 livres de médecine écrits de 1600 à 1949, auxquels ils faut ajouter les manuscrits ou livres imprimés qui circulent dans les réseaux privés –, les polémiques enflent entre partisans du rafraîchissement, de la purgation, et autres doctrines élaborées récemment, entre ceux qui considèrent les nouvelles doctrines comme partiales et invitent, comme leurs collègues philologues, à relire les textes classiques de l’époque des Han pour y retrouver la vérité ultime et l’efficacité optimale, enfin entre ceux qui considèrent les classiques d’autrefois dépassés et trop généraux et prônent une médecine adaptée à la région pour répondre à des maladies et des spécificités corporelles particulières.
En somme, quand, au début du XIXe siècle, la médecine européenne fait irruption en Chine, les experts en médecine ne constituent pas une communauté clairement identifiée. Une institution centrale de médecine existe pourtant, qui, depuis la dynastie des Sui, s’efforce de réglementer l’enseignement médical et la pratique de la médecine. Mais cette institution ne fédère ni socialement ni intellectuellement les praticiens qui, pour l’immense majorité, se forment à la médecine dans le cadre d’un apprentissage privé, auprès d’un maître, d’un ancêtre, ou par la lecture des textes transmis. À la fin de l’empire, la pratique de la médecine se partage donc entre des médecins aux profils social et culturel variés. Ces différents types de médecins sont en concurrence. Ils rivalisent de surcroît avec les chamans ou les moines taoïstes, capables, depuis l’Antiquité, d’exorciser les malades. En effet, si, tout au long de l’histoire de la Chine, il est courant que les médecins préconisent, en sus des prescriptions médicamenteuses ou d’acuponcture, les incantations ou les charmes, ce sont surtout les chamans ou les moines taoïstes qui en font leur fond de commerce pour lutter contre la maladie, conçue alors en termes démoniaques. Cette compréhension des maladies est en effet restée majeure dans l’histoire chinoise de la maladie et a donné lieu à des pratiques collectives ou individuelles encore très répandues au début du XXe siècle.
5. Les pratiques chamaniques, religieuses et rituelles
Première figure, dans l’Antiquité chinoise, à s’être occupée des souffrances humaines, le chaman est longtemps resté un intermédiaire privilégié par la population, en dépit des campagnes politiques qui, à différentes périodes, visèrent à l’éradiquer. Le chaman Wu était, depuis l’époque des Shang, investi d’un pouvoir magique. Il entretenait des relations privilégiées avec certaines divinités influentes. A ce titre, il pouvait diminuer les effets néfastes de démons mineurs sur les humains. Pour s’assurer l’aide des puissances surnaturelles, il devait d’abord se conformer à certaines conduites. La danse joua un rôle important, le pas de Yu en particulier. On sait que Yu le Grand (Dayu), fondateur légendaire de la dynastie des Xia (env. 2205-env. 1766), s’était sacrifié pour son peuple afin d’arrêter une inondation. Le dieu ne le prit qu’à moitié et le laissa hémiplégique. Ce n’est qu’en dansant sur un pied qu’il parvint à pacifier la terre et les eaux. Le pas de Yu devint célèbre et doté d’un pouvoir magique. Par le pas de Yu, le chaman s’assurait donc une certaine connivence avec les puissances surnaturelles qui le guidaient dans sa lutte contre les démons pathogènes. Incantations, souvent accompagnées de cris, coups de gong et mouvements d’épée, faisaient partie de son arsenal pour éloigner les démons et soulager les hommes.
À la fin des Han, la montée en puissance du taoïsme et la mise en place d’une Église taoïste introduisit de nouveaux acteurs. En dépit d’une foi partagée avec les chamans en la maladie démoniaque, ceux-ci, concurrents, proposaient de nouvelles manières de soigner. En place de la confrérie anarchique et des pratiques bruyantes des chamans, les taoïstes mirent sur pied une véritable Église hiérarchisée composée de moines lettrés. En place des divinités de l’Antiquité mal définies, ils élaborèrent une bureaucratie céleste, dirigée au sommet par Yu Huang, l’empereur de Jade, et composée de nombreux ministères chargés, entre autres, de comptabiliser les bonnes et mauvaises actions des hommes. Si les taoïstes partageaient avec les chamans la croyance en l’origine démoniaque des maladies, ils expliquaient l’intrusion du démon par les fautes morales du malade ou par celles de l’un de ses ancêtres, même très éloigné. Une fois isolé dans une chambre de retraite conçue à cet effet, le malade devait confesser ses fautes au prêtre. Celui-ci les transcrivait sur un document qu’il établissait en général en trois exemplaires, adressés au ciel, à la terre et à l’eau ou qu’il adressait à celui des généraux et officiels célestes le plus à même d’agir. Se confesser et faire des offrandes au prêtre, qui, par la voie épistolaire, intercédait donc auprès d’une hiérarchie céleste, étaient les conditions nécessaires pour espérer guérir, même si – les sources en témoignent – la pharmacopée était également largement utilisée.
Punition divine envers un individu, la maladie pouvait parfois sanctionner une communauté entière. En effet, dans la religion populaire qui se développe activement alors et qui mêle, de plus en plus, taoïsme et bouddhisme, l’épidémie était comprise comme une punition collective, décidée par l’un des nombreux ministères composant la bureaucratie céleste, le ministère des épidémies Wenbu. Constitué d’un président, d’assistants et de fonctionnaires subalternes, ce ministère était tout particulièrement chargé de surveiller la communauté des vivants et de faire un compte rendu annuel de ses fautes et de ses bonnes actions. En fonction du bilan, l’empereur de Jade pouvait décider de châtier collectivement la société en envoyant des fonctionnaires chargés de répandre l’épidémie. Cette croyance a suscité de nombreux rituels collectifs pratiqués comme mesure préventive, à date fixe, ou curative, en pleine épidémie. La pratique de rituels incluant tous les membres de la société dans un effort commun de rédemption, était en effet particulièrement propice à infléchir le jugement de l’empereur de Jade, qui garderait ou ferait revenir à lui ses fonctionnaires épidémiques. Généralement conduits par des moines taoïstes, ces rituels incluaient des pièces de théâtre en l’honneur de divinités compatissantes, des défilés de statuettes de dieux protecteurs, des processions et la mise à l’eau de bateaux en forme de dragon censés raccompagner les épidémies.
Par choix ou par nécessité, les chamans et les moines taoïstes furent certainement, tout au long de l’histoire chinoise, les acteurs les plus sollicités par la population pour soigner les maladies individuelles ou épidémiques. Au début du XXe siècle, les observateurs tant chinois qu’étrangers rapportent l’usage encore très répandu de pratiques chamaniques ou taoïstes fondées sur le paradigme démoniaque de l’Antiquité chinoise et soulignent le peu de confiance que suscitent médecins et médicaments.
6. Médecine occidentale et médecine chinoise : d’un régime de tolérance vers un régime de compétition et de la nécessité de se définir
En fait, jusqu’à la fin du XIXe siècle, il est plus juste de parler de médecine – voire de médecines – en Chine que de médecine chinoise, les acteurs impliqués dans l’assistance médicale ne revendiquant alors aucune essence nationale à leur corpus de doctrines et de pratiques médicales. Ce n’est qu’une fois mis en concurrence avec des praticiens formés à la médecine occidentale – principalement envoyés par les missions protestantes américaines, mais aussi européennes, depuis le milieu du XIXe siècle – qu’ils vont devoir ajouter un qualificatif à ce qu’ils appelaient jusqu’alors médecine yixue. L’histoire des divers adjectifs accolés à cette médecine dans la première partie du XXe siècle est intéressante à plus d’un titre : elle rend compte de l’accueil plus ou moins hostile que lui réservent les différents régimes chinois en ce début de XXe siècle ; de l’embarras que ce corpus « indigène » de savoirs et de pratiques cause aux gouvernements nationaliste et communiste, partagés entre la cause anti-impérialiste et l’attrait pour les sciences occidentales ; enfin, elle rend compte des différentes valeurs invoquées depuis un siècle pour rendre cette médecine légitime en Chine et à l’étranger.
Jusqu’en 1913 – malgré l’expansion de la médecine occidentale en Chine favorisée par l’établissement, depuis le début du XIXe siècle, de quelque deux cents dispensaires et hôpitaux étrangers et d’une vingtaine d’écoles de médecine, mais aussi par la création, à l’initiative de quelques gouverneurs provinciaux, d’écoles et d’hôpitaux chinois de médecine occidentale –, il règne un régime de relative anarchie et de non-compétition entre les différentes médecines. Le climat se détériore en 1913, à l’annonce par le ministre de l’Éducation Wang Daxie, de la toute nouvelle république, d’abolir la médecine chinoise. Cette annonce soulève de vives protestations et incite les médecins chinois à s’organiser. La tension est à son comble lorsque, en 1929, le régime nationaliste, établi à Nankin depuis 1927 et dans lequel les médecins formés à la médecine occidentale dominent, lance un plan d’élimination de la médecine chinoise. Pour les praticiens chinois formés à la médecine occidentale, l’opposition entre les deux médecines, que doit traduire leur appellation réciproque, ne doit pas porter sur l’essence chinoise Zhong ou occidentale xi, mais sur le caractère vieux Jiu d’un côté et nouveau Xin de l’autre. Pour les praticiens de médecine chinoise, « vieille médecine jiuyi » est inacceptable. C’est dans le champ lexical du nationalisme qu’ils vont puiser le qualificatif ingénieux distinguant la médecine chinoise de sa désormais rivale sans la reléguer dans les vieilleries. Ils la baptisent « médecine nationale guoyi » et alertent la population qu’abolir cette médecine ne serait rien d’autre que promouvoir l’impérialisme et l’antipatriotisme. La médecine chinoise, pour quelques années « médecine nationale », n’est pas abolie sous le Guomindang.
Sous le gouvernement communiste, la médecine chinoise est soumise à divers régimes de faveur qui se reflètent là encore dans les différents qualificatifs qui lui sont associés. Créer une nouvelle Chine, souveraine et débarrassée des pressions étrangères, mais aussi amputée de ses superstitions, tel était le projet de Mao Zedong avant qu’il accède au pouvoir. La médecine chinoise et tout son arrière-plan cosmologique étaient en partie suspects, l’acuponcture la sauve. Moyen thérapeutique peu coûteux et en voie de légitimation par les recherches scientifiques du moment, en particulier celles qui portent sur le système nerveux, l’acuponcture, entièrement réinterprétée et redéfinie en termes militaires, gagne le soutien du régime communiste. Inspiré aussi bien par des considérations de coûts économiques, de faisabilité que de stabilité sociale, Mao Zedong va plus loin et, dès son accession au pouvoir, lance le projet de réunir les deux médecines. Dans un premier temps, cependant, le régime intime aux médecins formés à la médecine chinoise d’apprendre la médecine occidentale. L’échec de cette première tentative, mesurée par un examen national en 1952, inverse l’ordre de subordination : c’est désormais aux médecins formés à la médecine occidentale d’étudier la médecine chinoise, dont le statut est rehaussé à la faveur d’un projet politique de revalorisation du passé chinois pouvant fournir des preuves de la supériorité culturelle chinoise. La médecine chinoise se trouve alors qualifiée de « médecine du passé gudai yixue » ou d’« héritage médical de notre patrie zuguo yixue yichan ». La tactique est d’utiliser le passé honorable de la médecine chinoise pour promouvoir la médecine chinoise du présent, c’est-à-dire cette nouvelle discipline que la politique du moment est en train de façonner. En effet, enseigner à des médecins formés à la médecine occidentale ce qui n’avait jusqu’alors jamais constitué un ensemble cohérent d’idées et de pratiques posait problème. Il fallait donner à la médecine chinoise une forme systématique et universelle. Le gouvernement fonde pour cela des écoles et fait rédiger des manuels cherchant à mettre en cohérence deux mille ans de traditions hétéroclites. Une discipline nouvelle est fondée, qui prélève des éléments de doctrines et de pratiques du passé, les réunit dans une théorie d’ensemble susceptible de s’adapter à la rationalité occidentale, et l’assortit d’éléments de biomédecine. C’est cette discipline qui, de façon paradoxale, est baptisée « médecine traditionnelle chinoise » en 1955. Les Chinois supprimeront rapidement le « traditionnel », tandis qu’Européens et Américains, à la recherche d’alternatives à la biomédecine dans le mouvement contre-culturel des années 1960 et 1970, s’appuieront au contraire sur ce « traditionnel » pour donner toute sa légitimité à ce que la Chine leur laissait entrevoir des traditions médicales chinoises. Ainsi, malgré son nom évoquant un flot ininterrompu et inchangé de savoirs et de pratiques, la médecine traditionnelle chinoise est une discipline nouvellement formée, à partir d’un ensemble de doctrines et de pratiques médicales beaucoup plus variées, et dont les modalités de transmission se situent aux antipodes de celles qui liaient maîtres et disciples ou père et enfant dans la Chine impériale. Entre les textes fondateurs, sommairement évoqués ici, et cette nouvelle discipline, le corpus de doctrines et de pratiques médicales n’a jamais cessé d’évoluer, même si les concepts de base n’ont jamais été fondamentalement remis en cause par l’émergence de nouvelles doctrines.
Florence BRETELLE-ESTABLET
CHINOISE (CIVILISATION) - La pensée chinoise
Depuis des temps qui se perdent aux origines légendaires, la mentalité chinoise est soutenue et sous-tendue par ce que l’on peut, faute de mieux, appeler une doctrine.
Doctrine forte et profonde qui justifie l’histoire entière de la Chine, mais sans laquelle un monde s’écroule pour ne laisser subsister qu’une poussière de faits dans un désordre inexplicable. Aucune analyse socio-économique ne saurait éluder ce complexe cosmologique de thèmes et variations qui ne ressemblent en rien aux propositions induites de l’expérimentation par nos sciences de la nature. Il s’agit d’une emblématique en mode profus de l’univers et de l’homme, à laquelle toute expérience sert d’exemple, comme un paradigme à la règle qu’il expose in concreto.
Pendant des dizaines de siècles, cette doctrine a animé la pensée et la vie des Chinois jusque dans les plus menus détails des conduites quotidiennes ; et il n’est pas certain qu’elle soit tout à fait effacée dans la Chine d’aujourd’hui. Il n’est pas simple pour autant de l’approcher. Encore moins de la définir, car si les Chinois excellent à montrer, à désigner, à découvrir des concordances et des analogies, rien ne leur répugne plus que la définition.
Il faut en outre souligner qu’il n’existe pas de faits isolés aux yeux des Chinois : tout est contexte et partie de contexte ; et tout sans cesse fonctionne. Rien n’est stable et fixé. Tout dure ; mais rien ne dure qui ne change et ne devienne. De là, il est aisé de comprendre que la triade immémoriale tiandiren, « le ciel, la terre et l’homme » – notation lapidaire et sceau chinois de quelque idée et de quelque œuvre que ce soit – indique une façon de voir le monde, nommée plus haut doctrine, mais qui, paradoxalement, ne s’embarrasse d’aucun corps doctrinal parce qu’elle n’en a pas besoin. Rébus, textes métaphoriques conservés dans la vénération quoique bourrés d’apocryphes – ce qui laisse les Chinois parfaitement indifférents –, allégories, apologues, récits et anecdotes, dialogues attribués à d’illustres personnages de l’histoire mythique, gloses, commentaires, polémiques, voilà les matériaux à travers quoi l’on dépiste une pensée qui fuit le concept et abhorre le développement du raisonnement linéairement ordonné. Dans les vieux textes, pleins de joyaux obscurs, faits pour luire des seules lumières jetées par le lecteur, mais transformées en superbes éclats, la copule formelle « être », shi, n’apparaît pour ainsi dire jamais. Ou bien elle est purement et simplement négligée, ou bien c’est you, « il y a », renvoyant au contexte d’existence, qui en tient lieu. Il convient d’admettre, si l’on veut tenter de pénétrer la mentalité chinoise, qu’elle a de l’identité une appréhension différente de la nôtre.
1. Le ciel, la terre et l’homme
Aussi loin qu’on remonte dans le passé, le consensus sinicus tient l’univers pour un immense organisme auquel il est insensé de chercher une origine et une cause, une forme et des limites, un sens et une fin. En un mot, il ne s’inquiète point de ne pas le comprendre. Que l’homme assiste et participe à l’existence transitoire des « dix mille choses » n’entraîne pas la supposition qu’il faille y comprendre quelque chose, ni même qu’il y ait quelque chose à comprendre. Par là s’explique chez les Chinois l’absence de religiosité, leur prudence et leur modestie devant le spectacle de la nature et le peu de développement des sciences positives jusqu’au XXe siècle. Pourtant, curieux à l’extrême, s’ils ne s’attachent pas à découvrir ce que sont et comment sont les choses, ils s’efforcent d’observer ces choses tandis qu’elles vont, se font et se défont.
Il s’agit de montrer, nullement de démontrer ; de laisser paraître, puis de classer des phénomènes, insignifiants par eux-mêmes, mais qui ressortissent à des cycles, à des alternances et à des rythmes, à des associations, à des correspondances organisées par une double numérologie (dénaire et duodénaire). Ces relations et ces variations, loin d’être abstraites, sont pour les Chinois la réalité même, rendue évidente à travers l’infinité d’exemples qui la manifestent. À la voir appliquée à des objets dotés de si peu d’autonomie, on s’étonnerait à tort de ce qui fut une véritable passion classificatrice propre au goût chinois : classer n’est là qu’une démarche pratique, voire commode. Nous sommes dans le domaine de l’utilité, de l’habileté, non dans celui de la science. Il est question d’ordonnancement et d’accords, pas du tout de taxonomie. Rien ne saurait échapper à l’ordonnancement : le ciel, la terre, les hommes et l’empereur, les orients et les saisons, la naissance et la mort ; tout est justiciable de cette physiologie cosmique marquetée non pas d’étiquettes mais d’innombrables flèches.
La pensée chinoise, d’une cohérence unique dans l’histoire du monde, n’a connu à cet égard, jusqu’au XXe siècle, d’autres divergences que celles qui résultaient du maniement des flèches.
Une telle manière de voir est commune au taoïsme et au confucianisme, et même à la forme du bouddhisme mahayaniste la mieux assimilée à la Chine : le Chan. Elle est millénaire et traditionnelle. Les vestiges qui témoignent de cette tradition (bronzes par exemple), toujours par lueurs allusives et désignations cryptiques susceptibles de multiples interprétations, sont antérieurs aux œuvres les plus anciennes de la littérature.
Sous le ciel, tian, et au sein de celui-ci, la terre, di, qui, pour l’homme, se présente comme centre de toute référence, puisque séjour et repère. Il faut entendre ces termes dans leur valeur emblématique : le ciel, figuré par une coupe ou un cercle – c’est ce qui enveloppe – contient, dépasse les êtres perceptibles, et, en quelque sorte, les nourrit de l’énergie, qi, partout régnante, qui fait naître, croître, transforme et se transforme ; tantôt subtile et sans support matériel, tantôt sensible dans les corps graves.
L’échange est permanent entre le ciel et la terre, à laquelle appartiennent choses animées et inanimées.
Sous tian et sur di, figurée par un carré, ren : l’homme, produit et témoin de l’un et de l’autre, mais qui n’occupe pas pour autant une position particulièrement remarquable. Point de frontières à cet univers, à cet organisme où l’homme est régi, à l’intérieur de son corps, par le même ordonnancement, li, qui convient à l’extérieur ; dans lequel, littéralement, il trempe, et qu’il subit.
2. Wu et dao
Avant d’évoquer le dao – et l’on ne peut guère que l’évoquer – il faut mettre en exergue le mot wu, sans doute le plus important de la langue chinoise.
Jusqu’en 1911, année de son effondrement, le trône des empereurs de Chine était surmonté d’un panneau de laque qui portait l’inscription wuwei, généralement rendue par : non-agir, ne pas agir, ne pas intervenir (Kaltenmark), venue du fond des âges et élevée au rang de devise nationale.
Dans wuwei, c’est wu qui compte (son antonyme est you). On traduit littéralement wu par : « ne, ne... pas, sans ». Mais c’est trop ou trop peu dire : l’identité, partant la contradiction, n’ayant pas pour les Chinois la valeur d’un principe d’exclusion, il y a, entre oui et non, plus et autre chose qu’entre la pure affirmation et la pure négation. « Celui qui d’abord pense par you ou par wu égarera sa vie », dit Zhaozhu, maître bouddhiste de l’époque Tang (environ 800 apr. J.-C.). Wu représente, inhérent à elle, un complément à l’affirmation ; comme la virtualité qu’elle recèle d’un changement informulable mais inéluctable. Wuwei ne nie pas l’action ; il signifie : « ne trouble pas l’action par l’action », puisque déjà elle se défait tandis qu’elle s’accomplit. Et l’essentiel du sens est porté par wu. Un wu se cache dans ou derrière chaque assertion de la langue chinoise. Chaque être est autre chose, et même autres choses. Autre encore il deviendra. Concours transitoire de possibles actualisés en présent, il ne se dévoile pas sur fond d’être selon une essence ; ni l’être ne se dévoile surgissant du néant. L’important est l’écart innommable et vertigineux qui sépare le probable de l’accompli, plus mince que le fil du rasoir et qui fait le présent plus vaste que toute immensité. Cet entre-rien-et-quelque-chose, à la fois contingence et nécessité, à quoi nulle chose n’échappe, cet innommable demeure l’innominé. Le mot dao, qui ne renvoie à aucun contenu conceptuel, en est l’index. En l’unité suprême de l’univers, taiyi, réside l’hiérophanie du dao.
Faîte suprême. Diagramme du « faîte suprême » adapté de Zhou Dunyi (Tcheou Touen-yi), env. 1050 apr. J.-C. Les cinq cercles sont rigoureusement équivalents et ne font que présenter aux yeux humains les aspects de « tai ji », le faîte suprême. Cercle supérieur : tai ji dans sa pure vacuité indicible. Deuxième cercle : yang (blanc) et yin (noir) se pénétrant et s'engendrant réciproquement. Le noyau de ce cercle est identique au cercle du haut. Troisième cercle : relation et succession des cinq modalités (wu xing) yin-yang (voir détails sur la figure 2). Quatrième cercle : fusion de la masculinité et de la féminité qui se constate par tout l'univers. Cercle inférieur : celui de l'existence et de la transformation des mille choses.
De même que les mathématiciens parlent du calcul ternaire, réservé à certain type de computeur, en faisant observer qu’il résiste à l’entendement humain, de même les Chinois évoquent ou invoquent le dao.
Celui qui parvient à briser la muraille de l’entendement ou, mieux, à la dissoudre en dissolvant l’entendement lui-même pour se retrouver – dès lors sans objectivité – réunifié en taiyi, par une sorte de coalescence que le langage est impuissant à énoncer, celui-là est le zhen ren, « l’homme véritable », « l’homme qui chevauche le vent ». In vivo, il a connu le dao. L’homme ordinaire, enchaîné par les désirs et les passions, l’homme malheureux, l’homme malade, en sont les contraires.
Il existe des pratiques qui visent à provoquer ce « résultat » (appelé à tort extase), mais ne le promettent pas plus que la prière ne promet la sainteté. Transmises de maître à disciple, elles n’ont pas tout à fait disparu.
Dans le monde phénoménal, qui, sous ses multiples aspects, révèle les aspects mêmes du qi, on reconnaît assez improprement le « pouvoir », l’« efficace » du dao. Ce pouvoir intrinsèque, ou génie de la chose, du fait, de l’acte, ce de, appelé encore « vertu » par nombre de traducteurs, ne saurait être considéré comme l’instrument du dao. Ce serait conférer l’être ou une sorte d’être au dao ; lequel n’a point d’attributs, de qualifications. Le de, c’est le « il » de « il se fait que... », « il arrive que... », selon le sens le plus impersonnel du pronom « il », comme dans des locutions aussi triviales et troublantes à la réflexion que : « il pleut », « il fait beau ». Le mot de offre à coup sûr un biais à la pensée, un « moyen habile » grâce auquel elle réfère au dao ou symbolise avec lui à travers les phénomènes, en évitant de s’enferrer dans la dualité que masque l’emploi de toute dénomination. Plutôt que comme une réponse à la question : pourquoi ceci plutôt que rien ? – les Chinois ne se la posent pas – le de se propose comme un doigt pointé vers le ziran, spontanéité de fait, ou effectivité, ou, si l’on veut, natura naturans. De là, l’équivalence fondamentale dans la réalité, de l’éternel et du temporel, de l’immobile et du mobile ; de là, la puissance prégnante du présent sur le passé et sur le futur.
Mais si les choses arrivent parce qu’elles arrivent et non parce que des conditions déterminées les rendent inéluctables par raison