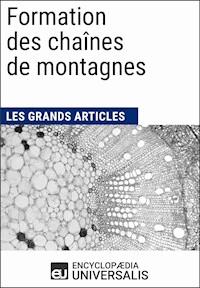
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
À la surface de la Terre, les zones de relief élevé qui forment ce que l'on appelle des «chaînes de montagnes» constituent un trait morphologique de première importance, comparable à celui des dorsales qui sillonnent le fond des océans. Les chaînes de montagnes correspondent donc à un marqueur ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 51
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341004251
© Encyclopædia Universalis France, 2016. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © D. Kucharski-K. Kucharska/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans ce Grand Article publié par Encyclopædia Universalis.
La collection des Grands Articles rassemble, dans tous les domaines du savoir, des articles : · écrits par des spécialistes reconnus ; · édités selon les critères professionnels les plus exigeants.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Formation des chaînes de montagnes
À la surface de la Terre, les zones de relief élevé qui forment ce que l’on appelle des « chaînes de montagnes » constituent un trait morphologique de première importance, comparable à celui des dorsales qui sillonnent le fond des océans. Les chaînes de montagnes correspondent donc à un marqueur géologique de premier ordre qui nous renseigne sur le fonctionnement de notre planète.
Les géologues l’ont compris très tôt. Dès le XIXe siècle, ils ont commencé à étudier les grandes chaînes de montagnes du globe. Ils ont rapidement montré que la durée de vie d’une chaîne pouvait dépasser 100 millions d’années. Ils ont distingué plusieurs stades dans la vie de ces chaînes et ont commencé à proposer des mécanismes explicatifs. Cependant, malgré un travail minutieux effectué dans quelques régions comme les Alpes, c’est seulement au début des années 1970 que l’on a commencé à avoir une vue globale de ce problème, et cela à la lumière des acquis de la tectonique des plaques. Avant, on ignorait que les fonds océaniques pouvaient disparaître par subduction dans le manteau terrestre, et on n’avait pas encore compris que les ophiolites, complexes de roches basiques et ultrabasiques que l’on trouve dans les chaînes de montagnes, sont des vestiges d’anciens océans disparus dans ces zones de subduction. Enfin, les ordres de grandeur des vitesses de déplacement des continents les uns par rapport aux autres étaient inconnus. Grâce à l’étude des fonds océaniques, on sait maintenant que ces vitesses sont de quelques centimètres par an, c’est-à-dire de quelques milliers de kilomètres en 100 millions d’années.
Pour reconstituer l’histoire d’une chaîne, il faut donc connaître l’histoire des océans, existants ou disparus. Ainsi, la formation des Pyrénées et des Alpes ne peut être étudiée sans tenir compte, respectivement, de l’évolution de l’océan Atlantique et de l’ancien océan Téthys (cf. TÉTHYS). C’est dans cet esprit que sera fait le point sur l’état de nos connaissances concernant le mode de formation des grandes chaînes de montagnes.
1. La convergence des plaques et les types de chaînes de montagnes
En tectonique des plaques, on admet que la couche la plus externe du globe, ou lithosphère, est formée par une dizaine de grandes plaques, relativement rigides, qui se déplacent les unes par rapport aux autres ; elles sont séparées par des zones, plus ou moins étroites, où se trouve concentrée la déformation et qui correspondent aux zones sismiques.
La nature des déformations qui se produisent dans ces zones dépend du mouvement relatif des plaques, de la géométrie et de l’orientation de leurs limites par rapport à ce mouvement (fig. 1). Si les plaques s’écartent (divergent), la zone s’allonge : elle est en extension ; lorsque l’écartement est important, il naît un océan. Si les plaques coulissent parallèlement à leurs limites, de grands décrochements prennent naissance. Si les plaques se rapprochent (convergent), la zone se raccourcit : elle est en compression ; c’est dans ce contexte que se forment les chaînes de montagnes.
La figure 2 montre que le bilan des mouvements de convergence, de divergence et de coulissage, et des cas intermédiaires, doit être fait à l’échelle du globe. L’ouverture des océans, qui correspond à un écartement des continents, est nécessairement compensé par un rapprochement de continents dans d’autres zones du globe. Les chaînes de montagnes sont donc la conséquence de l’ouverture des océans.
On distingue deux grands types de convergence. Le premier se produit lorsque l’ouverture d’un nouvel océan (néo-océan) est compensée par le rétrécissement d’un ancien océan (paléo-océan) qui finit par se fermer totalement. Cette disparition progressive du vieil océan se fait grâce à une subduction, c’est-à-dire à un enfoncement et à une absorption de la lithosphère océanique dans le manteau. Ce mécanisme correspond à un régime stationnaire qui peut fonctionner pendant de très longues périodes (plus de 100 millions d’années) avec une vitesse de convergence importante (quelques centimètres par an) ; les perturbations du champ de contraintes qu’il provoque sont souvent assez localisées ; elles peuvent être aussi bien en distension qu’en compression.
Le second type de convergence se produit dès lors qu’un continent entre en collision avec un autre. Or les continents ne peuvent pas être entraînés dans le manteau, contrairement au plancher océanique plus dense. Ils offrent une résistance à la subduction, et celle-ci se ralentit et parfois se coince ; la vitesse de convergence diminue, les perturbations du champ de contraintes sont fortes et s’étendent à une large zone. On est passé d’un régime stationnaire à un régime transitoire.
Ces deux types de convergence se comprennent bien si l’on tient compte de la nature de la lithosphère impliquée dans les zones de convergence. La lithosphère se subdivise en deux couches. La couche inférieure, correspondant au manteau supérieur, est la plus épaisse ; elle est formée de péridotites (roches ultrabasiques lourdes) ; son épaisseur sous les continents (de l’ordre de 100 km) est plus grande que sous les océans. La couche supérieure correspond, dans les continents, à la croûte continentale (épaisse de 30 à 40 km) et, sous les océans, à la croûte océanique, épaisse seulement de 5 à 7 kilomètres. On passe de l’une à l’autre de façon progressive.
Ces deux croûtes sont très différentes sous les sédiments superficiels qui peuvent, localement, atteindre 10 kilomètres d’épaisseur. Dans l’océan, il s’agit de roches volcaniques basaltiques (avec coulées de lave en surface). Dans le continent, en revanche, il s’agit de roches acides, dont le granite est le type principal.





























