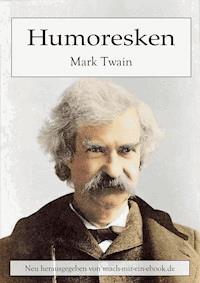50 Chefs-D'œuvre Que Vous Devez Lire Avant De Mourir : Vol 1 (Golden Deer Classics) E-Book
Mark Twain
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Oregan Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Ce livre contient les ouvrages suivants classés par ordre alphabétique (noms de famille auteurs ) Le Grand Meaulnes [Alain-Fournier] Alcools [Guillaume Apollinaire] Les Diaboliques [Jules Amédée Barbey d'Aurevilly] Les Fleurs du mal [Charles Baudelaire] Un crime d'amour [Paul Bourget] Jane Eyre ou Les Mémoires d'une institutrice [Charlotte Brontë] Les Hauts de Hurle-vent [Emily Brontë] Alice au Pays des Merveilles [Lewis Carroll] Mémoires d'Outre-tombe [François-René de Chateaubriand] Le Cid [Pierre Corneille] De l'Origine des espèces [Charles Darwin] Discours de la méthode [René Descartes] Cantique de Noël [Charles Dickens] Le Monde perdu [Arthur Conan Doyle] La Reine Margot [Alexandre Dumas] L'Éducation Sentimentale [Gustave Flaubert] Madame Bovary [Gustave Flaubert] Le journal d'un fou [Nikolai Gogol] L'Iliade et l'Odyssée [Homère] Le Dernier Jour d'un condamné [Victor Hugo] Cosette [Victor Hugo] L'Esclave amoureuse [Gustave Le Rouge] Le Fantôme de l'Opéra [Gaston Leroux] Le Mystère de la chambre jaune [Gaston Leroux] Justice de femme [Daniel Lesueur] Babbitt [Sinclair Lewis] L'Appel de la forêt [Jack London] Justine ou Les Malheurs de la vertu [Marquis de Sade] Bel-Ami [Guy de Maupassant] Le Chat noir par [Edgar Allan Poe] Double Assassinat dans la rue Morgue [Edgar Allan Poe] Du côté de chez Swann [Marcel Proust] Cyrano de Bergerac [Edmond Rostand] Du contrat social ou Principes du droit politique [Jean-Jacques Rousseau] Frankenstein ou le Prométhée moderne [Mary Shelley] Le Rouge et le Noir [Stendhal] La Chartreuse de Parme [Stendhal] Dracula [Bram Stoker] L'art de la Guerre (Les Treize Articles) [Sun Tzu] Les Aventures de Tom Sawyer [Mark Twain] La bibliothèque de mon oncle [Rodolphe Töpffer] Le Kama Sutra [Vatsyayana] Le Tour du monde en quatre-vingts jours [Jules Verne] Voyage au centre de la Terre [Jules Verne] Candide, ou l'Optimisme [Voltaire] L'Homme invisible [H. G. Wells] La Machine à explorer le temps [H. G. Wells] et plus...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 20735
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
50 Chefs-D'œuvre Que Vous Devez Lire Avant De Mourir : Vol 1
Le Grand Meaulnes
Alain-Fournier
Préface
Henri-Alban Fournier (Alain-Fournier est un demi-pseudonyme) est né le 3 octobre 1886, à La Chapelle-d’Angillon (Cher). Après une enfance passée en Sologne et dans le Bas-Berry, où ses parents sont instituteurs, il commence ses études secondaires à Paris, puis va préparer à Brest le concours d’entrée à l’École Navale, à quoi il renonce bientôt, ayant compris qu’il ne pourrait jamais vivre loin de ces campagnes de son enfance qu’il a passionnément aimées. Il revient faire sa philosophie à Bourges. Puis, ayant choisi la carrière de l’enseignement des Lettres, il poursuit ses études au Lycée Lakanal, à Sceaux, où il se lie de profonde amitié avec Jacques Rivière (qui épousera en 1909 sa jeune sœur Isabelle). Tous deux se lancent à la recherche de la vérité et de la beauté dans tous les arts : peinture, musique et surtout littérature, où ils seront les premiers à découvrir, parmi les jeunes écrivains – alors incompris et moqués – ceux qui deviendront les grands noms de notre époque : Claudel, Péguy, Valéry, etc. En juin 1905, Henri avait rencontré celle qui, sous le nom d’Yvonne de Galais sera l’héroïne du Grand Meaulnes. Brève rencontre, unique conversation le long des quais de la Seine, d’où est né en lui, cependant, ce qui sera le grand amour de sa vie. Il ne retrouvera qu’en 1913, après huit ans de recherches et de souffrances, pour une deuxième courte rencontre, « La Belle Jeune Fille », alors mariée et mère de deux enfants.
Ses études ayant été interrompues en 1907 par les deux ans de son service militaire, il ne les avait pas reprises. Il avait tenu alors quelque temps un Courrier littéraire, publié divers poèmes, essais, contes (réunis plus tard sous le titre Miracles), cependant que s’élaborait lentement l’œuvre qui l’a rendu célèbre.
Et c’est quelques mois après la deuxième rencontre – la dernière – que parut Le Grand Meaulnes commencé presque au lendemain de la première, patiemment bâti, remanié, transformé au long de ces huit années, et qui est l’histoire, à peine transposée, de tout ce qu’il avait vécu jusqu’alors, et du grand douloureux amour qui a dominé sa vie.
Un an plus tard, il était tué aux Éparges, le 22 septembre 1914.
Sa sœur Isabelle, à qui est dédié le roman, après la mort de son mari, Jacques Rivière, en 1925, publia l’abondante Correspondance des deux amis ; ensuite les Lettres au Petit B. (René Bichet, un gentil camarade de Lakanal) et les Lettres d’Alain-Fournier à sa Famille, puis des souvenirs sur son frère : Images d’Alain-Fournier, etc.
(Préface proposée par [email protected], Project Gutenberg volunteer)
À ma sœur Isabelle.
Partie 1
Chapitre1 Le Pensionnaire
Il arriva chez nous un dimanche de novembre 189…
Je continue à dire « chez nous », bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le pays depuis bientôt quinze ans et nous n’y reviendrons certainement jamais.
Nous habitions les bâtiments du Cours Supérieur de Sainte-Agathe. Mon père, que j’appelais M. Seurel, comme les autres élèves, y dirigeait à la fois le Cours Supérieur, où l’on préparait le brevet d’instituteur, et le Cours Moyen. Ma mère faisait la petite classe.
Une longue maison rouge, avec cinq portes vitrées, sous des vignes vierges, à l’extrémité du bourg ; une cour immense avec préaux et buanderie, qui ouvrait en avant sur le village par un grand portail ; sur le côté nord, la route où donnait une petite grille et qui menait vers La Gare, à trois kilomètres ; au sud et par derrière, des champs, des jardins et des près qui rejoignaient les faubourgs… tel est le plan sommaire de cette demeure où s’écoulèrent les jours les plus tourmentés et les plus chers de ma vie – demeure d’où partirent et où revinrent se briser, comme des vagues sur un rocher désert, nos aventures.
Le hasard des « changements », une décision d’inspecteur ou de préfet nous avaient conduits là.
Vers la fin des vacances, il y a bien longtemps, une voiture de paysan, qui précédait notre ménage, nous avait déposés, ma mère et moi, devant la petite grille rouillée. Des gamins qui volaient des pêches dans le jardin s’étaient enfuis silencieusement par les trous de la haie… Ma mère, que nous appelions Millie, et qui était bien la ménagère la plus méthodique que j’aie jamais connue, était entrée aussitôt dans les pièces remplies de paille poussiéreuse, et tout de suite elle avait constaté avec désespoir, comme à chaque « déplacement », que nos meubles ne tiendraient jamais dans une maison si mal construite… Elle était sortie pour me confier sa détresse. Tout en me parlant, elle avait essuyé doucement avec son mouchoir ma figure d’enfant noircie par le voyage. Puis elle était rentrée faire le compte de toutes les ouvertures qu’il allait falloir condamner pour rendre le logement habitable… Quant à moi, coiffé d’un grand chapeau de paille à rubans, j’étais resté là, sur le gravier de cette cour étrangère, à attendre, à fureter petitement autour du puits et sous le hangar.
C’est ainsi, du moins, que j’imagine aujourd’hui notre arrivée. Car aussitôt que je veux retrouver le lointain souvenir de cette première soirée d’attente dans notre cour de Sainte-Agathe, déjà ce sont d’autres attentes que je me rappelle ; déjà, les deux mains appuyées aux barreaux du portail, je me vois épiant avec anxiété quelqu’un qui va descendre la grand’rue. Et si j’essaie d’imaginer la première nuit que je dus passer dans ma mansarde, au milieu des greniers du premier étage, déjà ce sont d’autres nuits que je me rappelle ; je ne suis plus seul dans cette chambre ; une grande ombre inquiète et amie passe le long des murs et se promène. Tout ce paysage paisible – l’école, le champ du père Martin, avec ses trois noyers, le jardin dès quatre heures envahi chaque jour par des femmes en visite – est à jamais, dans ma mémoire, agité transformé par la présence de celui qui bouleversa toute notre adolescence et dont la fuite même ne nous a pas laissé de repos.
Nous étions pourtant depuis dix ans dans ce pays lorsque Meaulnes arriva.
J’avais quinze ans. C’était un froid dimanche de novembre, le premier jour d’automne qui fit songer à l’hiver. Toute la journée, Millie avait attendu une voiture de La Gare qui devait lui apporter un chapeau pour la mauvaise saison. Le matin, elle avait manqué la messe ; et jusqu’au sermon, assis dans le chœur avec les autres enfants, j’avais regardé anxieusement du côté des cloches, pour la voir entrer avec son chapeau neuf. Après midi, je dus partir seul à vêpres.
« D’ailleurs, me dit-elle, pour me consoler, en brossant de sa main mon costume d’enfant, même s’il était arrivé, ce chapeau, il aurait bien fallu, sans doute, que je passe mon dimanche à le refaire. »
Souvent nos dimanches d’hiver se passaient ainsi.
Dès le matin, mon père s’en allait au loin, sur le bord de quelque étang couvert de brume, pêcher le brochet dans une barque ; et ma mère, retirée jusqu’à la nuit dans sa chambre obscure, rafistolait d’humbles toilettes. Elle s’enfermait ainsi de crainte qu’une dame de ses amies, aussi pauvre qu’elle mais aussi fière, vînt la surprendre. Et moi, les vêpres finies, j’attendais, en lisant dans la froide salle à manger, qu’elle ouvrit la porte pour me montrer comment ça lui allait.
Ce dimanche-là, quelque animation devant l’église me retint dehors après vêpres. Un baptême, sous le porche, avait attroupé des gamins. Sur la place, plusieurs hommes du bourg avaient revêtu leurs vareuses de pompiers ; et, les faisceaux formés, transis et battant la semelle, ils écoutaient Boujardon, le brigadier, s’embrouiller dans la théorie…
Le carillon du baptême s’arrêta soudain comme une sonnerie de fête, qui se serait trompée de jour et d’endroit ; Boujardon et ses hommes, l’arme en bandoulière, emmenèrent la pompe au petit trot ; et je les vis disparaître au premier tournant, suivis de quatre gamins silencieux, écrasant de leurs grosses semelles les brindilles de la route givrée où je n’osais pas les suivre.
Dans le bourg, il n’y eut plus alors de vivant que le café Daniel, où j’entendais sourdement monter puis s’apaiser les discussions des buveurs. Et, frôlant le mur bas de la grande cour qui isolait notre maison du visage, j’arrivai, un peu anxieux de mon retard, à la petite grille.
Elle était entre ouverte et je vis aussitôt qu’il se passait quelque chose d’insolite.
En effet, à la porte de la salle à manger – la plus rapprochée des cinq portes vitrées qui donnaient sur la cour – une femme aux cheveux gris, penchée, cherchait à voir au travers des rideaux. Elle était petite, coiffée d’une capote de velours noir à l’ancienne mode. Elle avait un visage maigre et fin, mais ravagé par l’inquiétude ; et je ne sais quelle appréhension, à sa vue, m’arrêta sur la première marche, devant la grille.
« Où est-tu passé ? mon Dieu ! disait-elle à mi-voix. Il était avec moi tout à l’heure. Il a déjà fait le tour de la maison. Il s’est peut-être sauvé… »
Et, entre chaque phrase, elle frappait au carreau trois petits coups à peine perceptibles.
Personne ne venait ouvrir à la visiteuse inconnue.
Millie, sans doute, avait reçu le chapeau de La Gare, et sans rien entendre, au fond de la chambre rouge, devant un lit semé de vieux rubans et de plumes défrisées, elle cousait, décousait, rebâtissait sa médiocre coiffure… En effet, lorsque j’eus pénétré dans la salle à manger, immédiatement suivi de la visiteuse, ma mère apparut tenant à deux mains sur sa tête des fils de laiton, des rubans et des plumes, qui n’étaient pas encore parfaitement équilibrés…
Elle me sourit, de ses yeux bleus fatigués d’avoir travaillé à la chute du jour, et s’écria :
« Regarde ! Je t’attendais pour te montrer… »
Mais, apercevant cette femme assise dans le grand fauteuil, au fond de la salle, elle s’arrêta, déconcertée. Bien vite, elle enleva sa coiffure, et, durant toute la scène qui suivit, elle la tint contre sa poitrine, renversée comme un nid dans son bras droit replié.
La femme à la capote, qui gardait, entre ses genoux, un parapluie et un sac de cuir, avait commencé de s’expliquer, en balançant légèrement la tête et en faisant claquer sa langue comme une femme en visite. Elle avait repris tout son aplomb.
Elle eut même, dès qu’elle parla de son fils, un air supérieur et mystérieux qui nous intrigua.
Ils étaient venus tous les deux, en voiture, de La Ferté-d’Angillon, à quatorze kilomètres de Sainte-Agathe. Veuve – et fort riche, à ce qu’elle nous fit comprendre –, elle avait perdu le cadet de ses deux enfants, Antoine, qui était mort un soir au retour de l’école, pour s’être baigné avec son frère dans un étang malsain. Elle avait décidé de mettre l’aîné, Augustin, en pension chez nous pour qu’il pût suivre le Cours Supérieur.
Et aussitôt elle fit l’éloge de ce pensionnaire qu’elle nous amenait. Je ne reconnaissais plus la femme aux cheveux gris, que j’avais vue courbée devant la porte, une minute auparavant, avec cet air suppliant et hagard de poule qui aurait perdu l’oiseau sauvage de sa couvée.
Ce qu’elle contait de son fils avec admiration était fort surprenant : il aimait à lui faire plaisir, et parfois il suivait le bord de la rivière, jambes filles, pendant des kilomètres, pour lui rapporter des œufs de poules d’eau, de canards sauvages, perdus dans les ajoncs…
Il tendait aussi des nasses… L’autre nuit, il avait découvert dans le bois une faisane prise au collet…
Moi qui n’osais plus rentrer à la maison quand j’avais un accroc à ma blouse, je regardais Millie avec étonnement.
Mais ma mère n’écoutait plus. Elle fit même signe à la dame de se taire, et déposant avec précaution son « nid » sur la table, elle se leva silencieusement comme pour aller surprendre quelqu’un…
Au-dessus de nous, en effet, dans un réduit où s’entassaient les pièces d’artifice noircies du dernier Quatorze Juillet, un pas inconnu, assuré, allait et venait, ébranlant le plafond, traversait les immenses greniers ténébreux du premier étage, et se perdait enfin vers les chambres d’adjoints abandonnées où l’on mettait sécher le tilleul et mûrir les pommes.
« Déjà, tout à l’heure, j’avais entendu ce bruit dans les chambres du bas, dit Millie à mi-voix, et je croyais que c’était toi, François, qui étais rentré… »
Personne ne répondit. Nous étions debout tous les trois, le cœur battant, lorsque la porte des greniers qui donnait sur l’escalier de la cuisine s’ouvrit ; quelqu’un descendit les marches, traversa la cuisine, et se présenta dans l’entrée obscure de la salle à manger.
« C’est toi, Augustin ? » dit la dame.
C’était un grand garçon de dix-sept ans environ. Je ne vis d’abord de lui, dans la nuit tombante, que son chapeau de feutre paysan coiffé en arrière et sa blouse noire sanglée d’une ceinture comme en portent les écoliers. Je pus distinguer aussi qu’il souriait…
Il m’aperçut, et, avant que personne eût pu lui demander aucune explication :
« Viens-tu dans la cour ? » dit-il.
J’hésitai une seconde. Puis, comme Millie ne me retenait pas, je pris ma casquette et j’allai vers lui.
Nous sortîmes par la porte de la cuisine et nous allâmes au préau, que l’obscurité envahissait déjà. À la lueur de la fin du jour, je regardais, en marchant, sa face anguleuse au nez droit, à la lèvre duvetée.
« Tiens, dit-il, j’ai trouvé ça dans ton grenier. Tu n’y avais donc jamais regardé. »
Il tenait à la main une petite roue en bois noirci ; un cordon de fusées déchiquetées courait tout autour ; ç’avait dû être le soleil ou la lune au feu d’artifice du Quatorze Juillet.
« Il y en a deux qui ne sont pas parties : nous allons toujours les allumer », dit-il d’un ton tranquille et de l’air de quelqu’un qui espère bien trouver mieux par la suite.
Il jeta son chapeau par terre et je vis qu’il avait les cheveux complètement ras comme un paysan. Il me montra les deux fusées avec leurs bouts de mèche en papier que la flamme avait coupés, noircis, puis abandonnés. Il planta dans le sable le moyeu de la roue, tira de sa poche – à mon grand étonnement, car cela nous était formellement interdit – une boîte d’allumettes. Se baissant avec précaution, il mit le feu à la mèche. Puis, me prenant par la main, il m’entraîna vivement en arrière.
Un instant après, ma mère qui sortait sur le pas de la porte, avec la mère de Meaulnes, après avoir débattu et fixé le prix de pension, vit jaillir sous le préau, avec un bruit de soufflet, deux gerbes d’étoffes rouges et blanches ; et elle put m’apercevoir, l’espace d’une seconde, dressé dans la lueur magique, tenant par la main le grand gars nouveau venu et ne bronchant pas…
Cette fois encore elle n’osa rien dire.
Et le soir, au dîner, il y eut, à la table de famille, un compagnon silencieux, qui mangeait, la tête basse, sans se soucier de nos trois regards fixés sur lui.
Chapitre2 Après quatre heures
Je n’avais guère été, jusqu’alors, courir dans les rues avec les gamins du bourg. Une coxalgie, dont j’ai souffert jusque vers cette année 189…, m’avait rendu craintif et malheureux. Je me vois encore poursuivant les écoliers alertes dans les ruelles qui entouraient la maison, en sautillant misérablement sur une jambe…
Aussi ne me laissait-on guère sortir. Et je me rappelle que Millie, qui était très fière de moi, me ramena plus d’une fois à la maison, avec force taloches, pour m’avoir ainsi rencontré, sautant à cloche-pied, avec les garnements du village.
L’arrivée d’Augustin Meaulnes, qui coïncida avec ma guérison, fut le commencement d’une vie nouvelle.
Avant sa venue, lorsque le cours était fini, à quatre heures, une longue soirée de solitude commençait pour moi. Mon père transportait le feu du poêle de la classe dans la cheminée de notre salle à manger ; et peu à peu les derniers gamins attardés abandonnaient l’école refroidie où roulaient des tourbillons de fumée. Il y avait encore quelques jeux, des galopades dans la cour ; puis la nuit venait ; les deux élèves qui avaient balayé la classe cherchaient sous le hangar leurs capuchons et leurs pèlerines, et ils partaient bien vite, leur panier au bras, en laissant le grand portail ouvert…
Alors, tant qu’il y avait une lueur de jour, je restais au fond de la Mairie, enfermé dans le Cabinet des Archives plein de mouches mortes, d’affiches battant au vent, et je lisais assis sur une vieille bascule, auprès d’une fenêtre qui donnait sur le jardin.
Lorsqu’il faisait noir, que les chiens de la ferme voisine commençaient à hurler et que le carreau de notre petite cuisine s’illuminait, je rentrais enfin. Ma mère avait commencé de préparer le repas. Je montais trois marches de l’escalier du grenier ; je m’asseyais sans rien dire et, la tête appuyée aux barreaux froids de la rampe, je la regardais allumer son feu dans l’étroite cuisine où vacillait la flamme d’une bougie.
Mais quelqu’un est venu qui m’a enlevé à tous ces plaisirs d’enfant paisible. Quelqu’un a soufflé la bougie qui éclairait pour moi le doux visage maternel penché sur le repas du soir. Quelqu’un a éteint la lampe autour de laquelle nous étions une famille heureuse, à la nuit, lorsque mon père avait accroché les volets de bois aux portes vitrées. Et celui-là, ce fut Augustin Meaulnes, que les autres élèves appelèrent bientôt le grand Meaulnes. Dès qu’il fut pensionnaire chez nous, c’est-à-dire dès les premiers jours de décembre, l’école cessa d’être désertée le soir, après quatre heures. Malgré le froid de la porte battante, les cris des balayeurs et leurs seaux d’eau, il y avait toujours, après le cours, dans la classe, une vingtaine de grands élèves, tant de la campagne que du bourg, serrés autour de Meaulnes. Et c’étaient de longues discussions, des disputes interminables, au milieu desquelles je me glissais avec inquiétude et plaisir.
Meaulnes ne disait rien, mais c’était pour lui qu’à chaque instant l’un des plus bavards s’avançait au milieu du groupe, et, prenant à témoin tour à tour chacun de ses compagnons, qui l’approuvaient bruyamment, racontait quelque longue histoire de maraude, que tous les autres suivaient, le bec ouvert, en riant silencieusement.
Assis sur un pupitre, en balançant les jambes, Meaulnes réfléchissait. Aux bons moments, il riait aussi, mais doucement, comme s’il eût réservé ses éclats de rire pour quelque meilleure histoire, connue de lui seul. Puis, à la nuit tombante, lorsque la lueur des carreaux de la classe n’éclairait plus le groupe confus des jeunes gens, Meaulnes se levait soudain et, traversant le cercle pressé :
« Allons, en route ! » criait-il.
Alors tous le suivaient et l’on entendait leurs cris jusqu’à la nuit noire, dans le haut du bourg…
Il m’arrivait maintenant de les accompagner. Avec Meaulnes, j’allais à la porte des écuries des faubourgs, à l’heure où l’on trait les vaches… Nous entrions dans les boutiques, et, du fond de l’obscurité, entre deux craquements de son métier, le tisserand disait :
« Voilà les étudiants ! »
Généralement, à l’heure du dîner, nous nous trouvions tout près du Cours, chez Desnoues, le charron, qui était aussi maréchal. Sa boutique était une ancienne auberge, avec de grandes portes à deux battants qu’on laissait ouvertes. De la rue on entendait grincer le soufflet de la forge et l’on apercevait à la lueur du brasier, dans ce lieu obscur et tintant, parfois des gens de campagne qui avaient arrêté leur voiture pour causer un instant, parfois un écolier comme nous, adossé à une porte, qui regardait sans rien dire.
Et c’est là que tout commença, environ huit jours avant Noël.
Chapitre3 "Je fréquentais la boutique d'un Vannier"
La pluie était tombée tout le jour, pour ne cesser qu’au soir. La journée avait été mortellement ennuyeuse. Aux récréations, personne ne sortait. Et l’on entendait mon père, M. Seurel, crier à chaque minute, dans la classe :
« Ne sabotez donc pas comme ça les gamins ! »
Après la dernière récréation de la journée, ou comme nous disions, après le dernier « quart d’heure », M. Seurel, qui depuis un instant marchait de long en large pensivement, s’arrêta, frappa un grand coup de règle sur la table, pour faire cesser le bourdonnement confus des fins de classe où l’on s’ennuie, et, dans le silence attentif, demanda : « Qui est-ce qui ira demain en voiture à La Gare avec François, pour chercher M. et Mme Charpentier ? »
C’étaient mes grands-parents : grand-père Charpentier, l’homme au grand burnous de laine grise, le vieux garde forestier en retraite, avec son bonnet de poli de lapin qu’il appelait son képi… Les petits gamins le connaissaient bien. Les matins, pour se débarbouiller, il tirait un seau d’eau, dans lequel il barbotait, à la façon des vieux soldats, en se frottant vaguement la barbiche. Un cercle d’enfants, les mains derrière le dos, l’observaient avec une curiosité respectueuse… Et ils connaissaient aussi grand-mère Charpentier, la petite paysanne, avec sa capote tricotée, parce que Millie l’amenait, au moins une fois, dans la classe des plus petits.
Tous les ans, nous allions les chercher, quelques jours avant Noël, à La Gare, au train de 4 h 2. Ils avaient pour nous voir, traversé tout le département, chargés de ballots de châtaignes et de victuailles pour Noël enveloppées dans des serviettes. Dès qu’ils avaient passé, tous les deux, emmitouflés, souriants et un peu interdits, le seuil de la maison, nous fermions sur eux toutes les portes, et c’était une grande semaine de plaisir qui commençait…
Il fallait, pour conduire avec moi la voiture qui devait les ramener, il fallait quelqu’un de sérieux qui ne nous versât pas dans un fossé, et d’assez débonnaire aussi, car le grand-père Charpentier jurait facilement et la grand-mère était un peu bavarde.
À la question de M. Seurel, une dizaine de voix répondirent, criant ensemble : « Le grand Meaulnes ! le grand Meaulnes ! »
Mais M. Seurel fit semblant de ne pas entendre.
Alors ils crièrent : « Fromentin ! »
D’autres : « Jasmin Delouche ! »
Le plus jeune des Roy, qui allait aux champs, monté sur sa truie lancée au triple galop, criait : « Moi ! Moi ! », d’une voix perçante.
Dutremblay et Mouchebœuf se contentaient de lever timidement la main.
J’aurais voulu que ce fût Meaulnes. Ce petit voyage en voiture à âne serait devenu un événement plus important. Il le désirait aussi, mais il affectait de se taire dédaigneusement. Tous les grands élèves s’étaient assis comme lui sur la table, à revers, les pieds sur le banc, ainsi que nous faisions dans les moments de grand répit et de réjouissance. Coffin, sa blouse relevée et roulée autour de la ceinture, embrassait la colonne de fer qui soutenait la poutre de la classe et commençait de grimper en signe d’allégresse. Mais M. Seurel refroidit tout le monde en disant : « Allons ! Ce sera Mouchebœuf. »
Et chacun regagna sa place en silence.
À quatre heures, dans la grande cour glacée, ravinée par la pluie, je me trouvai seul avec Meaulnes.
Tous deux, sans rien dire, nous regardions le bourg luisant que séchait la bourrasque. Bientôt, le petit Coffin, en capuchon, un morceau de pain à la main, sortit de chez lui et, rasant les murs, se présenta en sifflant à la porte du charron. Meaulnes ouvrit le portail, le héla et, tous les trois, un instant après, nous étions installés au fond de la boutique rouge et chaude, brusquement traversée par de glacials coups de vent : Coffin et moi, assis auprès de la forge, nos pieds boueux dans les copeaux blancs ; Meaulnes, les mains aux poches, silencieux, adossé au battant de la porte d’entrée. De temps à autre, dans la rue, passait une dame du village, la tête baissée à cause du vent, qui revenait de chez le boucher, et nous levions le nez pour regarder qui c’était.
Personne ne disait rien. Le maréchal et son ouvrier, l’un soufflant la forge, l’autre battant le fer, jetaient sur le mur de grandes ombres brusques… Je me rappelle ce soir-là comme un des grands soirs de mon adolescence. C’était en moi un mélange de plaisir et d’anxiété : je craignais que mon compagnon ne m’enlevât cette pauvre joie d’aller à La Gare en voiture ; et pourtant j’attendais de lui, sans oser me l’avouer, quelque entreprise extraordinaire qui vînt tout bouleverser.
De temps à autre, le travail paisible et régulier de la boutique s’interrompait pour un instant. Le maréchal laissait à petits coups pesants et clairs retomber son marteau sur l’enclume. Il regardait, en l’approchant de son tablier de cuir, le morceau de fer qu’il avait travaillé. Et, redressant la tête, il nous disait, histoire de souffler un peu : « Eh bien, ça va, la jeunesse ? »
L’ouvrier restait la main en l’air à la chaîne du soufflet, mettait son poing gauche sur la hanche et nous regardait en riant.
Puis le travail sourd et bruyant reprenait.
Durant une de ces pauses, on aperçut, par la porte battante, Millie dans le grand vent, serrée dans un fichu, qui passait chargée de petits paquets.
Le maréchal demanda :
« C’est-il que M. Charpentier va bientôt venir ?
– Demain, répondis-je, avec ma grand-mère, j’irai les chercher en voiture au train de 4 h 2.
– Dans la voiture à Fromentin, peut-être ?
Je répondis bien vite : – Non, dans celle du père Martin.
– Oh ! alors, vous n’êtes pas revenus. »
Et tous les deux, son ouvrier et lui, se prirent à rire.
L’ouvrier fit remarquer, lentement, pour dire quelque chose :
« Avec la jument de Fromentin on aurait pu aller les chercher à Vierzon. Il y a une heure d’arrêt. C’est à quinze kilomètres. On aurait été de retour avant même que l’âne à Martin fût attelé.
– Ça, dit l’autre, c’est une jument qui marche !…
– Et je crois bien que Fromentin la prêterait facilement. »
La conversation finit là. De nouveau la boutique fut un endroit plein d’étincelles et de bruit, où chacun ne pensa que pour soi.
Mais lorsque l’heure fut venue de partir et que je me levai pour faire signe au grand Meaulnes, il ne m’aperçut pas d’abord. Adossé à la porte et la tête penchée, il semblait profondément absorbé par ce qui venait d’être dit. En le voyant ainsi, perdu dans ses réflexions, regardant, comme à travers des lieues de brouillard, ces gens paisibles qui travaillaient, je pensai soudain à cette image de Robinson Crusoé, où l’on voit l’adolescent anglais, avant son grand départ, « fréquentant la boutique d’un vannier »…
Et j’y ai souvent repensé depuis.
Chapitre4 L'évasion
À une heure de l’après-midi, le lendemain, la classe du Cours supérieur est claire, au milieu du paysage gelé, comme une barque sur l’océan. On n’y sent pas la saumure ni le cambouis, comme sur un bateau de pêche, mais les harengs grillés sur le poêle et la laine roussie de ceux qui, en rentrant, se sont chauffés de trop près.
On a distribué, car la fin de l’année approche, les cahiers de compositions. Et pendant que M. Seurel écrit au tableau l’énoncé des problèmes, un silence imparfait s’établit, mêlé de conversations à voix basse, coupé de petits cris étouffés et de phrases dont on ne dit que les premiers mots pour effrayer son voisin :
« Monsieur ! Un tel me… »
M. Seurel, en copiant ses problèmes, pense à autre chose. Il se retourne de temps à autre, en regardant tout le monde d’un air à la fois sévère et absent. Et ce remue-ménage sournois cesse complètement, une seconde, pour reprendre ensuite, tout doucement d’abord, comme un ronronnement.
Seul, au milieu de cette agitation, je me tais. Assis au bout d’une des tables de la division des plus jeunes, près des grandes vitres, je n’ai qu’à me redresser un peu pour apercevoir le jardin, le ruisseau dans le bas, puis les champs.
De temps à autre, je me soulève sur la pointe des pieds et je regarde anxieusement du côté de la ferme de la Belle-Étoile. Dès le début de la classe, je me suis aperçu que Meaulnes n’était pas rentré après la récréation de midi. Son voisin de table a bien dû s’en apercevoir aussi. Il n’a rien dit encore, préoccupé par sa composition. Mais, dès qu’il aura levé la tête, la nouvelle courra par toute la classe et quelqu’un, comme c’est l’usage, ne manquera pas de crier à haute voix les premiers mots de la phrase :
« Monsieur ! Meaulnes… »
Je sais que Meaulnes est parti. Plus exactement, je le soupçonne de s’être échappé. Sitôt le déjeuner terminé, il a dû sauter le petit mur et fuir à travers champs, en passant le ruisseau à la Vieille-Planche jusqu’à la Belle-Étoile. Il aura demandé la jument pour aller chercher M. et Mme Charpentier. Il fait atteler en ce moment.
La Belle-Étoile est, là-bas, de l’autre côté du ruisseau, sur le versant de la côte, une grande ferme, que les ormes, les chênes de la cour et les haies vives cachent en été. Elle est placée sur un petit chemin qui rejoint d’un côté la route de La Gare, de l’autre un faubourg du pays. Entourée de hauts murs soutenus par des contreforts dont le pied baigne dans le fumier, la grande bâtisse féodale est au mois de juin enfouie sous les feuilles, et de l’école, on entend seulement, à la tombée de la nuit, le roulement des charrois et les cris des vachers. Mais aujourd’hui, j’aperçois par la vitre, entre les arbres dépouillés, le haut mur grisâtre de la cour, la porte d’entrée, puis, entre des tronçons de haie, une bande du chemin blanchi de givre, parallèle au ruisseau, qui mène à la route de La Gare.
Rien ne bouge encore dans ce clair paysage d’hiver. Rien n’est changé encore.
Ici, M. Seurel achève de copier le deuxième problème. Il en donne trois d’habitude. Si aujourd’hui, par hasard, il n’en donnait que deux… Il remonterait aussitôt dans sa chaire et s’apercevrait de l’absence de Meaulnes. Il enverrait pour le chercher à travers le bourg deux gamins qui parviendraient certainement à le découvrir avant que la jument ne soit attelée…
M. Seurel, le deuxième problème copié, laisse un instant retomber son bras fatigué… Puis, à mon grand soulagement, il va à la ligne et recommence à écrire en disant :
« Ceci, maintenant, n’est plus qu’un jeu d’enfant ! »
Deux petits traits noirs, qui dépassaient le mur de la Belle-Étoile et qui devaient être les deux brancards dressés d’une voiture ont disparu. Je suis sûr maintenant qu’on fait là-bas les préparatifs du départ de Meaulnes. Voici la jument qui passe la tête et le poitrail entre les deux pilastres de l’entrée, puis s’arrête, tandis qu’on fixe sans doute à l’arrière de la voiture un second siège pour les voyageurs que Meaulnes prétend ramener. Enfin tout l’équipage sort lentement de la cour, disparaît un instant derrière la haie, et repasse avec la même lenteur sur le bout de chemin blanc qu’on aperçoit entre deux tronçons de la clôture. Je reconnais alors, dans cette forme noire qui tient les guides, un coude nonchalamment appuyé sur le côté de la voiture, à la façon paysanne, mon compagnon Augustin Meaulnes.
Un instant encore tout disparaît derrière la haie.
Deux hommes qui sont restés au portail de la Belle-Étoile, à regarder partir la voiture, se concertent maintenant avec une animation croissante. L’un d’eux se décide enfin à mettre sa main en porte-voix près de sa bouche et à appeler Meaulnes, puis à courir quelques pas, dans sa direction, sur le chemin…
Mais alors, dans la voiture qui est lentement arrivée sur la route de La Gare et que du petit chemin on ne doit plus apercevoir, Meaulnes change soudain d’attitude. Un pied sur le devant, dressé comme un conducteur de char romain, secouant à deux mains les guides, il lance sa bête à fond de train et disparaît en un instant de l’autre côté de la montée. Sur le chemin, l’homme qui appelait s’est repris à courir ; l’autre s’est lancé au galop à travers champs et semble venir vers nous.
En quelques minutes, et au moment même où M. Seurel, quittant le tableau, se frotte les mains pour en enlever la craie, au moment où trois voix à la fois crient du fond de la classe :
« Monsieur ! Le grand Meaulnes est parti ! »
L’homme en blouse bleue est à la porte, qu’il ouvre soudain toute grande, et, levant son chapeau, il demande sur le seuil :
« Excusez-moi, monsieur, c’est-il vous qui avez autorisé cet élève à demander la voiture pour aller à Vierzon chercher vos parents ? il nous est venu des soupçons…
– Mais pas du tout ! » répond M. Seurel.
Et aussitôt c’est dans la classe un désarroi effroyable. Les trois premiers, près de la sortie, ordinairement chargés de pourchasser à coups de pierres les chèvres ou les porcs qui viennent brouter dans la cour les corbeilles d’argent, se sont précipités à la porte. Au violent piétinement de leurs sabots ferrés sur les dalles de l’école a succédé, dehors, le bruit étouffé de leurs pas précipités qui mâchent le sable de la cour et dérapent au virage de la petite grille ouverte sur la route. Tout le reste de la classe s’entasse aux fenêtres du jardin. Certains ont grimpé sur les tables pour mieux voir…
Mais il est trop tard. Le grand Meaulnes s’est évadé.
« Tu iras tout de même à La Gare avec Mouchebœuf, me dit M. Seurel. Meaulnes ne connaît pas le chemin de Vierzon. Il se perdra aux carrefours. Il ne sera pas au train pour trois heures. »
Sur le seuil de la petite classe, Millie tend le cou pour demander :
« Mais qu’y a-t-il donc ? »
Dans la rue du bourg, les gens commencent à s’attrouper. Le paysan est toujours là, immobile, entêté, son chapeau à la main, comme quelqu’un qui demande justice.
Chapitre5 La Voiture qui revient
Lorsque j’eus ramené de La Gare les grands-parents, lorsqu’après le dîner, assis devant la haute cheminée, ils commencèrent à raconter par le menu détail tout ce qui leur était arrivé depuis les dernières vacances, je m’aperçus bientôt que je ne les écoutais pas.
La petite grille de la cour était tout près de la porte de la salle à manger. Elle grinçait en s’ouvrant.
D’ordinaire, au début de la nuit, pendant nos veillées de campagne, j’attendais secrètement ce grincement de la grille. Il était suivi d’un bruit de sabots claquant ou s’essuyant sur le seuil, parfois d’un chuchotement comme de personnes qui se concertent avant d’entrer. Et l’on frappait. C’était un voisin, les institutrices, quelqu’un enfin qui venait nous distraire de la longue veillée.
Or, ce soir-là, je n’avais plus rien à espérer du dehors, puisque tous ceux que j’aimais étaient réunis dans notre maison et pourtant je ne cessais d’épier tous les bruits de la nuit et d’attendre qu’on ouvrît notre porte.
Le vieux grand-père, avec son air broussailleux de grand berger gascon, ses deux pieds lourdement posés devant lui, son bâton entre les jambes, inclinant l’épaule pour cogner sa pipe contre son soulier, était là. Il approuvait de ses yeux mouillés et bons ce que disait la grand-mère, de son voyage et de ses poules et de ses voisins et des paysans qui n’avaient pas encore payé leur fermage. Mais je n’étais plus avec eux.
J’imaginais le roulement de voiture qui s’arrêterait soudain devant la porte. Meaulnes sauterait de la carriole et entrerait comme si rien ne s’était passé…
Ou peut-être irait-il d’abord reconduire la jument à la Belle-Étoile ; et j’entendrais bientôt son pas sonner sur la route et la grille s’ouvrir…
Mais rien. Le grand-père regardait fixement devant lui et ses paupières en battant s’arrêtaient longuement sur ses yeux comme à l’approche du sommeil.
La grand-mère répétait avec embarras sa dernière phrase, que personne n’écoutait.
« C’est de ce garçon que vous êtes en peine ? » dit-elle enfin.
À La Gare, en effet, je l’avais questionnée vainement. Elle n’avait vu personne, à l’arrêt de Vierzon qui ressemblât au grand Meaulnes. Mon compagnon avait dû s’attarder en chemin. Sa tentative était manquée. Pendant le retour, en voiture, j’avais ruminé ma déception, tandis que ma grand-mère causait avec Mouchebœuf. Sur la route blanchie de givre, les petits oiseaux tourbillonnaient autour des pieds de l’âne trottinant. De temps à autre, sur le grand calme de l’après-midi gelé, montait l’appel lointain d’une bergère ou d’un gamin hélant son compagnon d’un bosquet de sapins à l’autre. Et chaque fois, ce long cri sur les coteaux déserts me faisait tressaillir, comme si c’eût été la voix de Meaulnes me conviant à le suivre au loin…
Tandis que je repassais tout cela dans mon esprit, l’heure arriva de se coucher. Déjà le grand-père était entré dans la chambre rouge, la chambre-salon, tout humide et glacée d’être close depuis l’autre hiver. On avait enlevé pour qu’il s’y installât, les têtières en dentelle des fauteuils, relevé les tapis et mis de côté les objets fragiles. Il avait posé son bâton sur une chaise, ses gros souliers sous un fauteuil, il venait de souffler sa bougie, et nous étions debout, nous disant bonsoir, prêts à nous séparer pour la nuit, lorsqu’un bruit de voitures nous fit taire.
On eût dit deux équipages se suivant lentement au très petit trot. Cela ralentit le pas et finalement vint s’arrêter sous la fenêtre de la salle à manger qui donnait sur la route, mais qui était condamnée.
Mon père avait pris la lampe et, sans attendre, il ouvrait la porte qu’on avait déjà fermée à clef. Puis poussant la grille, s’avançant sur le bord des marches, il leva la lumière au-dessus de sa tête pourvoir ce qui se passait.
C’étaient bien deux voitures arrêtées, le cheval de l’une attaché derrière l’autre. Un homme avait sauté à terre et hésitait…
« C’est ici la Mairie ? dit-il en s’approchant. Pourriez-vous m’indiquer M. Fromentin, métayer à la Belle-Étoile ? J’ai trouvé sa voiture et sa jument qui s’en allaient sans conducteur, le long d’un chemin près de la route de Saint-Loup-des-Bois. Avec mon falot, j’ai pu voir son nom et son adresse sur la plaque. Comme c’était sur mon chemin, j’ai ramené son attelage par ici, afin d’éviter des accidents, mais ça m’a rudement retardé quand même ».
Nous étions là, stupéfaits. Mon père s’approcha. Il éclaira la carriole avec sa lampe.
« Il n’y a aucune trace de voyageur, poursuivit l’homme. Pas même une couverture. La bête est fatiguée ; elle boitille un peu. »
Je m’étais approché jusqu’au premier rang et je regardais avec les autres cet attelage perdu qui nous revenait, telle une épave qu’eût ramenée la haute mer – la première épave et la dernière, peut-être, de l’aventure de Meaulnes.
« Si c’est trop loin, chez Fromentin, dit l’homme, je vais vous laisser la voiture. J’ai déjà perdu beaucoup de temps et l’on doit s’inquiéter, chez moi. »
Mon père accepta. De cette façon nous pourrons dès ce soir reconduire l’attelage à la Belle-Étoile sans dire ce qui s’était passé. Ensuite, on déciderait de ce qu’il faudrait raconter aux gens du pays et écrire à la mère de Meaulnes… Et l’homme fouetta sa bête, en refusant le verre de vin que nous lui offrions.
Du fond de sa chambre où il avait rallumé la bougie, tandis que nous rentrions sans rien dire et que mon père conduisait la voiture à la ferme, mon grand-père appelait :
« Alors ? Est-il rentré, ce voyageur ? »
Les femmes se concertèrent du regard, une seconde :
« Mais oui, il a été chez sa mère. Allons, dors. Ne t’inquiète pas !
– Eh bien, tant mieux. C’est bien ce que je pensais », dit-il.
Et, satisfait, il éteignit sa lumière et se tourna dans son lit pour dormir.
Ce fut la même explication que nous donnâmes aux gens du bourg. Quant à la mère du fugitif, il fut décidé qu’on attendrait pour lui écrire. Et nous gardâmes pour nous seuls notre inquiétude qui dura trois grands jours. Je vois encore mon père rentrant de la ferme vers onze heures, sa moustache mouillée par la nuit, discutant avec Millie d’une voix très basse, angoissée et colère…
Chapitre6 On Frappe au carreau
Le quatrième jour fut un des plus froids de cet hiver-là. De grand matin les premiers arrivés dans la cour se réchauffaient en glissant autour du puits. Ils attendaient que le poêle fût allumé dans l’école pour s’y précipiter.
Derrière le portail, nous étions plusieurs à guetter la venue des gars de la campagne. Ils arrivaient tout éblouis encore d’avoir traversé des paysages de givre, d’avoir vu les étangs glacés, les taillis où les lièvres détalent… Il y avait dans leurs blouses un goût de foin et d’écurie qui alourdissait l’air de la classe, quand ils se pressaient autour du poêle rouge. Et, ce matin-là, l’un d’eux avait apporté dans un panier un écureuil gelé qu’il avait découvert en route. Il essayait, je me souviens, d’accrocher par ses griffes, au poteau du préau, la longue bête raidie…
Puis la pesante classe d’hiver commença…
Un coup brusque au carreau nous fit lever la tête.
Dressé contre la porte, nous aperçûmes le grand Meaulnes secouant, avant d’entrer, le givre de sa blouse, la tête haute et comme ébloui !
Les deux élèves du banc le plus rapproché de la porte se précipitèrent pour l’ouvrir : il y eut à l’entrée comme un vague conciliabule que nous n’entendîmes pas, et le fugitif se décida enfin à pénétrer dans l’école.
Cette bouffée d’air frais venue de la cour déserte, les brindilles de paille qu’on voyait accrochées aux habits du grand Meaulnes, et surtout son air de voyageur fatigué, affamé, mais émerveillé, tout cela fit passer en nous un étrange sentiment de plaisir et de curiosité.
M. Seurel était descendu du petit bureau à deux marches où il était en train de nous faire la dictée, et Meaulnes marchait vers lui d’un air agressif. Je me rappelle combien je le trouvai beau, à cet instant, le grand compagnon, malgré son air épuisé et ses yeux rougis par les nuits passées au dehors, sans doute.
Il s’avança jusqu’à la chaire et dit, du ton très assuré de quelqu’un qui rapporte un renseignement :
« Je suis rentré, monsieur.
– Je le vois bien, répondit M. Seurel, en le considérant avec curiosité… Allez vous asseoir à votre place. »
Le gars se retourna vers nous, le dos un peu courbé, souriant d’un air moqueur, comme font les grands élèves indisciplinés lorsqu’ils sont punis, et, saisissant d’une main le bout de la table, il se laissa glisser sur son banc.
« Vous allez prendre un livre que je vais vous indiquer, dit le maître – toutes les têtes étaient alors tournées vers Meaulnes – pendant que vos camarades finiront la dictée. »
Et la classe reprit comme auparavant. De temps à autre le grand Meaulnes se tournait de mon côté, puis il regardait par les fenêtres, d’où l’on apercevait le jardin blanc, cotonneux, immobile, et les champs déserts, où parfois descendait un corbeau. Dans la classe, la chaleur était lourde, auprès du poêle rougi.
Mon camarade, la tête dans les mains, s’accouda pour lire : à deux reprises je vis ses paupières se fermer et je crus qu’il allait s’endormir.
« Je voudrais aller me coucher, monsieur, dit-il enfin, en levant le bras à demi. Voici trois nuits que je ne dors pas.
– Allez ! » dit M. Seurel, désireux surtout d’éviter un incident.
Toutes les têtes levées, toutes les plumes en l’air, à regret nous le regardâmes partir, avec sa blouse fripée dans le dos et ses souliers terreux.
Que la matinée fut lente à traverser ! Aux approches de midi, nous entendîmes là-haut, dans la mansarde, le voyageur s’apprêter pour descendre. Au déjeuner, je le retrouvai assis devant le feu, près des grands-parents interdits, pendant qu’aux douze coups de l’horloge, les grands élèves et les gamins éparpillés dans la cour neigeuse filaient comme des ombres devant la porte de la salle à manger.
De ce déjeuner je ne me rappelle qu’un grand silence et une grande gêne. Tout était glacé : la toile cirée sans nappe, le vin froid dans les verres, le carreau rougi sur lequel nous posions les pieds… On avait décidé, pour ne pas le pousser à la révolte, de ne rien demander au fugitif. Et il profita de cette trêve pour ne pas dire un mot.
Enfin, le dessert terminé, nous pûmes tous les deux bondir dans la cour. Cour d’école, après midi, où les sabots avaient enlevé la neige… cour noircie où le dégel faisait dégoutter les toits du préau… cour pleine de jeux et de cris perçants ! Meaulnes et moi, nous longeâmes en courant les bâtiments. Déjà deux ou trois de nos amis du bourg laissaient la partie et accouraient vers nous en criant de joie, faisant gicler la boue sous leurs sabots, les mains aux poches, le cache-nez déroulé. Mais mon compagnon se précipita dans la grande classe, où je le suivis, et referma la porte vitrée juste à temps pour supporter l’assaut de ceux qui nous poursuivaient. Il y eut un fracas clair et violent de vitres secouées de sabots claquant sur le seuil ; une poussée qui fit plier la tige de fer maintenant les deux battants de la porte ; mais déjà Meaulnes, au risque de se blesser à son anneau brisé, avait tourné la petite clef qui fermait la serrure.
Nous avions accoutumé de juger très vexante une pareille conduite. En été, ceux qu’on laissait ainsi à la porte couraient au galop dans le jardin et parvenaient souvent à grimper par une fenêtre avant qu’on eût pu les fermer toutes. Mais nous étions en décembre et tout était clos. Un instant on fit au dehors des pesées sur la porte ; on nous cria des injures ; puis, un à un, ils tournèrent le dos et s’en allèrent, la tête basse, en rajustant leurs cache-nez.
Dans la classe qui sentait les châtaignes et la piquette, il n’y avait que deux balayeurs, qui déplaçaient les tables. Je m’approchai du poêle pour m’y chauffer paresseusement en attendant la rentrée, tandis qu’Augustin Meaulnes cherchait dans le bureau du maître et dans les pupitres. Il découvrit bientôt un petit atlas, qu’il se mit à étudier avec passion, debout sur l’estrade, les coudes sur le bureau, la tête entre les mains.
Je me disposais à aller près de lui ; je lui aurais mis la main sur l’épaule et nous aurions sans doute suivi ensemble sur la carte le trajet qu’il avait fait, lorsque soudain la porte de communication avec la petite classe s’ouvrit toute battante sous une violente poussée, et Jasmin Delouche, suivi d’un gars du bourg et de trois autres de la campagne, surgit avec un cri de triomphe. Une des fenêtres de la petite classe était sans doute mal fermée, ils avaient dû la pousser et sauter par là.
Jasmin Delouche, encore qu’assez petit, était l’un des plus âgés du Cours Supérieur. Il était fort jaloux du grand Meaulnes, bien qu’il se donnât comme son ami. Avant l’arrivée de notre pensionnaire, c’était lui, Jasmin, le coq de la classe. Il avait une figure pâle, assez fade, et les cheveux pommadés. Fils unique de la veuve Delouche, aubergiste, il faisait l’homme, il répétait avec vanité ce qu’il entendait dire aux joueurs de billard, aux buveurs de vermouth.
À son entrée, Meaulnes leva la tête et, les sourcils froncés, cria aux gars qui se précipitaient sur le poêle, en se bousculant :
« On ne peut donc pas être tranquille une minute, ici !
– Si tu n’es pas content, il fallait rester où tu étais », répondit, sans lever la tête, Jasmin Delouche qui se sentait appuyé par ses compagnons.
Je pense qu’Augustin était dans cet état de fatigue où la colère monte et vous surprend sans qu’on puisse la contenir.
« Toi, dit-il, en se redressant et en fermant son livre, un peu pâle, tu vas commencer par sortir d’ici ! »
L’autre ricana :
« Oh ! cria-t-il. Parce que tu es resté trois jours échappé, tu crois que tu vas être le maître maintenant ? »
Et, associant les autres à sa querelle :
« Ce n’est pas toi qui nous feras sortir, tu sais ! »
Mais déjà Meaulnes était sur lui. Il y eut d’abord une bousculade ; les manches des blouses craquèrent et se décousirent. Seul, Martin, un des gars de la campagne entrés avec Jasmin, s’interposa :
« Tu vas le laisser ! » dit-il, les narines gonflées, secouant la tête comme un bélier.
D’une poussée violente, Meaulnes le jeta, titubant, les bras ouverts, au milieu de la classe, puis, saisissant d’une main Delouche par le cou, de l’autre ouvrant la porte, il tenta de le jeter dehors. Jasmin s’agrippait aux tables et traînait les pieds sur les dalles, faisant crisser ses souliers ferrés, tandis que Martin, ayant repris son équilibre, revenait à pas comptés, la tête en avant, furieux. Meaulnes lâcha Delouche pour se colleter avec cet imbécile, et il allait peut-être se trouver en mauvaise posture, lorsque la porte des appartements s’ouvrit à demi.
M. Seurel parut, la tête tournée vers la cuisine, terminant, avant d’entrer, une conversation avec quelqu’un…
Aussitôt la bataille s’arrêta. Les uns se rangèrent autour du poêle, la tête basse, ayant évité jusqu’au bout de prendre parti. Meaulnes s’assit à sa place, le haut de ses manches décousu et défroncé. Quant à Jasmin, tout congestionné, on l’entendit crier durant les quelques secondes qui précédèrent le coup de règle du début de la classe :
« Il ne peut plus rien supporter maintenant. Il fait le malin. Il s’imagine peut-être qu’on ne sait pas où il a été !
– Imbécile ! Je ne le sais pas moi-même », répondit Meaulnes, dans le silence déjà grand.
Puis, haussant les épaules, la tête dans les mains, il se mit à apprendre ses leçons.
Chapitre7 Le Gilet de soie
Notre chambre était, comme je l’ai dit, une grande mansarde. À moitié mansarde, à moitié chambre. Il y avait des fenêtres aux autres logis d’adjoints ; on ne sait pas pourquoi celui-ci était éclairé par une lucarne. Il était impossible de fermer complètement la porte, qui frottait sur le plancher. Lorsque nous y montions, le soir, abritant de la main notre bougie que menaçaient tous les courants d’air de la grande demeure, chaque fois nous essayions de fermer cette porte, chaque fois nous étions obligés d’y renoncer.
Et, toute la nuit, nous sentions autour de nous, pénétrant jusque dans notre chambre, le silence des trois greniers.
C’est là que nous nous retrouvâmes, Augustin et moi, le soir de ce même jour d’hiver.
Tandis qu’en un tour de main j’avais quitté tous mes vêtements et les avais jetés en tas sur une chaise au chevet de mon lit, mon compagnon, sans rien dire, commençait lentement à se déshabiller. Du lit de fer aux rideaux de cretonne décorés de pampres, où j’étais monté déjà, je le regardais faire.
Tantôt il s’asseyait sur son lit bas et sans rideaux.
Tantôt il se levait et marchait de long en large, tout en se dévêtant. La bougie, qu’il avait posée sur une petite table d’osier tressée par des bohémiens, jetait sur le mur son ombre errante et gigantesque.
Tout au contraire de moi, il pliait et rangeait, d’un air distrait et amer, mais avec soin, ses habits d’écolier. Je le revois plaquant sur une chaise sa lourde ceinture ; pliant sur le dossier sa blouse noire extraordinairement fripée et salie ; retirant une espèce de paletot gros bleu qu’il avait sous sa blouse, et se penchant en me tournant le dos, pour l’étaler sur le pied de son lit… Mais lorsqu’il se redressa et se retourna vers moi, je vis qu’il portait, au lieu du petit gilet à boutons de cuivre, qui était d’uniforme sous le paletot, un étrange gilet de soie, très ouvert, que fermait dans le bas un rang serré de petits boutons de nacre.
C’était un vêtement d’une fantaisie charmante, comme devaient en porter les jeunes gens qui dansaient avec nos grand-mères, dans les bals de mille huit cent trente.
Je me rappelle, en cet instant le grand écolier paysan, nu-tête, car il avait soigneusement posé sa casquette sur ses autres habits – visage si jeune, si vaillant et si durci déjà. Il avait repris sa marche à travers la chambre lorsqu’il se mit à déboutonner cette pièce mystérieuse d’un costume qui n’était pas le sien. Et il était étrange de le voir, en bras de chemise, avec son pantalon trop court, ses souliers boueux, mettant la main sur ce gilet de marquis.
Dès qu’il l’eut touché, sortant brusquement de sa rêverie, il tourna la tête vers moi et me regarda d’un œil inquiet. J’avais un peu envie de rire. Il sourit en même temps que moi et son visage s’éclaira.
« Oh ! dis-moi ce que c’est, fis-je, enhardi, à voix basse. Où l’as-tu pris ? »
Mais son sourire s’éteignit aussitôt. Il passa deux fois sur ses cheveux gras sa main lourde, et tout soudain, comme quelqu’un qui ne peut plus résister à son désir, il réendossa sur le fin jabot sa vareuse qu’il boutonna solidement et sa blouse fripée ; puis il hésita un instant, en me regardant de côté… Finalement, il s’assit sur le bord de son lit, quitta ses souliers qui tombèrent bruyamment sur le plancher ; et, tout habillé comme un soldat au cantonnement d’alerte, il s’étendit sur son lit et souffla la bougie.
Vers le milieu de la nuit je m’éveillai soudain.
Meaulnes était au milieu de la chambre, debout, sa casquette sur la tête, et il cherchait au portemanteau quelque chose – une pèlerine qu’il se mit sur le dos… La chambre était très obscure. Pas même la clarté que donne parfois le reflet de la neige. Un vent noir et glacé soufflait dans le jardin mort et sur le toit.
Je me dressai un peu et je lui criai tout bas :
« Meaulnes ! tu repars ? »
Il ne répondit pas. Alors, tout à fait affolé, je dis :
« Eh bien, je pars avec toi. Il faut que tu m emmènes ».
Et je sautai à bas.
Il s’approcha, me saisit par le bras, me forçant à m’asseoir sur le rebord du lit, et il me dit :
« Je ne puis pas t’emmener, François. Si je connaissais bien mon chemin, tu m’accompagnerais. Mais il faut d’abord que je le retrouve sur le plan, et je n’y parviens pas.
– Alors, tu ne peux pas repartir non plus ?
– C’est vrai, c’est bien inutile… fit-il avec découragement. Allons, recouche-toi. Je te promets de ne pas repartir sans toi. »
Et il reprit sa promenade de long en large dans la chambre. Je n’osais plus rien lui dire. Il marchait s’arrêtait, repartait plus vite, comme quelqu’un qui, dans sa tête, recherche ou repasse des souvenirs, les confronte, les compare, calcule, et soudain pense avoir trouvé ; puis de nouveau lâche le fil et recommence à chercher…
Ce ne fut pas la seule nuit où, réveillé par le bruit de ses pas, je le trouvai ainsi, vers une heure du matin, déambulant à travers la chambre et les greniers – comme ces marins qui n’ont pu se déshabituer de faire le quart et qui, au fond de leurs propriétés bretonnes, se lèvent et s’habillent à l’heure réglementaire pour surveiller la nuit terrienne.
À deux ou trois reprises, durant le mois de janvier et la première quinzaine de février, je fus ainsi tiré de mon sommeil. Le grand Meaulnes était là, dressé, tout équipé, sa pèlerine sur le dos, prêt à partir, et chaque fois, au bord de ce pays mystérieux, où une fois déjà il s’était évadé, il s’arrêtait, hésitait. Au moment de lever le loquet de la porte de l’escalier et de filer par la porte de la cuisine qu’il eût facilement ouverte sans que personne l’entendit, il reculait une fois encore… Puis, durant les longues heures du milieu de la nuit, fiévreusement, il arpentait, en réfléchissant, les greniers abandonnés.
Enfin une nuit, vers le 15 février, ce fut lui-même qui m’éveilla en me posant doucement la main sur l’épaule.
La journée avait été fort agitée. Meaulnes, qui délaissait complètement tous les jeux de ses anciens camarades, était resté, durant la dernière récréation du soir, assis sur un banc, tout occupé à établir un mystérieux petit plan, en suivant du doigt, et en calculant longuement, sur l’atlas du Cher. Un va-et-vient incessant se produisait entre la cour et la salle de classe. Les sauts claquaient. On se pourchassait de table en table, franchissant les bancs et l’estrade d’un saut… On savait qu’il ne faisait pas bon s’approcher de Meaulnes lorsqu’il travaillait ainsi, cependant, comme la récréation se prolongeait, deux ou trois gamins du bourg, par manière de jeu, s’approchèrent à pas de loup et regardèrent par-dessus son épaule.
Chacun d’eux s’enhardit jusqu’à pousser les autres sur Meaulnes… Il ferma brusquement son atlas, cacha sa feuille et empoigna le dernier des trois gars, tandis que les deux autres avaient pu s’échapper.
… C’était ce hargneux Giraudat, qui prit un ton pleurard, essaya de donner des coups de pied, et, en fin de compte, fut mis dehors par le grand Meaulnes, à qui il cria rageusement :
« Grand lâche ! ça ne m’étonne pas qu’ils sont tous contre toi, qu’ils veulent te faire la guerre !… » et une foule d’injures, auxquelles nous répondîmes, sans avoir bien compris ce qu’il avait voulu dire.
C’est moi qui criais le plus fort, car j’avais pris le parti du grand Meaulnes. Il y avait maintenant comme un pacte entre nous. La promesse qu’il m’avait faite de m’emmener avec lui, sans me dire, comme tout le monde, « que je ne pourrais pas marcher », m’avait lié à lui pour toujours. Et je ne cessais de penser à son mystérieux voyage. Je m’étais persuadé qu’il avait dû rencontrer une jeune fille. Elle était sans doute infiniment plus belle que toutes celles du pays, plus belle que Jeanne, qu’on apercevait dans le jardin des religieuses par le trou de la serrure, et que Madeleine, la fille du boulanger, toute rose et toute blonde ; et que Jenny, la fille de la châtelaine, qui était admirable, mais folle et toujours enfermée.
C’est à une jeune fille certainement qu’il pensait la nuit, comme un héros de roman. Et j’avais décidé de lui en parler, bravement, la première fois qu’il m’éveillerait…
Le soir de cette nouvelle bataille, après quatre heures, nous étions tous les deux occupés à rentrer des outils du jardin, des pics et des pelles qui avaient servi à creuser des trous, lorsque nous entendîmes des cris sur la route. C’était une bande de jeunes gens et de gamins, en colonne par quatre, au pas gymnastique, évoluant comme une compagnie parfaitement organisée, conduits par Delouche, Daniel, Giraudat, et un autre que nous ne connûmes point. Ils nous avaient aperçus et ils nous huaient de la belle façon.
Ainsi tout le bourg était contre nous, et l’on préparait je ne sais quel jeu guerrier dont nous étions exclus.
Meaulnes, sans mot dire, remisa sous le hangar la bêche et la pioche qu’il avait sur l’épaule…
Mais, à minuit, je sentais sa main sur mon bras, et je m’éveillais en sursaut.
« Lève-toi, dit-il, nous partons.
– Connais-tu maintenant le chemin jusqu’au bout ?
– J’en connais une bonne partie. Et il faudra bien que nous trouvions le reste ! répondit-il, les dents serrées.
– Écoute, Meaulnes, fis-je en me mettant sur mon séant. Écoute-moi : nous n’avons qu’une chose à faire ; c’est de chercher tous les deux en plein jour, en nous servant de ton plan, la partie du chemin qui nous manque.
– Mais cette portion-là est très loin d’ici.
– Eh bien, nous irons en voiture, cet été, dès que les journées seront longues. »
Il y eut un silence prolongé qui voulait dire qu’il acceptait.
« Puisque nous tâcherons ensemble de retrouver la jeune fille que tu aimes, Meaulnes, ajoutais-je enfin, dis-moi qui elle est, parle-moi d’elle. »
Il s’assit sur le pied de mon lit. Je voyais dans l’ombre sa tête penchée, ses bras croisés et ses genoux. Puis il aspira l’air fortement, comme quelqu’un qui a eu gros cœur longtemps et qui va enfin confier son secret…
Chapitre8 L'Aventure
Mon compagnon ne me conta pas cette nuit-là tout ce qui lui était arrivé sur la route. Et même lorsqu’il se fut décidé à me tout confier, durant des jours de détresse dont je reparlerai, cela resta longtemps le grand secret de nos adolescences. Mais aujourd’hui que tout est fini, maintenant qu’il ne reste plus que poussière de tant de mal, de tant de bien, je puis raconter son étrange aventure.
À une heure et demie de l’après-midi, sur la route de Vierzon, par ce temps glacial, Meaulnes fit marcher sa bête bon train, car il savait n’être pas en avance. Il ne songea d’abord, pour s’en amuser, qu’à notre surprise à tous, lorsqu’il ramènerait dans la carriole, à quatre heures, le grand-père et la grand-mère Charpentier. Car, à ce moment-là, certes, il n’avait pas d’autre intention.
Peu à peu, le froid le pénétrant, il s’enveloppa les jambes dans une couverture qu’il avait d’abord refusée et que les gens de la Belle-Étoile avaient mise de force dans la voiture.
À deux heures, il traversa le bourg de La Motte. Il n’était jamais passé dans un petit pays aux heures de classe et s’amusa de voir celui-là aussi désert, aussi endormi. C’est à peine si, de loin en loin, un rideau se leva, montrant une tête curieuse de bonne femme.
À la sortie de La Motte, aussitôt après la maison d’école, il hésita entre deux routes et crut se rappeler qu’il fallait tourner à gauche pour aller à Vierzon.
Personne n’était là pour le renseigner. Il remit sa jument au trot sur la route désormais plus étroite et mal empierrée. Il longea quelque temps un bois de sapins et rencontra enfin un roulier à qui il demanda, mettant sa main en porte-voix, s’il était bien là sur la route de Vierzon. La jument, tirant sur les guides continuait à trotter ; l’homme ne dut pas comprendre ce qu’on lui demandait ; il cria quelque chose en faisant un geste vague, et, à tout hasard, Meaulnes poursuivit sa route.
De nouveau ce fut la vaste campagne gelée, sans accident ni distraction aucune ; parfois seulement une pie s’envolait, effrayée par la voiture, pour aller se percher plus loin sur un orme sans tête. Le voyageur avait enroulé autour de ses épaules, comme une cape, sa grande couverture. Les jambes allongées, accoudé sur un côté de la carriole, il dut somnoler un assez long moment…
… Lorsque, grâce au froid, qui traversait maintenant la couverture, Meaulnes eut repris ses esprits, il s’aperçut que le paysage avait changé. Ce n’étaient plus ces horizons lointains, ce grand ciel blanc où se perdait le regard, mais de petits près encore verts avec de hautes clôtures. À droite et à gauche, l’eau des fossés coulait sous la glace. Tout faisait pressentir l’approche d’une rivière. Et, entre les hautes haies, la route n’était plus qu’un étroit chemin défoncé.
La jument, depuis un instant, avait cessé de trotter.
D’un coup de fouet, Meaulnes voulut lui faire reprendre sa vive allure, mais elle continua à marcher au pas avec une extrême lenteur, et le grand écolier, regardant de côté, les mains appuyées sur le devant de la voiture, s’aperçut qu’elle boitait d’une jambe de derrière. Aussitôt il sauta à terre, très inquiet.
« Jamais nous n’arriverons à Vierzon pour le train », dit-il à mi-voix.