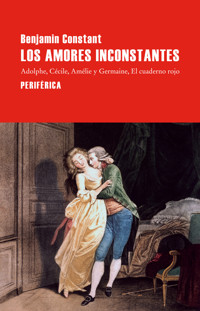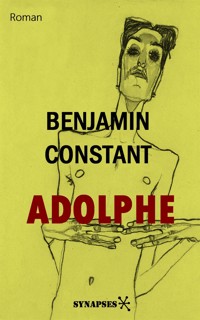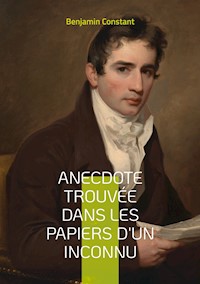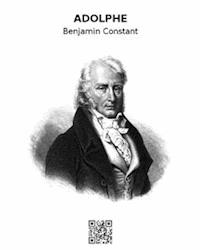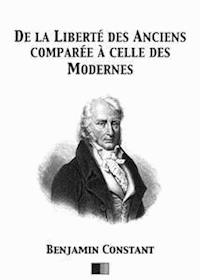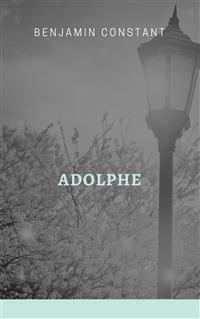Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Adolphe, le héros du roman, est un jeune bourgeois qui ne se sent pas très à l'aise avec la société, qu'il juge stupide et insipide. Chez le comte de P***, il tombe amoureux d'Ellénore, unePolonaise de dix ans son aînée et maîtresse fidèle du comte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Adolphe
Pages de titreChapitre premierChapitre IIChapitre IIIChapitre IVChapitre VChapitre VIChapitre VIIChapitre VIIIChapitre IXChapitre XPage de copyright1
Adolphe
Benjamin Constant
2
Chapitre premier
Je venais de finir à vingt-deux ans mes études à l’université de
Gottingue. – L’intention de mon père, ministre de l’électeur de **,
était que je parcourusse les pays les plus remarquables de l’Europe. Il
voulait ensuite m’appeler auprès de lui, me faire entrer dans le
département dont la direction lui était confiée, et me préparer à le
remplacer un jour. J’avais obtenu, par un travail assez opiniâtre, au
milieu d’une vie très dissipée, des succès qui m’avaient distingué de
mes compagnons d’étude, et qui avaient fait concevoir à mon père
sur moi des espérances probablement fort exagérées.
Ces espérances l’avaient rendu très indulgent pour beaucoup de
fautes que j’avais commises. Il ne m’avait jamais laissé souffrir des
suites de ces fautes. Il avait toujours accordé, quelquefois prévenu,
mes demandes à cet égard.
Malheureusement sa conduite était plutôt noble et généreuse que
tendre. J’étais pénétré de tous ses droits à ma reconnaissance et à
mon respect. Mais aucune confiance n’avait existé jamais entre nous.
Il avait dans l’esprit je ne sais quoi d’ironique qui convenait mal à
mon caractère. Je ne demandais alors qu’à me livrer à ces
impressions primitives et fougueuses qui jettent l’âme hors de la
sphère commune, et lui inspirent le dédain de tous les objets qui
l’environnent. Je trouvais dans mon père, non pas un censeur, mais
un observateur froid et caustique, qui souriait d’abord de pitié, et qui
finissait bientôt la conversation avec impatience.
Je ne me souviens pas, pendant mes dix-huit premières années,
d’avoir eu jamais un entretien d’une heure avec lui. Ses lettres étaient
affectueuses, pleines de conseils, raisonnables et sensibles ; mais à
3
peine étions-nous en présence l’un de l’autre qu’il y avait en lui
quelque chose de contraint que je ne pouvais m’expliquer, et qui
réagissait sur moi d’une manière pénible. Je ne savais pas alors ce
que c’était que la timidité, cette souffrance intérieure qui nous
poursuit jusque dans l’âge le plus avancé, qui refoule sur notre cœur
les impressions les plus profondes, qui glace nos paroles, qui
dénature dans notre bouche tout ce que nous essayons de dire, et ne
nous permet de nous exprimer que par des mots vagues ou une ironie
plus ou moins amère, comme si nous voulions nous venger sur nos
sentiments mêmes de la douleur que nous éprouvons à ne pouvoir les
faire connaître. Je ne savais pas que, même avec son fils, mon père
était timide, et que souvent, après avoir longtemps attendu de moi
quelques témoignages d’affection que sa froideur apparente semblait
m’interdire, il me quittait les yeux mouillés de larmes et se plaignait
à d’autres de ce que je ne l’aimais pas.
Ma contrainte avec lui eut une grande influence sur mon caractère.
Aussi timide que lui, mais plus agité, parce que j’étais plus jeune, je
m’accoutumai à renfermer en moi-même tout ce que j’éprouvais, à
ne former que des plans solitaires, à ne compter que sur moi pour
leur exécution, à considérer les avis, l’intérêt, l’assistance et jusqu’à
la seule présence des autres comme une gêne et comme un obstacle.
Je contractai l’habitude de ne jamais parler de ce qui m’occupait,
de ne me soumettre à la conversation que comme à une nécessité
importune et de l’animer alors par une plaisanterie perpétuelle qui me
la rendait moins fatigante, et qui m’aidait à cacher mes véritables
pensées. De là une certaine absence d’abandon qu’aujourd’hui
encore mes amis me reprochent, et une difficulté de causer
sérieusement que j’ai toujours peine à surmonter. Il en résulta en
même temps un désir ardent d’indépendance, une grande impatience
des liens dont j’étais environné, une terreur invincible d’en former de
nouveaux. Je ne me trouvais à mon aise que tout seul, et tel est même
à présent l’effet de cette disposition d’âme que, dans les
circonstances les moins importantes, quand je dois choisir entre deux
partis, la figure humaine me trouble, et mon mouvement naturel est
de la fuir pour délibérer en paix. Je n’avais point cependant la
profondeur d’égoïsme qu’un tel caractère paraît annoncer : tout en ne
4
m’intéressant qu’à moi, je m’intéressais faiblement à moi-même. Je
portais au fond de mon cœur un besoin de sensibilité dont je ne
m’apercevais pas, mais qui, ne trouvant point à se satisfaire, me
détachait successivement de tous les objets qui tour à tour attiraient
ma curiosité. Cette indifférence sur tout s’était encore fortifiée par
l’idée de la mort, idée qui m’avait frappé très jeune, et sur laquelle je
n’ai jamais conçu que les hommes s’étourdissent si facilement.
J’avais à l’âge de dix-sept ans vu mourir une femme âgée, dont
l’esprit, d’une tournure remarquable et bizarre, avait commencé à
développer le mien.
Cette femme, comme tant d’autres, s’était, à l’entrée de sa
carrière, lancée vers le monde, qu’elle ne connaissait pas, avec le
sentiment d’une grande force d’âme et de facultés vraiment
puissantes. Comme tant d’autres aussi, faute de s’être pliée à des
convenances factices, mais nécessaires, elle avait vu ses espérances
trompées, sa jeunesse passer sans plaisir ; et la vieillesse enfin l’avait
atteinte sans la soumettre. Elle vivait dans un château voisin d’une de
nos terres, mécontente et retirée, n’ayant que son esprit pour
ressource, et analysant tout avec son esprit. Pendant près d’un an,
dans nos conversations inépuisables, nous avions envisagé la vie
sous toutes ses faces, et la mort toujours pour terme de tout ; et après
avoir tant causé de la mort avec elle, j’avais vu la mort la frapper à
mes yeux.
Cet événement m’avait rempli d’un sentiment d’incertitude sur la
destinée, et d’une rêverie vague qui ne m’abandonnait pas. Je lisais
de préférence dans les poètes ce qui rappelait la brièveté de la vie
humaine. Je trouvais qu’aucun but ne valait la peine d’aucun effort. Il
est assez singulier que cette impression se soit affaiblie précisément à
mesure que les années se sont accumulées sur moi. Serait-ce parce
qu’il y a dans l’espérance quelque chose de douteux, et que,
lorsqu’elle se retire de la carrière de l’homme, cette carrière prend un
caractère plus sévère, mais plus positif ? Serait-ce que la vie semble
d’autant plus réelle que toutes les illusions disparaissent, comme la
cime des rochers se dessine mieux dans l’horizon lorsque les nuages
se dissipent ?
Je me rendis, en quittant Gottingue, dans la petite ville de D**.
5
Cette ville était la résidence d’un prince qui, comme la plupart de
ceux de l’Allemagne, gouvernait avec douceur un pays de peu
d’étendue, protégeait les hommes éclairés qui venaient s’y fixer,
laissait à toutes les opinions une liberté parfaite, mais qui, borné par
l’ancien usage à la société de ses courtisans, ne rassemblait par là
même autour de lui que des hommes en grande partie insignifiants ou
médiocres. Je fus accueilli dans cette cour avec la curiosité qu’inspire
naturellement tout étranger qui vient rompre le cercle de la
monotonie et de l’étiquette. Pendant quelques mois je ne remarquai
rien qui put captiver mon attention. J’étais reconnaissant de
l’obligeance qu’on me témoignait ; mais tantôt ma timidité
m’empêchait d’en profiter, tantôt la fatigue d’une agitation sans but
me faisait préférer la solitude aux plaisirs insipides que l’on
m’invitait à partager. Je n’avais de haine contre personne, mais peu
de gens m’inspiraient de l’intérêt ; or les hommes se blessent de
l’indifférence, ils l’attribuent à la malveillance ou à l’affectation ; ils
ne veulent pas croire qu’on s’ennuie avec eux, naturellement.
Quelquefois je cherchais a contraindre mon ennui ; je me réfugiais
dans une taciturnité profonde : on prenait cette taciturnité pour du
dédain. D’autres fois, lassé moi-même de mon silence, je me laissais
aller à quelques plaisanteries, et mon esprit, mis en mouvement,
m’entraînait au-delà de toute mesure. Je révélais en un jour tous les
ridicules que j’avais observés durant un mois. Les confidents de mes
épanchements subits et involontaires ne m’en savaient aucun gré et
avaient raison ; car c’était le besoin de parler qui me saisissait, et non
la confiance.
J’avais contracté dans mes conversations avec la femme qui la
première avait développé mes idées une insurmontable aversion pour
toutes les maximes communes et pour toutes les formules
dogmatiques. Lors donc que j’entendais la médiocrité disserter avec
complaisance sur des principes bien établis, bien incontestables en
fait de morale, de convenances ou de religion, choses qu’elle met
assez volontiers sur la même ligne, je me sentais poussé à la
contredire, non que j’eusse adopté des opinions opposées, mais parce
que j’étais impatiente d’une conviction si ferme et si lourde. Je ne
sais quel instinct m’avertissait, d’ailleurs, de me défier de ces
6
axiomes généraux si exempts de toute restriction, si purs de toute
nuance. Les sots font de leur morale une masse compacte et
indivisible, pour qu’elle se mêle le moins possible avec leurs actions
et les laisse libres dans tous les détails.
Je me donnai bientôt, par cette conduite une grande réputation de
légèreté, de persiflage, de méchanceté. Mes paroles amères furent
considérées comme des preuves d’une âme haineuse, mes
plaisanteries comme des attentats contre tout ce qu’il y avait de plus
respectable. Ceux dont j’avais eu le tort de me moquer trouvaient
commode de faire cause commune avec les principes qu’ils
m’accusaient de révoquer en doute : parce que sans le vouloir je les
avais fait rire aux dépens les uns des autres, tous se réunirent contre
moi. On eût dit qu’en faisant remarquer leurs ridicules, je trahissais
une confidence qu’ils m’avaient faite.
On eût dit qu’en se montrant à mes yeux tels qu’ils étaient, ils
avaient obtenu de ma part la promesse du silence : je n’avais point la
conscience d’avoir accepté ce traité trop onéreux. Ils avaient trouvé
du plaisir à se donner ample carrière : j’en trouvais à les observer et à
les décrire ; et ce qu’ils appelaient une perfidie me paraissait un
dédommagement tout innocent et très légitime.
Je ne veux point ici me justifier : j’ai renoncé depuis longtemps à
cet usage frivole et facile d’un esprit sans expérience ; je veux
simplement dire, et cela pour d’autres que pour moi qui suis
maintenant à l’abri du monde, qu’il faut du temps pour s’accoutumer
à l’espèce humaine, telle que l’intérêt, l’affectation, la vanité, la peur
nous l’ont faite. L’étonnement de la première jeunesse, à l’aspect
d’une société si factice et si travaillée, annonce plutôt un cœur
naturel qu’un esprit méchant. Cette société d’ailleurs n’a rien à en
craindre. Elle pèse tellement sur nous, son influence sourde est
tellement puissante, qu’elle ne tarde pas a nous façonner d’après le
moule universel. Nous ne sommes plus surpris alors que de notre
ancienne surprise, et nous nous trouvons bien sous notre nouvelle
forme, comme l’on finit par respirer librement dans un spectacle
encombré par la foule, tandis qu’en y entrant on n’y respirait qu’avec
effort.
Si quelques-uns échappent à cette destinée générale, ils
7
renferment en eux-mêmes leur dissentiment secret ; ils aperçoivent
dans la plupart des ridicules le germe des vices : ils n’en plaisantent
plus, parce que le mépris remplace la moquerie, et que le mépris est
silencieux.
Il s’établit donc, dans le petit public qui m’environnait, une
inquiétude vague sur mon caractère. On ne pouvait citer aucune
action condamnable ; on ne pouvait même m’en contester quelques-
unes qui semblaient annoncer de la générosité ou du dévouement ;
mais on disait que j’étais un homme immoral, un homme peu sûr :
deux épithètes heureusement inventées pour insinuer les faits qu’on
ignore, et laisser deviner ce qu’on ne sait pas.
8
Chapitre II
Distrait, inattentif, ennuyé, je ne m’apercevais point de
l’impression que je produisais, et je partageais mon temps entre des
études que j’interrompais souvent, des projets que je n’exécutais pas,
des plaisirs qui ne m’intéressaient guère, lorsqu’une circonstance très
frivole en apparence produisit dans ma disposition une révolution
importante.
Un jeune homme avec lequel j’étais assez lié cherchait depuis
quelques mois à plaire à l’une des femmes les moins insipides de la
société dans laquelle nous vivions : j’étais le confident très
désintéressé de son entreprise. Après de longs efforts il parvint à se
faire aimer ; et, comme il ne m’avait point caché ses revers et ses
peines, il se crut obligé de me communiquer ses succès : rien
n’égalait ses transports et l’excès de sa joie. Le spectacle d’un tel
bonheur me fit regretter de n’en avoir pas essayé encore ; je n’avais
point eu jusqu’alors de liaison de femme qui pût flatter mon amour-
propre ; un nouvel avenir parut se dévoiler à mes yeux ; un nouveau
besoin se fit sentir au fond de mon cœur. Il y avait dans ce besoin
beaucoup de vanité sans doute, mais il n’y avait pas uniquement de la
vanité ; il y en avait peut-être moins que je ne le croyais moi-même.
Les sentiments de l’homme sont confus et mélangés ; ils se
composent d’une multitude d’impressions variées qui échappent à
l’observation ; et la parole, toujours trop grossière et trop générale,
peut bien servir à les désigner, mais ne sert jamais à les définir.
J’avais, dans la maison de mon père, adopté sur les femmes un
système assez immoral. Mon père, bien qu’il observât strictement les
convenances extérieures, se permettait assez fréquemment des propos
9
légers sur les liaisons d’amour : il les regardait comme des
amusements, sinon permis, du moins excusables, et considérait le
mariage seul sous un rapport sérieux. Il avait pour principe qu’un
jeune homme doit éviter avec soin de faire ce qu’on nomme une
folie, c’est-à-dire de contracter un engagement durable avec une
personne qui ne fût pas parfaitement son égale pour la fortune, la
naissance et les avantages extérieurs ; mais du reste, toutes les
femmes, aussi longtemps qu’il ne s’agissait pas de les épouser, lui
paraissaient pouvoir, sans inconvénient, être prises, puis être
quittées ; et je l’avais vu sourire avec une sorte d’approbation à cette
parodie d’un mot connu :
« Cela leur fait si peu de mal, et à nous tant de plaisir ! »
L’on ne sait pas assez combien, dans la première jeunesse, les
mots de cette espèce font une impression profonde, et combien à un
âge où toutes les opinions sont encore douteuses et vacillantes, les
enfants s’étonnent de voir contredire, par des plaisanteries que tout le
monde applaudit, les règles directes qu’on leur a données. Ces règles
ne sont plus à leurs yeux que des formules banales que leurs parents
sont convenus de leur répéter pour l’acquit de leur conscience, et les
plaisanteries leur semblent renfermer le véritable secret de la vie.
Tourmenté d’une émotion vague, je veux être aimé, me disais-je,
et je regardais autour de moi ; je ne voyais personne qui m’inspirât
de l’amour, personne qui me parût susceptible d’en prendre ;
j’interrogeais mon cœur et mes goûts : je ne me sentais aucun
mouvement de préférence. Je m’agitais ainsi intérieurement, lorsque
je fis connaissance avec le comte de P**, homme de quarante ans,
dont la famille était alliée à la mienne. Il me proposa de venir le voir.
Malheureuse visite ! Il avait chez lui sa maîtresse, une Polonaise,
célèbre par sa beauté, quoiqu’elle ne fût plus de la première jeunesse.
Cette femme, malgré sa situation désavantageuse, avait montré dans
plusieurs occasions un caractère distingué. Sa famille, assez illustre
en Pologne, avait été ruinée dans les troubles de cette contrée. Son
père avait été proscrit ; sa mère était allée chercher un asile en
France, et y avait mené sa fille, qu’elle avait laissée, à sa mort, dans
un isolement complet. Le comte de P** en était devenu amoureux.
J’ai toujours ignoré comment s’était formée une liaison qui, lorsque
10
j’ai vu pour la première fois Ellénore, était, dès longtemps, établie et
pour ainsi dire consacrée. La fatalité de sa situation ou l’inexpérience
de son âge l’avaient-elles jetée dans une carrière qui répugnait
également à son éducation, à ses habitudes et à la fierté qui faisait