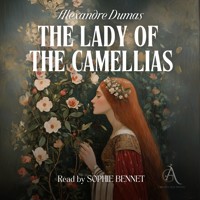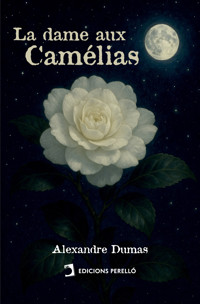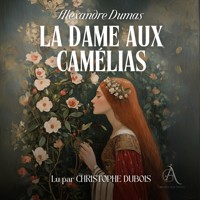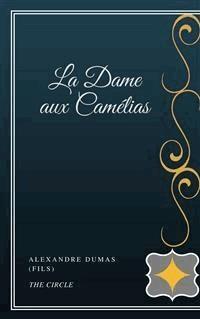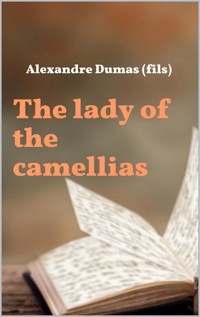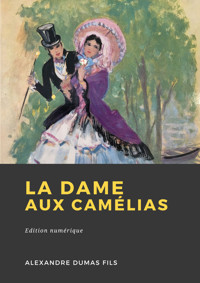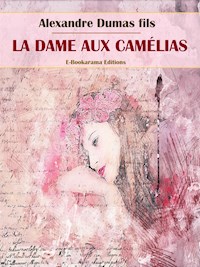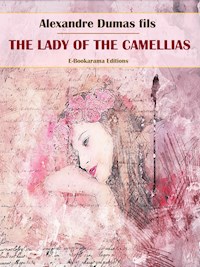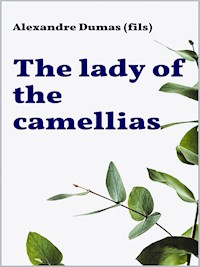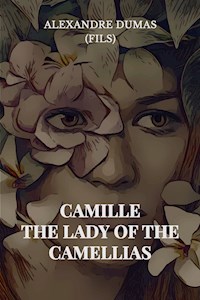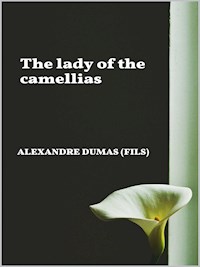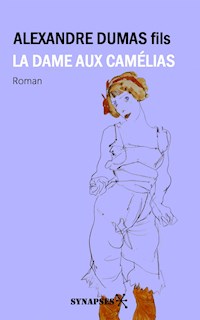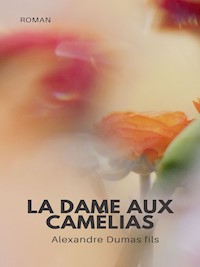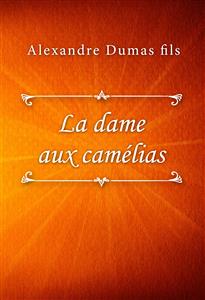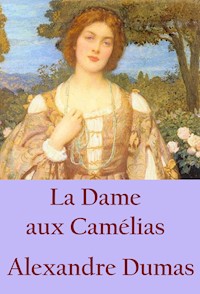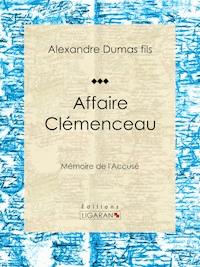
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Puisque, à la première nouvelle de mon arrestation, sans vous demander ce qu'il y a de vrai et de faux dans les bruits contradictoires qui courent sur mon compte, vous vous êtes souvenu de nos amicales relations et que vous m'avez décidé à vivre le plus longtemps possible, au nom de mon enfant et de mon honneur, je commence aujourd'hui, je ne dirai pas seulement le mémoire des faits..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335054811
©Ligaran 2015
À MON EXCELLENT AMI
LE DOCTEUR DEMARQUAY
SOUVENIR DES ANNÉES DIFFICILES
A. DUMAS FILS.
Avocat à la Cour royale.
« Puisque, à la première nouvelle de mon arrestation, sans vous demander ce qu’il y a de vrai et de faux dans les bruits contradictoires qui courent sur mon compte, vous vous êtes souvenu de nos amicales relations et que vous m’avez décidé à vivre le plus longtemps possible, au nom de mon enfant et de mon honneur, je commence aujourd’hui, je ne dirai pas seulement le mémoire des faits dont la connaissance exacte est indispensable à l’avocat qui veut bien se charger de ma cause, mais le récit confidentiel, scrupuleux, inexorable des évènements, des circonstances, des pensées qui ont amené la catastrophe du mois dernier.
L’affaire ne viendra pas avant cinq ou six semaines ; j’aurai donc le temps de me recueillir. Je vous dirai la vérité comme je la dirais à Dieu s’il m’interrogeait et voulait, lui qui sait tout, faire dépendre son arrêt du plus ou moins de sincérité de mes aveux. Vous prendrez dans cette relation tout ce que vous croirez utile à ma défense. J’y mettrai, d’ailleurs, autant d’ordre et de clarté que me le permettra l’état de mon esprit, moins troublé que je ne l’aurais cru. Votre talent et votre amitié feront le reste.
Quelle que soit la décision du jury, je n’oublierai jamais vos deux bras tendus vers moi lorsqu’on vous a ouvert la porte de ma prison, et ma dernière pensée, que je sois condamné ou non, sera partagée entre mon fils et vous.
PIERRE CLÉMENCEAU.
8 mai 18… »
Je suis d’une Camille plus qu’obscure. Le mot ma famille veut une explication. Ma famille, c’était ma mère. Je tiens tout d’elle : ma naissance, mon instruction, mon nom, car à cette heure je ne connais pas encore mon père. S’il vit, il aura, comme tout le monde, en lisant son journal, appris mon arrestation, et il se sera réjoui de n’avoir pas reconnu un enfant qui l’aurait traîné un jour sur les bancs de la Cour d’assises, en admettant que ma destinée eût été la même s’il s’y fût intéressé.
Jusqu’à l’âge de dix ans, j’ai fréquenté assez régulièrement un petit externat tenu par un vieux bonhomme au rez-de-chaussée de la maison contiguë à la nôtre. J’y ai appris la lecture, l’écriture, un peu d’arithmétique, d’histoire sainte et de catéchisme.
Lorsque ma dixième année fut venue, ma mère résolut de me mettre tout à fait en pension, préférant mon intérêt à venir à son bonheur présent ; car se séparer de moi devait être cruel pour une femme qui n’avait que moi à aimer dans le monde.
– Tu n’as pas de père, me dit-elle à cette époque ; cela ne signifie pas que ton père est mort : cela signifie que beaucoup de gens te mépriseront, t’insulteront pour un malheur qui devrait exciter leur sympathie et provoquer leur assistance ; cela signifie encore qu’il ne faut compter que sur toi et sur moi qui, malheureusement ne pourrai pas travailler toujours ; cela signifie enfin que, quelque chagrin que tu me causes, je suis forcée de te le pardonner. N’en abuse pas trop.
Voilà plus de vingt ans que j’ai entendu ces paroles, et je les retrouve nettes et précises comme si je les avais entendues hier. Quel effroyable don que la mémoire ! De quelle faute Dieu avait-il à punir l’homme quand il lui a imposé ce redoutable bienfait ? Il est des souvenirs heureux, dit-on. Oui, tant que le bonheur nous accompagne ; mais, au premier deuil ou au premier remords, tous ces souvenirs s’enfuient, et, si nous courons après eux, ils se retournent et nous frappent en plein cœur.
Je ne pouvais guère, à dix ans, m’identifier avec le sens littéral des paroles de ma mère ; mais j’y démêlai, d’instinct, une souffrance pour elle et un devoir pour moi.
Je l’embrassai, c’est la première réponse des enfants émus ; puis, avec un accent de résolution subite et de fermeté au-dessus de mon âge :
– Sois tranquille, lui dis-je, je travaillerai bien, et, quand je serai grand, tu verras comme je te rendrai heureuse.
Ma mère avait créé un petit commerce de lingerie et de broderie au coin de la rue de la Grange-Batelière, au deuxième étage, en face de la mairie. Première ouvrière de la célèbre Caroline, elle s’était établie à son tour, et son goût, son exactitude, son caractère, lui avaient attiré une clientèle peu nombreuse mais choisie.
Je vois encore notre modeste logement si proprement tenu, la vieille bonne, frottant dès le point du jour, et avec qui, sous prétexte de lui aider dans ce travail matinal, je venais jouer, à mon réveil ; nos simples repas, durant lesquels ma mère causait avec cette même servante, habitude commune à la petite bourgeoisie ; les voisins que je rencontrais sur l’escalier, lorsque je me rendais à mon école et qui s’amusaient de mon babillage ; enfin la veillée et les deux ou trois ouvrières, jeunes et rieuses, à qui ma mère distribuait de l’ouvrage après l’avoir coupé elle-même.
Ces jeunes filles me gâtaient de leur mieux. Ma position d’enfant naturel était sans doute pour elles une raison de plus de m’aimer. Les femmes, dans cette classe, ont trop souvent à souffrir d’un semblable accident, pour ne pas y compatir et ne pas le respecter chez les autres. Pendant les dernières soirées qui précédèrent mon entrée en pension, elles s’ingéniaient à me distraire et à me faire oublier l’exil prochain ; car, malgré ma grande résolution de courage, l’âge reprenait ses droits, et je n’y pensais pas sans alarmes.
Enfin, la veille du grand jour, – le 1er octobre 18. . ! – après le dîner, ma mère me dit :
– Allons terminer nos emplettes.
Elle me conduisit d’abord chez un petit joaillier du boulevard Saint-Martin, et, là, pauvre chère femme ! elle m’acheta un couvert et une timbale d’argent, en ayant encore la bonté de consulter mon goût. Je choisis le plus simple modèle, pensant que ce serait le moins cher. Elle m’embrassa ; le cœur est si intelligent !
Nous revînmes ensuite tout le long des boulevards, et, comme je me plaisais à colorier des images (c’était ma grande distraction pendant qu’elle travaillait, l’hiver), elle m’acheta une boîte de couleurs ; puis ce fut une toupie, une corde à sauter, que sais-je ! tous les petits jouets destinés à atténuer le chagrin du lendemain en occupant mon jeune esprit de mes plaisirs accoutumés.
Quand nous rentrâmes à la maison, il était tard, les ouvrières étaient parties. La lampe, aux trois quarts baissée, nous attendait sur l’établi. Toutes mes petites affaires terminées étaient rangées avec soin. Chacun de ces objets représentait une somme d’argent péniblement acquise, une veille prolongée dans la nuit, quelquefois jusqu’au matin. L’homme qui rend mère une fille pauvre, et qui laisse le travail de cette femme pourvoir seul aux besoins de son enfant, a-t-il conscience de ce qu’il fait ?
Ma mère s’assit, me prit sur ses genoux, je posai ma tête sur son épaule, et nous restâmes ainsi près d’une heure sans parler, elle rêvant au passé, sans doute, moi ne pensant à rien, qu’à me trouver bien où j’étais.
– Veux-tu être gentille, petite maman ? lui dis-je lorsqu’il fut temps de me coucher ; laisse-moi dormir avec toi.
J’étais très délicat dans ma première enfance. Ma mère, qui m’avait nourri, me couchait avec elle. Cette habitude s’était prolongée pour moi jusqu’à l’âge de six ans. C’était devenu ensuite une récompense ou une compensation lorsque j’avais été exceptionnellement sage, ou qu’un plaisir m’avait été promis, et que, pour une raison de travail ou d’économie, il avait fallu m’en priver. Alors, je demandais à ma mère la permission de reposer auprès d’elle, et, le soir venu, je courais dans sa chambre, je me coulais dans son lit, je m’y retournais en frétillant comme un poisson qu’on rejette dans l’eau, et je m’endormais de ce sommeil plein qui n’appartient, hélas ! qu’à l’enfance. Sa besogne achevée, ma mère se glissait tout doucement à mon côté, et, le lendemain, je me retrouvais toujours dans la même attitude, tenant son bras entre les miens, contre mes lèvres. De ce réveil, surtout, je me faisais une fête ; je me mettais alors à jouer avec elle, je la décoiffais. Nous riions ensemble, et, me pressant avec énergie dans ses bras, elle me disait :
– Comme je t’aime, mon cher enfant !
Voilà bien des détails inutiles à la cause, n’est-ce pas ? Mais, je vous le répète, je n’écris pas seulement pour mon défenseur, j’écris pour moi-même : car il me serait impossible de raconter tout de suite la seconde partie de ma vie sans faire une halte dans la première. J’ai besoin de courage. Où le trouver, sinon dans le rappel de ces premières années si calmes et si douces ?
Le lendemain, à sept heures du matin, j’étais dans le cabinet du chef d’institution, à qui ma mère me recommandait pour la centième fois : « Je ne l’avais jamais quittée ; j’avais besoin des plus grands ménagements ; on obtenait tout de moi par la douceur ; si j’étais malade, il fallait l’envoyer chercher tout de suite ; du reste, elle ne demeurait pas très loin du pensionnat, elle viendrait, pendant les premiers temps, tous les jours à l’heure de la récréation, etc., etc. » La cloche sonna, elle m’embrassa une dernière fois, et je restai seul.
Comme presque tous les hommes, vous avez eu cette minute-là dans votre enfance. Vous savez ce qu’elle contient.
M. Frémin me dit, du ton affectueux d’un père habitué à ne pas brusquer cette première souffrance dont il était souvent le témoin :
– Venez, mon ami.
Et il me conduisit au milieu de mes nouveaux camarades.
En me mettant en pension au lieu de me mettre au collège, ce qui eût été plus simple et moins coûteux, ma mère avait pris une de ces demi-mesures que le cœur ingénieux accepte pour amortir le choc de certaines nécessités. Puis cette institution, située dans un quartier sain, dans le voisinage des jardins de Tivoli, semblait offrir tous les avantages possibles d’hygiène et d’éducation. C’était en effet, mais à tort, un des établissements les plus renommés de Paris. Il comptait près de trois cents élèves appartenant pour la plupart à la haute finance, au grand commerce ou à la noblesse récente.
Ma mère, comme toutes les personnes auxquelles l’instruction a manqué, voulait m’en faire donner une aussi complète que possible. Elle avait donc cru devoir s’adresser à une de ses plus riches clientes, laquelle avait un fils à peu près de mon âge, et loi avait demandé, en lui apprenant pourquoi elle lui faisait cette demande, dans quelle maison elle avait placé son fils. Cette circonstance bien simple devait amener les premiers évènements douloureux de ma vie. La dame se trouva blessée de ce qu’une de ses fournisseuses avait l’outrecuidance de vouloir faire de son fils, enfant naturel par-dessus le marché, un camarade du sien, fils d’un comte de la Restauration.
Ma mère ne soupçonna rien. En communiquant ses projets à madame d’Anglepierre, elle avait eu même la naïveté d’ajouter :
– Je serais bien heureuse que mon fils se trouvât avec le vôtre, madame. Vous avez toujours été si bienveillante pour moi, que M. Fernand, j’en suis certaine, sera bon aussi pour Pierre. Ce cher enfant ne m’a jamais quittée, il a grand besoin qu’on l’aime.
Ma mère était sans orgueil comme elle était sans servilité. Elle dit ces paroles tout simplement à sa cliente, en lui montrant des broderies et en me tenant la tête contre ses genoux.
D’ailleurs, une mère qui parle enfant à une autre mère se considère comme son égale. L’amour maternel semble devoir mettre, au moins momentanément, toutes les femmes au même niveau, puisqu’il n’y a pas, suivant les différentes classes, différentes manières d’engendrer et d’aimer ses enfants. C’est là surtout que la nature implacable supprime clairement les hiérarchies sociales, en astreignant toutes les génératrices aux mêmes moyens, aux mêmes dangers, aux mêmes devoirs.
Cette dame ne pensait pas ainsi. Rentrée chez elle, elle raconta probablement, en présence de son fils, ce qu’elle venait d’entendre, en y ajoutant des réflexions dont je devais bientôt recevoir le contrecoup.
L’établissement était immense, tel qu’il devait être pour contenir environ deux cent cinquante élèves pensionnaires. Il se divisait en deux parties, le petit et le grand collège : dans le premier, les élèves depuis les classes élémentaires jusqu’à la cinquième inclusivement ; dans le second, depuis la quatrième jusqu’à la rhétorique, la philosophie, les mathématiques spéciales, les Humanités enfin. Les deux collèges occupaient chacun un bâtiment différent, et, séparés par des balustrades, n’avaient ensemble aucun rapport ostensible. Ils avaient même leur sortie particulière sur deux rues parallèles.
Dans le grand quartier, quelques élèves de mérite se groupaient autour de M. Frémin et formaient un noyau de travail, d’émulation et de succès qui maintenait la pension dans sa bonne réputation d’autrefois. M. Frémin se donnait absolument à ces jeunes gens, abandonnant aux professeurs subalternes ceux qui ne valaient pas la peine qu’on s’occupât d’eux et qui, entre les mains de son associé, purement homme d’affaires, représentaient le côté lucratif de l’entreprise.
Ce qui se passait parmi ces derniers n’est pas chose croyable. Les mauvais livres, l’ostentation du vice et de l’impiété, provoquée peut-être par les trop grandes exigences cléricales du temps, la mollesse et l’oisiveté, le libertinage précoce, tels étaient les vices courants de cette véritable république. Pendant les récréations, les petits regardaient curieusement, à travers les barrières qui les séparaient des grands, les héros des scandales presque quotidiens dont les récits arrivaient quelquefois jusqu’à eux. Ils se les montraient avec admiration.
Ces, messieurs, fiers de leur renommée, se livraient avec un orgueil bien légitime aux regards de cette menue foule, se dandinant, tirant leurs moustaches timides, affectant toutes les allures propres à pervertir de jeunes et faibles imaginations.
Le mal s’étendait donc peu à peu et devait à la longue gangrener les plus innocents. Si j’y échappai, moi, ce fut par des circonstances exceptionnelles, que je bénis puisqu’elles m’ont détourné du vice, qui eût été un plus grand malheur pour moi.
M. Frémin m’avait laissé, je vous l’ai dit, au milieu de mes nouveaux camarades, après m’avoir recommandé particulièrement à notre professeur, à qui je demandai si le fils de madame d’Anglepierre était déjà rentré ; il me dit que non, et que très probablement cet élève ne rentrerait que le lendemain. J’allai donc m’asseoir sur un banc et j’attendis.
Vous devinez quels regards je fixais sur cette grande porte refermée tout à coup entre ma mère et moi. Ma pauvre chère mère ! je la suivais en esprit dans la rue. Je la voyais, son mouchoir sur les yeux pour dérober ses larmes aux étrangers, rentrant chez elle d’un pas rapide, et, une fois rentrée, s’abandonnant à son émotion, essuyant ensuite ses yeux avec ce courage dont elle m’avait donné tant de preuves, reprenant son travail quotidien et répondant amicalement aux questions que les ouvrières ne pouvaient manquer de lui adresser. Tous les objets familiers de mon enfance repassaient devant mes yeux comme des amis ; je me sentis près de fondre en larmes ; mais il ne fallait pas pleurer là.
Alors, je regardai autour de moi pour essayer de me faire à ma vie nouvelle. Chacun de ces enfants avait pris ou repris les habitudes de la communauté. Ils se promenaient par groupes, ils sautaient à la corde, ils jouaient à la balle, ils se montraient les présents reçus pendant les vacances, ils se racontaient ce qu’ils avaient fait depuis six semaines, ils riaient, ils se partageaient des friandises.
Moi aussi, j’avais dans mon panier ma petite provision de gâteaux et de jouets. J’aurais voulu partager les uns et utiliser les autres. Je n’osais pas. À qui m’adresser dans cette cohue ? Personne ne faisait attention à moi. Si la porte eût été ouverte, je me serais sauvé certainement.
Au fait, pourquoi étais-je là ? J’étais si heureux encore une heure auparavant ! Qu’allais-je donc apprendre qui dût me faire oublier ma mère ?
La tristesse allait bien certainement me vaincre lorsqu’un de ces enfants, qui avait été causer avec tous ses camarades les uns après les autres, vint se camper devant moi et me regarder sans rien dire.
Planté sur ses jambes écartées, ses deux mains dans ses poches, par un mouvement de tête fréquent et gracieux, il rejetait en arrière ses cheveux longs, épais, très blonds, souples comme des fils de soie et qui tendaient toujours à retomber sur son front. Je regardai cet enfant comme il me regardait, et, d’ailleurs, sa figure me paraissait assez remarquable. Très pâle, d’une pâleur crayeuse, il avait les yeux bleu clair, bleu de Chine, avec des cils et des sourcils châtains. Ces yeux mobiles, et qui avaient toujours l’air de chercher une pensée nouvelle, étaient entourés d’un cercle de nacre auquel chaque évolution de leurs globes imprimait une légère palpitation, semblable à ces éclairs sans bruit et sans foudre qui entrouvrent un moment les ciels d’été. Une jolie bouche, bien que les lèvres fussent d’un ton maladif et qu’il les mordît sans cesse jusqu’à y faire venir le sang, des dents petites comme des dents de chat, un nez droit, aux narines un peu relevées, complétaient ce visage vraiment féminin.
De temps en temps, il sortait une main de sa poche et se mâchonnait les ongles. C’était dommage, car ses mains étaient blanches, sans os apparents, à fossettes, et je n’en vis jamais de pareilles à un aussi jeune garçon.
– Qu’est-ce que tu fais là ? me dit-il d’une voix légèrement voilée, coupée d’une petite toux nerveuse.
– Rien.
– Tu es un nouveau ?
– Oui, et toi ?
– Moi, je suis un ancien. De quel pays es-tu ?
– De Paris. Et toi ?
– Moi, je suis de Boston.
– Où est-ce ?
– En Amérique. Comment t’appelles-tu ?
– Pierre Clémenceau. Et toi ?
– André Minati. Qu’est-ce que fait ton père ?
– Je n’en ai pas.
– Il est mort ?
Je ne répondis rien ; il prit probablement mon silence pour une affirmation.
– Et ta mère, qu’est-ce qu’elle fait ?
– Elle est lingère.
– Lingère ? Elle fait des chemises ?
– Et d’autres choses encore, répondis-je naïvement. Et la tienne ?
– La mienne, elle ne fait rien. Elle est riche, et mon père aussi. Il voyage pour son plaisir.
– Quel âge as-tu ?
– Douze ans. Et toi ?
– Dix.
– Dans quelle classe es-tu ?
– Dans la classe de ce monsieur qui se promène.
– Moi aussi.
– Cependant tu es plus âgé que moi.
– Mais je suis en retard parce que je suis étranger. Qu’est-ce que tu as là dans ton panier ?
– Des gâteaux. En veux-tu ?
– Voyons tes gâteaux.
J’ouvris mon panier sur mes genoux ; André plongea sa main dedans, la retira pleine, et mordit à belle bouche dans ce qu’il avait pris.
– Ils sont bons, tes gâteaux ; pourquoi n’en manges-tu pas ?
– Je n’ai pas faim.
– Qu’est-ce que ça fait ?
Et, revenant à la charge, il en eut bien vite fini avec mes provisions.
– C’est tout ce que tu as ?
– Oui.
– Bonjour. Je te trouve un peu bête.
Tournant alors sur ses talons, il me laissa tout étourdi de cette entrée en matière, et, prenant son élan, il courut vers un autre enfant qui ne pouvait le voir, lui sauta sur le dos sans le prévenir, et tous deux roulèrent dans le sable ; mais l’autre seul s’était fait mal. À chaque instant, il recommençait une plaisanterie du même genre, ayant soin de s’adresser toujours à de moins forts que lui.
Le maître d’étude ne voyait rien ou paraissait ne rien voir. Il se promenait de long en large, les mains derrière le dos et songeait ; à quoi ? À sa dure destinée sans doute, que les vacances avaient interrompue et qui se renouait encore une fois à ses anneaux de fer.
Cependant, comme André était le seul enfant qui m’eût parlé, je le suivais machinalement des yeux. D’abord, j’avais mes gâteaux sur le cœur, et puis je le trouvais étrange. Je le vis donc quitter peu à peu ses camarades, et, après s’être retourné deux ou trois fois pour s’assurer qu’on ne le remarquait pas, se diriger vers la balustrade qui nous séparait du grand collège et regarder dans l’autre cour. Sans doute il découvrit ce qu’il cherchait, car il fit un signe ; et, tournant le dos à la barrière, il s’y appuya, passa sa main derrière lui, et reçut, d’un grand garçon de dix-huit ans, un billet qu’il cacha dans sa poche ; après quoi, il se perdit de nouveau dans le mouvement général.
Quelques minutes après, nous nous rendions à la messe du Saint-Esprit, qu’un prêtre disait dans la chapelle même de la pension, et, de là, nous gagnions les salles d’étude. Celle où je pris place était très vaste. Une chaire en occupait le fond et une douzaine de tables à pupitres, de dix élèves chacune, disposées les unes devant les autres, en occupaient le milieu.
Par suite de la recommandation de M. Frémin, j’étais le premier, à la gauche du professeur, sur le premier banc, et mon Américain se trouvait à côté de moi. J’aurais préféré un autre voisinage ; car, après ce que ma mère m’avait dit, et les promesses qu’elle avait reçues de moi, je comptais ne pas perdre une minute, même la première, et je me disposais à absorber par tous les pores cette science si utile, que l’on me séparait, en son nom, de tout ce qui m’était cher. J’ouvrais donc les yeux, les oreilles et même la bouche, à la voix du maître qui nous en exposait les principes.
Cela ne faisait pas l’affaire de mon voisin. Il commença par lire son petit billet écrit au crayon, en ayant l’air de lire dans son livre, puis il le mâcha et l’avala, puis il me poussa le genou pour me montrer je ne sais quoi dans son pupitre ; mais, voyant mon indifférence, il se tourna vers son autre voisin ; puis il revint à moi, me parlant bas, m’accablant de questions auxquelles je ne comprenais et ne répondais rien, ce qui le détermina à me jeter de l’encre sur ma veste.
Oh ! quand je le vis abîmer ainsi ma veste neuve qui coûtait de l’argent à ma mère, je lui enjoignis assez haut de cesser. En somme, je savais aussi bien que lui ce que c’était que de donner un coup de poing ; j’en avais reçu et donné, dans mon école, et je n’étais pas disposé à me laisser malmener comme les enfants auxquels il s’était adressé pendant la récréation.
Mes procédés parurent l’étonner un peu. Il me dit tout bas que j’aurais affaire à lui après la classe.
À peine étions-nous dans la cour, que, accompagné de deux ou trois de nos camarades, il s’approcha de moi, et, me mettant son poing sous le nez, m’appela marchand de chemises, me demanda ce que j’avais voulu lui dire, et me défendit de lui adresser jamais la parole. Je lui tournai le dos sans lui répondre. Il attribua cette retraite à la peur, et m’envoya une bourrade qui faillit me jeter par terre. Alors, je me retournai, et, avant qu’il pût arriver à la parade, sans savoir moi-même ce que je faisais, je lui appliquai un tel coup de poing sur sa pâle figure, que le sang coula.
Effrayé de mon action, je m’approchais pour le secourir, quand il me donna, de toute sa force, un coup de pied dans la jambe. La douleur me fit perdre la tête et je tombai sur le malheureux à bras raccourcis. Je l’eus bien vite terrassé ; je lui posai le genou sur la poitrine, et, si on ne me l’eût pas arraché des mains, je l’étranglais certainement.
Pendant quelques minutes je fus haletant, avide de luttes nouvelles, vibrant dans tout mon corps. On nous interrogea. Je racontai nettement la vérité, depuis l’histoire des gâteaux jusqu’à la provocation. J’avais été le plus fort ; la plupart de ceux qui avaient à se plaindre d’André et qui n’avaient jamais osé lui répondre passèrent hardiment de mon côté, et, dans leur rapport, le chargèrent tant qu’ils purent ; d’autres s’éloignèrent, ne voulant pas se compromettre en cas de représailles ; quelques-uns l’entourèrent en ayant l’air de le plaindre, mais en riant sournoisement ensemble.
J’eus ainsi, dès mon premier jour de contact direct avec les hommes, le spectacle de la lâcheté individuelle et de la lâcheté collective. Mes expériences ne devaient malheureusement pas s’arrêter là.
On conduisit le blessé à la fontaine ; on lui lava la figure. Il ne disait rien ; mais il était aisé de voir, à sa pâleur plus grande et à ses regards obliques, qu’il ne me pardonnerait jamais.
Le fils de madame d’Anglepierre ne revint que le soir de chez ses parents, lorsque nous étions couchés. Je vous fais grâce des idées noires qui précédèrent mon sommeil dans mon nouveau lit. Le lendemain matin, je connus le jeune vicomte. Il me fut à l’instant aussi antipathique, plus antipathique peut-être que Minati.
Figurez-vous un petit homme de dix ans, déjà officiel dans toute sa petite personne. Coiffé à l’oiseau royal, avec deux larges mèches collées sur les tempes, il affectait des airs sérieux qu’il imitait évidemment de monsieur son père, dont il était une réduction des plus ridicules et des plus comiques. Ce jeune noble répandait autour de lui l’odeur de sa noblesse toute neuve. On la voyait positivement reluire au soleil. Très soigné dans sa mise, serré dans son col comme un préfet en tournée, la tête droite, il poussait la solennité jusqu’à la sentence, et la morgue jusqu’au mépris. En le voyant, on recomposait aisément toute sa famille ; on devinait de quel sot personnage il avait eu l’honneur de sortir et on ne doutait plus de la carrière qu’il embrasserait : la haute administration.
C’était une des mille nullités en herbe sur lesquelles la Restauration comptait pour l’avenir. Je l’ai rencontré, depuis cette époque. Il servait le gouvernement de Juillet auquel il s’était rallié, ainsi que M. le comte son père, et je lui ai retrouvé le visage, la voix et le maintien que je lui avais connus, à l’âge de dix ans.
Une fois posées sur une cravate, ces têtes-là ne bougent plus. La cravate est invariablement noire ou blanche, la tête reste la même. La coiffure a pris un certain pli, l’œil un certain regard, la bouche une certaine ligne. En voilà pour quatre-vingts ans. La barbe est rasée de si près et si souvent, qu’elle finit par ne plus oser pousser. Ces hommes-là en arrivent tout de suite à convaincre la société qu’ils lui sont indispensables. Il y a d’honnêtes mères qui élèvent saintement leurs filles pour la faveur de leur couche, comme dirait Arnolphe. Ils ont ordinairement deux enfants à la suite de leur mariage, un garçon et une fille. Ils sont devenus pères sans oublier le décorum, sans ôter leur croix de la Légion d’honneur, qui leur tombe à la boutonnière vers vingt-cinq ou trente ans, et dont le ruban ne bronche plus jusqu’à ce qu’ils changent de grade. Ils passent par les trois premiers degrés de l’ordre et meurent commandeurs. On célèbre alors leurs vertus, leurs services, leurs talents, devant un mausolée de famille, et ils disparaissent après avoir touché à tout, sans rien laisser derrière eux, ni une œuvre, ni une idée, ni un mot. On se demande comment ils ont pu tenir tant de place, et si longtemps, dans une civilisation qui a besoin de mouvement, d’initiative et de progrès, et, au moment où l’on s’en étonne le plus, on aperçoit messieurs leurs fils qui les recommencent et les continuent.
Ces individus composent cette force imposante contre laquelle le génie lutte en vain depuis la constitution de la première société, et qu’on retrouve honorée et triomphante dans toutes les classes, dans la Noblesse, dans la Bourgeoisie, dans la Science, dans les Arts, dans l’Armée ; association invincible et indissoluble, qui reconnaît et glorifie les siens partout, sans distinction de rangs ni de castes ; communauté formidable qui se lègue de famille en famille et de génération en génération, comme des cartes perpétuelles de circulation à travers l’ignorance humaine, une morale, des idées et des phrases toutes faites appropriées à tous les sujets ; qui veille pompeusement et dogmatiquement sur l’arche sainte de la routine, et qu’on nomme enfin : la Médiocrité.
Mon nouveau camarade, qui devait encore ajouter à cette race, avait déjà de l’ascendant sur les condisciples de son âge et même sur de plus âgés que lui, tant la confiance en soi peut imposer aux autres, lorsqu’elle est sincère et imméritée.
Il me suffisait de voir le jeune vicomte pour n’avoir nulle envie de l’aborder ; mais, puisque ma mère désirait que je le connusse, et que j’étais déjà en bons termes avec la plupart de mes camarades, depuis ma victoire de la veille, j’allai à lui et je me nommai en faisant tout simplement appel aux relations de nos deux familles.
– J’ai mes amis, me répondit-il d’un ton sec, presque sans me regarder, et je n’en veux pas avoir d’autres. On n’a d’amis que parmi ses égaux.
Évidemment ce petit sot répétait une phrase qu’il avait entendu dire. Je ne lui en demandai pas davantage, mais je ne m’expliquais guère ce que je voyais et entendais depuis vingt-quatre heures.
Ma mère arriva sur ces entrefaites. Je lui racontai mes impressions. Afin de ne pas l’inquiéter, je lui tus ma bataille. Elle devina tout de suite la conduite de madame d’Anglepierre, et me conseilla naturellement de ne plus m’occuper de son fils, ajoutant :
– Si tu as à souffrir de quoi que ce soit ici, mon enfant, dis-le-moi, je te mettrai dans une autre pension.
En somme, il ne m’était encore arrivé que ce qui aurait pu arriver à tout autre.
Ce qui ne devait arriver qu’à, moi se préparait.
Pour m’épargner de nouveaux conflits avec André, on l’avait changé de place à l’étude. J’avais un autre voisin, doux comme miel, attentif, méthodique, soigneux. Il répétait les leçons sans sourciller, et récitait, matin et soir, à haute voix, entre deux beaux signes de croix aussi larges que lui, la prière que le reste de la classe murmurait entre les dents. Si, par hasard, il m’adressait la parole, c’était toujours pour choses indispensables ayant rapport au travail commun.
Bernavoix gagna bien vite ma confiance en me parlant de ses parents peu aisés, compatriotes de l’associé de M. Frémin, et ayant obtenu ainsi, à la condition du labeur assidu de l’élève, un grand rabais sur le prix de la pension. Puis, il m’entretint de sa première enfance, qui s’était écoulée à la campagne, de son père, de sa mère, qu’il avait perdue.
Questionné à mon tour, je me livrai sans réserve. Pourquoi me serais-je défié ? Je lui racontai, tout ce que je savais de moi-même et de maman, jusqu’aux paroles qu’elle m’avait dites au sujet de ma naissance.
Comme son père, régisseur dans son pays, ne pouvait le faire sortir qu’aux vacances, je lui promis de l’emmener de temps en temps avec moi, le dimanche. Nous irions nous promener, et puis il viendrait dîner chez nous. Notre maison était fort simple, mais c’était toujours moins triste que la solitude des maisons d’éducation, durant les jours de fête.
Nous voilà donc amis et passant la plupart de nos récréations ensemble, soit à jouer, soit à causer, soit à lire.
En effet, le dimanche suivant, ma mère vint me chercher et nous emmena tous les deux. Elle nous fit monter dans une de ces petites diligences qui desservaient la banlieue et nous conduisit à Saint-Cloud. Nous déjeunâmes là, en plein air, dans un modeste restaurant, et nous revînmes tous les trois, à pied, dîner à Paris, rue de la Grange-Batelière.
Mon ami paraissait enchanté, et moi, je me promettais de recommencer souvent cette petite fête. J’avais rapporté un bon bulletin de ma première semaine. Avec les visites fréquentes de maman, cette sortie hebdomadaire, le plaisir de m’instruire, et un ami comme Bernavoix, il me serait possible, à mon âge, de m’acclimater à la pension. J’y rentrai donc plein de courage et presque gaiement.
André ne me parlait plus ; Fernand ne me parlait pas. C’étaient les seuls de mes camarades avec lesquels je ne fusse pas en bons rapports. Un lundi, m’étant approché de l’un de ceux avec qui je jouais d’habitude, je le vis, avant que je lui eusse adressé la parole, se sauver en criant :
– Quarantaine !
Je crus à une plaisanterie, et je m’approchai d’un autre. Même manœuvre. Ainsi d’un troisième, et, de tous ceux qui me voyaient venir dans leur direction, Bernavoix seul ne se sauva pas à mon approche. Je lui demandai en riant l’explication du fait. Il prit alors un air sérieux et m’annonça que ce n’était pas risible ; on m’avait condamné.
Condamné ! Quarantaine ! Qu’est-ce que ces mots signifiaient ? Il m’apprit cette coutume, empruntée par les écoliers aux lois de la marine, qui consiste à n’avoir aucune communication ni directe ni indirecte, pendant quarante jours, avec un camarade à qui l’on a quelque chose à reprocher. Dans le principe, la quarantaine ne pouvait être prononcée et appliquée qu’après un délit grave, comme la délation, ou le vol, ou la tricherie ; mais, depuis, elle était devenue plus arbitraire et dépendait un peu de la fantaisie des plus forts et des rancunes personnelles. Quelques enfants en décrétaient un autre en quarantaine ; ils prévenaient le reste du collège de la détermination prise, et elle avait force de loi.
Mon Américain avait ruminé cette vengeance, pour laquelle il avait flairé un auxiliaire dans Fernand, dont la conduite à mon égard ne lui avait pas échappé. Il l’avait interrogé sur la cause de cette conduite. Celui-ci avait répété tout ce qu’il avait entendu dire chez lui ; on m’avait donc jeté hors de la communauté, parce que je n’avais pas de père, et qu’aux yeux de ces enfants c’était quelque chose d’équivalent à la peste ou au scorbut. Ainsi la prédiction de ma mère allait se réaliser ; mais la chère femme n’aurait jamais pensé qu’elle se réalisât si tôt, et par le verdict d’aussi jeunes cœurs.
Sans me rendre compte immédiatement de cette étrange condamnation, je dis à mon ami que je ne voulais pas le brouiller avec ses camarades, et qu’il était libre de ne plus me parler. Il parut hésiter un peu, il baissa les yeux, tourna son mouchoir dans ses mains ; bref, le bon sentiment l’emporta. Il me répondit que cela lui était égal, et que, du reste, il ferait son possible pour qu’on diminuât la peine, comme il arrivait souvent, lorsque le patient demandait pardon.
À ce mot, mon sang se révolta. Je n’avais rien fait pour encourir le mépris, je ne ferais rien pour reconquérir l’estime. Mes condisciples ne voulaient pas me parler pendant quarante jours : soit. Nous nous passerions bien les uns des autres pendant ce temps.
– Mais je dois te prévenir, me dit Bernavoix, que, lorsque le condamné veut lutter, on double, on triple son temps, et que cela peut durer une année entière.
– Va pour un an.
– Mais on ne se contente plus de ne pas parler au condamné.
– Qu’est-ce qu’on lui fait ?
– Toute sorte de choses.
– Lesquelles ?
– Tu verras, car je crois qu’ils veulent te les faire.
– Eh bien, je verrai.
Ce que Bernavoix ne me disait pas, c’est que lui-même avait donné les renseignements sur moi, sur notre intérieur ; que sa bonne foi avait été surprise, volontairement peut-être, qu’il avait raconté tout ce que je lui avais confié et qu’il avait empoisonné les armes dont ces petits misérables allaient se servir contre moi pour varier un peu la monotonie de leurs jeux.
Donc, voilà que l’un se croyait en droit de me reprocher ma pauvreté, parce qu’il était riche : l’autre, le travail de ma mère, parce que la sienne était oisive ; celui-ci, ma qualité de fils d’artisane, parce qu’il était fils de noble ; celui-là, de n’avoir pas de père, parce qu’il en avait deux – peut-être. Pas un de ces enfants à qui ses parents eussent commandé la charité envers son semblable. Au contraire, à l’un d’eux, sa mère m’avait désigné comme un être malfaisant. Ainsi les préjugés qui, dans le monde, ont peut-être leurs raisons ou leur excuse dans l’antagonisme des intérêts ou des passions, se faisaient jour sans raison, sans excuse, bruts et difformes, parmi des enfants dont l’aîné n’avait pas atteint sa quatorzième année, et les premiers sentiments que je devais découvrir chez les hommes, dans l’âge soi-disant d’innocence et d’expansion, étaient l’injustice et la cruauté. Soit. Je me promis tout bas de me faire plutôt écharper que de ne pas repousser toutes les attaques comme j’avais repoussé la première. N’importe, il est dur, à dix ans, d’avoir déjà besoin de se défendre !
Je me mis à étudier avec soin. Je passais mes récréations à causer avec le maître, qui me prenait en amitié, sans avoir le courage de me prendre sous sa protection effective, bien qu’il vît de quelle conspiration j’étais la victime. Ce pauvre homme n’avait que ses modiques fonctions pour vivre, et il savait que, si les élèves décidaient de lui faire perdre sa place, ils y arriveraient pour lui comme ils y étaient arrivés pour d’autres. De là une condescendance muette, un encouragement tacite à bien des désordres.
Il ne pouvait donc rien pour moi que m’aimer plus qu’il n’aimait les autres, me plaindre et s’occuper spécialement de mon travail.
Il le fit ; je lui en ai conservé la reconnaissance qu’il méritait. Il est devenu fort misérable plus tard. Il buvait pour s’étourdir. Je lui ai donné quelques secours, et c’est moi qui l’ai fait enterrer, il y a cinq ou six ans.
Notre cour était spacieuse. Lors de la fondation de l’établissement, M. Frémin avait réservé une partie de cette cour, un quart, à peu près, pour des petits jardins particuliers, qui seraient cultivés par les élèves et où ils étudieraient ainsi la nature face à face, au lieu de ne la voir qu’à travers la sécheresse des livres autorisés.
Cette coutume utile avait disparu comme les autres du même genre, et les jeux bruyants avaient envahi le territoire de ces tranquilles récréations. Cependant, il restait un petit coin où il était possible de rétablir un jardin de quelques pieds carrés. La terre en était encore bonne. Mon maître me conseilla de demander ce terrain et de le cultiver. Je l’obtins facilement de M. Frémin, qui aurait été heureux de voir renaître le goût des plaisirs simples et instructifs. Il me fit donner un râteau, une pelle, une bêche, les tiges qu’on pouvait planter en automne, et je commençai mon nouveau travail sur les indications du concierge, qui avait été le jardinier des fondateurs.
Je vous laisse à penser si cette façon d’accepter la quarantaine exaspéra mes ennemis. Ils n’entendaient pas ça du tout, et de l’indifférence et du mépris ils passèrent à l’offensive.
Ils se seraient lassés peut-être plus tôt que moi, si André n’avait entretenu cette animosité. Où prenait-il le courage nécessaire pour me persécuter ainsi ? Dans l’humiliation que lui avait causée sa défaite, dans la conscience de son tort, dans sa nature déjà viciée, dans son sang américain, peut-être dans le souvenir des tortures qu’il avait vu infliger par son père à des hommes d’une autre couleur que lui ?
On commença par attaquer mon sommeil. La nuit, on me jetait n’importe quoi sur la tête, et on me réveillait en sursaut ; ou bien, lorsque je venais me coucher, je trouvais mes draps tout humides. À qui m’en prendre ? Je sentais le coup sans voir la main. Me plaindre ? La dénonciation répugnait à ma fierté. Je me tus.
Au réfectoire, on finit par me reléguer au bout de la table sous différents prétextes. Les élèves se servaient eux-mêmes, c’était l’habitude. Ils ne me passaient les plats que lorsqu’il n’y avait plus rien ou presque plus rien dedans. Je réclamais auprès du domestique, car j’avais faim ; mais, souvent, on avait dit les Grâces avant que cet homme eût répondu à ma réclamation ; et, d’ailleurs, il encourageait le complot moyennant quelques gratifications prélevées sur les semaines. Je déjeunais ou je dînais donc parfois d’un morceau de pain et d’un verre d’eau. Il va sans dire que, pendant que j’étais occupé de mon petit jardin, on y lançait des pierres, et qu’en revenant, le lundi, je trouvais tout bouleversé par ceux qui, retenus le dimanche, avaient reçu de leurs camarades la mission de continuer la guerre, même en mon absence.
J’aurais pu quitter la pension ; mais je me figurais qu’il devait en être de même dans les autres, et puis je ne voulais rien faire perdre à ma mère, qui avait payé mon trimestre d’avance. La guerre ne cessait plus, me harcelant dès le réveil et ne m’épargnant pas la nuit. Je ne m’endormais et ne m’éveillais qu’avec effroi. J’étais toujours sur le qui-vive. Mon caractère et ma santé s’altéraient. Je devenais ombrageux, inquiet, haineux. J’éprouvais le besoin de la vengeance, de celle qui convient, après tout, aux faibles et aux opprimés, de la vengeance occulte et basse. Allait-on me rendre lâche ? En tout cas, je souffrais assez, déjà, pour vouloir faire du mal à tous ces enfants ; mais comment m’y prendre ? Les combattre en face était impossible, et, du reste, ce n’était pas ainsi qu’ils m’attaquaient. J’en eusse provoqué un ou deux, que tous les autres se fussent rangés de leur bord. Si, par hasard, la nuit s’était bien passée, je reprenais un peu de courage et me disposais à tout oublier ; mais cette trêve ne durait pas longtemps, et je la devais plus à la fatigue ou à la négligence de mes ennemis qu’à leur repentir ou à leur pardon. Pardon de quoi ? je vous le demande.
J’arrivais à vivre comme un coupable. J’avais des palpitations de cœur qui m’étouffaient. Lorsque la mesure était comble, je m’en allais pleurer dans un coin, n’importe où, pourvu que ceux qui faisaient couler mes larmes ne pussent ni les voir ni s’en réjouir.
Cependant tous n’étaient pas aussi acharnés contre moi. Il y en avait même qui paraissaient ignorer à quelles tribulations j’étais en butte ; mais la plupart, sans complicité active, laissaient faire, comme on laisse tout faire ici-bas, par indifférence ou paresse. Si les barres ou le saut de mouton ennuyaient, il suffisait que le premier venu eût l’idée de dire : « Et le Clémenceau, on n’en joue donc plus ? » pour que l’on recommençât les attaques ; c’était alors à qui en inventerait une bonne.
Enfin, un soir, ne sachant plus qu’imaginer, comme j’étais resté en arrière pour ranger mes livres et fermer mon pupitre dont on forçait le cadenas presque tous les jours, ils trouvèrent le moyen d’éteindre la lampe de l’escalier et de barrer le passage avec une corde. Je fis une chute de plusieurs marches, la tête en avant. Je faillis me tuer. Cette fois, je criai, tant la douleur était vive, et le professeur, voyant la tournure que prenaient les choses, se décida à prévenir M. Frémin. Celui-ci vint, le lendemain, dans la salle, après la prière, et fulmina une remontrance énergique, accompagnée d’une menace de retenue générale et d’exclusions partielles. Il me demanda, tout haut, les noms de ceux dont j’avais particulièrement à me plaindre, et me permit de déterminer la punition à leur infliger. Je ne voulus nommer personne. Ce refus lui servit de texte pour rendre témoignage de ma générosité. Il m’autorisa à me faire justice moi-même, n’importe par quels moyens, si de pareilles scènes se renouvelaient et que je ne voulusse point en appeler à lui.
Cet excellent homme était véritablement ému. Moi, je pleurais, mais au fond j’étais heureux, pensant que tout était terminé. J’eus, en effet, quelque répit. On me laissait manger, dormir, travailler, cultiver mon jardin. Je n’en demandais pas davantage.
Un matin, je bêchais de mon mieux mon petit domaine, lorsqu’un nom de baptême, qui m’était bien connu et bien cher, frappa mon oreille à plusieurs reprises. J’écoutai, sans paraître y prendre garde et tout en continuant ma besogne, la conversation de deux de mes camarades, dont l’un était André. Il s’agissait d’une histoire dont l’héroïne avait nom Félicité. Or, Félicité était le nom de baptême de ma mère, et le narrateur affectait de le prononcer très haut, chaque fois que sa promenade le ramenait dans mon voisinage, et d’appuyer dessus avec quelque épithète bizarre dont je ne comprenais pas la signification ; mais cette signification devait être outrageante ou ironique, car l’autre ne manquait pas de pousser des exclamations d’étonnement ou des éclats de rire exagérés. L’histoire roulait, d’après ce que j’en pouvais saisir, sur un sujet amoureux. Ils conclurent en disant qu’on pourrait l’intituler : la Félicité de l’amour. Du reste, mon nom à moi n’avait pas été prononcé, et je n’avais surpris nulle allusion directe, pas même un regard dirigé de mon côté. Ces deux enfants avaient bien l’air de causer entre eux et pour eux seuls. Je rentrai dans la classe, espérant encore que le hasard avait produit une similitude de noms.
Il y avait à peu près une demi-heure que nous nous étions remis au travail, lorsqu’un des élèves interpella le professeur pour lui demander un renseignement. Ces interpellations étaient fréquentes, et souvent on s’en faisait un jeu.
– Monsieur, quel était le surnom du beau Dunois ?
– Le bâtard d’Orléans.
– Qu’est-ce qu’un bâtard ?
– C’est…
Le professeur s’arrêta devant l’explication à donner, comme si elle eût dû le mener trop loin.
– C’est un enfant qui n’a pas de père, riposta un second interlocuteur, jaloux de se montrer aussi courageux que le premier.
À ce mot, je dressai la tête ; je flairai de nouveau l’ennemi. D’ailleurs, tous les regards étaient tournés, en dessous, vers moi, comme pour ne pas me laisser le moindre doute. Mais je ne comprenais pas encore.
Je n’avais pas de père, je le savais bien et m’en cachais d’autant moins que personne ne m’avait dit de m’en cacher. Ma mère avait suffi jusqu’alors à toutes les exigences de mon cœur, ce père ne me manquait donc pas encore. On appelait « bâtard » un enfant dans ma situation ; soit, j’étais un bâtard, c’était une dénomination comme une autre. Il en faut une pour chaque sujet et je ne trouvais rien d’extraordinaire à celle-là. D’ailleurs, je n’étais pas le seul à qui elle pût s’appliquer, puisque le héros d’Orléans l’avait portée fièrement. Si l’incident en fût resté là, j’eusse répondu très simplement à qui m’eût questionné sur ma famille : « Je suis un bâtard. » Mais tel n’était pas le but de mes camarades, et ils tenaient à m’initier à toutes les valeurs du mot.
– Comment peut-on ne pas avoir de père ? demanda le questionneur.
– Tais-toi donc, animal ! cria un troisième du nom de Constantin Ritz, avec l’accent du dégoût et de la menace.
Ce fut la première preuve de sympathie que je reçus dans cette maison. On se tut.
Je le regrettai presque, car, au fait, comment cela se faisait-il ? Je me le demandai à moi-même. Alors, ô pure naïveté de l’enfance ! j’ouvris mon dictionnaire et je cherchai : bâtard, « né hors du mariage. » Qu’est-ce que cela signifiait ? Je cherchai mariage : « union légale de l’homme et de la femme par le lien conjugal. » Durant toute la classe, je retournai ces deux explications dans ma tête. J’avais beau les presser entre mes dents, je n’en faisais rien sortir. Elles restaient toujours énigmatiques.
Qu’est-ce que c’était que naître ? Comment naissait-on ? Tous ceux qui m’entouraient étaient-ils nés autrement que moi ? Certainement, puisqu’ils me reprochaient de ne pas être né comme eux. Pourtant nous étions conformés de la même manière. J’étais même plus fort, plus intelligent, meilleur que beaucoup de mes camarades ; mais ils avaient un père qui venait les voir, dont ils parlaient ou qu’ils avaient connu, s’ils ne l’avaient plus ; tandis que, moi, je n’en avais pas. Là était la différence ; mais cette différence était un malheur, non un crime !
À partir de ce jour, je fus surnommé le beau Dunois, et ce nom, accolé à celui de Félicité, servit de texte aux plaisanteries les plus injurieuses.