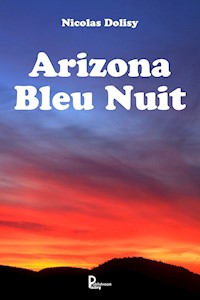
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Vous êtes-vous jamais imaginé(e) découvrir la vérité sur une des énigmes les plus troublantes de l’histoire ?
Le narrateur, Nick, un Français d’une vingtaine d’années, intègre une université américaine dans le cadre de ses études. À la suite de l’acquisition d’une mystérieuse guitare, il plaque un quotidien confortable et décide de jouer quitte ou double en acceptant de se lancer dans un road trip effréné à travers les Etats-Unis. Qu’est-il véritablement arrivé au célèbre bluesman Robert Johnson, le premier artiste du « club des 27 » ? Nick entend bien le découvrir, mais ce périple envoûtant et périlleux va littéralement ébranler son destin. Chaque étape, chaque découverte, exclut un peu plus toute possibilité d’un retour en arrière et finit par brouiller la frontière entre rêve et réalité.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Nicolas Dolisy enseigne l’anglais depuis 2007. Il a passé une année aux États-Unis, à l’Université d’Illinois en 2005/2006.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nicolas Dolisy
Arizona BleuNuit
« Il n’y a pas de coïncidences, l’usage de ce mot est l’apanage des ignorants. »
– Paul Auster
CHAPITRE 1 Monterey, Californie.
Je me revois assis sur un bout de rocher, le regard perdu dans l’immensité bleu nuit de l’Océan Pacifique. J’ai tant aimé l’Amérique. Du Midwest à Monterey où je vagabondais ce jour-là. Les voitures vont et viennent et les mouettes se meurent, au bout de vingt-cinq ans, épuisées d’une existence dont elles ont ignoré le sens, dont elles n’ont d’ailleurs aucune conscience. Au loin, un bateau naviguait vers le sud, et je l’enviais déjà de longer les rochers noirs de Big Sur. Je me disais que s’ils ne me rattrapaient pas d’ici au lendemain, j’aurais filé le long de Cabrillo Highway et Highway 1 pour respirer ce mélange d’iode océanique et de forêts de pins que Kerouac avait connu en son temps. En attendant, je restais là à contempler le monde. Un coucher de soleil majestueux s’annonçait, et le jaune du soleil se muait en un orange californien qui inondait la plage. Un spectacle offert par un monde généreux qui ne manque pourtant pas de vous rappeler à votre humble condition humaine. J’ai découvert, bien malgré moi, le prix de chaque chose et ce qui se dissimule insidieusement derrière chaque individu. Quand la relation de confiance, l’amour, et l’abandon de soi apparaissent comme des idéaux dans lesquels plonger, le prosaïsme nous enseigne que les lois qui régissent le lien à autrui se basent inexorablement sur du rapport de force, de ce que l’un convoite chez l’autre, et ce qu’il est prêt à sacrifier pour l’obtenir. Ce pessimisme en l’être humain était peut-être la résultante d’une fatigue extrême de l’instant et d’un désarroi incommensurable instillé à petites gouttes tout au long de mon aventure, jusqu’à ma chute finale que je sentais approcher en ces heures. En attendant, je me consolais en me reposant dans ma solitude et en me repaissant de la vision d’Eden de ces troublantes nuances de rose et de violet accompagnant la course du soleil dans le Pacifique, qui n’avait jamais aussi bien porté son nom que ce soir-là. La brise chaude de ce début juillet m’enivrait au point que je me serais presque passé du peu de bourbon qui me restait.
J’ignorais si mon périple s’arrêterait au petit matin, ou bien le lendemain soir. Ce que je savais, c’est que j’étais piégé et que ce n’était plus qu’une affaire d’heures. Cette fébrilité d’ignorer le moment où le FBI allait me retrouver m’aurait presque fait me rendre, mais l’instinct de conservation et la promesse que je venais de faire finissaient toujours par me ragaillardir. La nuit tombait, et en regardant les milliers d’étoiles qui me contemplaient, cette chanson des Eagles me revenait : « I want to sleep with you in the desert tonight, with the billion stars all around » (je veux dormir avec toi dans le désert ce soir, avec le milliard d’étoiles autour de nous). Elle fait partie de ces chansons qui m’ont incité à quitter la France pour l’Amérique, pour y découvrir l’Amérique rêvée, et que j’ai connues par bulles durant tout ce séjour, des bulles ô combien merveilleuses qui ne durèrent qu’un temps, et qui furent balayées par le poids des ennuis accumulés, et que je traînais comme un fardeau dont il me semblait impossible de me délester. La naissance de mon périple avait pourtant le goût d’une promesse sucrée. Tout commença ainsi…
CHAPITRE 2Champaign, Illinois.
Après de brefs « au revoir » sur le quai de gare je m’installai à ma place. Je tournai le dos à la locomotive et ne serais donc pas dans le sens de la marche. Pour éviter des pensées tristes à l’idée d’être loin de mes proches pendant une année, je trouvais toutes sortes de subterfuges et essayais de prendre de la distance, de la hauteur. C’était finalement plus facile que je ne l’avais imaginé. L’excitation aidant… Le train démarra et je me dis qu’à partir de ce moment précis chaque personne que j’allais croiser, avec qui je discuterais, que j’apprécierais ou qui me laisserait indifférent serait une personne que je n’aurais jamais vue auparavant. Cette idée me donnait le vertige et me plaisait. Le contrôleur ignorait ma destination finale. La dame en face de moi me jeta bien quelques regards furtifs, mais ne savait pas où je serais vingt-quatre heures plus tard. Mille pensées s’entrechoquaient. C’est sans doute comme ça quand on est seul ; on se résout à l’introspection et au silence. Mes deux valises étaient lourdes. J’emportais mon monde, ma France. Arrivé à Dublin, je manquai ma correspondance. J’entamai alors une conversation avec un Américain fort sympathique, d’une cinquantaine d’années, à l’allure bonhomme, au visage affable.
–Alors vous allez où comme ça ?
–Dans l’Illinois.
–Ah l’Illinois ! Formidable. C’est la première fois ? Vous allez étudier là-bas ?
–C’est la première fois que je prends l’avion ! Je vais étudier et donner des cours de conversation française à l’université.
–UIUC ?
–UIUC.
–Si je peux vous donner un conseil, méfiez-vous des Américains, me lança-t-il en faisant un clin d’œil.
–Je tâcherai d’y penser, merci !
–Bon séjour, jeune homme.
–Merci, monsieur, bon vol ! Vous allezoù ?
–San Diego, Californie. Enfin, j’ai une affaire qui devrait me faire arpenter tout l’état. On ne connaît pas suffisamment les États-Unis, même après cinquante-sept ans. Je compte bien m’en mettre plein les mirettes !
J’ai adoré ce type. Nous n’avions conversé que deux minutes, mais ce furent deux minutes de qualité. Il était vif d’esprit, altruiste, modeste, et suffisamment intelligent pour finir l’échange au moment opportun. Sur sa valise, j’avais pu lire Thomas Leary, lawyer. Un avocat. Il était dans le même état d’esprit que moi. Il voulait voir du pays, bien qu’ayant plus du double de mon âge. Après quatre heures d’attente, je suis monté dans l’avion et j’atterris à Chicago huit heures plus tard.
Sorti du terminal cinq, j’étais debout sur un trottoir. La chaleur était moite et étouffante. Je fus surpris par le ballet singulier des limousines, puis, je levai la tête et découvris une bonne cinquantaine de drapeaux qui flottaient au vent. Mes valises avaient été perdues… C’était catastrophique, mais je tâchais de me ressaisir et de continuer à avancer. Trois heures de bus eurent raison de moi. Cela faisait plus de vingt-quatre heures que j’étais debout et j’avais fini par m’assoupir. Un type m’appuya sur l’épaule pour me dire qu’on était arrivé. Bon sang, me voilà à Champaign, Illinois. Il était minuit, heure locale.
Le bus nous a déposés et je n’avais pas le plan de la ville, je savais juste à quelle adresse je devais me rendre. Foley Avenue. Par chance, j’ai trouvé un taxi à héler. Le conducteur n’était pas avare de paroles et me conseilla un bar : The White Horse. Je lui promis de m’y rendre à l’occasion. En arrivant à l’adresse de Foley Avenue, j’ai poussé fébrilement la porte que mon hôtesse n’avait pas verrouillée et me suis retrouvé nez à nez avec un braque hongrois qui, par son attitude, me fit comprendre que j’avais intérêt à me tenir tranquille. L’hôtesse me montra enfin ma chambre. J’étais épuisé, mais content.
Le lendemain, je découvris l’université. J’étais dans un rêve éveillé. Des groupes de filles défilaient sous mes yeux. Les sororités investissaient le campus, dans une même tenue qui les identifiait à une « maison ». Mon Dieu, tous ces bars, ces bibliothèques, ces salles de concert, ces diners, ces barber shops, ces disquaires, ces complexes sportifs. Il m’a semblé qu’on avait créé un univers pour ma personne. J’étais le roi du monde. Je devais voir des gens, discuter, mettre en pratique l’anglais que j’avais rigoureusement appris en quatre ans d’université. Tout était si facile. Un tennis le matin, puis une heure de littérature, une heure de sciences politiques, des cours de conversation française dispensés à des étudiants charmants, et des promenades dans toute la ville pour finir l’après-midi. Le pire c’est que j’étais payé pour ça. Je m’estimais chanceux et coupable. La vie était belle et l’apothéose de ce mois d’août fut le concert de Lifehouse au Canopy Club, petite salle qui accueillait deux-cents personnes, tout au plus.
CHAPITRE 3Josh Travis.
Dans mon appartement au cœur du campus, vous ne trouviez qu’un canapé convertible, une planche et deux piles de bouquins en guise de table basse, mon lecteur MP3 et une enceinte, et vingt-six livres achetés dans un vide-grenier pour huit dollars cinquante. J’en avais déjà lu une bonne demi-douzaine à la mi-octobre. America de Ginsberg, The Sea Came In at Midnight, d’Erickson, The Scarlet Letter d’Hawthorne, A Streetcar Named Desire de Tennessee Williams, The Sound and the Fury de Faulkner, un recueil de poèmes de Robert Frost, et Big Sur de Kerouac. Sur la table basse, une bouteille de bourbon accompagnait un verre toujours trop vide, et vidé trop vite. Mon appartement n’était d’ailleurs pas l’endroit où je passais le plus de temps.
J’ai rencontré et conversé avec des centaines de personnes. Beaucoup de rencontres, et peu d’amitiés. J’ai ressenti un sentiment anti-français, très rapidement, un sentiment anti-Européen, voire hostile à tout ce qui n’était pas américain. Et quand je dis américain, je veux dire WASP. John Smith et Abigail Johnson menaient toujours la danse outre-Atlantique. Ma première véritable rencontre, ce fut un type sur la terrasse d’un café. Il lisait un roman de Russell Banks et je lui ai dit que j’adorais cet auteur.
–Oh, ça c’est rien. C’est juste pour passer le temps, dit-il, en jetant le bouquin négligemment sur la table en fer forgé.
–Tu rigoles, c’est un chef-d’œuvre, bien que ce ne soit pas mon préféré.
–Tu sais quoi de Russell Banks, tu sais quoi de ces putains d’écrivains ? D’ailleurs, tu viens pas d’icitoi !
–Non je suis français.
–Ça va. Tu peux rester.
Il avait l’air très arrogant ce type, vraiment bizarre, peu aimable, mystérieux, et sûr de lui. Sa chemise bleu clair ouverte aux deux tiers, sa barbe de trois jours et sa coupe faussement négligée faisaient de lui le séducteur américain qu’on aime détester. Je ne suis pas de cette espèce. Je suis plutôt discret et pudique. En temps normal, j’aurais ignoré ce type avec ses lunettes de soleil et ses jeans délavés. Mais quelque chose clochait. Il lisait Russell Banks, et ce n’était pas dans le cadre de ses études.
–Écoute, là j’ai pas le temps, mais si tu veux discuter de tout et de rien, passe boire un verre chez moi, ce soir, vers vingt-et-une heures, me proposa-t-il.
–OK ! Je viendrai.
–55 East Green Street, mon gars. C’est la sonnette Josh Travis.
–À ce soir !
Je ne sais pas ce qui m’a pris. Pourquoi j’allais voir ce gars. Tout l’après-midi j’ai hésité à honorer le rendez-vous. Ce type n’était pas clair. Je décidai de prendre mon courage à deux mains, et de me rendre à l’adresse de ce Josh Travis. Neuf heures moins deux, je m’arrêtai devant un bâtiment de briques rouges, les fenêtres, simple vitrage, n’étaient en bon état à aucun étage. J’ai eu l’impression que je m’embarquais dans un coup bien foireux, du genre qui se termine en guet-apens. Pas de sonnette en bas. J’entrai dans l’immeuble, et je dus faire le tour des étages, le tour des portes, pour trouver l’appartement de Travis. La moquette des couloirs était miteuse. Je sonnai à la bonne porte, une porte dégueulasse, et endommagée vers le milieu, comme si quelqu’un avait mis un coup de poing dedans. Josh m’ouvrit, et je découvris un appartement en tout point identique au mien, aussi spartiate que le mien. Il n’y avait pas de clic-clac, mais un matelas posé à même le sol. Pas de table basse, mais une table de cuisine de fortune composée d’une planche et de deux tréteaux. Il me montra son frigo, rempli de boissons protéinées.
–T’inquiète, j’ai autre chose pour toi, me dit-il.
–J’espère bien,mec.
Je ne sais pas pourquoi, sans doute l’instinct, je me mis à parler avec la même assurance, le même détachement, la même arrogance que lui. Je me suis dit un instant que c’était la clef pour ne pas se faire manger tout cru. Mais évidemment, ça sonnait on ne peut plus faux. Josh commença à parler français. Je fus estomaqué.
–Tu aimes le whisky ?
–Tu parles français ?!
–Oui, un peu, j’ai passé une année à Lyon. C’était chouette.
–Oui, le whisky, parfait !
Ce type, en passant au français, avait changé de ton. Ce n’était plus la même assurance. Il était mielleux et mélancolique. Le passage d’une langue à l’autre entraînait chez lui un changement d’apparence, de personnalité. Cela confinait à la schizophrénie.
–Tu aimes les États-Unis ?
–Un peu que je les aime ! Ettoi ?
–C’est un pays de merde. Enfin, par rapport à la France, ou à l’Italie.
–Pourquoi tu dis ça ?! Justement je trouve que c’est autrement plus facile qu’en France de vivreici.
–Ouais, tu dis ça parce que t’es frais ici. Tu déchanteras !
–Je pense pas, lui dis-je avec certitude.
–Regarde James Dean. Tu connais James Dean ?
–Biensûr !
–James Dean, c’est le pur produit de l’Amérique. Ils l’ont fait, ils l’ont utilisé, ils l’ont pourri, et ils ont fini par lui faire la peau. L’Amérique, elle te bouffe tout jusqu’à la moelle épinière, elle t’écrase les os, en fait de la poussière et mélange cette poussière au terreau qui fait naître d’autres produits. Tu vois ce que je veux dire ?
–N’abuse pas du whisky, Josh !
–T’es un bon, toi. Tu t’appelles comment déjà ?
–Tu peux m’appelerNick.
–OK, Nick, tu sais quoi ? Ce soir on va faire la tournée des bars. Je vais te montrer comment faire pour s’intégrer ici sans se faire pisser à la gueule.
–C’est quoi derrière la porte ?
–Ça ? C’est ma guitare. Mais j’en joue pas. Tu sais en jouer toi ?
J’avais alors adopté Josh, définitivement. L’appart, le whisky, la mélancolie profonde d’un type qui porte un masque le reste du temps, et la guitare. Après l’avoir accordée, je lui jouai les quelques notes d’un standard classic rock,Dust in the Wind (la poussière dans le vent). Il semblait apprécier mon picking. On termina la bouteille. On sortit de chez lui. Il ne verrouilla pas la porte. Il me dit : « si jamais quelqu’un veut tapisser en mon absence, on sait jamais… »
Méticuleusement, on avait fait les trois bars de East Green Street. Il m’avait montré les filles, les serveuses, comment on parle aux types du comptoir, comment on mâche un chewing-gum, et comment on ignore des filles qui vous observent.
–Surtout il faut les ignorer, Nick, sinon t’es mort.
–J’suis mort ?
–Tu comprendras… Enfin, quand tu seras mort, tu vois ce que je veux dire ?!
Cette question rhétorique était un véritable tic de langage chez lui. C’était sa ponctuation. Là où tu mets un point, lui disait ça. Bien souvent, j’ai voulu lui dire que non, je ne voyais pas tout à fait ce qu’il voulait dire, mais ça aurait gâché le script. Il faut savoir s’arrêter au bon moment pour ne pas gâcher une conversation qui tutoie des considérations philosophiques. Si vous regardez Le Bon, la brute et le truand, vous comprendrez. Ce soir-là, on avait testé quelques bourbons, de l’Amaretto Sour, et du Sex On the Beach. Assez pour que le lendemain, mes yeux se reposent sur des valises d’alcool. Le bâtiment où je faisais cours, le Greg Hall, me regardait avec condescendance. Quant aux étudiants, ils avaient peut-être compris que j’avais écumé les zincs la veille. En tout cas ils étaient particulièrement bienveillants ce 25 octobre 2003.
CHAPITRE 4The Music Shoppe.
Le lendemain, c’était samedi, et c’était un jour où je ne travaillais pas. Je ressentis, vers deux heures de l’après-midi, l’irrépressible envie de jouer de la guitare. Il me fallait une guitare. Je me mis en route vers la boutique de musique sur Neil Street. Pas de lumière, malgré la pancarte qui indiquait que l’échoppe était ouverte. Je poussai la porte, et, au fond du magasin, assis sur un tabouret, je voyais un type avec un chapeau de cowboy, une longue moustache qui lui donnait l’air d’avoir quarante-cinq, cinquante ans. En réalité, il ne devait pas avoir plus de trente-cinq ans. Les bras croisés, il était en train de piquer un somme.
–Bonjour, dis-je en éclaircissant bien ma voix pour le réveiller.
–Ah, b’jour. J’peux aider ?
–J’aimerais bien acheter une guitare.
–A priori vous êtes au bon endroit. Mais vous êtes pas du coin, vous ?!
–Non, pas vraiment, répondis-je blasé. Malgré les presque trois mois passés ici, je n’avais pas encore l’accent du Midwest.
–Allez-y, vous pouvez essayer. Faites gaffe à la marchandise, quandmême.
–Sûr !
J’ai essayé huit guitares acoustiques, des guitares folks où je laissais traîner mes doigts, en jouant tantôt du K’s Choice, tantôt du Simon and Garfunkel. J’ai vu que le type a levé la tête quand j’ai joué l’intro de The Boxer.
–Vous vous débrouillez.
–Oui, mais ne vous fiez pas aux apparences. Le picking, c’est à peu près tout ce que je maîtrise, répondis-je sans fausse modestie.
Mes yeux furent alors attirés par une guitare bleu foncé qui était posée contre un mur, au fond de la boutique.
–Je pourrais essayer celle-là ?
–Ah… Celle-là…
Le vendeur avait l’air très embarrassé. Il se frottait le front comme si je lui avais demandé lalune.
–Pour jouer de celle-là, faut le mériter, M’sieur, me dit-il.
–Commentça ?
–Ben, faut être un vrai amoureux de l’Amérique ! C’est la guitare de l’Amériqueça !
–Elle est à combien ?
–Ben… Elle a pas vraiment de prix. Ce qu’on peut faire, c’est que je la mets à six-cents dollars.
–Six-cents dollars ! Mais c’est la moitié de mon salaire !
–Attends, coco, j’ai pas dit que j’étais d’accord de te la vendre.
Alors ça c’était la meilleure, j’étais en train de supplier un redneck qui m’avait catalogué comme « étranger » pour qu’il me prenne la moitié de mon salaire pour une guitare qui n’a pas l’air de valoir plus de deux cents dollars, pensai-je.
–Je peux au moins l’essayer d’abord ?
–Nan, dit-il de façon catégorique. Ce qu’on va faire, c’est un petit test. Je vais vous poser trois questions, si vous répondez correctement aux trois questions, vous aurez le droit de l’essayer.
–OK, répondis-je, amusé.
J’adore les défis, et si ce type était si peu prompt à me laisser essayer cette guitare, sur laquelle, d’ailleurs, rien n’était inscrit, c’est qu’elle devait être spéciale.
–Première question : qui est Thaddeus Stevens ?
–Vous voulez plutôt dire « Qui était Thaddeus Stevens ? », un des plus éminents membres du Parti républicain, contemporain du Président Lincoln, corrigeai-je.
Mon vendeur était éberlué. Qu’un étranger sache cela lui avait coupé la chique. Il faut dire que la chance était de mon côté. J’avais rédigé mon mémoire de maîtrise sur le Grand Old Party.
–Deuxième question : quel Américain a écrit, composé, et chanté la chanson Famous Blue Raincoat ?
Je me frottai le menton, et le type se délectait de mon apparente ignorance. Je connaissais parfaitement la réponse, cette chanson étant une de mes favorites :
–Il n’est pas américain, mais canadien, et c’est l’excellent Léonard Cohen.
Je jouissais de voir la mine de l’homme, déconfite. Il ne se laissa pas démonter et enchaîna avec la troisième question :
–Très bien, très bien, monsieur est connaisseur. Dernière question. Je vous laisserai essayer la gratte si vous répondez correctement à celle-ci : quelle est la capitale de l’Oregon ?
Il s’avère qu’avant mon départ, j’avais bossé les états américains et leurs capitales à tel point que je connaissais tout sur le bout des doigts.
–C’est la ville de Salem.
Mon interlocuteur rit aux éclats !
–Salem, c’est dans le Massachusetts, c’est la ville des sorcières. La capitale de l’Oregon, c’est Portland. Désolé mon pauvre, mais va falloir vous contenter des guitares que vous avez essayées.
–Je suis navré, monsieur, mais je suis certain d’avoir raison.
Il sortit alors du tiroir une vieille carte des USA, et découvrit avec effroi que j’avais raison. Ma victoire était sans appel. La chance était avec moi. En tendant mon bras, je lui demandai :
–Puis-je ?
Il me tendit la guitare. Elle était incroyablement chaude. Je veux dire, chaude au sens premier du terme. Comme si elle avait été près d’un fourneau, ou quelque chose. À la première note, je tressaillis, et mes doigts s’engourdirent pendant trois secondes. J’ai joué Hotel California des Eagles avec une facilité déconcertante. C’est-à-dire que j’ai joué ce morceau en reprenant les parties de toutes les guitares du groupe, ce qui était pour ainsi dire impossible, vu mon petit niveau d’autodidacte. J’ai alors dit au vendeur que je l’achetais.
–Nan, nan, nan, c’était pas dans le marché ! Vous avez juste le droit de l’essayer. Si vous voulez pouvoir l’acheter, j’ai une dernière question à vous poser. Je pense que vous ne trouverez pas. Vous êtes trop jeune pour savoir, et c’est sûrement pas votre genre de musique.
Un vieil homme entra alors dans le magasin et resta figé au milieu de la pièce, en nous regardant. Il était placide, mais ses yeux étaient perçants. Il était vieux, très vieux. Ses joues étaient creusées et il portait la mort sur son visage. Je me tournai alors vers mon vendeur, qui me posa l’ultime question :
–Complétez les premiers mots de la chanson de Robert Johnson, Crossroad Blues : « I went to the crossroads… »
La tension était palpable. D’un côté, mon vendeur, fébrile à l’idée que je pusse connaître la réponse, de l’autre côté, ce vieux bonhomme qui vous glaçait le sang à distance. Lors de mon année de licence, j’avais suivi un cours sur le blues, et c’est là que j’ai découvert le répertoire de Robert Johnson. Je connaissais parfaitement cette chanson. Je lui donnai donc ma réponse :
–« Fell down on my knees. »Le vendeur était horrifié. J’étais conquérant. Josh aurait été fier de moi s’il avait été à mes côtés. Il aurait sorti un truc du genre : « Tu le fais ricocher jusque dans le Michigan avec ça. Well done, dude. » Il n’accepta pas le paiement par carte de crédit. Je dus aller retirer six beaux billets de cent dollars à l’ATM le plus proche. En revenant dans l’échoppe, le vieux était appuyé sur l’épaule du vendeur. Ils avaient l’air de se connaître. Je lui donnai les six billets et il me donna la guitare. Le tout se passa dans le silence le plus total. Je rentrai avec la guitare poussiéreuse sous le bras. Elle était belle, elle était bleue, et elle sentait le vieux bouquin. C’était ma guitare. J’en ai joué toute la nuit. J’ai joué des morceaux que je n’avais jamais joués ; mes doigts glissaient sur les frets avec magie. Cette guitare m’avait fait passer du statut de guitariste amateur à guitariste talentueux. À compter de ce samedi 26 octobre, ma vie bascula.
CHAPITRE 5White HorseInn.
J’appelai Josh, au petit matin, et lui enjoignis de venir chez moi, en apportant sa guitare. Il arriva. Je saisis immédiatement son instrument, et parvins à jouer des morceaux invraisemblables ; certes avec moins de facilité qu’avec ma guitare bleue, mais j’y parvins malgré tout. Quelque chose avait changé. Je demandai alors à Josh de tester ma nouvelle guitare. Il n’en joua pas mieux que de la sienne.
–Tu l’as dégotée où cette gratte ? Elle a au moins cinquanteans !
–Au magasin sur Neil.
–T’as payé ça combien ?
–Six cents balles.
–Tu rigoles ?! Tu t’es fait avoir, Nick ! Tu t’es fait avoir par l’Amérique, je t’avais prévenu.
Je ne bougeais plus, j’étais livide. Josh pensait que j’étais déprimé de m’être fait avoir, et me proposa qu’on aille se saouler le soir même. J’acceptai. Je n’étais pas déprimé. J’étais médusé, hypnotisé. Un bonheur intense m’envahissait et se mêlait à une terreur panique à l’idée d’avoir été doublé par je ne sais quelle force.
Il fallait que je donne un nom à ma guitare. J’ai choisi Lisa. Je pris le parti de ne rien dire à Josh, à qui pourtant je disais tout. Enfin, on ne peut pas dire qu’il s’agissait d’un parti pris de ne rien dire. C’était la guitare, d’une certaine façon, qui m’intimait de ne rien dire. Lisa avait un pouvoir, et je n’étais plus maître de tous mes choix. Bien qu’ayant gardé une certaine forme de libre arbitre, de capacité de raisonnement, je savais qu’il ne s’agissait là que de leurres, et qu’au final, certaines des décisions les plus importantes de ma vie, certains des choix qui devaient infléchir mon destin, étaient pris par Lisa, et que, de la chaleur perpétuelle de son bois émanait sonâme.
Le soir, j’allais passer chercher Josh pour qu’on aille se saouler. Mais, avant, je fis un crochet par Neil Street. Le magasin de musique avait fermé, définitivement fermé. Au 55 East Green Street, Josh sortit en enfilant sa veste en cuir. Nous nous prîmes dans les bras, comme à l’habitude, dans une accolade virile, en se tapant dans le dos, en se promettant de boire comme des hommes.
–Josh, ça te dirait d’aller au White Horse ? lui proposai-je.
–Au White Horse ?! Ça c’est un vrai bar de l’Amérique profonde ! T’es sûr ?!
–Tu sais que ce que j’aime par-dessus tout c’est l’Amérique profonde !
–Pas de problème, ils servent aussi de l’alcool au WhiteHo’ !
–Au White Ho’ ? demandai-je surpris de cette dénomination.
–Oui, tout le monde appelle ce bar comme ça, ça veut dire pute blanche, quand on contracte ! Ça te dérange ?
Je fis non de la tête. Je savais bien qu’il n’y avait pas de prostituées dans ce bar, mais ce surnom renforçait la réputation du bar, un bar de l’Amérique du Midwest. Je me suis souvenu du nom de ce lieu que m’avait conseillé le chauffeur de taxi. À l’extérieur, un toit en chaume et des néons lumineux bleus et rouges offerts par les marques de bière ajoutaient de la plus-value à une ambiance tamisée et chaleureuse. En franchissant les portes de l’établissement, nos sens se mirent en éveil, musique country, odeur d’onion rings, filles en short en jeans, courts, très courts, la moiteur ambiante des effluves de bière. La première chanson que j’ai entendue était Too Early, de Son Volt, avec de la steel guitar à ne plus savoir qu’en faire, et des bends à en écailler un tableau de Hopper. Cette chanson m’est restée en tête un moment. C’est la chanson de l’Amérique masculine qui pleure une fille trop tôt partie et qui se morfond au-dessus d’un verre de Tennessee Whisky… On the rocks, évidemment. Mes états d’âme furent tout à coup mis à mal par une franche tape dans le dos que Josh m’administra. Je l’avais oublié l’espace d’un instant.
–Je paie la première tournée, mon gars, me dit-il.
–Sûr !
–Bourbon ?
–Bourbon.
Après quatre verres, Josh fila aux toilettes. Mon regard se posa alors sur un homme à l’autre bout du bar. Il me fixa, se leva, et vint à ma table. C’était absolument incroyable : c’était le vieux du magasin de musique, mais en beaucoup moins vieux !
–On se connaît ! lui dis-je.
–Pour sûr, on s’est vus au magasin de musique.
–C’est pas possible. C’est votre père ou votre grand-père que j’aivu.
C’était troublant, car les traits étaient identiques. Il était évident que ça ne pouvait pas être un autre homme, sauf à pousser le clonage transgénérationnel à son paroxysme, mais d’un autre côté, il avait rajeuni de quarante ans, au moins.
–C’est bien moi, mais ce serait trop long à te raconter. J’ai pas beaucoup de temps. Ton ami ne va pas tarder à refaire surface.
Mon visage s’assombrit, et je compris que ce bonhomme avait quelque chose d’important à me confier. À dire vrai, je n’avais pas tellement envie d’écouter ce qu’il avait à me dire. Je craignais que ce que j’allais entendre allait être trop pesant ou terrifiant. Mais je n’avais pas le choix.
–Est-ce que cela a un rapport avec la guitare ?
–Oui et non, répondit-il après quelque hésitation.
–Je vous écoute.
–La guitare n’est que la première étape. En fait il faut croire qu’elle t’a choisi.
–Je ne comprendspas…
–Tu veux savoir la vérité sur la mort de Robert Johnson ?
–Biensûr.
–Hé, prends pas ça à la légère, gamin, me fit le vieux sur un ton fort contrarié.
–D’accord, d’accord. Évidemment, je sais qu’un mystère entoure autant les circonstances exactes de sa mort que l’endroit où il a été enterré. J’ai vu des documentaires là-dessus.
–Exactement, répliqua le vieux. Seulement, tu peux peut-être découvrir toute la vérité sur ces événements. Il te suffit d’y consacrer quelque temps.
–C’est-à-dire ?
–Quelques mois si tu es doué. C’est un jeu de piste qui te conduira à voyager dans tout le pays. Tu devras y consacrer tout ton temps et toute ton énergie.
–Je ne comprends pas. Je suis en compétition avec quelqu’un ?
–Oui, et non… Enfin tu verras si tu acceptes de commencer la partie.
–La partie ?
–Je t’ai dit, c’est comme un jeu de piste, mais n’oublie pas, c’est la vraie vie, et ce que tu vas découvrir au fil du jeu risque de te secouer. Le jeu en vaut la chandelle. Voici la première carte.
Il me tendit un bout de papier, et sans même me laisser le temps d’accepter ou de décliner, disparut. Josh reparut, la tête dans le brouillard. J’en venais presque à me demander si le vieux ne l’avait pas hypnotisé à distance le temps qu’il était aux waters. Peu importe, pas un mot à Josh. Je fourrai le bout de papier au fond de la poche arrière droite de mon pantalon, résolu de me comporter le plus normalement du monde. Le bar passait alors le premier album de Jesse Sykes, une musique profonde et envoûtante qui collait parfaitement avec un bar embrumé par la fumée des cigarettes.
Deux filles se pointèrent à notre table. Josh me glissa à l’oreille que sa technique du « ignore les filles, surtout les belles » avait fonctionné. J’ose avouer qu’avec le début de soirée que j’avais vécu, je n’avais regardé personne et que les clients du bar se confondaient les uns avec les autres en une masse indistincte, floue, mais pas bruyante. Les deux filles étaient d’égale beauté. Une beauté naturelle. Maureen et Emily ne se maquillaient pas parce qu’elles n’en avaient pas besoin. Emily jeta son dévolu sur Josh. Josh ne laissait personne de glace. Bonne joueuse, Maureen se rabattit sur moi. La nuit fut délicieusement longue.





























