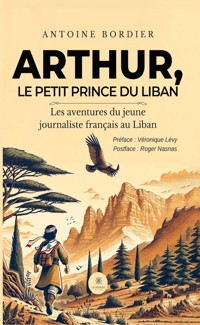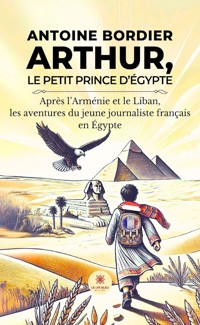
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Arthur, le petit prince est une trilogie qui retrace les périples fascinants d’Arthur de La Madrière, un jeune journaliste français. Âgé de 21 ans, orphelin depuis le tragique accident de voiture ayant emporté ses parents, il est l’aîné d’une fratrie de sept enfants. Dans ce troisième opus, Arthur, surnommé « le petit prince d’Égypte », poursuit son destin hors du commun. Après l’Arménie et le Liban, il s’envole pour Le Caire afin d’y établir l’antenne de son journal mais son voyage dépasse les limites de la simple mission professionnelle, l’entraînant à travers les âges. Des splendeurs des pharaons aux campagnes napoléoniennes, jusqu’à nos époques contemporaines, Arthur se lance dans des aventures qui mêlent le journalisme à l’humanité la plus profonde. Laissez-vous transporter dans une fresque palpitante où s’enchevêtrent exploration historique et exploits fantastiques et surnaturels.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Écrivain-journaliste-voyageur,
Antoine Bordier a découvert sa passion pour la littérature dès son enfance en Afrique de l’Est. En 2021 et 2022, après des débuts dans le journalisme et diverses expériences en finance et dans l’entrepreneuriat, il séjourne en Arménie pour développer ses activités de conseil et de communication. Il y écrit son premier roman, "Arthur, le petit prince d’Arménie", paru aux éditions SIGEST. En 2024, après ses voyages au pays du Cèdre, il publie son deuxième opus : "Arthur, le petit prince du Liban" chez Le Lys Bleu Éditions. "Arthur, le petit prince d’Égypte" vient couronner cette trilogie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antoine Bordier
Arthur, le petit prince d’Égypte
Après l’Arménie et le Liban,
les aventures du jeune journaliste français
en Égypte
Roman
© Lys Bleu Éditions – Antoine Bordier
ISBN : 979-10-422-5321-9
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Préambule
Ce 7 septembre 2021, il est 18 h, quand mon avion atterrit sur le tarmac de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Alors que je récupère mes bagages, je relis la lettre de la reine Anahit :
Cher Arthur, mon petit prince,
Le Liban est le berceau de l’humanité et de la paix. Son unité et ses valeurs ont été menacées. Son peuple martyr a été si souvent attaqué, convoité, persécuté. Les Libanais sont, encore aujourd’hui, debout. Nous allons continuer à les aider. Comme pour l’Arménie et l’Artsakh, vos missions lui ont permis de recouvrer sa pleine souveraineté. Nous sommes, à la fois, leurs gardiens et leurs protecteurs. Nous sommes leurs libérateurs.
Merci pour tout ce que vous avez fait.
Petit prince, la prochaine fois, vous aiderez l’Égypte à devenir la Nouvelle Égypte. Longtemps, trop longtemps, l’Égypte a sombré. Oubliée, elle est restée dans l’ombre. Elle va de nouveau prospérer et être le phare de l’Afrique. Ce ne sera plus un rêve, cela deviendra une réalité. Ce sera votre prochaine mission dans ce pays rempli de promesses.
N’oubliez pas, vous êtes le petit prince d’Heradis !
À bientôt,
Reine Anahit
Je la relis une troisième fois. Je rentre du Liban, et, déjà, une nouvelle mission m’attend, dans ce grand pays des pharaons.
Je n’y pense pas. J’ai hâte de retrouver mes grands-parents, Hubert et Elisabeth. Je ne sais pas, cette fois-ci, si j’irai voir mon oncle Jacques. Si je vais rester dormir chez lui. Oui, je veux vite me rendre en Anjou et revoir mes frères et sœurs, Joseph, Marie, Pierre, Sophie, Gabriel et Sarah.
Ah, mon Anjou, avec le petit château familial perdu au milieu de ses bois, de son lac, et de sa petite rivière… Quelle joie !
À l’aéroport, la sirène me sort de mes pensées et m’annonce l’arrivée de mes bagages. Deux valises, dont l’une est remplie de cadeaux et de souvenirs libanais.
Je les récupère et je passe tous les contrôles. Cette fois-ci, je n’ai pas vu Ara, Scarlett et Tondor. Tant mieux, car j’aspire à une vie normale, basique, bien terrienne. Je ne veux pas les voir débouler à l’improviste. Ils sont tellement imprévisibles. Même si je me suis habitué à eux et qu’ils me sont familiers, ne pas les voir pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, me ravirait.
Je me méfie quand même d’eux. Je regarde une dernière fois dans mon sac à dos. Ils ne sont pas là. J’ai juste le bâton de Moïse, que j’ai décidé d’appeler Bamoï.
À la douane, je n’ai rien à déclarer. Mais, un agent me fait signe de m’arrêter, et il fixe avec son doigt mon sac à dos. Je blêmis, car il va mettre la main sur Bamoï, qui peut s’apparenter à une antiquité.
Il ouvre mon sac à dos, fouille et ne le trouve pas. Incroyable, car il est devenu invisible, à l’instant même où il plongeait la main dans le sac. Tant mieux.
Je sors, finalement, de la salle de débarquement. J’emprunte le long couloir que je commence à connaître par cœur. Je suis à l’air libre. Je tourne la tête dans tous les sens. Je ne vois aucun de mes grands-parents. Mes frères et sœurs ne sont pas là non plus. Ils ne sont pas venus me chercher, cette fois-ci. J’aperçois, néanmoins, oncle Jacques qui me fait un grand signe de la main. Il est seul. Il a l’air un peu triste. Je lui réponds d’un signe de la main.
Je passe le portillon.
Cette mauvaise nouvelle me laisse sans voix. Depuis l’accident mortel de mes parents, le fait de prononcer ce mot « accident » me fige et me rend totalement muet et sourd. Je le regarde, il continue de me parler, mais je n’entends plus rien. Le silence le plus total m’a envahi. Autour de moi, des gens se parlent, mais là encore je n’entends rien. Je reprends mes esprits au moment où mon oncle me serre dans ses bras.
Nous sortons de l’aéroport avec de grandes difficultés. J’avais oublié la circulation parisienne. Nous allons mettre une heure de plus que d’habitude. La raison essentielle ? Une manifestation monstre. Les manifestants ont bloqué toute la circulation périphérique.
Nous arrivons, enfin, avenue Suffren, devant le numéro 13. Il me tarde de dîner et de me coucher. Cette dernière semaine au Liban a été harassante. Je retrouve avec joie son appartement, un triplex situé aux trois derniers étages, avec ascenseur.
J’aime beaucoup oncle Jacques. Il me rappelle mon père. Il était plus voyageur que lui. D’ailleurs, il continue de voyager. Il enchaîne ses tours du monde, comme d’autres enchaînent les balades de 50 km à bicyclette. Je pressens qu’un jour, il viendra me voir soit au Liban, soit en Arménie, soit ailleurs. En Égypte ?
Il porte toujours sur la tête sa fameuse casquette bleue. Avec sa barbe blanche, qui arrondit son visage carré surmonté de ses petits yeux verts toujours rieurs, il ressemble vraiment à un vieux loup de mer. Son surnom de Capitaine Haddock résonne en moi, alors que je prends l’ascenseur. Direction le 5e étage.
Au 5e, je fouille dans les poches de mon manteau pour attraper les clefs. Sur le palier, je les fais tomber, malencontreusement. Les lumières s’éteignent à ce moment-là. J’allume alors la lampe de mon smartphone, puis j’entre. Le grand couloir est dans le noir le plus complet. Je recherche à tâtons le bouton de l’interrupteur. Je le fais fonctionner, mais rien ne s’éclaire. Les plombs ont dû sauter.
Je continue à avancer vers le grand salon. Je fais dix pas, et toujours à l’aide de la lampe de mon smartphone, j’éclaire la double porte. Je l’ouvre lorsque, soudain, tout s’éclaire et j’entends derrière moi des voix crier :
Je me retourne stupéfait. J’ai reconnu les voix de mes frères et sœurs. Incroyable ! ils sont tous là. Il n’en manque pas un : Joseph, Marie, Pierre, Sophie, Gabriel et Sarah. J’entends des bouchons de champagne sauter. L’un d’eux me touche en plein front. Tout le monde s’esclaffe de rire. Je vois toutes ces gorges déployées riant aux éclats. Comme il est bon de retrouver les siens ! Cela fait du bien.
Oncle Jacques vient de rentrer et me donne une bonne tape dans le dos. Je l’embrasse affectueusement.
Tous mes frères et sœurs me tombent alors, littéralement, dessus. Et nous finissons en atterrissant dans le grand divan bleu nuit.
De quoi parle-t-il ? Il m’intrigue. Du coup, tout le monde vient avec moi. Direction ma chambre, en courant.
Tout au fond du couloir, j’ouvre la lourde porte en bois massif. Ma chambre est située à côté de l’un des escaliers qui mènent à l’étage. Sur sa porte a été ciselé le mot Tonkin. Au-dessous du nom, une carte sculptée représente ce pays où j’ai toujours rêvé de mettre les pieds, depuis ma plus tendre enfance. Je lis sur le post-it placardé dessus : « Attention à la surprise ! » Je suis plus qu’intrigué, presque excité, malgré la fatigue. Mon adrénaline est de nouveau remontée à la surface. Je respire un bon coup et entre le premier en essayant de contenir tout ce petit monde qui s’accumule comme un jeu de dominos derrière moi. À l’intérieur… un énorme cadeau trône au beau milieu de la pièce. J’en rougis. Puis, je me laisse déborder. Et tous se précipitent pour ouvrir le cadeau.
À peine ai-je attrapé le ruban bleu que le cadeau explose en mille morceaux de confettis et laisse apparaître mon petit aigle Tondor, ma petite licorne Scarlett et mon petit perroquet Ara. Et dire que je pensais ne plus jamais les revoir. Qu’ils étaient rentrés définitivement avec la reine Anahit. Non, ils sont bien là.
Ara est en forme. J’ouvre la porte-fenêtre de la terrasse. Nous nous y précipitons. La nuit est tombée sur Paris. Un rayon de lumière tournoie dans un ciel pur, étoilé, habillé de noir. C’est celui de la tour Eiffel. Je pense à Aroso et à la reine Anahit. J’espère vite les revoir.
Nous filons tous à la cuisine où nous attend Georges.
Le dîner terminé, il est 1 heure du matin, quand je retrouve ma chambre et mes amis du royaume d’Heradis. Ils dorment tous sur le grand tapis. Je les enjambe pour ne pas les réveiller. Leur présence devient des plus naturelles. Est-ce moi qui m’habitue à eux, ou le contraire ?
Aurais-je réussi à les apprivoiser ? Ou ne serait-ce pas le contraire ? Quoi qu’il en soit, je me couche rapidement dans mon lit à deux places. Je regarde le vieux plafond, les vieux meubles, ramenés d’Asie. Je ferme les yeux, et je me mets à voyager dans mes rêves.
J’ai reconnu la voix de Georges. Je me lève d’un bond. C’est déjà le matin. La nuit m’a paru si courte. Je regarde dans ma chambre, les amis d’Heradis ne sont plus là.
J’ouvre la porte-fenêtre de ma chambre et respire un bon coup. Il fait encore chaud, en ce mois de septembre. Le thermomètre tutoie les 15 °C.
Je passe rapidement sous la douche. Je m’habille en quatrième vitesse. Je me surprends à être en forme et rapide, moi qui suis habituellement lent au démarrage matinal.
Je m’arrête 10 min dans la cuisine où Georges m’a préparé un mug de café noir et une tartine de pain brioché, grillée et beurrée à merveille.
Je regarde Georges. Il commence à blanchir des cheveux. J’admire cet homme si discret qui est resté fidèle à mon oncle. Ce sont les meilleurs amis du monde.
Rendez-vous au journal
À peine, suis-je entré dans l’ascenseur que je retrouve Ara, comme par magie.
Arrivés au rez-de-chaussée, je vois, effectivement, Scarlett et Tondor qui m’attendent derrière la grande grille.
Ni une, ni deux, je bondis sur la croupe de Scarlett. Et la voilà qui galope en direction de la tour Eiffel. Cette fois-ci, elle ne passe pas par l’Arc-de-Triomphe.
Je n’ai pas eu le temps de finir ma phrase qu’Ara nous crie :
Un camion fonce tout droit sur nous. Scarlett ne peut pas l’éviter et passe à travers. Nous restons invisibles, nous absorbons la matière comme si elle s’était réduite en un instant à l’état moléculaire. Cependant, nous provoquons le freinage instantané du camion. Le chauffeur a eu peur et a donné un coup de volant sur sa droite, ce qui a pour effet de percuter le parapet. Il est stoppé net. J’ai cru un moment qu’il allait tomber dans l’eau. Plus de peur, que de mal ! Les quais sont bloqués. Je regarde en arrière, et j’aperçois le chauffeur descendre de sa cabine. Il n’est pas blessé, tant mieux. Il a dû avoir la peur de sa vie. Les klaxons fusent.
Scarlett reprend son galop, comme si de rien n’était. Nous passons devant le musée du Quai Branly qui porte, depuis peu, le nom de Jacques Chirac. Puis, sur notre droite, la grande étendue verte soudaine de l’esplanade des Invalides attire machinalement notre regard. Sur notre gauche, le pont Alexandre III, toujours aussi majestueux. J’aime ce quartier qui dit quelque chose de Paris, de la France, de son histoire.
Je lui fais signe. Il se pose devant nous. En un battement d’ailes, nous survolons la capitale. Elle est céleste. Tondor fait un 360° et je distingue tous les monuments importants de Paris.
Nous atterrissons en plein milieu de l’un des jardins, celui des Quatre Colonnes. Il n’y a personne. Je redeviens visible. Je ne pensais pas me retrouver au cœur même du Palais Bourbon. Je me dirige vers l’attroupement. Je comprends alors que la centaine de personnes sont des députés. Ils se sont donné rendez-vous dans ces jardins et ont organisé un évènement pour accueillir les nouveaux députés. Parmi eux, un député d’origine arménienne, Jean Kerkian.
Je me dirige vers lui.
Je rougis, car j’ai beau regarder autour de moi, je suis le seul journaliste présent à ce moment. Que lui répondre ? J’ai l’impression d’être un intrus.
Jean Kerkian m’entraîne avec lui, en montant trois à trois les marches du perron du Palais Bourbon.
Les députés se mettent à m’applaudir en disant :
Des députés s’approchent de moi.
Je me tourne vers Jean Kerkian.
Je lui réponds :
Jean Kerkian reprend la parole :
Je m’arrête net, alors qu’il est en train d’ouvrir la grande porte d’entrée. Je viens de me souvenir de mon rendez-vous avec mon rédacteur en chef, Paul Roderre.
Je file à la française, sous les applaudissements de ces députés français amis de la cause arménienne. Ils viennent de s’engouffrer dans la salle des Quatre Colonnes. Je jette un coup d’œil, dans cet immense hall qui porte bien son nom. Je suis, soudain, happé de l’intérieur et je me retrouve dans cette salle.
Je visite en accéléré le salon Delacroix, la salle Casimir-Périer, le salon Pujol, la salle des conférences.
Et je rentre dans l’hémicycle, toujours pris dans cette aspiration. Personne ne m’a vu. Je suis redevenu invisible. Ce phénomène s’arrête lorsque je me retrouve sur le perron du jardin de la présidence, où m’attend Tondor. J’entends les grandes portes vitrées se refermer avec fracas.
Tondor m’invective.
Tondor s’envole. Et, 5 minutes plus tard, il me dépose au pied de l’immeuble du journal. J’ai 15 min de retard.
En entrant dans le hall, l’hôtesse d’accueil me salue de la main.
Au passage du tourniquet, mon badge d’accès ne fonctionne plus. Comme la dernière fois, quand je suis rentré d’Arménie. Quand je m’absente plus d’un mois, il se désactive automatiquement. J’aperçois Paul au loin qui marche dans ma direction.
Nous prenons l’ascenseur, direction le 5e étage où se trouve toute la rédaction. À l’ouverture des portes de l’ascenseur, j’entends le début d’un refrain qui ne m’est pas inconnu :
« Il est vraiment, il est vraiment phénoménal… »
Tous les collègues sont là, debout, en train de chanter ce refrain. Ils m’applaudissent à mon passage. Il me semble qu’il y a plus de monde que d’habitude. L’immense plateau en open-space est comble.
Nous entrons dans son bureau flambant neuf. En un peu plus d’un mois, le siège social s’est transformé. Les baies vitrées, qui courent le long de la façade, ont été remplacées par des baies dites écologiques. Elles produisent toute l’énergie électrique dont a besoin le journal pour fonctionner. Elles sont revêtues de la dernière des technologies solaires.
Il n’y a pas de panneaux photovoltaïques à proprement parler. Mais juste une fine membrane de quelques millimètres d’épaisseur qui courent de chaque côté des baies. Et puis, il y a ces volets en bois, qui automatiquement en fonction du soleil et du vent s’abaissent ou se lèvent complètement.
Quelqu’un frappe à la porte du bureau de Paul. C’est Robert, le responsable de l’administration et du secrétariat général.
J’interviens.
Il referme la porte du bureau.
Paul me donne une bonne tape dans le dos. Il reprend :
Un long silence interrompt notre conversation. Puis, nous nous regardons dans les yeux et nous éclatons de rire pendant 5 min.
Au cours d’une demi-heure non-stop, en buvant notre apéritif, je lui raconte le Liban.
À la fin, la porte de son bureau s’ouvre, c’est Jean Massaud. Nous nous levons.
Nous sortons et nous nous dirigeons vers l’ascenseur. Direction le 7e et dernier étage. C’est là que se trouvent les bureaux de Jean Massaud, le propriétaire du journal. Il fait partie de la 5e génération des Massaud qui ont dirigé le journal de père en fils. Le journal a été fondé en 1895, par l’un des pionniers du photo-journalisme, Léonce Massaud. C’était un avant-gardiste, un génie.
Le 7e étage est occupé uniquement par lui. Son étage comprend son appartement privé – il n’est pas marié et vit comme un vieux moine dans ses 200 m2 – où se trouvent en plus sa salle de sport et son bureau.
Une soirée à l’Élysée
C’est une soirée pas comme les autres que je vais vivre, en présence de mon oncle et de ma petite sœur. J’ai obtenu qu’ils nous accompagnent. Nous nous mettons sur notre 31. Le rendez-vous est à 20 h. Cette fois-ci, il n’y aura pas d’Ara, de Scarlett et de Tondor. Je leur ai demandé de nous laisser seuls, afin d’éviter toute gaffe. Ara pourrait apparaître en plein dîner et créer un enchaînement de petites catastrophes toutes imprévisibles, qui seraient dès le lendemain à la une des… journaux : Un perroquet qui parle à l’Élysée !
Il est 19 h 30 quand nous montons tous dans la nouvelle voiture d’oncle Jacques, une Tesla bleu nuit.
Sarah, qui est bien calée dans le siège arrière, pousse un long bâillement et intervient dans la conversation.
Nous partons dans un fou rire, alors que nous arrivons, déjà, devant les grilles de l’Élysée. Nous avons droit à la cour d’honneur. Nous sommes tous salués et contrôlés par les gendarmes de la Garde républicaine, avant de passer le grand portail. Puis, nous suivons les indications et nous nous garons sur le côté, à droite. Nous traversons la grande cour. Sur le perron, nous sommes accueillis par le Secrétaire général.
Après le vestibule d’honneur décoré avec des œuvres d’art contemporaines chinées par madame Macron, nous passons devant le grand escalier.
Dans le haut de l’escalier, une voix se fait entendre.
Sans attendre, Sarah se précipite et on la voit sautiller de marche en marche, sur le grand tapis bleu roi. Elle rejoint Brigitte Macron, tout essoufflée à mi-parcours.
Brigitte Macron descend tout doucement les marches en tenant bien par la main Sarah.
Nous la suivons. Et, nous nous arrêtons devant le salon Cléopâtre.
Elle se tourne alors vers mon oncle.
Nous arrivons dans le jardin d’Hiver où la quinzaine d’invités a déjà pris place.
Paul Roderre vient à notre rencontre, suivi d’un serveur qui nous apporte des flûtes de champagne. Une voix protocolaire se fait entendre :
À cette annonce, tous, nous nous tournons vers l’entrée de la pièce chapeautée d’une verrière. Le président nous rejoint tout sourire.
Quelques applaudissements nourrissent ses propos. Des « vive Arthur » fusent. Puis, nous suivons le couple présidentiel. Brigitte se retourne.
Il porte bien son nom. Décorée par Napoléon III, cette pièce était celle de son conseil des ministres. Huit régnants étrangers y sont représentés : l’empereur François-Joseph d’Autriche, le pape Pie IX, les rois Victor-Emmanuel d’Italie, Frédéric-Guillaume IV de Prusse, Guillaume Ier de Wurtemberg, la reine Isabelle II d’Espagne, la reine Victoria du Royaume-Uni, et le tsar Nicolas Ier de Russie.
Nous nous étions tous assis autour de la grande table. Nous nous levons d’un coup, notre coupe de champagne à la main. Et nous trinquons les uns avec les autres.
Au moment où je trinque avec Brigitte Macron, au cliquetis du bruit qui s’échappe de l’entrechoquement des deux flûtes, je me retrouve, soudainement, ailleurs, dans une autre pièce de l’Élysée.
Le général de Gaulle
J’entends une voix typique, que je reconnais facilement. Et, je le vois, là, devant moi, en chair et en os. Mon ubiquité me fait rencontrer, de nouveau, le général de Gaulle. La première fois, je l’avais rencontré pour fêter son anniversaire. C’était au Liban, le 22 novembre 1930. Il y était avec toute sa famille, depuis un an. En tant que commandant, il dirigeait les renseignements militaires et le service opérations. J’avais bénéficié, là encore, de mon don d’ubiquité. C’était incroyable.
Et là, de nouveau ! Comment est-ce possible de le revoir ici à son bureau de Président ? Je me retrouve face à lui, devant ce monument de la Ve République, devant ce héros aux deux étoiles de la Seconde Guerre mondiale, qui a sauvé les Français du Nazisme et du Stalinisme. Devant, le grand homme qui a redonné à la France son indépendance et sa souveraineté, tout en sauvegardant son histoire et ses racines.
J’avoue que je ne sais pas quoi lui répondre. Je comprends que je suis son conseiller personnel en communication. C’est exactement cela. Je le lis dans la lettre qu’il vient de me remettre et qui est adressée à Arthur de La Madrière, Conseiller personnel du Président en Communication. Nous sommes dans le salon Doré, et avec sa stature il m’impressionne. Mais, il ne me domine pas de sa phrasée, de sa gestuelle et de ses hausses de ton. Il a gardé son caractère et son style militaire. Notre conversation reste assez simple et directe, même si le sujet est grave. Nous sommes en mai 1968. La révolution estudiantine gronde. Le vieux président se demande ce qu’il doit faire. Dois-je envoyer ou non la troupe contre les étudiants et les ouvriers, si les choses devaient empirer ?
Il faut voir le général se lever d’un trait. Il hausse maintenant le ton. Fait les 100 pas entre son bureau et la grande porte-fenêtre qui donne sur le parc. Il tourne autour et pose ses mains sur mes épaules, en répétant : « Capituler face à ces jeunes, qui ne connaissent rien de la vie, jamais. Vous m’entendez, Arthur ? JAMAIS ! »
Il me regarde droit dans les yeux pour m’impressionner. Il ne crie pas pour autant. Il n’en a pas besoin. Avec ses grands bras, ses grands gestes, la diction de ses mots, lente et précise, il sait qu’il n’a pas d’autre choix, s’il veut éviter un bain de sang, une mini guerre civile. Il doit partir.
Le général de Gaulle se lève. Je lui emboîte le pas. Nous nous retrouvons dans sa salle à manger familiale. Nous ne sommes que tous les deux. Il débouche une bouteille de champagne. Puis, il lève son verre et dit :
C’est, en effet, là qu’il se rend dès le lendemain matin, à l’aube. Il est parti en Allemagne rejoindre le quartier général des forces françaises, où il retrouve Massu…
En même temps, mon don d’ubiquité me permet d’être pleinement à la soirée des Macron. Comment leur dire que je suis, aussi, en tête-à-tête avec le général ? Impossible, il me prendrait pour un fou.
Jean Massaud et Paul Roderre se regardent et répondent ensemble.
Tous éclatent de rire. Moi, le premier !
Parmi la quinzaine de personnalités, Brigitte Macron a invité dans un souci d’équilibre 4 Arméniens et 4 Libanais. Parmi les 4 Arméniens, il y a le fils de Charles Aznavour, Nicolas et son épouse. Il y a, également, le bienfaiteur que j’avais rencontré en Arménie, Tigran Gazadirian et son épouse. Parmi les 4 Libanais, il y a le célèbre homme d’affaires, Ibrahim Sharouy, accompagné de l’égérie d’une grande marque de luxe française.
Il est, toujours, très bien accompagné. Et ce fameux grand professeur Sfeir. Ah, comme nous avons bien ri ensemble, lorsque nous nous sommes revus ! Le couple Macron n’a pas manqué d’inviter Maya Mahhad, cette jeune orpheline propriétaire de la célèbre librairie qui porte mon prénom Arthur.
À table, elle est à ma droite. Je tombe de nouveau sous son charme. Nous avons juste un an de différence.
I
De retour en Anjou
Le dîner à l’Élysée s’est terminé avec une annonce personnelle du Président de la République.
Cette annonce inattendue est une vraie surprise. Je ne sais pas quoi dire. Je n’ai plus de voix. Je rougis. Un silence sort de ma bouche bée. Nous nous regardons en souriant.
Nous nous sommes salués sur le perron. Brigitte m’a embrassé. Puis, une longue nuit de sommeil a suivi.
Le vendredi, nous partons avec Sarah, juste après le déjeuner.
C’est oncle Jacques qui s’est mis aux fourneaux. Avec Sarah, nous le retrouvons dans la grande cuisine.
Nous éclatons de rire, car au moment où elle pose cette question, elle vient de découper une tomate qui l’a éclaboussée en plein sur le visage.
Nous déjeunons vers 13 h sur la terrasse. Le soleil est, en effet, radieux. La température dépasse les 20 °C.
Puis, nous partons vers 14 h. De nouveau, oncle Jacques me prête sa vieille Alpine Renault 130 RTS.
Oncle Jacques nous salue de la main. Plus je voyage, plus je l’aime. Lui, le grand aventurier. J’aime bien passer le voir à Paris. Il me rappelle mon père. Ils se ressemblent tellement, comme de vrais jumeaux.
Oui, c’est un grand aventurier, car outre l’Asie, il a fait, également, l’Afrique. Il aime beaucoup retourner en Afrique du Sud. Après le décès de papa, il avait mis entre parenthèses tous ses voyages. Puis, un an après, il les a repris. Mais il voyage moins qu’avant.
Je prends la direction du périphérique aussi bruyant que pollué. La capitale s’éloigne. Nous empruntons l’autoroute A6. Nous dépassons souvent les 130 km/h. Il faut que je fasse attention, car cette voiture est un petit bolide.
Je la conduis depuis mes quinze ans. Je profitais des vacances d’été à La Madrière pour me glisser dedans et faire le tour du village. À l’époque, la voiture avait l’ancien moteur thermique, qui faisait beaucoup plus de bruit.
Je n’avais pas peur de la vitesse. Et, quand j’accélère, je pense à mon père. Dès le plus jeune âge, vers 5 ans, il m’avait mis dans un mini-kart. Il m’a, ainsi, transmis sa passion pour le sport automobile, pour la vitesse.
Les souvenirs remontent à la surface alors que nous nous approchons de Chartres.
C’est vrai, mon père était un pilote hors du commun. Il a remporté plusieurs fois le Paris-Dakar. Mes yeux s’embuent à son souvenir.
Pour mes 10 ans, il avait décidé de faire les 24 h du Mans. Et, il a terminé sur le podium. Je m’en souviens très bien, car nous avions fêté mes 10 ans sur place.
Arrivé 3e, il avait déclaré :
J’étais dans ses bras, et tous les frères et sœurs étaient au pied du podium. Sarah et Gabriel n’étaient pas encore nés. Ce jour-là, j’ai eu droit à ma première flûte de champagne, juste un fond, un doigt.
Ah, comme il me manque.
Ah, comme je l’aime, ma petite sœur. Avec elle, le monde ressemble à un conte pour enfants. Un monde merveilleux où brillent, dans les yeux des êtres aimés, les lueurs de l’espièglerie, de l’innocence et de la tendresse.
La route est facile. C’est étonnant, il y a peu de circulation. Je roule entre 130 et 135 km/h sur l’A11, qui vient d’être refaite. Les paysages de la Beauce sont magnifiques. Ils ont revêtu leur manteau d’automne. Les champs de blé, de colza, de maïs, d’orge et de seigle sont dénudés. Ils ne sont plus que des tapis de semences, qui attendent le printemps et l’été pour s’éveiller, grandir et germer…
J’emprunte la sortie numéro 2 vers Chartres. 10 min après nous nous arrêtons devant la cathédrale.
En sortant de la voiture, je la prends dans mes bras et nous nous faisons un gros câlin. Avec sa petite robe mousseline, elle me fait penser à Sissi l’impératrice.
Je regarde les flèches de la cathédrale, et je me souviens qu’au mois de juin nous les avions survolées avec Tondor. Tiens, cette fois-ci, ils ne sont pas là, Ara, Scarlett et Tondor.
Ils n’ont plus donné signe de vie. Je les ai oubliés. Je ne sais même pas si j’ai pris avec moi le fameux bâton de Moïse, Bamoï.
De nouveau, et je ne sais pas pourquoi, je pense en regardant les flèches, à celle du mémorial du génocide arménien. À Tsitsernakaberd, à Erevan en Arménie. L’Arménie me manque, comme le Liban. J’y ai vécu des moments inoubliables. Ah, comme les Arméniens et les Libanais se ressemblent, finalement. Ils ont vécu tant d’épreuves. Ils sont toujours là. Ce sont des survivants. Plus que résilients, ils sont des combattants.
Nous entrons dans cette cathédrale majestueuse. Dire qu’elle existe depuis 1230. Elle a été construite sur les bases de l’ancienne cathédrale carolingienne, détruite par le feu. Quelle durée ! Elle en a vu des femmes et des hommes prestigieux. Je pense notamment à Henri IV. Il y a été sacré. Habituellement, les rois étaient sacrés à Reims, mais là non. Est-ce lié à la religion protestante qui s’étendait comme l’huile sur le feu dans le Royaume de France ? Je m’interroge.
Je pense également à un autre personnage célèbre que j’ai étudié pendant mes études supérieures, je pense à Noël Parfait. Quel nom et quel prénom ! C’était un député des années 1850, qui s’est opposé à Louis-Napoléon Bonaparte, alors président de la République. Après le coup d’État du 2 décembre 1851, il a dû s’exiler en Belgique. Il est devenu le secrétaire d’Alexandre Dumas. Il a pu revenir en France. Il est devenu journaliste et puis, il a été de nouveau député. C’est pour cela que je l’aime beaucoup. Sans lui, Alexandre Dumas n’aurait pas été le grand Alexandre.
Et puis, en franchissant la grande et lourde porte de la cathédrale, je ne peux m’empêcher de penser à Péguy. Ah Péguy ! Dans la pénombre de la cathédrale, je pense à ce priant-poète, à sa vie, à ses engagements politiques, à ses écrits poétiques. Il est étonnant cet homme de gauche qui s’est converti. Et qui, ensuite, a fait de la cathédrale son palais préféré. Il aimait souvent marcher entre Paris et Chartres. Pendant ses deux ou trois jours de marche, il écrivait. Sa plume devenait lyrique.
Dans l’un de ses poèmes, Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, il fait virevolter sa plume :
Un homme de chez nous, de la glèbe féconde
A fait jaillir ici d’un seul enlèvement,
Et d’une seule source et d’un seul portement,
Vers votre assomption la flèche unique au monde.
Un homme de chez nous a fait ici jaillir,
Depuis le ras du sol jusqu’au pied de la croix,
Plus haut que tous les saints, plus haut que tous les rois,
La flèche irréprochable et qui ne peut faillir.
Tour de David, voici votre tour beauceronne.
C’est l’épi le plus dur qui soit jamais monté
Vers un ciel de clémence et de sérénité,
Et le plus beau fleuron dedans votre couronne.
C’est la pierre sans tache et la pierre sans faute,
La plus haute oraison qu’on ait jamais portée,
La plus droite raison qu’on ait jamais jetée,
Et vers un ciel sans bord la ligne la plus haute.
Je connais ce poème par cœur. Je le récite souvent, comme s’il devenait une sorte de prière.
Je sors de ma rêverie, et j’entends Sarah qui m’appelle en chuchotant fortement. Elle me fait de grands gestes. Elle est du côté de l’autel. En la rejoignant, je regarde les magnifiques rosaces aux couleurs bleu, rouge et violet, qui me fascinent toujours.
Je me rapproche de l’autel.
Je vois une petite larme rouler sur sa joue. Je la prends dans mes bras, lui fais un gros bisou et la serre très fort.
Elle me prend la main. Et, m’entraîne vers la statue de la Vierge Marie, Notre-Dame du Pilier.
En commençant cette prière, je me souviens que c’est à cet endroit-là que j’avais vu, lors de mon dernier passage avec Sarah, des rayons de soleil illuminer la statue de la Vierge.
Cette fois-ci, rien d’extraordinaire ne se passe.
Je ne lui ai jamais raconté cette histoire de la Vierge, avec le prénom de la reine Anahit qui s’était inscrit comme par magie sur le front de la statue.
Sur la route de tante Angèle
Nous filons en direction de Tours. Il est 16 h. Nous serons chez tante Angèle dans moins de deux heures. Nous empruntons les routes de campagne, via la nationale 10. L’Alpine va parcourir les 200 km en moins de deux heures. J’évite les excès de vitesse. Nous passons Châteaudun, Vendôme et Monnaie. Nous arrivons dans le nord de Tours vers 17 h 30. Je rejoins la route de l’aérodrome. Oncle Jacques s’y est souvent posé. Nous passons devant la BA 705. C’est là qu’il a appris à piloter. Il n’avait pas 17 ans. C’était le plus jeune pilote de sa génération. Il était un as des as. Comme j’aurais aimé le connaître dans ces années-là.