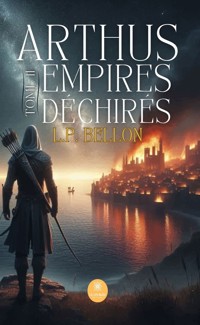
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Novembre 1202. La croisade lancée par le pape Innocent III s’enlise. Avant même d’atteindre l’Orient, les croisés tombent sous l’emprise de Venise. Arthus, jeune Provençal au cœur sincère, est propulsé dans un choc brutal entre l’Occident et Byzance. À Constantinople, cité envoûtante et perfide, il découvre un monde d’intrigues, de trahisons et d’alliances instables. Pris dans un jeu qui le dépasse, parviendra-t-il à garder le cap et à tracer sa propre voie ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
L.P. Bellon n’avait jamais envisagé une carrière d’écrivain auparavant. Toutefois, les auteurs tels que Follet, Eco, Druon, Calmel et de nombreux historiens médiévistes ont réussi à aiguiser sa curiosité pour la période des 12 et 13 siècles. Tout naturellement, l’inspiration pour ce premier roman lui est venue des zones d’ombre qui ont entouré le détournement de la croisade de 1204.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L.P. Bellon
Arthus
Tome II
Empires déchirés
Roman
© Lys Bleu Éditions – L.P. Bellon
ISBN : 979-10-422-8287-5
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À Sylvie, ma sœur de cœur,
À Cherazade, ma plus belle rencontre,
À mes parents,
À mon fils,
À mes lecteurs et à mes lectrices,
présents et futurs,
compagnons fidèles et passionnés.
1
L’an de grâce 1202 fut une année de tumulte et de désillusion, une année où le fer se mêla à l’opportunisme et où la piété sembla vaciller sous le poids de la dette et de la convoitise. La croisade, initialement voulue par le pape, Innocent le troisième, pour libérer la Terre sainte des infidèles, sombrait déjà, avant même d’effleurer les rivages d’Orient, dans les eaux troubles de la politique vénitienne et des compromis financiers. Le siège de Zara s’était dressé comme un sombre présage, annonçant non pas la gloire de Dieu, mais la déchéance d’un idéal.
Comment les croisés, animés par une foi fervente et un désir sincère de délivrer Jérusalem, s’étaient-ils retrouvés inextricablement liés à Venise ?
L’orgueil et l’opulence de la Sérénissime incarnée par son doge, Enrico Dandolo, n’étaient pas sans contrepartie. Le transport maritime, indispensable à la vaste entreprise portée par les soldats du Christ, avait été négocié. Mais à quel prix ! La somme colossale due par les armées croisées, après maintes promesses et collectes laborieuses, ne put être réunie dans sa totalité.
Cette dette faisait suite à la défection de plusieurs milliers de chevaliers et de barons qui avaient boudé le départ depuis Venise pour préférer d’autres itinéraires qu’ils avaient jugés peut-être moins onéreux.
Elle menaçait non seulement d’anéantir l’expédition avant même son commencement, mais aussi de réduire à néant les investissements de la République vénitienne.
Le vieux doge, homme d’État pragmatique et calculateur, vit dans cette situation une occasion inespérée. Il proposa un marché cynique déguisé en solution providentielle : en échange d’un report de leur dette, les croisés devaient prêter leurs épées et leurs bras à la reconquête de Zara la Dalmate, cité prospère qui s’était détournée des lois vénitiennes pour se soumettre à la Couronne hongroise.
Zara. Un nom qui résonnait comme une dissonance stridente aux oreilles de nombreux croisés. Une ville chrétienne, baptisée du même sang rédempteur que le leur, allait devenir la cible de leur fureur guerrière.
L’idée même de verser le sang de frères en Christ pour assouvir les appétits mercantiles de Venise était insupportable pour certains. Des voix s’étaient élevées, portées par des cœurs purs et des consciences tourmentées. Elles dénonçaient la trahison des idéaux, l’infamie d’un acte sacrilège.
Parmi ces voix, on entendait celles de barons et de prélats respectés qui voyaient dans cette entreprise un péché mortel.
Mais les murmures de la conscience furent recouverts par le cri des ambitions et la pression des nécessités.
Le doge, en stratège expérimenté, sut jouer des divisions et des intérêts divergents au sein de l’ost. La promesse de butin et surtout la peur de se retrouver bloqués à Venise, entravés par une dette accablante, finissent par convaincre une majorité de chevaliers.
Le pape Innocent, en gardien vigilant de la chrétienté, avait flairé le danger. Il adressa des lettres véhémentes aux croisés, les mettant en garde contre les conséquences désastreuses de leur entreprise. Il menaça d’excommunication quiconque oserait lever la main contre une cité chrétienne et, par conséquent, sous sa protection. Ses avertissements, bien que portés par des messagers zélés, arrivèrent trop tard ou furent ignorés par ceux qui avaient déjà scellé leur pacte avec l’ambition.
Le 10 novembre 1202, les premières pierres volèrent au-dessus des murailles de Zara. Le siège commença, écrivant une page sombre de l’histoire des croisades.
Les cris de guerre des assaillants se mêlèrent aux lamentations des assiégés, et le sang chrétien coula, souillant la terre d’une manière que la foi ne pourrait facilement effacer.
Le siège dura deux semaines, et le gros de la bataille cinq jours.
Malgré une défense vaillante, la ville rebelle ne put résister à la puissance combinée des forces vénitiennes et latines.
Le 24 novembre, la cité tomba. Le drapeau de Venise flotta triomphalement au-dessus des remparts, symbole d’une victoire amère, d’une conquête entachée de sang et de sacrilège.
La prise de Zara allait marquer le crépuscule de l’idéal croisé. Elle révélait au grand jour les faiblesses humaines, la corruption de l’ambition et la fragilité de la foi face aux pressions du pouvoir et des richesses. Elle annonçait la transformation de la croisade en un instrument de pouvoir au service d’intérêts purement politiques et économiques. Elle était un exemple tragique de la manière dont les intentions les plus nobles pouvaient être perverties, rappelant que la foi peut être éclipsée par l’appétit de pouvoir et de gloire.
Daniel Balbi, en armure sur son cheval, attendait dans les derniers rayons du soleil se couchant sur l’Adriatique. Avec sa petite troupe, il s’était posté sur le flanc sud-est d’une cluse au fond de laquelle serpentait la route menant à Zara. S’il comptait bien, la troupe du capitaine Romuald ne tarderait pas à passer par là, chargée du butin de son pillage.
Car il fallait bien que l’armée croisée reconstitue ses stocks.
Les chefs de guerre avaient décidé de confier au contingent de l’évêque de Soissons l’organisation du pillage des environs de Zara. Il fallait remplir les réserves, mais cela devait être fait dans les règles que le pape lui-même, mis devant le fait accompli, avait validées, probablement à contrecœur.
Le petit contingent de Toramina dans le comté de Provence, gracieusement prêté par le seigneur Balbi, fut affecté à certaines de ces missions, sous le commandement du capitaine Romuald.
Daniel avait prétexté une autre opération de pillage non loin de celle prévue et menée par Romuald. L’opération, l’autorisant à déplacer environ quarante soldats, était pure invention et par conséquent illégale au regard des règles édictées par le souverain pontife, mais personne ne le vérifia réellement.
Daniel avait le don de s’entourer de personnages peu recommandables. Ces derniers trouvaient auprès de lui un discours bienveillant qui leur promettait richesses et merveilles. En échange, il trouvait la reconnaissance qui lui faisait tant défaut au sein de l’ost. Il avait décidé d’en user afin de régler ses comptes une bonne fois pour toutes.
Il avait recruté sans difficulté quelques mercenaires au sein de l’armée croisée, en prétendant que leur mission était d’intercepter un convoi de déserteurs, dont ils allaient pouvoir se partager la cargaison. Il n’en fallait pas plus pour aiguiser l’appétit de brutes, dont la foi était entachée d’impuretés et la morale inexistante, ce qui permit de constituer rapidement une petite armée équipée jusqu’aux dents.
Aucun soldat sous les ordres de Daniel ne devait porter la croix afin qu’aucun témoin de ce qui allait se produire ne pût impliquer un quelconque contingent croisé.
À la tête de son escouade de soudards, il avait bel et bien l’intention de tendre une embuscade au capitaine Romuald et à la troupe de Toramina.
À ses côtés se tenait un ancien soldat de la garnison de Toramina, qui se faisait appeler Lupus, et qui avait préféré rejoindre son armée plutôt que de rester sous les ordres de messire Romuald.
— Te sentiras-tu le courage de mener à bien ta mission, Lupus ? lui demanda-t-il. Il n’est pas encore trop tard pour renoncer. Et je ne t’en voudrais point si c’était le cas.
— Vous savez, messire, lui répondit Lupus, la rancœur que j’éprouve pour le capitaine.
— Il est vrai que tu as un lourd passif avec Romuald. Mais il s’agit aujourd’hui de faire plus que te venger de lui. Ceux qui ont été tes frères d’armes vont mourir.
— Ils ne sont plus ce que vous dites pour moi, monseigneur. Et, si je puis me permettre, ils ont aussi été vos frères d’armes, en qui votre père a mis sa confiance pour porter celles de la maison Balbi en Orient.
Daniel fit mine de ne pas relever.
— Ne t’avise pas de me trahir lorsque ta conscience rongée par le remords viendra te hanter, s’il plaît à Dieu que tu vives suffisamment longtemps.
— Monseigneur, je vous resterai fidèle, quoi qu’il m’en coûte.
Daniel hocha légèrement la tête pour signifier qu’il prenait acte de la position de Lupus.
Quand le contingent se présenta enfin à l’entrée de la cluse, le soleil venait juste de passer derrière les collines. Il faisait encore assez clair pour lancer l’attaque.
Daniel se coiffa de son heaume.
Il attendit que la moitié du convoi fût passée pour lancer la charge sur le flanc gauche. Bénéficiant de l’effet de surprise et de l’avantage tactique que lui donnait sa position, la troupe prit rapidement le dessus. Le capitaine Romuald et Gontran, le frère de Daniel, tentèrent de redéployer leurs hommes, mais le terrain trop étriqué ne s’y prêtait pas.
Face à tant d’opposants aussi bien équipés, le capitaine Romuald tomba, et la troupe de Toramina fut littéralement taillée en pièces.
Daniel donna le signal du retrait, épargnant ainsi la vie de son frère et de deux soldats qui réussirent à s’échapper.
Après avoir laissé la horde de mercenaires se partager le butin, il quitta le lieu de l’embuscade sans même jeter un regard à ses anciens frères d’armes qu’il avait tout bonnement assassinés.
Après avoir traversé les Alpes pour rejoindre la Vénétie et présenté ses deux fils à l’évêque de Soissons, le seigneur Balbi était reparti vers son fief, car son âge et une ancienne blessure occasionnée lors de la précédente croisade ne lui permettaient plus d’assister à une nouvelle opération militaire.
Le départ retardé de l’armée pour l’Égypte puis le détournement vers Zara avaient profondément contrarié Daniel qui voyait dans ces contretemps les conséquences de considérations mercantiles et politiques au détriment de la foi chrétienne.
Il avait logiquement refusé de participer au siège de la cité dalmate, comme beaucoup de chevaliers.
Enfin, la mission de pillage que l’on confiait à sa troupe avait été la goutte d’eau qui avait fait déborder le vase.
Quelques jours avant l’embuscade, il s’adressa à son frère Gontran. Il ne décolérait pas.
— Nous ne nous sommes pas croisés pour piller des terres chrétiennes ! s’insurgea-t-il.
— Nous n’avons pas bien le choix, lui répondit Gontran.
— Et encore moins sous les ordres de cet incompétent de Romuald, ragea Daniel, comme s’il n’avait pas entendu son frère.
— Je sais que vous avez toujours été en profond désaccord avec messire Romuald, mais c’est à lui que l’évêque a prêté sa confiance et de facto donné ses ordres. Soyez patient, mon frère. Un jour, vous serez reconnu pour vos faits d’armes.
Daniel aimait profondément son frère et il lui sut gré de lui parler ainsi. Seulement, il avait oublié ce qu’était la patience.
Il avait, peu ou prou, obtenu ce qu’il souhaitait : Romuald avait été renvoyé ad patres, Gontran avait eu la vie sauve, mais il ne commandait plus d’hommes, du moins pour le moment. Enfin, personne ne s’était douté qu’il fût à l’origine de l’embuscade.
Bien qu’il n’eût souhaité en aucune façon la mort de son frère, un sentiment contradictoire de vengeance s’était un moment immiscé dans son esprit. De ce point de vue, il avait réglé ses comptes.
Au fil du temps, il s’était retrouvé à la tête des pires soldats de l’ost, un peu malgré lui. Et pour cela, on lui rendit grâce, car il était le seul à pouvoir les supporter et à maintenir un semblant de discipline, mais en apparence seulement.
Il était tout simplement devenu plus fou que les hommes qui s’étaient ralliés à lui.
Ils le respectaient pour cette raison.
Son caractère exécrable contribuait à asseoir son autorité, ce qui lui valut les bonnes grâces des chefs de guerre.
Pourtant, malgré les quelques succès qu’il avait finalement obtenus, il n’était pas satisfait. Privé d’une véritable armée de chevaliers, il se sentait frustré.
De colérique, il devint hystérique. Si bien qu’on le craignit au sein de l’armée au-delà de son propre contingent.
2
22 décembre 1202 – Venise, port de l’arsenal
L’imposante galère arborant les armes de la République de Venise glissait lentement vers l’embouchure du port. Navire de guerre par excellence, inconfortable au possible, L’Aquila mesurait environ vingt-trois toises de long pour trois de large. Elle disposait, en outre, de deux mâts équipés de voiles latines. La proue était ornée d’une tête de bélier en bronze au ras des flots. Le pont central était principalement constitué de treize bancs sur les deux bords, recevant chacun trois rameurs manipulant une rame.
Ceux-ci étaient organisés alla sensile. Les cinq premières rangées étaient occupées par les buonavoglia, rameurs volontaires et libres. Les cinq derniers bancs de nage l’étaient par les zontaroli, des conscrits que la République avait enrôlés pour les besoins de la croisade. Enfin, les trois rangées du milieu étaient réservées aux sforzati, des criminels que leur malfaisance avait condamnés à la rame. Ces derniers, formant un équipage de moins bonne qualité, étaient disposés au milieu des rameurs plus qualifiés afin de les entraîner à maintenir la cadence nécessaire à la bonne marche du bâtiment.
L’Aquila, navire flambant neuf, sortait tout droit du chantier naval de l’arsenal. Une dizaine de milliers d’ouvriers et d’artisans y travaillaient toute l’année. On y avait instauré la pratique du travail à la chaîne. Le chantier le plus gros d’Europe assemblait des navires de toutes tailles pour tous usages depuis presque cent ans. Parmi ceux-ci, on comptait les quatre cents navires de guerre que la République avait vendus en partie aux croisés pour les transporter jusqu’en Égypte.
On nous invita à nous installer sur le château-avant de L’Aquila afin d’assister aux manœuvres du départ.
Nous étions dix-sept passagers à embarquer pour la ville de Zara, que Venise venait de reprendre au roi de Hongrie, en échange du moratoire sur la dette que l’armée croisée avait contractée envers la République pour traverser la Méditerranée.
Je me remémorai les événements qui m’avaient conduit à embarquer à bord de L’Aquila.
Au début de l’an de grâce 1202, je me trouvai redevable envers Sancha Nunez de Lara, comtesse du Roussillon, qui, lors de son passage à Salon-de-Provence, me tendit une main salvatrice. Échappant ainsi à la vengeance de princes aragonais dont j’avais imprudemment froissé l’honneur, je me liai à elle par une promesse des plus exigeantes.
En contrepartie, je devais retrouver la trace, depuis les murs de Vérone, de la progéniture illégitime de Boniface de Montferrat, figure de proue de la croisade alors en préparation. Or, cette entreprise se révéla semée d’embûches, et je ne fus pas exempt de revers. Mon complice véronais, Desiderio, subit une fin tragique sur la potence. Quant à Mona, rencontrée quelques mois auparavant, elle connut le triste sort d’être jugée pour sorcellerie par l’Inquisition.
Le doge de Venise, Enrico Dandolo, eut vent de mes agissements. Il profita de l’occasion pour évincer le marquis Boniface de Montferrat, qui avait été choisi pour diriger la croisade, et le lança à mes trousses à travers la Souabe. Dandolo prit les rênes de l’expédition, démunie de chef, et la détourna vers Zara, province vénitienne en rébellion qu’il souhaitait faire revenir dans le droit chemin de la République.
Tandis que Dandolo mettait le cap sur Zara, Boniface me poursuivit sans relâche. Ce fut une traque acharnée qui, finalement, me mena au contact du fils de mon persécuteur, dont certains avaient imaginé un moment qu’il pouvait représenter une menace politique. Mais la nature avait frappé ce rejeton d’une infirmité congénitale, le condamnant à l’impuissance, incapable de la moindre malice.
L’affaire aurait pu en rester là. Pourtant, le chemin jusqu’à cette résolution avait été semé de troubles et de perturbations, témoignages de la tourmente que j’avais traversée.
Le destin, dans un tour de main inattendu, fit converger nos chemins en Souabe, ceux de Boniface, d’Alexis Ange, de Sancha et du mien.
Sancha, douée d’une sagacité politique indéniable, conseilla à Boniface de prendre Alexis sous sa protection et de l’aider à récupérer le trône de Byzance usurpé par son oncle. À Byzance, Boniface pourrait trouver les richesses nécessaires pour acquitter la dette de l’ost envers Venise.
De surcroît, elle décréta que je devais me lier corps et âme à l’armée de Boniface. Ce devait être ma punition car ma mission avait été ébruitée, ce qui constituait un échec pour sa part. Mais peut-être aussi que la comtesse avait d’autres raisons qui lui étaient propres pour exiger cela.
Boniface implora l’aide de Philippe de Souabe, son suzerain, roi de Germanie et beau-frère d’Alexis. Philippe, dont l’esprit était occupé par la guerre civile qui ravageait le Saint-Empire, se contenta d’envoyer des ambassadeurs pour persuader les croisés d’aider le jeune Alexis Ange. Ces émissaires nous précédèrent de trois jours sur le chemin de Zara, où les croisés étaient désormais rassemblés depuis plusieurs semaines.
Il était grand temps pour nous de mettre les voiles pour la côte Dalmate.
Ainsi, à bord de L’Aquila, il y avait comme passagers : Boniface de Montferrat, l’officiel chef de la croisade qui comptait bien reprendre sa place, son fidèle ami, Geoffroy de Villehardouin, maréchal de Champagne et le non moins fidèle soldat Paolo, tous trois rescapés de la poursuite en Souabe.
Venait ensuite le jeune prince Alexis Ange, fils de l’empereur déchu Isaac Ange, que le frère, non content d’avoir usurpé le trône, avait aveuglé et jeté en prison, et qui espérait avec ferveur que justice lui soit rendue. Il était accompagné de son aide de camp et complice de son évasion des geôles impériales, Arnoldo le Pisan.
On comptait également l’énigmatique Béranger de Marseille, que j’avais rencontré sur la route de Vérone et qui avait soudainement réapparu depuis quelques jours.
Toujours parmi les passagers, on comptait dix soldats flamands qui nous avaient été confiés par Philippe de Souabe.
Et enfin moi-même.
Les rameurs accélérèrent la cadence tandis que nous dépassions la pointe nord de la dune du Lido. Des chants marins se firent entendre tandis que nous mettions le cap au nord-est.
Le prince Alexis avait le plus à gagner dans cette entreprise. Il avait retrouvé fière allure après avoir passé quelques jours chez son beau-frère Philippe et grâce aux habits d’apparat qu’il lui avait offerts. Il lui faudrait convaincre les barons à Zara s’il voulait qu’ils l’aident à remettre son père, Isaac, sur le trône de Byzance.
Montferrat, lui non plus, n’avait guère été épargné par le destin ces dernières semaines. Bien qu’il fût chassé de sa croisade, qu’il découvrît l’existence d’un héritier illégitime, qu’il fût humilié par une femme, fut-elle comtesse, qu’il fût réduit au rang de tâcheron, investi de la mission presque impossible de détourner une deuxième fois la croisade ordonnée par un pape qui, malgré les apparences, avait jusqu’alors fait preuve d’une grande patience, les événements semblaient glisser sur lui sans véritablement l’atteindre. S’il était inquiet quant à la réaction des chefs de guerre face à cette nouvelle voie qu’allait possiblement prendre la croisade, il ne le montrait pas. Au contraire, il était d’une humeur joviale, jurant et blaguant avec toute sa verve lombarde.
— Par le cul du diable ! beuglait-il en s’adressant à Villehardouin. Que je sois pendu par les couilles si vous n’en avez pas jeté un par-dessus bord avant qu’on ne soit arrivé !
Il parlait de la cohorte de soldats flamands que Philippe de Souabe nous avait donnée ou plutôt dont il s’était débarrassé. Paresseux et indisciplinés, il avait fallu toute l’expérience de Villehardouin pour mater les soudards et faire régner dans la troupe un semblant d’ordre.
— Des pandours de la pire espèce, râlait Villehardouin avec un agacement non feint. À croire qu’ils réfléchissent avec le bout de viande qui leur sert de postérieur.
Pour ma part, même si je pouvais espérer meilleur sort, je ne m’en étais pas si mal sorti, bien que totalement dépassé par les événements et les enjeux politiques en présence. J’avais, au cours de ces aventures, perdu des amis chers qui me manquaient, et gagné des ennemis impatients de me voir pendu au bout d’une corde.
Pour le moment, j’étais davantage préoccupé par la présence de Béranger à bord, maintenant que j’avais la preuve qu’il appartenait à ce que j’avais nommé la « confrérie de la pieuvre » après avoir aperçu leur signe de reconnaissance, un médaillon doré, mi-crâne, mi-pieuvre, à son poignet.
Il était à peu près certain que la confrérie était à l’origine de l’attaque des brigands que nous avions subie en Souabe au cours de l’automne, et il était non moins certain qu’elle ne s’arrêterait pas sur ce nouvel échec. Pire, elle continuerait à me tourmenter jusqu’à ce qu’elle obtienne réparation des dégâts causés dans les exploitations minières de l’Argentière et auxquels j’avais largement participé.
De là à soupçonner Béranger de vouloir m’assassiner, il n’y avait qu’un pas. Malgré tout, je ne révélai à personne le sujet de ma préoccupation ni ne questionnai l’intéressé. Je me contentai de rester sur mes gardes, remettant mon enquête à plus tard.
Il nous tardait à tous de savoir comment la délégation de Philippe de Souabe, qui nous avait précédés, avait été reçue par les barons à Zara.
Compte tenu de l’absence de soleil le jour et de constellations la nuit, pour cause de conditions météorologiques défavorables, nous longeâmes la côte, passant au large de Trieste jusqu’à notre destination que nous atteignîmes le jour de Noël.
Zara se situait sur la côte dalmate derrière une myriade d’îles allongées dans une mer remplie d’écueils. Il fallait toute la dextérité d’un marin vénitien pour se diriger dans ce dédale.
Le capitaine manœuvra avec finesse et bientôt, lorsque la brume marine fut complètement levée, le port de Zara fut en vue, avec, derrière lui, de hautes murailles en partie démantelées.
Des hommes se trouvaient sur les fortifications qu’ils s’employaient à démonter pierre après pierre.
Pour le moment, ils avaient cessé leur travail et observaient le navire aux couleurs de la République de Venise qui approchait.
Le capitaine fit avancer lentement L’Aquila en se frayant un chemin entre la rive et l’immense flotte latine qui mouillait à quelques encablures de la côte.
Les tentes de l’armée recouvraient une très large partie de la grève. La bannière croisée flottait sur la partie gauche du camp, et la flamme de la République flottait sur la partie droite, de l’autre côté du port.
Sur le ponton d’accostage, une troupe de soldats se tenait prête à nous accueillir.
Mais quelque chose ne collait pas ; il nous sembla arriver dans un camp retranché. L’atmosphère était étrange, glaciale. Nous n’allions pas tarder à en connaître la raison.
Sitôt Boniface et Alexis débarqués, ils furent escortés vers la cité. Le doge Dandolo présidant le conseil de guerre des princes croisés les attendait. Paolo, Béranger et moi-même fûmes dirigés vers nos tentes, du côté du camp croisé.
L’atmosphère était pesante, presque aucun son ne s’échappait du camp.
— Mais enfin, que se passe-t-il ici ? On dirait qu’on veille les morts, interrogea Paolo, perplexe.
Le sergent qui nous accompagnait expliqua :
— À la suite du siège et de la prise de la cité, les Vénitiens, qui avaient fait le plus gros du travail, se sont emparés des plus belles villas pour s’y installer. Ce qui a provoqué des jalousies chez les Français. Il y a eu de nombreuses bagarres et nous avons eu à déplorer plus de morts que pendant le siège lui-même. Les barons ont eu toutes les peines du monde à calmer la situation. Alors, ils ont pris la décision de séparer les deux armées en attendant que nous reprenions la mer au printemps. Nous n’avons pratiquement plus aucun contact avec les Vénitiens installés de l’autre côté du port et réciproquement.
— Qu’est-il advenu de la population ? demandai-je.
— La moitié s’est exilée à l’extérieur de la ville, l’autre moitié vit encore dans certains quartiers.
— Pourquoi démantèle-t-on les défenses de la ville ?
— Pour punir les Zaraouites de s’être rebellés contre Venise. Décision du doge Dandolo. L’avantage, c’est que ça nous occupe en attendant la belle saison pour reprendre la mer.
Une fois ces paroles prononcées, le sergent nous indiqua nos tentes, puis il tourna les talons.
Quoique sommaires, elles seraient toujours plus confortables que les paillasses de L’Aquila.
Il ne nous restait plus qu’à savoir ce qui allait être décidé par les barons pour la suite des événements.
Alors que je sortais de ma tente, un soldat me dévisagea. Si je ne le reconnus pas tout de suite, lui, par contre, semblait bien me connaître.
— Messire Arthus ? m’interpella-t-il. Vous vous souvenez de moi ? C’est Augustino.
Augustino. Mon premier contact avec la garnison de la Bastide dans les environs de Toramina. C’était il y a presque un an déjà.
J’avais intercédé auprès de Daniel Balbi, le fils du seigneur local, pour qu’il fît partie du contingent que son père avait l’intention d’enrôler pour la croisade. Augustino se morfondait à la Bastide comme beaucoup de ses camarades et rêvait d’aventures en Orient. Mais au vu de la tournure des événements et de ce dont il me fit part, je ne fus pas certain que ce fût une bonne idée.
— Pour dire vrai, messire, c’est que le mauvais sort s’est acharné sur nous… D’abord à Venise, on a attendu longtemps avant de partir. Messire Daniel et messire Romuald, notre capitaine, ont failli s’entretuer… C’est messire Gontran, le frère de messire Daniel, qui a dû les séparer. Ensuite, quand on est partis, on nous a dit que ce n’était pas pour l’Égypte, mais pour Zara… Le siège n’a pas duré bien longtemps et c’était une bonne chose, mais après il y a eu les accrochages avec les Vénitiens. Messire Daniel est devenu de plus en plus aigri. Et ensuite, il y a eu cette mission… On devait piller un village aux alentours de Zara, pour refaire les réserves, vous comprenez… Mais sur le chemin du retour, on s’est fait surprendre par une horde de pillards et on a eu de grosses pertes parmi les gens de la maison. On a pu s’enfuir, messire Gontran, un camarade et moi. Même messire Romuald a trouvé la mort.
— Une embuscade, dis-tu ? Étaient-ils à ce point armés pour mettre en déroute une escouade de soldats croisés ?
— Très bien armés et probablement très bien renseignés.
— Je suis désolé d’apprendre ça, Augustino.
— Bah, que voulez-vous ? C’est comme ça. Dieu en a décidé ainsi, dit-il en se signant.
— Tu disais que messire Daniel est devenu aigri.
— C’est comme si parfois c’était quelqu’un d’autre. Il s’énerve pour un rien. Tenez, rien qu’hier soir, par exemple, il y avait quelques soldats qui faisaient la queue devant les tonneaux pour remplir leur bol de vin. Un tonneau était presque vide et le débit au robinet était faible. Mais il pouvait encore remplir une dizaine de bols. Un jeune soldat était en train de se servir. Messire Daniel venait ensuite. Celui-ci, trouvant que ça prenait trop de temps, perdit patience et il assomma le jeune soldat avec son bol. Le jeune fut emmené à l’infirmerie. Des voix s’élevèrent, les témoins prenant parti pour l’un ou pour l’autre. Une bagarre s’ensuivit. Il fallut l’intervention de plusieurs chevaliers pour que le calme revienne. Une fois de plus, ce fut messire Gontran qui calma son frère.
— C’est étrange : quand je les ai rencontrés, les deux frères avaient des personnalités exactement contraires à celles que tu me décris aujourd’hui. Daniel était calme et posé, tandis que Gontran était en permanence à fleur de peau.
— C’est fort juste ce que vous dites là, messire Arthus. Ce ne sont plus les mêmes personnes.
— Y a-t-il eu un événement qui a provoqué ce changement de comportement, en particulier chez messire Daniel ?
— Pas à ma connaissance, répondit Augustino en haussant les épaules. Messire Arthus, je dois vous laisser à présent. Je suis bien content de vous voir parmi nous. Que Dieu vous garde !
— Que Dieu te garde Augustino.
Inévitablement, la rencontre avec Augustino me rappela cette chère Mona. Son sourire et les taches de rousseur sur son corps me revinrent à l’esprit. Une bouffée de tristesse emplit mon cœur.
La journée ne toucherait pas à sa fin avant plusieurs heures. Je décidai de me rendre sur le port afin d’en savoir plus sur les délibérations du conseil de guerre qui devait encore se tenir à ce moment-là.
En laissant traîner les oreilles, je ne tardai pas à avoir une idée de la situation.
Les ambassadeurs de Philippe de Souabe avaient été écoutés avec beaucoup d’attention par les chefs croisés lors du conseil. Il avait été notamment question que, si le jeune prince Alexis était rétabli sur le trône de l’Empire, il s’engage à maintenir l’armée et la flotte croisée pendant une année, à verser deux cent mille marcs d’argent pour couvrir les frais de guerre, à fournir dix mille hommes qui viendraient grossir les rangs latins et à entretenir cinq cents chevaliers en Terre sainte jusqu’à sa mort. Et comme si cela n’était pas suffisant, il fut également évoqué qu’Alexis serait prêt à jurer sur les évangiles qu’il ferait cesser l’hérésie qui souillait l’empire d’Orient et qu’il soumettrait l’église grecque à l’église de Rome.
Ce discours avait fortement impressionné l’auditoire. Une fois leur mission terminée, les ambassadeurs avaient été renvoyés afin que le conseil des croisés pût délibérer.
Inutile de dire que les débats qui s’ensuivirent furent pour le moins tumultueux. Ceux-là mêmes qui s’étaient opposés à l’attaque de Zara montèrent à nouveau en première ligne.
Tour à tour, l’abbé cistercien de Vaux, puis le comte de Montfort prirent la parole avec véhémence, rejetant l’idée d’une expédition contre Constantinople. Ils arguaient du fait qu’Isaac Ange, le père du jeune Alexis, était lui-même un usurpateur, qu’il avait été l’ennemi des catholiques lors de la précédente croisade, et que, après tout, le peuple grec ne réclamait pas l’aide des soldats du Christ, contrairement aux chrétiens d’Orient.
« Si le malheur vous touche, proclamèrent les orateurs, et si vous êtes impatients de défendre la cause de la justice et de l’humanité, dirent-ils, en reprenant les termes du discours des ambassadeurs, écoutez les gémissements de nos frères de la Palestine, qui sont menacés par les Sarrasins, et qui n’ont plus d’espérance que dans votre courage. »
Philippe de Souabe fut aussi vivement critiqué. On lui reprochait de se borner à envoyer des ambassadeurs, et une poignée de soldats, plutôt que de prendre les armes, à défaut de rejoindre l’armée croisée pour secourir son beau-frère, qui faisait des promesses dont on n’était pas sûr qu’il pût les tenir. Enfin, si l’on cherchait des victoires faciles, alors il fallait se tourner vers l’Égypte qui connaissait en ces temps une grande famine réduisant considérablement sa capacité de défense face aux armes des chrétiens.
Ce à quoi les défenseurs d’une opération militaire en Grèce répondirent aussitôt qu’il pouvait justement être périlleux pour une grande armée de débarquer dans un pays à bout de ressources et dans lequel il serait impossible de compter sur le moindre ravitaillement.
L’arrivée à Zara du jeune Alexis et du marquis de Montferrat raviva les arguments des barons et des prélats en faveur d’une expédition vers Constantinople.
Quelle injustice, quelles souffrances ce jeune prince n’avait-il pas endurées ? Celui-là même qui maintenant prenait les armes pour sortir son père des geôles d’un empereur ennemi des catholiques. Cette piété filiale forçait l’admiration de nombre de chevaliers.
Dans le même temps, les barons avaient calmé l’ire du souverain pontife à la suite du pillage de Zara en lui envoyant une lettre dans laquelle ils disaient regretter leur geste, ainsi que de s’être détournés de leur principale mission, faisant preuve d’une grande dévotion. Ce à quoi le pape leur répondit qu’il fallait, dès que les conditions de navigation le permettraient, faire diligence vers l’Orient.
Mais une nouvelle fois, les événements allaient prendre Innocent de court.
Dans le cas où le pape serait séduit par les promesses du jeune Alexis ou par la perspective de voir fusionner les deux Églises chrétiennes et, de fait, de ne pas condamner une attaque de Byzance, une députation menée par l’abbé de Vaux allait se mettre en route pour Rome. Ses membres avaient l’intention d’argumenter devant Innocent que ce n’était pas une bonne chose de s’immiscer dans la politique grecque et que le jeune prince Alexis n’était pas légitimé à devenir empereur.
Par ailleurs, Simon de Monfort et le contingent d’Île-de-France affichèrent sans ambiguïté le souhait de quitter l’armée latine. Leur objectif était dorénavant de se rendre au plus vite dans le sud de l’Italie, d’où ils embarqueraient pour joindre directement Jaffa.
Les débats allaient probablement se prolonger toute la journée. Pour l’heure, je n’allais pas en apprendre davantage. Je décidai de retourner dans mes pénates en attendant la suite.
J’arrivai bientôt près du quartier des marins. C’est alors que j’entendis un aboiement dans mon dos.
Je me retournai.
Sur le coup, je n’en crus pas mes yeux.
Aussi incroyable que cela pût paraître, c’était bien Cendre qui me regardait ! Le molosse se tenait là, la truffe levée, l’œil pétillant, on aurait presque pu dire qu’il souriait jusqu’aux oreilles.
Mon cœur bondit. Si Cendre était là, Mona l’était-elle aussi ?
Il fit deux tours sur lui-même, m’indiquant que je devais le suivre.
L’animal m’emmena jusqu’à un vaste espace carré à ciel ouvert, délimité par des rangées de tentes qu’on avait placées là.
Au milieu régnait l’effervescence, toutefois, dans une certaine discipline. Chacun s’affairait autour de tables, de chaudrons et de foyers.
Il s’agissait d’une immense cuisine à ciel ouvert qui participait à nourrir une partie des deux armées croisées. En effet, de l’autre côté de cette grande place se trouvait le camp vénitien.
J’aperçus alors, au milieu du groupe des cuisiniers, une petite silhouette menue coiffée d’un tissu blanc noué derrière la tête et vêtue d’un grand manteau couleur azur.
Sans que je dise un mot, la petite silhouette se figea, se retourna comme si elle s’était sentie observée.
Les grands yeux bleus de Mona se posèrent sur moi. Elle lâcha aussitôt sa louche dans une gamelle et bondit vers moi. Nous nous embrassâmes sous le regard perplexe et légèrement agacé des cuisiniers.
— Je désespérais de te revoir un jour, me dit-elle en me serrant contre elle.
Cendre sautait joyeusement autour de nous, réclamant sa part d’embrassades.
3
Nous nous éloignâmes du tumulte des cuisines pour que Mona pût me raconter ses aventures depuis les événements de Vérone à la suite desquels nous avions été séparés.
Elle rassembla ses souvenirs puis commença.
— Nous étions, Cendre et moi, devant l’entrée des souterrains, comme nous l’avions convenu. Soudain, il sentit une présence autour de nous. Je choisis alors de nous cacher dans les souterrains afin d’observer de quoi il s’agissait et éventuellement t’avertir quand tu passerais. Mais quand je vis Desiderio filer en courant devant moi ventre à terre vers la sortie, je ne compris pas tout de suite ce qu’il se passait. Des hommes d’armes sortirent des buissons à l’entrée du tunnel et se jetèrent sur lui. Je décidai de partir à ta recherche, mais les soldats investirent tous les tunnels et, finalement, je me fis prendre au piège. Ils tentèrent d’attraper Cendre, cependant, il réussit à s’enfuir.
« Ils m’ont attaché les bras dans le dos et m’ont emmenée directement en prison. Ne te voyant pas arriver, j’ai repris espoir et j’ai pensé que tu avais pu t’échapper. Après quelques heures, je ne me souviens plus trop combien, le capitaine des hommes d’armes est venu m’interroger. Il m’a questionnée sur toi, sur ce que je savais des souterrains, si j’avais laissé des affaires ou des traces, mais bizarrement, il ne m’a posé aucune question sur le vol. Il semblait pressé d’en finir et je dirais même qu’il semblait vouloir effacer toute trace de cette affaire. À peine quelque temps plus tard, depuis ma cellule, j’ai entendu Desiderio que l’on allait bientôt pendre. Il hurlait qu’il voulait s’expliquer, qu’il voulait un procès. Ses cris cessèrent à l’instant où la corde lui rompit le cou. »
Mona fit une pause. Je racontai à mon tour ce qu’avait conclu Boniface à la suite de son enquête sur le vol de Vérone, la maladresse de Desiderio, son double jeu vis-à-vis des autorités et de sa faction de crapules, son scénario pour se rapprocher de nous pour mieux nous voler ensuite mais qui en fin de compte échoua.
Mona reprit le cours de son histoire.
— Je pensais ma dernière heure arrivée lorsqu’ils sont venus me chercher au matin. Mais au lieu d’être conduite au gibet, j’ai été remise à des moines. Ils m’ont mis un sac de toile sur la tête et m’ont emmenée dans un couvent, ou quelque chose de similaire. Puis, ils m’ont fait entrer dans un grand sac de toile et m’ont dit que j’allais être jugée pour sorcellerie. Je reçus quelques coups de bâton en réponse à mes protestations. Pour finir, ils m’ont laissée seule dans une pièce, toujours enfermée dans le sac. Régulièrement, des nonnes venaient me donner un coup de pied pour voir si j’étais toujours vivante. Ceci fait, elles sortaient bien vite. On aurait dit qu’elles craignaient de rester dans la même pièce que moi. C’est ce qui m’a sauvée car c’est lorsqu’elles eurent le dos tourné que Cendre est arrivé. Il avait pu se faufiler par un soupirail. Il a gratté, a fini par déchirer le sac de toile, a rongé mes liens et j’ai pu enfin me libérer.
Mona sourit pour elle-même.
— Je me suis dit que, pour m’échapper, je pouvais prendre le même chemin que Cendre. Le problème était qu’il me fallait suffisamment d’avance, car, si les nonnes se rendaient compte que je n’étais plus dans le sac, je serais immédiatement recherchée et rapidement retrouvée. C’est alors que j’eus une idée : s’ils voulaient de la sorcellerie, ils allaient en avoir ! Je fis entrer Cendre dans le sac. Le plan était qu’il reste à l’intérieur, que les nonnes continuent de lui donner des coups de pied, tandis que je m’enfuirais. Puis, lorsque les inquisiteurs viendraient chercher la fameuse sorcière, Cendre bondirait hors du sac au dernier moment. Beaucoup plus agile, il pourrait s’échapper sans difficulté, d’autant plus qu’il bénéficierait d’un effet de surprise. Je me glissai donc hors les murs du monastère par le soupirail étroit qui menait à l’extérieur juste avant que les nonnes ne reviennent pour leur ronde. J’aurais bien voulu être une petite souris pour voir la tête des inquisiteurs découvrant un molosse sortir du sac alors qu’ils s’attendaient à trouver une jeune fille sans défense, fut-elle présumée sorcière. Je les imaginai se signant à tour de bras, les plus téméraires fouettant l’air avec des crosses ou des bâtons, manquant de s’assommer ou de se briser les tibias, tandis que Cendre leur filait entre les pattes !
Mona éclata de rire.
— Quoi qu’il en soit, ne sachant où aller, je me dirigeai vers le soleil du matin, comme on l’avait fait jusqu’alors, tout en espérant que Cendre me rejoindrait bientôt. Ce qu’il fit. Nous dormîmes dans des greniers ou des granges, nous nourrissant des fruits de saison. Après deux jours de marche, nous arrivâmes à Venise.
« Hélas, je fus très vite remarquée comme une étrangère et une crève-la-faim. On me proposa divers travaux tous aussi dégradants et humiliants les uns que les autres. Je dus fuir un homme qui m’avait proposé, ou plutôt je devrais dire, forcée à forniquer avec lui et son compère. Cendre lui fit comprendre que sa proposition n’était pas acceptable. Mais nous eûmes bientôt l’ensemble de la clique sur le dos. Je me réfugiai dans une auberge. La femme de l’auberge, qui avait eu la gentillesse de m’accueillir, m’apprit que les soldats du Christ campaient sur une dune non loin de là, qu’on appelait le Lido, et qu’on y cherchait des cuisiniers. »
« Je patientai quelque temps dans l’auberge, le temps que la bande de sauvages se lasse. Peine perdue. Ils m’attendaient. Sitôt passée le coin de la rue, je frémis d’angoisse en entendant une cavalcade dans mon dos. Prise de panique, je m’enfuis. Cendre tenta d’arrêter mes agresseurs mais je le rappelai à moi. Je ne souhaitais pas être accusée d’assassinat pour lequel on n’aurait pas manqué de me poser des questions, surtout après ce qu’il s’était passé à Vérone. Au détour des ruelles, je me perdis et fus prise au piège. Je n’avais qu’un canal comme issue. Sans hésiter, je plongeai dans l’eau saumâtre. Mes poursuivants n’hésitèrent pas à faire de même, trouvant cette chasse décidément fort amusante. Je m’accrochai à Cendre pour ne pas me noyer. Je ne dus mon salut qu’à une embarcation qui passait à ce moment, et sur laquelle se trouvaient de nombreux pèlerins qui m’aidèrent à monter à bord, ainsi que Cendre. Mes poursuivants comprirent que c’en était terminé pour eux. C’est à bout de souffle que je remerciai chaleureusement mes sauveurs. Ils m’indiquèrent qu’ils rejoignaient le Lido, ce qui était exactement ma destination. »
« Une fois débarquée, c’est encore trempée de ma baignade forcée que je m’adressai à deux soldats aux abords du camp croisé.
— Il paraît que vous cherchez des cuisiniers ? les questionnai-je. »
Ils m’indiquèrent l’allée centrale du camp au bout de laquelle j’aurais plus de précisions.
« Je n’y avais guère prêté attention dans un premier temps, mais je me rendis compte très vite de l’immensité du campement. Il y avait là environ dix mille âmes qui vivaient sous presque autant de tentes. Leurs chevaux étaient parqués dans des écuries de fortune. C’était vaste comme une ville. Les cuisines étaient réparties dans tout le camp. On m’indiqua l’une d’elles. Là, il ne manquait pas de bras. On m’en indiqua donc une autre plus au sud. »
Dans cette partie, l’ambiance était plus morose. Je compris bien vite pourquoi. Les cuisiniers avaient soudainement déserté leur feu, ne supportant plus les conditions inhumaines de leur travail. Les soldats qui avaient été désignés pour les remplacer étaient totalement dépassés. Je trouvai la tente qui servait de cuisine en grand désordre : des gamelles et des ustensiles sales s’entassaient un peu partout sur des tables, les vivres se mélangeaient aux déchets. Des marmites, qui avaient connu des jours meilleurs, dont certaines contenaient encore des restes de nourriture qui commençaient à moisir, jonchaient le sol. M’armant de courage, je pris les choses en main sous l’œil soulagé de mes nouveaux aides-cuisiniers. Chacun reçut sa consigne, qui d’aller chercher de l’eau, qui d’aller chercher du bois. Je commençai à nettoyer de fond en comble l’endroit et à l’organiser à ma façon. Pour avoir passé la moitié de ma vie dans les cuisines d’une caserne, je me trouvais là parfaitement dans mon élément. Cendre montait la garde à l’entrée de la tente, stoppant toute velléité de protestation de la garnison qui commençait à trouver le temps long. Je prévins que la soupe mettrait un peu de temps à être servie, mais qu’elle serait bonne.
« J’en préparai une aux haricots cuisinés à la manière de notre région. Bientôt, un délicieux fumet emplit le camp. J’en eus presque le mal du pays. Loin de calmer les appétits, les effluves avaient au moins calmé les esprits. J’eus droit à mon petit moment de gloire quand les premiers bols furent engloutis, et pour cause, cela faisait sept jours que les soldats n’avaient pas mangé de nourriture convenable. Je fus malgré tout vertement sermonnée par l’intendant du camp pour avoir dépassé les quantités quotidiennes autorisées. Le fait est que les croisés auraient dû embarquer depuis un mois et qu’on piochait allègrement dans le stock prévu pour le voyage jusqu’en Égypte. Mais pour l’heure, j’avais rempli des estomacs presque vides. »
« Les jours suivants, la soupe fut certes moins abondante, mais elle n’en fut que mieux appréciée. Bien vite, je comptai davantage de clients : ils avaient ouï-dire que le brouet d’une certaine cuisine au sud du camp valait le détour. Dans mon petit estaminet, je dus encore embaucher. À partir de ce moment, je me fis de nombreux amis parmi les soldats, mais pas seulement malheureusement.
Mona se gratta la gorge avant de continuer.
— Un jour vint se présenter un jeune chevalier. Tout chez lui transpirait l’arrogance et le mépris. Il commença à bousculer tout le monde pour atteindre le comptoir, puis menaça de son épée ceux qui osaient protester. Il faut dire que c’était un sacré gaillard qui mesurait une tête de plus que les autres soldats. Je lui servis un bol de soupe sans croiser son regard. C’est alors que j’aperçus son blason, ce blason que je connaissais si bien, celui de la maison Balbi. L’homme que j’avais en face moi n’était autre que Daniel Balbi. Il ne me remit pas immédiatement. Mais après avoir bu deux gorgées, il sortit le nez de son bol et me dévisagea. Il avait reconnu le goût de la soupe qu’on servait à la Bastide.
— Ne serais-tu pas la fille sans terre qui avait coutume de vivre chez mon père ? demanda-t-il, l’œil inquisiteur.
— Si fait, répondis-je sèchement.
— Espèce de petite garce, n’as-tu pas honte d’avoir décampé de la sorte ?
— C’est bien la première fois que vous vous intéressez à mon sort, répondis-je avec aplomb. J’ai vécu chez vous parce que je n’avais pas d’autre endroit où aller. Ne me faites pas croire que je vous ai manqué.
— Ingrate ! Ne t’avons-nous pas logée et nourrie ?
— Certes, monseigneur, mais contre corvées et basses besognes. J’ai dû gagner ma pitance chaque jour que Dieu fit et subir la grossièreté de vos soldats. Je ne m’en plains pas et je rends grâce à votre père et à sa mansuétude. Mais ne pensez-vous pas que je suis plus utile ici ?
Je fis un pas de côté pour retourner dans ma cuisine quand il se leva brusquement et me saisit l’avant-bras d’une telle poigne que je crus être prise dans un étau. Je poussai un cri et je brandis ma louche, menaçant de le frapper au visage. Le coup ne l’aurait que légèrement blessé, mais malmener une femme en public et être frappé en retour aurait été terriblement humiliant pour lui. D’un ordre bref, je dissuadai Cendre de bondir sur Daniel.
— Oui, c’est ça ! ironisa-t-il. Retiens ta bête sauvage, jeune damoiselle, si tu ne veux pas qu’il t’arrive des ennuis.
Daniel hésita, le visage cireux. Son regard plongea dans le mien. Il ne bouillait pas de fureur ; au contraire, ses pupilles s’étaient dilatées au point qu’elles recouvraient presque entièrement l’iris, et que d’énormes yeux noirs me fixaient à présent. C’était le regard d’un fou.
— Holà, mon frère, restez calme, intervint Gontran. Savourez votre soupe et laissez cette jeune personne tranquille. Elle n’a rien fait de mal après tout.
Daniel repoussa mon bras avec une telle brutalité qu’il manqua de me faire tomber. Il se rassit, finit tranquillement son bol et s’en fut avec son frère à ses côtés. Les soldats témoins de la scène étaient abasourdis. Je me dis qu’il ne fallait pas donner trop d’importance à cet incident. De fait, tout rentra dans l’ordre et je n’eus plus eu affaire à Daniel avant d’arriver à Zara.
J’interrompis un instant le récit de Mona.
— C’est un hasard sans doute, mais je viens de croiser Augustino qui m’a conté une histoire impliquant Daniel dans une rixe.
— Avec Daniel, les rixes sont quotidiennes. Ses hommes ne veulent plus être sous ses ordres, du moins ce qu’il en reste, la garnison de la Bastide a été décimée au retour d’un pillage dans la région.
— Je suis au courant de cela. Autre chose, leur père m’avait dit qu’il rejoindrait Venise avec ses fils. Il avait aussi l’intention de faire don à l’ost d’un reliquaire. Il était convenu aussi qu’il n’irait pas plus loin en raison de sa santé.
— Oui, je me rappelle en effet que leur arrivée fit sensation. Le seigneur Balbi présenta ses fils à l’évêque de Soissons. Gontran lui remit les reliques que son père lui avait confiées. Les membres du clergé présents louèrent chaudement ce don précieux et cette pieuse dévotion. La famille Balbi fut bénie. Et le seigneur Balbi s’en retourna vers Toramina. La troupe qui accompagnait les frères rejoignit le contingent de l’évêque de Soissons. Gontran fut nommé capitaine. Messire Romuald conserva sa place à la tête des trente hommes qui les accompagnaient. Seul Daniel ne reçut aucune promotion, ce qui ne satisfit pas vraiment son ego et ne contribua en rien à le calmer.
En écoutant Mona, je commençais à me faire une idée de ce qui avait pu contrarier les plans de Daniel, et changer son état d’esprit.
Mona avala sa salive, avant de reprendre son récit.
— Comme il n’était pas question que je parte pour l’Égypte, j’appréhendais le jour où les croisés finiraient par embarquer. Il en serait alors fini de mon travail et surtout de ma protection. J’amenai de temps à autre le sujet de mes préoccupations dans les discussions avec les soldats : comment ferez-vous en Égypte quand je ne serai plus là, à vous mitonner des soupes aux haricots et des galettes de miel ? ironisai-je sur le ton de la plaisanterie. Les soldats répondaient : pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous ? Après tout, tu n’as aucune attache ici, et il nous faudra des cuisiniers où que nous allions. À vrai dire, au début, je ne me voyais pas embarquer. Le voyage me faisait peur ; tant de temps sur un bateau ! Mais après réflexion, ce n’était pas une si mauvaise idée et je priai pour qu’il en fût ainsi. »
« Le jour du départ fut annoncé et la nouvelle se répandit comme les semences qu’on jette sur un champ. On nous avait donné une semaine pour embarquer vivres et matériel. Mais personne ne vint m’avertir. J’étais résignée, je projetais déjà de partir vers le nord, vers les montagnes. »
« Pourtant, deux jours avant, un chevalier que je connaissais de vue pour l’avoir aperçu quelques fois attablé dans ma cuisine s’approcha de moi. Mon instinct me dit qu’il allait se passer quelque chose d’important. »
— Jeune damoiselle, j’ai ouï-dire que vous cherchiez une place sur un navire, me lança-t-il sans même s’être présenté.
« Je regardai par-dessus son épaule et aperçus les mines réjouies de mes amis soldats. Ils avaient, semble-t-il, intercédé en ma faveur et loin de leur en vouloir, bien au contraire, je leur rendis grâce. Je n’eus même presque pas à négocier une place à bord pour Cendre. »
« Le jour dit, l’effervescence était à son comble ; les premiers soldats embarquèrent dès le lever du jour, essentiellement sur des galères. Le camp se vida lentement. J’appris qu’on n’embarquait pas pour l’Égypte, mais pour Zara, une ville à deux ou trois jours de navigation. Je ne posai pas plus de questions. Nous fûmes les derniers à lever l’ancre presque au coucher du soleil. Je grimpai sur la passerelle, réalisant à peine ce qu’il m’arrivait. On m’indiqua l’échelle menant à la cale du navire. C’est là que je passerais le voyage. Il s’agissait d’un navire de transport de vivres. Je me glissai vers la poupe parmi les sacs de farine, de viande salée, les tonneaux d’eau douce et de vin. Cendre me rejoignit, puis la trappe de la cale fut refermée, me plongeant dans l’obscurité. Il ne me vint pas à l’esprit de me plaindre, j’avais embarqué, c’était l’essentiel. »
« L’arrière du bateau était animé d’un mouvement vertical, conséquence de la houle qui me donna bientôt la nausée. Je me demandai si j’avais fait le bon choix de me mettre à l’arrière de la nef. Nous prîmes le large et j’entendis les ordres criés aux marins qui bientôt firent place aux chants, se mêlant aux craquements de la coque. Alors que la nausée s’intensifiait, je me décidai à trouver un endroit où les mouvements du navire seraient plus supportables. En prenant appui sur la paroi pour me lever, ma main trouva une sorte de verrou que j’actionnai. Je pus ouvrir une trappe qui donnait vers l’arrière du navire. Aussitôt, la lumière du soleil déclinant envahit la cale, accompagnée d’une bouffée d’air marin. Je pus contempler la côte qui s’éloignait tandis que le soir tombait sur Venise. Je restai agrippée à mon ouverture, fascinée par cette vue magnifique. Mon regard pouvait s’accrocher à l’horizon et toute sensation de malaise disparut presque aussitôt. Bientôt, la nuit vint, les étoiles se reflétaient sur les flots calmes à peine perturbés par le sillage du navire. J’observai le spectacle pendant des heures. Puis, la fatigue se faisant sentir, je m’allongeai sur un sac de blé, Cendre à mes pieds. Je dormis d’un profond sommeil, bercée par les mouvements du navire et sans être perturbée par les craquements de la coque.
— Réveille-toi !
Je vis au-dessus de moi la figure de deux marins.
— C’est le matin. Il va falloir préparer à manger. On vient t’aider, me dit l’un.
— Rassure-toi, me dit l’autre. En mer, on est moins exigeant que sur terre. L’essentiel, c’est qu’on ait du vin.
Fidèle à mon défaut, je fis un repas plus riche et copieux que ne le voulait la raison. Mais mes deux acolytes ne me firent aucun reproche. J’avisai un sac de galettes de blé, de la viande salée et un tonnelet de vin, puisque c’était l’essentiel m’avait-on dit. De quoi caler au plus haut le moral de l’équipage.
Je demandai à pouvoir monter sur le pont, ce qui me fut refusé catégoriquement. Des religieux étaient à bord et auraient vu d’un très mauvais œil la présence d’une femme déambulant librement dans cet espace restreint, exclusivement masculin. Je ne pouvais pas tout avoir. »
« Je pris progressivement mes marques dans mon fond de cale. Je n’avais pas grand-chose pour me laver à part quelques louches que je prélevais dans des tonneaux d’eau douce. Je pissais et chiais par l’unique ouverture que j’avais sur le monde au prix, il est vrai, de quelques acrobaties. Quant à Cendre, je le laissais se débrouiller. Au bout de deux jours, j’avais trouvé mes repères dans le fatras de la cale quand on annonça que nous étions en vue de Zara. »
« L’ancre fut jetée et le navire s’immobilisa. De mon observatoire, je ne pouvais distinguer que quelques îles au loin. La ville était hors de ma vue. J’entendis des clameurs martiales accompagnées du claquement des épées qu’on frappe sur les boucliers avant l’assaut pour impressionner l’ennemi. »
« Cependant, au gré des courants et des vents, le navire pivota autour de son ancre, changeant par conséquent mon point de vue, ce qui me permit de découvrir le spectacle le plus étrange auquel il me fut donné d’assister. Nous étions encore assez loin de la côte puisque, en tant que transports de vivres, il n’était pas utile de nous exposer aux combats. Un nombre incroyable de galères et de navires-huissiers avaient investi la grève. Des navires étaient en flamme sans le port. Des machines de guerre étaient mises en place au pied des murailles de la ville. Ces hautes fortifications avaient une forme bizarre que je ne compris pas tout de suite. En y regardant mieux, je réalisai que ce que j’avais pris pour des éléments d’architecture était en réalité de grands draps que les Zaraouites avaient pendus au sommet des murailles sur lesquels étaient cousues d’immenses croix pour rappeler leur appartenance religieuse aux assaillants et tenter de les ramener à la raison. Déjà, le navire s’orientait de sorte que je ne pus plus voir la scène du siège, jusqu’à ce qu’il eût fait un tour complet sur lui-même, ce qui arrivait trois ou quatre fois par jour. »





























