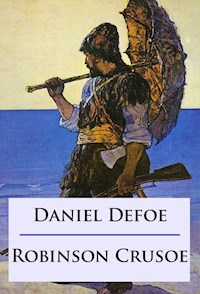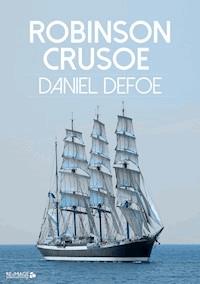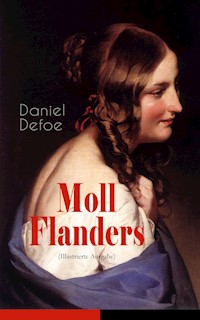Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Les ""Aventures de Robinson Crusoé"" de Daniel Defoe est un roman captivant qui raconte l'histoire extraordinaire d'un homme naufragé sur une île déserte. Publié pour la première fois en 1719, ce livre est devenu un classique de la littérature anglaise.
L'histoire commence lorsque Robinson Crusoé, un jeune homme avide d'aventure, décide de quitter sa vie confortable en Angleterre pour partir en mer. Cependant, son voyage tourne rapidement au cauchemar lorsqu'il est victime d'une tempête dévastatrice et se retrouve seul survivant sur une île isolée.
Le roman relate les efforts incroyables de Robinson pour survivre dans cet environnement hostile. Il apprend à chasser, à pêcher et à cultiver ses propres aliments. Il construit également un abri et fabrique des outils à partir des ressources limitées de l'île. Au fil des années, il développe des compétences et une résilience remarquables, devenant ainsi un véritable Robinson Crusoé.
Pendant son séjour sur l'île, Robinson fait également la rencontre d'un indigène qu'il nomme Vendredi. Ensemble, ils forment une amitié profonde et apprennent à se comprendre malgré leurs différences culturelles.
Les ""Aventures de Robinson Crusoé"" est bien plus qu'un simple récit d'aventures. C'est une réflexion sur la solitude, la survie et la capacité de l'homme à s'adapter à des situations extrêmes. Le roman explore également des thèmes tels que la religion, la morale et la nature humaine.
Avec son style d'écriture captivant et son personnage principal inoubliable, ""Les Aventures de Robinson Crusoé"" est un livre qui continue de fasciner les lecteurs du monde entier depuis plus de trois siècles. C'est un récit intemporel qui nous rappelle la force de la volonté humaine et la capacité de l'homme à surmonter les obstacles les plus difficiles.
Extrait : ""En peu de temps je commençai à lui parler et à lui apprendre à me parler. D'abord je lui fis savoir que son nom serait Vendredi ; c'était le jour où je lui avais sauvé la vie, et je l'appelai ainsi en mémoire de ce jour."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335004601
©Ligaran 2015
Je suis né en l’année 1632. Mon père, natif de Brême, après s’être enrichi dans le commerce, s’installa à York, en Angleterre, où il épousa ma mère qui appartenait à la famille de Robinson. Mon père s’appelait Kreutznar, mais son nom, déformé par la prononciation anglaise, se transforma en Crusoé. C’est ainsi que je ne fus jamais nommé autrement que Robinson Crusoé.
Dès ma première enfance, je n’eus pas d’autre rêve que celui d’aller sur mer. Ce désir d’aventures m’entraîna d’abord à monter sur un bateau qui naviguait le long des côtes anglaises, puis sur un vaisseau qui partait pour la Guinée. C’est au cours de ce dernier voyage que je devins prisonnier des Maures, mais, parvenu à m’échapper, je fus recueilli par un bâtiment portugais voguant vers le Brésil où je débarquai avec le capitaine et son équipage.
Là, je m’installai comme planteur de cannes à sucre et j’y vécus près de quatre ans, commençant à gagner considérablement et à prospérer.
Pendant ce temps, non seulement j’avais lié connaissance et amitié avec mes compagnons de plantations, mais encore avec les marchands de San Salvador, qui était notre port de mer. Dans les propos que j’avais tenus avec eux, je leur avais souvent rendu compte de mes voyages et parlé de la Guinée où l’on pouvait charger de la poudre d’or, des dents d’éléphant et surtout faire le trafic des nègres. Ce dernier point les intéressait particulièrement. Un jour où j’avais parlé sérieusement sur ce sujet, trois planteurs vinrent me trouver le lendemain, me dirent combien le travail des nègres serait précieux pour leurs cultures et pour les miennes et me firent d’avantageuses propositions pour me décider à entreprendre un nouveau voyage sur les côtes d’Afrique.
La sagesse me conseillait de renoncer à toute aventure, de continuer à faire prospérer mes biens, mais la passion de la mer me reprenant, je dis que je partirais de tout cœur si mes amis voulaient bien se charger du soin de ma plantation pendant mon absence. Tous me le promirent et le vaisseau étant équipé, la cargaison embarquée, j’allai à bord, pour mon malheur, le 1er septembre 1659, qui était le même jour où je m’étais embarqué pour la première fois en Angleterre, huit ans auparavant.
Notre vaisseau était d’environ cent vingt tonneaux, il portait six canons et quatorze hommes en y comprenant le maître, son garçon et moi. Nous ne l’avions chargé d’autres marchandises que de quincailleries propres à nos échanges, telles que des ciseaux, des haches et surtout de petits miroirs. Nous mîmes à la voile, nous dirigeant vers la côte d’Afrique, lorsque le treizième jour s’éleva un violent ouragan qui nous désorienta complètement. Il se déchaîna d’une manière si terrible que, pendant douze jours, il nous fut impossible d’aller autrement qu’à la dérive. Nous nous attendions à chaque instant à être ensevelis dans les flots lorsque le matin commençant à pointer, un de nos matelots s’écria : « Terre ! » À peine fûmes-nous sortis de la cabane pour voir ce que c’était, et dans quelle région du monde nous nous trouvions, que le vaisseau donna contre un banc de sable. Son mouvement cessa tout à coup et les vagues y entrèrent avec tant de précipitation que nous nous attendions à périr sur l’heure.
Nous eûmes cependant le temps de mettre la chaloupe à la mer et d’y prendre place pour essayer de nous sauver. Comme nous avions ramé, ou plutôt dérivé, l’espace d’une lieue et demie, une vague énorme, semblable à une montagne, se rua sur nous avec tant de furie qu’elle renversa tout d’un coup la chaloupe et nous sépara les uns des autres aussi bien que du bateau.
Après m’avoir enlevé plusieurs fois, la mer me jeta contre un rocher et cela si rudement que j’en perdis le sentiment. Heureusement, je revins à moi un peu avant son retour et, voyant que j’allais être enseveli, je résolus de m’attacher à un morceau du roc et de retenir mon haleine jusqu’à ce que les eaux se fussent retirées. Déjà les vagues étaient moins hautes ; j’eus soin de ne pas lâcher prise avant qu’elles n’eussent passé et repassé par-dessus moi. Après quoi, je pus parvenir à prendre terre et à monter sur le haut du rivage.
Me voyant ainsi en toute sûreté, je me mis à réfléchir sur le sort de mes camarades qui tous avaient été noyés. J’étais bien le seul qui eût pu se sauver, car je ne revis plus rien des autres, excepté trois de leurs chapeaux, un bonnet et deux souliers dépareillés.
Je tournai les yeux du côté du vaisseau qui avait échoué, mais il était à une si grande distance que c’est à peine si je pouvais le voir. « Grand Dieu, m’écriai-je, comment est-il possible que je sois venu à terre ! »
Puis, je regardai tout autour de moi pour voir en quel lieu j’étais. La joie de me sentir sauvé s’assombrit bientôt car j’étais mouillé et je n’avais point d’habits pour me changer ; j’avais faim et je n’avais rien à manger ; j’avais soif et je n’avais rien à boire. J’étais faible et je n’avais rien pour me fortifier. Je n’imaginais pas ce qu’il pourrait advenir de moi, sinon que je mourrais de faim ou serais la proie des bêtes féroces. Je n’avais pas d’arme pour chasser ou me défendre ; je n’avais rien sur moi, si ce n’est un couteau. L’avenir m’apparut si redoutable que, pendant quelque temps, je courus de tous côtés comme un insensé.
L’approche de la nuit augmentait encore mon effroi. Enfin, je décidai de dormir sur un certain arbre que je découvris dans le voisinage, arbre semblable à un sapin, mais au feuillage épineux et fort épais.
Comme j’étais extrêmement fatigué, je tombai vite dans un profond sommeil qui répara si bien mes forces que je crois n’en avoir jamais eu de meilleur.
Il faisait grand jour lorsque je m’éveillai. Le temps était clair, la tempête dissipée et la mer n’était plus courroucée. Je fus tout étonné de voir que la marée nocturne avait soulevé le vaisseau du banc de sable où il avait échoué et l’avait fait dériver jusque près du rocher contre lequel les flots m’avaient jeté. Il y avait environ un mille de l’endroit où j’étais jusque-là. Comme le bâtiment paraissait encore reposer sur sa quille, j’aurais bien souhaité être à bord afin de pouvoir en tirer pour mon usage quelques-unes des choses les plus nécessaires.
Un peu après midi, je vis que la mer était si calme et la marée si basse que je ne pus résister au désir d’essayer de rejoindre mon bâtiment.
Il faisait une chaleur extrême. Je me dépouillai de mes habits et me jetai dans l’eau. Mais quand je fus arrivé au pied du vaisseau, je me trouvai en présence de difficultés énormes. Il reposait sur terre, mais dépassait l’eau d’une grande hauteur et je ne voyais pas à quoi je pourrais m’accrocher pour grimper le long de ses flancs. J’en fis deux fois le tour à la nage. À la seconde, j’aperçus enfin un bout de corde que je saisis avec peine, mais qui me permit d’atteindre le sommet. Là, je vis que le vaisseau était entrouvert et qu’il y avait beaucoup d’eau à fond de cale ; seulement, la poupe était si haute que le pont était tout à fait sec comme aussi tout ce qu’il renfermait. Car vous pensez bien que mon premier soin fut de chercher partout pour découvrir ce qui était gâté ou ce qui était bon. Heureusement, toutes les provisions étaient sèches, et, comme j’étais très disposé à manger, je m’en allai à la soute où je remplis mes poches de biscuit. Je le grignotai tout en m’occupant à autre chose car je n’avais pas de temps à perdre. Je trouvai aussi du rhum dans la chambre du capitaine et j’en bus un bon coup car j’en avais grand besoin pour m’encourager à soutenir la vue des souffrances que j’aurais à supporter.
Il ne m’aurait servi de rien de demeurer les bras croisés et de perdre le temps à souhaiter ce que je ne pouvais obtenir, aussi décidai-je sans retard de me mettre à l’œuvre. Nous avions à bord plusieurs vergues, un ou deux mâts de perroquet qui étaient de réserve, et deux ou trois grandes barres de bois : je lançai hors du bord tout ce qui n’était point trop pesant. Cela fait, je descendis à côté du bâtiment et attachai ce qu’il fallait pour former une sorte de radeau sur lequel je plaçai en travers deux ou trois planches fort courtes. Tel qu’il était, il pouvait bien me porter, mais il me semblait trop léger pour une grosse charge. C’est pourquoi je retournai au travail, et, avec la scie du charpentier, je partageai une des vergues en trois pièces et les ajoutai à mon radeau après m’être donné beaucoup de peine et de travail. Il ne s’agissait plus alors que de le charger. Après avoir examiné ce dont j’avais le plus besoin, je commençai par prendre trois coffres de matelots que j’avais ouverts en forçant les serrures et que j’avais ensuite vidés, puis, je les descendis avec une corde sur mon radeau. Dans le premier, je mis des provisions, telles que du pain, du riz, trois fromages de Hollande, cinq morceaux de bouc séché et un petit reste de blé d’Europe destiné à nourrir quelques volailles emportées avec nous. Il y avait aussi une certaine quantité d’orge et de froment mêlés ensemble, mais bien endommagés par les rats. Pendant que j’étais ainsi occupé, je m’aperçus que la marée commençait à monter, et j’eus le chagrin de voir mon habit, ma veste et ma chemise, que j’avais laissés sur le rivage, flotter et s’en aller au gré de l’eau. Heureusement, comme ma culotte de toile était ouverte à l’endroit des genoux, je ne l’avais point quittée pour nager jusqu’à bord. Mais elle ne me suffisait point et j’eus la chance de n’avoir pas à fouiller trop longtemps pour trouver dans le bateau de quoi remplacer largement les hardes que le flot m’avait enlevées.
Toutefois, je me contentai de prendre ce dont je ne pouvais absolument me passer pour l’instant car il y avait d’autres choses que je désirais beaucoup plus. De ce nombre étaient des outils pour travailler quand je serais à terre. Après avoir longtemps cherché, j’eus le bonheur de découvrir le coffre du charpentier. Ce fut un trésor pour moi, trésor beaucoup plus précieux que ne l’aurait été un vaisseau chargé d’or. Je le descendis, le posai sur mon radeau tel qu’il était, sans perdre de temps à regarder dedans, car je savais en gros ce qu’il contenait.
Ce que je souhaitais le plus ensuite, c’était des munitions et des armes. Il y avait dans la chambre du capitaine deux fusils fort bons et deux pistolets ; je m’en saisis d’abord, comme aussi de quelques cornets à poudre, d’un petit sac de plomb et de deux vieilles épées rouillées. Je savais qu’il y avait quelque part trois barils de poudre, mais j’ignorais en quel endroit notre canonnier les avait serrés. À la fin, pourtant, je les déterrai après avoir visité coins et recoins. Il y en avait un qui avait été mouillé, mais les deux autres étaient secs et je les plaçai avec les armes sur mon radeau.
Alors, je crus m’être muni d’assez de provisions. Il ne me restait qu’à les conduire à terre, ce qui me donnait quelque souci, car je n’avais ni rames, ni gouvernail. Heureusement, la mer était tranquille ; la marée qui montait me porterait, et d’autant mieux que le vent était favorable. Je trouvai encore deux ou trois rames à moitié rompues qui me servirent de renfort, deux scies, une besaiguë avec un marteau que j’ajoutai à ma cargaison, après quoi je me mis en mer.
Mon radeau vogua très bien l’espace d’environ un mille ; seulement, je m’aperçus qu’il dérivait un peu de l’endroit où j’avais pris terre auparavant, ce qui me fit croire à l’existence d’un courant d’eau. Et l’espoir me vint de trouver dans les parages une baie ou une rivière qui me tiendrait lieu de port pour décharger ma cargaison.
La chose était telle que je me l’étais imaginée. Je découvris vis-à-vis de moi une petite ouverture de terre vers laquelle je me sentais entraîné par le cours violent de la marée, aussi gouvernai-je mon radeau de mon mieux pour lui faire tenir le fil de l’eau. Pendant que la marée le soulevait, je parvins à l’amener au-dessus d’un endroit plat et uni où je l’amarrai en enfonçant dans la terre mes deux rames rompues. J’attendis ainsi que la marée se fût abaissée et qu’elle laissât mon train, avec ce qu’il portait, à sec et en toute sûreté.
Mon premier soin fut ensuite d’aller reconnaître le pays et d’y chercher un lieu pour m’établir. J’ignorais encore si ce terrain était dans le continent ou dans une île, s’il était habité ou inhabité, si j’avais quelque chose à craindre des bêtes sauvages ou non. À moins d’un mille de là, il y avait une montagne très haute et difficile à gravir dont le sommet semblait dépasser une chaîne de plusieurs autres. Je pris un de mes fusils et un de mes pistolets avec un cornet de poudre et un petit sac de plomb ; armé de la sorte, je m’en allai à la découverte jusqu’au haut de cette montagne où, étant arrivé après beaucoup de fatigue et de sueur, je découvris avec tristesse que j’étais dans une île. Je regardai en vain de tous côtés sans pouvoir découvrir d’autres terres, si ce n’était quelques rochers fort éloignés de là et deux petites îles beaucoup plus petites que la mienne et situées près de trois lieues à l’ouest.