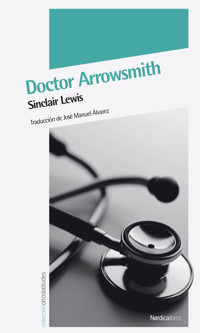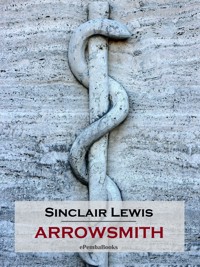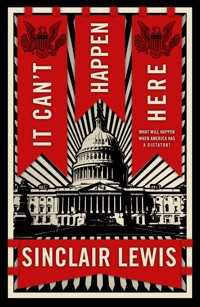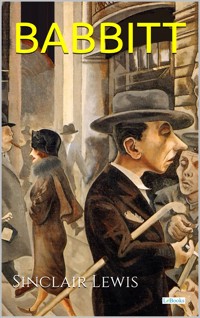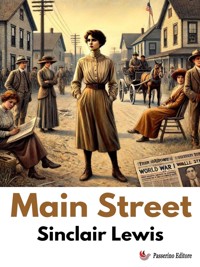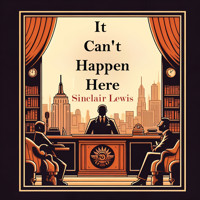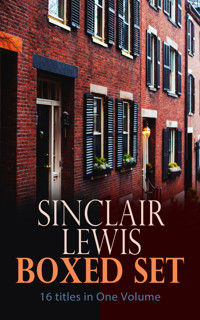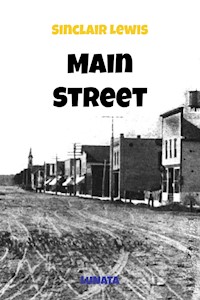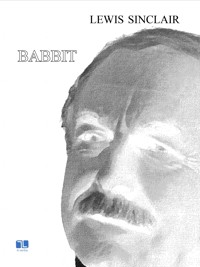
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: A verba futuroruM
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Le héros, George F. Babbitt, est agent immobilier de renom et vit à Zenith, une petite ville du Midwest. Riche, bavard, il a un avis sur tout et se targue d'être un citoyen modèle, éduqué et bien dans sa peau. Mais un jour, une terrible angoisse le saisit : cette vie passée à arnaquer la veuve et l'orphelin et à dîner avec des petits-bourgeois bien-pensants ne serait-elle pas vaine ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Sinclair Lewis, né en 1885 dans le Minnesota, est un romancier américain célèbre pour sa satire sociale. Il critique le conformisme et l’hypocrisie de la société américaine dans des œuvres marquantes comme "Main Street" (1920) et "Babbitt" (1922). Premier Américain à recevoir le prix Nobel de littérature en 1930, il s’attaque aussi au mercantilisme médical "Arrowsmith", à la religion "Elmer Gantry" ou au fascisme "It Can’t Happen Here". Il meurt en 1951 en Italie, après une carrière en déclin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
lewis sinclair
BABBITT
1922
CHAPITRE PREMIER
Les tours de Zénith se dressaient au-dessus de la brume matinale, tours austères d’acier, de ciment et de pierre, hardies comme des rocs et délicates comme des baguettes d’argent. Ce n’étaient ni des citadelles, ni des églises, mais franchement, magnifiquement, des édifices pour bureaux.
Le brouillard prenait en pitié les bâtisses lépreuses des générations précédentes, l’hôtel des postes au toit mansardé, les minarets en briques rouges de vieilles maisons pataudes, les fabriques aux fenêtres rares et noires de suie, les échoppes en bois couleur de boue. La ville était pleine de ces constructions baroques, mais les tours nettes les chassaient du centre des affaires et, sur les collines plus éloignées, brillaient des maisons neuves, foyers, semblait-il, faits pour le rire et la tranquillité. Sur un pont passa, rapide et silencieuse, une limousine au long capot brillant. Les occupants, en tenue de soirée, revenaient de la répétition de nuit de la pièce d’un petit théâtre, divertissement artistique égayé par beaucoup de champagne. Au-dessous du pont s’incurvait une ligne de chemin de fer, dédale de lumières vertes et rouges. Le rapide de New York se précipita avec fracas, et vingt rais d’acier poli bondirent dans la clarté. Dans l’un des gratte-ciel, on coupait les communications de la Presse Associée. Les opérateurs du télégraphe relevaient d’un air las leurs visières de celluloïd après une nuit de conversations avec Paris et Pékin. Les balayeuses se répandaient dans le bâtiment en bâillant et en traînant leurs savates bruyantes. La brume de l’aube se dissipait. Des hommes, leur déjeuner dans une boîte, se dirigeaient en longues files vers d’énormes fabriques neuves – feuilles de verre et briques creuses – et des boutiques étincelantes où cinq mille employés travaillent sous le même toit à répandre les honnêtes marchandises qui seront vendues sur les rives de l’Euphrate et à travers le veldt. Les sifflets saluaient cette aube d’avril en un chœur aussi joyeux qu’elle, chant du travail dans une ville bâtie, semblait-il, pour des géants. Il n’y avait pourtant rien du géant dans l’homme qui commençait à s’éveiller sur la véranda d’une maison de style colonial hollandais, dans le quartier de Zénith connu sous le nom de « Hauteurs Fleuries ». Il s’appelait George F. Babbitt, il avait, en ce mois d’avril 1920, quarante-six ans, et ne faisait rien de spécial, ni du beurre, ni des chaussures, ni des vers, mais était habile à vendre des maisons à un prix plus élevé que les gens ne pouvaient y mettre. Sa tête, qu’il avait grosse, était rose, ses cheveux bruns, fins et secs. Sa figure gardait dans le sommeil quelque chose d’enfantin, en dépit de ses rides et des marques rouges laissées par ses lunettes de chaque côté de son nez. Il n’était pas gras mais extrêmement bien nourri ; ses joues étaient rebondies, et sur la couverture kaki reposait avec abandon une main potelée, légèrement bouffie. Il avait un air de prospérité, d’homme tout ce qu’il y a de plus marié et de moins romanesque, aussi peu romanesque que cette véranda qui donnait sur un ormeau de taille moyenne, deux petites pelouses, une allée cimentée et un garage en tôle ondulée. Pourtant Babbitt rêvait encore à la fée enfant, rêve plus romanesque que des pagodes écarlates au bord d’une mer d’argent. Depuis des années, cette fée enfant l’avait hanté. Là où les autres ne voyaient que Georgie Babbitt, elle discernait un beau jeune homme. Elle l’attendait dans l’ombre, au-delà de bosquets mystérieux. Quand il réussissait enfin à se glisser hors de la maison encombrée, il volait vers elle. Sa femme, ses amis, avec de grands cris, cherchaient à le suivre, mais il leur échappait, la fée voltigeait à ses côtés et ils s’étendaient ensemble sur une pente ombragée. Elle était si mince, si blanche, si ardente ! Elle criait qu’il était gai et vaillant, qu’elle l’attendrait, qu’ils partiraient sur un navire… Fracas du camion du laitier. Babbitt geignit, se retourna et s’efforça de retrouver son rêve. Il ne voyait plus maintenant que la figure de la fée, par-delà les eaux brumeuses… Le chauffeur du calorifère claqua la porte du sous-sol, un chien aboya dans la cour voisine. Comme Babbitt sombrait avec volupté dans un flot tiède, le porteur de journaux passa en sifflant et le rouleau serré de l’Advocate Times heurta la porte d’entrée. Babbitt, réveillé en sursaut, se sentit l’estomac barré. Quand il se détendit de nouveau, un bruit familier et irritant lui perça les oreilles, quelqu’un tournait la manivelle d’une Ford : snap-ah-ah, snap-ah-ah. Fervent automobiliste lui-même, Babbitt mettait en marche avec le chauffeur invisible, attendait avec lui un temps interminable que le moteur ronflât, avec lui s’exaspérait quand le bruit faiblissait et que recommençait l’infernal, l’obstiné « snap-ah-ah », cette cadence ronde et plate, cette cadence de matin glacé, affolante et acharnée. Ce ne fut que quand la voix du moteur s’élevant lui révéla que la Ford se mettait en mouvement, qu’il fut soulagé de cette tension haletante. Il jeta un coup d’œil sur son arbre favori, branchages d’orme se détachant sur un ciel doré, et s’efforça de trouver le sommeil, comme on cherche une drogue. Lui, qui avait été un enfant plein de confiance dans la vie, ne s’intéressait plus beaucoup aux aventures possibles mais improbables de chaque journée nouvelle. Et il échappa à la réalité jusqu’à ce que son réveil sonnât, à sept heures vingt. C’était le meilleur de tous les réveils que prônait et répandait la publicité, doté de tous les perfectionnements modernes, y compris un carillon, une sonnerie intermittente et un cadran lumineux. Babbitt était fier d’être réveillé par une invention si complète : au point de vue social cela vous posait presque autant un homme que de payer très cher des pneus câblés. Il reconnut en boudant qu’il n’y avait plus à reculer, mais il resta couché, maudissant la besogne fastidieuse des affaires immobilières, détestant sa famille et se détestant lui-même pour ce sentiment. La veille au soir, il avait joué au poker chez Vergil Gunch jusqu’à minuit, et, après les séances de ce genre, il était irritable jusqu’à son petit déjeuner. Peut-être aussi cela venait-il de l’effroyable bière domestique de cette période de prohibition et des cigares que ce breuvage l’avait entraîné à fumer, peut-être était-ce l’effet du ressentiment éprouvé en retombant, de ce milieu viril et affranchi, dans le cercle restreint des épouses et des sténographes où on l’exhortait à ne pas tant fumer. De la chambre à coucher contiguë à la véranda lui arriva, odieux et enjoué, le « Il est temps de se lever, mon petit Georgie » de sa femme, avec le bruit crissant et énervant d’une brosse dure sur les cheveux. Il grogna, tira de sous la couverture kaki ses jambes enveloppées d’un pyjama bleu fané, s’assit sur le bord du lit, passa ses doigts dans ses mèches en désordre, tout en tâtonnant machinalement de ses pieds gras pour trouver ses pantoufles. Il jeta un regard de regret à la couverture, qui évoquait toujours pour lui une idée de liberté et d’héroïsme : il l’avait achetée en vue d’une partie de « camping » qu’il n’avait jamais faite. Elle symbolisait une somptueuse flânerie, d’abondants jurons et des chemises de flanelle viriles. Il sauta sur ses pieds, en gémissant sous la douleur lancinante qu’il sentait derrière les yeux et, tout en attendant son retour brûlant, il jeta dans la cour un regard encore brouillé de sommeil. Elle l’enchanta comme toujours : c’était bien la cour d’un homme d’affaires prospères de Zénith, c’est-à-dire une perfection qui faisait de lui également un homme parfait. Il considéra le garage en tôle ondulée. Pour la trois cent soixante-cinquième fois depuis un an il se fit cette réflexion : « Pas à la hauteur, cette baraque en zinc : il faut que je me construise un garage en planches et charpente. Mais, par Dieu, c’est la seule chose qui ne soit pas au point. » Cet examen le fit songer à un garage public pour son lotissement de Glen Oriole. Il cessa de souffler, de s’agiter et mit les poings sur ses hanches. Les traits de son visage pétulant, encore gonflé de sommeil, se durcirent. Il eut soudain un air capable de bureaucrate, celui d’un homme fait pour concevoir, diriger, exécuter. L’intensité de sa pensée le fit descendre dans la salle de bains à travers le vestibule sec, propre, qui semblait ne jamais servir. La maison n’était pas grande mais avait pourtant, comme toutes celles des « Hauteurs Fleuries », une salle de bains princière en porcelaine, carreaux vernis et métal luisant comme de l’argent. Le séchoir à serviettes était une barre de verre enchâssée dans du nickel. La baignoire eût été assez longue pour un soldat prussien de la Garde, et au-dessus s’étalait tout un attirail sensationnel : porte-brosse à dents et porte-blaireau, bol à savon et bol à éponge, armoire à médicaments, le tout si étincelant, si ingénieux, qu’on eût dit une installation d’appareils électriques. Mais le Babbitt qui faisait son dieu des inventions modernes n’était pas content : l’air de la salle était imprégné de l’odeur d’une pâte dentifrice barbare. « Encore un coup de Verona ! Au lieu de s’en tenir au Lilidol, comme je ne cesse de le lui demander, elle est allée chercher je ne sais quelle maudite drogue qui infecte et vous soulève le cœur. » Le tapis de bain était tout plissé et le sol mouillé. (De temps à autre, sa fille Verona avait la fantaisie de prendre son bain le matin.) Il glissa sur le tapis et se cogna dans la baignoire. « Nom de Dieu… ! » cria-t-il. Et saisissant furieusement son tube de savon, furieusement il fit mousser la crème en frappant d’un geste belliqueux avec le blaireau onctueux, furieusement il racla ses joues rebondies avec un rasoir de sûreté. Il s’écorchait : la lame était émoussée. Il dit : « Nom de D… de nom de D… ! » Il chercha dans l’armoire à remèdes un paquet de lames neuves, se disant, comme il faisait invariablement : « Ça reviendrait moins cher d’acheter un appareil pour repasser les lames soi-même », et quand il l’eut découvert, derrière la boîte ronde de bicarbonate de soude, il fut en colère contre sa femme qui l’avait mis là et très content de lui pour n’avoir pas dit « Nom de D… ». Mais il le lança aussitôt après quand, de ses doigts mouillés et pleins de savon, il essaya d’ôter l’odieuse petite enveloppe de papier végétal qui collait à la lame neuve. Ensuite ce fut le problème maintes fois abordé, jamais résolu, de savoir que faire de la vieille lame, qui aurait pu constituer un danger pour les doigts de sa dernière fille. Comme d’habitude, il la jeta sur le haut de l’armoire aux remèdes en se disant qu’il faudrait un jour enlever les cinquante ou soixante lames qu’il y avait entassées provisoirement. Il acheva de se raser avec une mauvaise humeur qu’accroissaient encore son mal de tête grandissant et le vide de son estomac. La chose faite, sa face ronde bien lisse et ruisselante, les yeux piqués par l’eau de savon, il chercha une serviette. Celles de la famille étaient mouillées, toutes, mouillées et visqueuses, il le constata en les tâtant en aveugle : la sienne, celle de sa femme, de Verona, de Ted et de Tinka, ainsi que l’unique serviette à bain, à l’énorme chiffre brodé. Alors George F. Babbitt fit une chose épouvantable : il s’essuya la figure avec la serviette de l’invité ! C’était un linge de fantaisie, orné de pensées, toujours accroché là pour indiquer que les Babbitt appartenaient à la meilleure société des « Hauteurs Fleuries ». Personne ne s’en était jamais servi, aucun invité n’en avait eu l’audace : ils prenaient en cachette un coin de la première serviette ordinaire venue. Il rageait : « Parbleu, ils emploient toutes les serviettes, ces animaux, tous tant qu’ils sont, ils les mouillent, les trempent et n’en sortent jamais une sèche pour moi… Naturellement, c’est moi le bouc !… Alors, comme il m’en faut une, je… Je suis le seul, dans cette sacrée maison, à avoir le moindre égard, la moindre prévenance pour autrui et à songer que d’autres peuvent avoir envie de se servir après moi de cette maudite salle de bains et à penser… » Et il lançait toutes ces horreurs humides dans la baignoire, heureux de cette vengeance en entendant le bruit mou et sinistre qu’elles faisaient en y tombant. Au milieu de cette opération, sa femme entra et dit avec sérénité : « Oh ! Georgie, mon chéri, que faites-vous ? Vous allez laver les serviettes ? Voyons, ce n’est pas votre affaire. Oh ! Georgie, vous ne vous êtes pas servi de la serviette des invités, j’espère ? » L’histoire ne dit pas s’il fut capable de répondre. Pour la première fois depuis des semaines, sa femme attira assez son attention pour qu’il la regardât. Myra, madame George F. Babbitt, avait atteint une maturité définitive. Sa chair était plissée, depuis les coins de sa bouche jusqu’à la pointe de son menton et à son cou épais, gonflé de graisse. Mais ce qui marquait le mieux qu’elle redescendait la pente, c’est qu’elle n’avait plus rien de caché pour son mari et ne souffrait plus de cet état de choses. Elle était en jupon et en corset, un corset trop rempli, et ne s’inquiétait pas de se laisser voir ainsi. Elle avait pris une si morne habitude de la vie conjugale que, devenue matrone, elle n’avait pas plus de sexe qu’une nonne anémique. C’était une femme bonne, affectueuse, attentive, mais personne, sauf peut-être sa fille Tinka, alors âgée de dix ans, ne faisait aucune attention à elle ou ne se rendait bien compte qu’elle était vivante. Après une discussion assez approfondie sur les serviettes, à tous les points de vue domestiques et sociaux, elle plaignit Babbitt d’avoir un mal de tête dû à l’alcool, et il retrouva assez de force pour chercher un gilet de dessous B. V. D. qui, par malveillance, il le fit remarquer, avait été caché parmi ses pyjamas propres. Il se montra assez aimable dans la conférence sur le costume brun. « Qu’en pensez-vous, Myra ? – Il tâtait le vêtement posé sur une chaise dans leur chambre à coucher, pendant qu’elle allait et venait, ajustant et tapotant mystérieusement son jupon, sans paraître, à ses yeux prévenus à lui, avancer dans sa toilette – Que faut-il faire ? Mettre le complet brun un autre jour ? – Ma foi, il vous va très bien. – Je le sais, mais il a besoin d’être repassé. – C’est vrai… oui, peut-être. – Il s’accommoderait fort d’un repassage. – Oui, cela ne lui ferait peut-être pas de mal. – Mais, sapristi, le veston n’en a pas besoin. Ce serait absurde… faire repasser tout le costume quand la pièce principale n’en a nul besoin. – C’est bien vrai. – Mais pour le pantalon ce serait tout à fait nécessaire. Regardez-le… ces plis, ces poches… sûr que cela lui ferait du bien. – Évidemment. Oh ! Georgie, pourquoi ne mettriez-vous pas le veston brun avec ce pantalon bleu dont nous nous demandions ce qu’on pourrait bien en faire ? – Grand Dieu ! M’avez-vous jamais vu mettre le veston d’un complet et le pantalon d’un autre ? Pour qui me prenez-vous ? Pour un comptable dans la mouise ? – Eh bien, pourquoi ne pas mettre aujourd’hui votre costume gris foncé et entrer chez le tailleur pour lui laisser le pantalon brun ? – Dame, il en a certainement besoin… Allons, où diable est-il, ce costume gris ? Ah ! oui, le voilà. » Il fut capable d’achever sa toilette avec une résolution et un calme relatifs. Le premier ornement qu’il revêtit fut le gilet de dessous sans manches dans lequel il avait l’air d’un jeune garçon, portant avec sérieux une tunique en étoffe de coton dans un cortège civique. Il ne mettait jamais ce B. V. D. sans remercier le Dieu du progrès de ne pas porter des sous-vêtements collants, longs, à la vieille mode, comme son beau-père et associé Henry Thompson. Le second embellissement consista à se peigner les cheveux en arrière. Cela lui faisait un front énorme, se bombant à deux pouces plus loin que l’alignement primitif des cheveux. Mais ce qui produisait l’effet le plus étonnant, c’étaient ses lunettes. Les lunettes ont chacune leur caractère : l’écaille prétentieuse, l’humble pince-nez du maître d’école, les verres cerclés d’argent tordu du vieux villageois. Celles de Babbitt se composaient d’énormes verres ronds, sans monture, mais de première qualité, et de branches faites d’un mince fil d’or. Quand il les chaussait, il était l’homme d’affaires moderne, celui qui donne des ordres à des employés, qui conduit son auto, joue au golf à l’occasion et est un expert en matière de vente. Sa tête paraissait soudain non plus enfantine mais importante, on remarquait son nez lourd et aplati, sa bouche droite, à la lèvre supérieure longue et épaisse, son menton trop charnu mais vigoureux ; avec respect on le contemplait revêtant le reste de son uniforme de grave citoyen. Le complet gris, bien coupé, bien fait, manquait complètement d’originalité : c’était le costume type. Un liséré blanc à l’ouverture en V du gilet faisait songer à l’homme de loi et au savant. Ses bottines noires, à lacets, étaient de bonnes, d’honnêtes bottines, du modèle ordinaire, étonnamment dénuées d’intérêt. Il n’y avait de fantaisie que dans sa cravate de tricot rouge. En faisant toutes sortes de commentaires sur la question à madame Babbitt – qui, obligée à des acrobaties pour attacher sa blouse à sa jupe avec une épingle de sûreté, n’en entendit pas un mot – il choisit entre l’écharpe rouge et une autre, genre tapisserie, avec des harpes brunes sans cordes au milieu de palmes, et il y enfonça une épingle à tête de serpent avec des yeux en opale. Un événement capital fut de faire passer le contenu de ses poches du costume brun au gris. Il ne traitait pas ces objets à la légère : ils avaient une importance immuable, comme le baseball ou le parti républicain. Ils comprenaient un stylo et un crayon en argent, – qui manquait toujours d’une réserve de mines neuves – : tous deux se plaçaient dans la poche en haut du gilet, à droite. Sans eux, il se serait senti tout nu. À sa chaîne de montre pendaient un canif en or, un coupe-cigares en argent, sept clefs – il avait oublié l’usage de deux d’entre elles – et accessoirement une bonne montre. Attenant à la chaîne, une grosse dent d’élan jaunâtre témoignait qu’il était membre de l’« Ordre fraternel et protecteur des Élans ». Plus significatif que tout était son carnet de poche à feuilles détachables, ce carnet moderne et pratique qui contenait des adresses de gens qu’il avait oubliés, les reçus prudemment gardés de mandats-poste, arrivés à destination depuis des mois, des timbres qui n’avaient plus de gomme, des coupures de vers de T. Cholmondeley Frink, et des éditoriaux de journaux qui fournissaient Babbitt d’opinions et de grands mots, des notes pour ne pas oublier de faire certaines choses qu’il n’avait pas l’intention de faire, et une curieuse inscription : D. S. S. D. M. Y. P. D. F. Mais il n’avait pas d’étui à cigarettes. Personne ne lui en avait jamais offert un, aussi n’en avait-il pas l’habitude et considérait-il comme des gens efféminés ceux qui s’en servaient. Pour finir, il mit à sa boutonnière le bouton du club des « Boosters(1) ». Avec la concision du grand art, ce bouton ne portait que deux mots : « Boosters-Pep (2). » Cela donnait à Babbitt un sentiment de loyauté, d’importance. Cela l’associait à de braves garçons, à des hommes qui étaient agréables et bons et qui occupaient une place dans le monde des affaires. C’était sa Croix de Victoria, son ruban de la Légion d’honneur, sa clef de Phi Beta Kappa (3). Aux détails délicats de la toilette s’ajoutaient d’autres ennuis complexes. « Je me sens un peu lourd ce matin, dit-il. Je crois que j’ai trop dîné hier soir. Vous ne devriez pas nous servir de ces beignets de banane. – Mais c’est vous qui m’en avez demandé. – Je le sais bien, seulement… je vais vous dire : quand on a dépassé quarante ans, il faut surveiller ses digestions. Il y a quantité de gens qui ne se soignent pas comme il le faudrait. À quarante ans, je vous assure, un homme, s’il n’est pas un imbécile, est son propre docteur. On ne fait pas assez attention à ces questions de régime. Je crois… bien entendu, on a besoin d’un repas copieux après une journée de travail, mais ce serait une bonne chose pour nous deux de déjeuner plus légèrement. – Mais, Georgie, ici, moi, je fais toujours un repas léger. – Ce qui veut dire que je mange comme un goinfre parce que je déjeune en ville ? Ah ! oui, parlons-en ! Vous seriez contente si vous aviez à avaler les ragoûts que le nouveau chef nous sert au Club Athlétique. Mais, pour sûr, je ne suis pas dans mon assiette, ce matin… C’est drôle, j’ai une douleur là, du côté gauche… mais non, ça ne peut pas être l’appendicite, n’est-ce pas ? Hier soir, en allant chez Verg Gunch, j’ai senti aussi une douleur dans l’estomac… juste là, une sorte d’élancement aigu. Je… Pourquoi ne nous servez-vous pas davantage de prunes au premier déjeuner ? Bien entendu, je mange une pomme tous les soirs : « Chaque jour une pomme – conserve son homme. » Mais tout de même, vous devriez nous donner plus de prunes, au lieu de toutes ces chatteries. – La dernière fois qu’on en a servi, vous n’en avez pas mangé. – C’est que ça ne me disait rien, je suppose…, mais en réalité je crois que j’en ai mangé. En tout cas… je vous assure qu’il est de la première importance de… je le disais encore à Verg Gunch hier soir : la plupart des gens ne surveillent pas assez leurs digestions. – Aurons-nous les Gunch à dîner la semaine prochaine ? – Bien sûr, voyons. – Alors, écoutez, George, je vous demande de mettre ce soir-là votre joli smoking. – Oh ! flûte ! Les autres ne voudront pas s’habiller. – Mais si, ils voudront. Rappelez-vous le jour où vous ne vous étiez pas habillé pour le souper de Littlefield, et où tout le monde l’était… Comme vous étiez gêné ! – Gêné ? Diable non, je ne l’étais pas. Tout le monde sait que je peux m’offrir un « Tux (4) » aussi cher que n’importe qui, et je serais embêté de ne pas le mettre quelquefois. Tout de même, c’est une sacrée corvée. Ça va bien pour une femme qui reste tout le temps chez elle, mais quand un pauvre bougre a travaillé comme un cheval toute la journée, il n’a guère envie de se décarcasser pour se mettre en grand tralala en l’honneur d’un tas de gens qu’il a vus le même jour en petite tenue. – Mais vous aimez vous montrer en smoking. L’autre soir, vous avez reconnu que j’avais bien fait d’insister pour que vous le mettiez, que vous vous sentiez plus à l’aise. Et puis, Georgie, j’aimerais tant que vous ne disiez pas « Tux »… C’est un smoking. – Qu’est-ce que ça peut bien fiche ? – C’est ce que disent tous les gens bien. Supposez que Lucile Mac Kelvey vous entende dire un « Tux » ! – Voilà qui me serait égal ! Je me fiche bien de Lucile Mac Kelvey. Son mari et son père peuvent être millionnaires, mais ils sont tous communs comme le pain d’orge. Vous voulez probablement soigner votre haute position sociale ? Eh bien, je vais vous dire une bonne chose : votre vénéré paternel Henry T… n’appelle même pas ça un « Tux », il dit, lui, « une jaquette écourtée pour un derrière de singe », et vous ne lui en feriez pas enfiler un, à moins de l’endormir au chloroforme. – Voyons, George, pas de grossièretés ! – Je ne veux pas en dire, mais, bon Dieu, voilà que vous faites autant d’histoires que Verona. Depuis qu’elle a quitté le collège, elle est devenue impossible à vivre… elle ne sait pas ce qu’elle veut… mais moi je m’en doute bien ! Tout ce qu’elle demande, c’est d’épouser un millionnaire, d’aller habiter l’Europe, de consulter à tout propos son pasteur, et en même temps de rester ici à Zénith, pour y être une sorte d’agitateur socialiste, patronner des œuvres de charité et jouer je ne sais quel sacré rôle. Dieu de Dieu ! et Ted ne vaut pas mieux : il veut aller au collège et en même temps il ne veut pas. Un seul des trois qui sache ce qu’il veut, c’est Tinka. Je n’arrive pas à comprendre comment j’ai jamais pu avoir un couple d’enfants hésitants comme Rone et Ted. Je ne suis sans doute pas un Rockefeller ni un James J. Shakespeare, mais je sais ce que je veux en tout cas et je ne cesse pas de turbiner au bureau et de… Savez-vous le bouquet ? Autant que je puis le démêler, la nouvelle marotte de Ted c’est de se faire acteur de cinéma… Je lui ai pourtant dit cent fois que s’il veut aller au collège, faire son droit et être sérieux, je lui mettrai le pied à l’étrier dans les affaires… Et Verona est toute pareille, elle ne sait pas ce qu’elle veut. Allons, vous venez ? Pas encore prête ? La bonne a sonné le déjeuner depuis trois minutes. » Avant de suivre sa femme, Babbitt s’arrêta devant la fenêtre de leur chambre qui donnait à l’ouest. Ce quartier des « Hauteurs Fleuries » était élevé, et, bien que le centre de la ville fût à trois milles de là – Zénith comptait maintenant de trois à quatre cent mille habitants – il voyait le sommet de la seconde Tour Nationale, édifice de trente-cinq étages en pierre de taille de l’Indiana. Ses murs se dressaient, brillants, sur le ciel d’avril, jusqu’à une corniche toute simple, comme une ligne de feu éblouissant. Il y avait dans cette tour de la probité, de la décision ; elle portait sa force légèrement, comme un soldat de haute taille. Tandis que Babbitt la contemplait, son visage perdit son expression de nervosité, il releva le menton, d’un air de respect. Il prononça uniquement ces mots : « Quelle vue délicieuse ! » mais le rythme de la cité le soulevait, l’affection qu’il lui portait était ravivée. Il considérait la tour comme la flèche d’un temple élevé à la religion des affaires, cette foi passionnée, exaltée, qui dépasse le commun des mortels, et en descendant déjeuner, il sifflait le refrain : « Oh ! parbleu, par Dieu, par Jingo… » comme si c’eût été un hymne grave et mélancolique.
CHAPITRE II
Débarrassée des éclats de voix de Babbitt et des petits grognements par lesquels sa femme exprimait la sympathie qu’elle avait trop d’expérience pour ressentir, mais beaucoup trop aussi pour ne pas montrer, leur chambre à coucher retomba instantanément dans l’impersonnalité.
Donnant sur la véranda, elle leur servait à l’un et à l’autre de cabinet de toilette et, par les nuits très froides, Babbitt renonçait voluptueusement au devoir de se montrer viril et se couchait dans le lit intérieur, pour avoir les pieds au chaud et se rire des bourrasques de janvier. La chambre présentait un ensemble de couleurs sobre et agréable, d’après un des meilleurs modèles du décorateur qui « faisait les intérieurs » pour la plupart des spéculateurs en maisons de Zénith. Les murs étaient gris, les boiseries blanches, le tapis d’un bleu franc : l’ameublement ressemblait beaucoup à de l’acajou, le bureau avec un grand miroir, la table à coiffer de madame Babbitt, avec des objets de toilette en argent presque massif, les deux lits jumeaux, entre eux une petite table supportant la lampe électrique type pour lire au lit, un verre d’eau, et un livre de chevet type avec illustrations en couleur. Quel ouvrage était-ce ? impossible de le dire, car personne ne l’avait jamais ouvert. Les matelas étaient fermes sans être durs, des matelas bien modernes, qui avaient coûté très cher ; les radiateurs à eau chaude avaient une surface calculée avec une précision toute scientifique pour la contenance cubique de la pièce. Les fenêtres, larges, s’ouvraient facilement, grâce au système le plus perfectionné de cordes et de crochets, et les jalousies hollandaises à rouleaux étaient garanties incassables. C’était un chef-d’œuvre de chambre à coucher, provenant des « Riantes maisons modernes pour fortunes moyennes ». Seulement elle n’avait rien à voir avec les Babbitt ni avec personne d’autre. Si quelqu’un y avait jamais vécu et aimé, lu à minuit des histoires palpitantes, y était resté étendu les dimanches matin dans une magnifique indolence, il n’en restait pas trace. Elle avait l’air d’une très bonne chambre dans un très bon hôtel. On s’attendait à voir une femme de chambre entrer et la préparer pour des gens qui y resteraient juste une nuit, en sortiraient sans tourner la tête et n’y penseraient plus jamais. Une maison sur deux à « Hauteurs Fleuries » avait une chambre à coucher identique à celle-là. Celle de Babbitt avait cinq ans d’existence. Tout y était aussi savamment combiné, aussi réussi que cette pièce. Elle était du meilleur goût, avait les meilleurs tapis d’un prix raisonnable, une architecture simple et louable, et le confort dernier cri. Partout l’électricité remplaçait les bougies et les cheminées malpropres. Dans la plinthe de la chambre à coucher, trois prises de courant se dissimulaient sous de petites plaques de cuivre. Dans les vestibules se trouvaient des prises pour le nettoyage par le vide, et le salon en avait pour la lampe du piano et pour le ventilateur. La belle salle à manger, avec son admirable buffet en chêne, son armoire aux portes garnies de vitraux, ses murs couverts d’un enduit crème, son modeste panneau représentant un saumon expirant sur un tas d’huîtres, avait des prises pour le filtre et le grilloir électrique. En somme, il ne manquait qu’une chose à la maison des Babbitt : c’était d’être un foyer. Souvent, le matin, Babbitt arrivait au petit déjeuner plein d’entrain, en humeur de rire. Mais ce jour-là, sans qu’on sût pourquoi, tout allait mal. En traversant gravement le palier du premier étage, il jeta un coup d’œil dans la chambre de Verona et gronda : « À quoi bon donner à sa famille une maison de premier ordre si elle ne l’apprécie pas, quand, tout en se consacrant aux affaires, on s’occupe du moindre détail ? » Il alla à ses enfants : Verona, une brune de vingt-deux ans, courtaude, sortant juste de chez Bryn Mawr (5), très préoccupée des questions de devoir, de sexualité, de religion, et de la coupe large du costume de sport gris qu’elle avait sur elle ; Ted – Théodore Roosevelt Babbitt, un garçon de dix-sept ans, très décoratif ; Tinka – Catherine, encore bébé à dix ans, – aux cheveux d’un rouge flamboyant, et dont la peau transparente révélait un excès de sucreries et d’« ice-cream sodas ». Babbitt, en entrant, ne laissa rien paraître de sa vague irritation : il avait horreur de jouer le tyran domestique et ses grogneries étaient aussi insignifiantes que fréquentes. Il cria à Tinka : « Eh bien, Chatonette ! » C’était le seul petit nom qu’il eût dans son vocabulaire avec le « chérie » et le « hon(6) » dont il saluait sa femme, et il le lançait tous les matins à Tinka. Il avala une tasse de café dans l’espoir de pacifier à la fois son estomac et son âme. Son estomac cessa de se faire sentir, comme s’il ne lui appartenait pas, mais Verona se mit à être assommante avec ses scrupules de conscience, et brusquement Babbitt retrouva les doutes sur la vie, la famille et les affaires qui l’avaient déchiré au moment où la svelte fée de ses rêves avait disparu. Verona avait été six mois employée aux écritures dans les bureaux des « Cuirs Gruensberg and Co », avec espoir de devenir secrétaire de M. Gruensberg et ainsi, comme le formulait son père, « de tirer profit de son éducation si coûteuse, jusqu’au jour où elle serait prête à se marier ». Mais voici que Verona disait : « Père, j’ai parlé à une camarade de classe qui travaille pour l’« Association Charitable »… Oh ! papa, on voit là, à la distribution de lait, les bébés les plus adorables, et je trouve que je devrais faire quelque chose dans ce genre-là, quelque chose qui en vaille la peine. – Qu’entends-tu par « qui en vaille la peine » ? Si tu arrives à être secrétaire de Gruensberg, – ça se pourrait, si tu t’entraînais à la sténographie au lieu de filer tous les soirs au concert ou à des parlotes, – tu trouveras, j’imagine, que trente-cinq ou quarante dollars par semaine en valent la peine. – Je sais bien, mais… oh ! je voudrais tant… coopérer… je voudrais travailler dans une de ces « Institutions de bienfaisance ». Je me demande si je ne pourrais pas décider un grand magasin à me laisser organiser un comptoir avec un joli salon de repos, tendu de perse et meublé de sièges de jonc, etc., etc. Ou encore, je pourrais… – Écoute-moi bien. La première chose qu’il faut que tu comprennes, c’est que tout ce micmac d’œuvres de secours, de bienfaisance et de récréation, ce n’est pas autre chose en ce bas monde que la porte ouverte au socialisme. Plus tôt un homme apprendra qu’on ne va pas le dorloter, qu’il n’a pas à compter sur de la boustifaille à l’œil et sur des classes gratuites et des friandises pour ses gosses, mais qu’il devra gagner tout cela, eh bien, plus tôt il se mettra au travail et produira, produira, produira. Voilà ce dont le pays a besoin et non pas de toutes ces blagues qui ne font qu’affaiblir la volonté de l’ouvrier et donner à ses gosses toutes sortes d’idées au-dessus de leur condition. Et toi… si tu voulais t’appliquer aux affaires au lieu de perdre ton temps à des tas de bêtises… tout ton temps ! Quand j’étais jeune, j’ai décidé ce que je voulais faire et je m’y suis cramponné dur et ferme, et voilà pourquoi je suis arrivé là où je suis aujourd’hui. En outre… Myra ! Pourquoi laissez-vous la bonne couper les toasts en jolis petits copeaux comme ça… impossibles à prendre… et presque froids, en tout cas ? » Ted Babbitt, junior à la grande École supérieure du quartier Est, avait fait entendre des sortes de petits hoquets pour interrompre. Il lança brusquement là-dessus : « Dis donc, Rone, est-ce que tu… » Verona se tourna vivement vers lui : « Ted, aurais-tu l’obligeance de ne pas nous arrêter quand nous parlons de choses sérieuses ? – Oh ! flûte, dit gravement Ted. Depuis qu’on a commis l’erreur de te laisser quitter le collège Ammonia, tu nous barbes avec tes conversations absurdes sur les faut-il ou ne faut-il pas… Est-ce que tu vas… Je voudrais la voiture ce soir. – Ah ! vraiment ? grogna Babbitt ; j’en aurai peut-être besoin, moi. » Verona protesta : « Ah ! tu la voudrais, jeune gigolo, mais je vais la prendre. » Tinka gémit : « Oh ! papa, tu avais dit que tu nous conduirais peut-être à Rosedale ! » Et madame Babbitt : « Attention, Tinka, tu mets ta manche dans le beurre. » Ils se jetaient des regards furieux et Verona hurla. « Ted, tu es absolument dégoûtant avec l’auto ! – Et toi pas, naturellement, pas du tout ! – Ted savait prendre un ton d’une douceur exaspérante. – Tu veux la chiper en sortant de table pour la laisser toute la soirée devant une porte, pendant qu’avec des filles de ton acabit vous jaboterez littérature ou discuterez sur les poseurs que vous allez épouser… pourvu qu’ils vous demandent. – Enfin, papa ne devrait jamais te laisser prendre l’auto. Avec ces horribles fils Jones vous conduisez comme des fous. On n’a pas idée de prendre le virage de la place Chautauqua à quarante milles à l’heure. – Où as-tu pris ça ? Toi, tu as une si sacrée peur de l’auto que tu mets le frein pour monter les côtes. – Pas vrai ! Et toi… toi qui prétends toujours te connaître si bien en moteurs, Eunice Littlefield m’a dit que tu soutenais que c’est la batterie qui alimente le carburateur. – Mais toi, ma bonne fille, tu ne distingues pas un carburateur d’un différentiel. » Ted avait ses raisons pour faire le malin avec elle : il était né mécanicien, il savait tripoter et réparer un moteur. « Assez là-dessus ! » lança machinalement Babbitt en allumant le premier cigare, si délicieux, de la journée et en dégustant la liqueur réjouissante des gros titres de l’Advocate Times. Ted entra en pourparlers : « Voyons, Rone, sérieusement, je ne veux pas te prendre la vieille bagnole, mais j’ai promis à deux ou trois filles de ma classe de les conduire à la répétition du chœur de l’école et, par Dieu, je n’y tiens pas, mais un gentleman doit respecter ses engagements. – Ah ! non, ma parole… tes engagements… à l’École supérieure ! – Oh ! ce que tu es difficile depuis que tu as été à ce collège de poules huppées ! Tu me permettras de te dire qu’il n’y a pas dans tout l’État une école particulière qui ait un lot de garçons aussi épatants que ceux que nous avons cette année en Gamma Digamma. Il y en a deux dont les pères sont millionnaires. Sais-tu quoi ? Eh bien, je devrais avoir ma voiture à moi, comme un tas de types. » Babbitt s’en leva presque : « Une voiture à toi ? Tu ne voudrais pas aussi un yacht, et une maison avec parc ? Après celle-là il n’y a qu’à tirer l’échelle ! Un garçon incapable de passer son examen de latin, comme le ferait n’importe qui, et il espère que je vais lui offrir une auto, avec un chauffeur, probablement, et peut-être bien un avion, pour le récompenser de la peine qu’il se donne pour aller au cinéma avec Eunice Littlefield ! Eh bien, quand tu me verras faire ça… » Un peu plus tard, après beaucoup de diplomatie, Ted amena Verona à avouer qu’elle allait tout simplement ce soir-là à l’Arsenal, à l’exposition canine et féline. Elle n’aurait donc, suivant les instructions de Ted, qu’à laisser l’auto devant chez le confiseur, en face de l’Arsenal, où il la prendrait. Il y eut de parfaites combinaisons au sujet de la clef à laisser et du réservoir à tenir plein, et passionnément, en dévots du Grand Dieu Moteur, ils chantèrent la pièce mise à la chambre à air de rechange et le cric perdu. Cette trêve finie, Ted déclara que les amies de sa sœur étaient « un tas de pies-grièches, de bluffeuses au caquet prétentieux ». « Ses amies à lui, dit-elle, singeaient ridiculement les sportives et n’étaient que d’affreuses petites ignorantes qui glapissaient. » Et encore ceci : « C’est dégoûtant de fumer tant de cigarettes et cet accoutrement que tu as ce matin est trop grotesque ; sérieusement, c’est à vous lever le cœur. » Ted se dandina jusqu’au miroir biseauté du buffet, y contempla ses charmes et sourit avec complaisance. Son costume, dernière création de « Old Eli Togs », était étroitement collant, et le pantalon étriqué s’arrêtait en haut de ses éblouissantes bottines brunes, veston serré à la taille, étoffe à carreaux et, dans le dos, une ceinture qui ne tenait rien. Comme cravate, une énorme écharpe de soie noire. Ses cheveux blonds relevés en arrière, sans raie, étaient collés et unis comme de la glace. Pour aller à son école, il ajoutait à cela une casquette avec une visière longue comme un fer de bêche. Le plus superbe de tout était son gilet, pour lequel il avait économisé, supplié, combiné, un véritable gilet de fantaisie, en peau de faon à pois rouges, aux pointes étonnamment longues. À leur extrémité inférieure, il portait un insigne de son école, un de sa classe et une « épingle de fraternité ». Mais tout cela importait peu. Il était souple, preste et vigoureux ; ses yeux, qu’il croyait cyniques, étaient pleins d’une ardeur candide. Mais il n’était pas trop bien élevé. Avec un geste de la main à la pauvre courtaude de Verona, il dit d’une voix traînante : « Oui, je crois que nous sommes un peu ridicules et dégueulasses et que notre nouvelle cravate fait tache. – Pour sûr ! aboya Babbitt, et pendant que tu t’admires, laisse-moi te dire que tu ajouterais à ta beauté virile si tu essuyais ce jaune d’œuf sur tes lèvres. » Verona ricana, momentanément victorieuse dans la plus grande des Grandes Guerres, qui est celle de la famille. Ted lui jeta un regard désespéré puis cria à Tinka : « Pour l’amour de Dieu, ne verse pas tout le sucrier sur tes grains de blé ! » Verona et Ted partis et Tinka remontée au premier, Babbitt dit à sa femme : « Jolie famille, ma foi ! Je ne prétends pas être un agneau bêlant et il peut arriver que je sois parfois un peu hargneux au déjeuner, mais la façon dont ils ne cessent de s’asticoter… je ne peux plus supporter ça. Ma parole, j’ai envie de me sauver quelque part où je puisse avoir un peu la paix. Je crois vraiment que, quand un homme a passé sa vie à essayer de donner à ses gosses une éducation convenable et de leur mettre des atouts en main, il est assez décourageant de les entendre tout le temps grincer des dents, comme une bande de hyènes, et ne jamais, jamais… Tiens, curieux : on dit là, dans le journal… se taire un seul mom… Vous avez vu le journal de ce matin ? – Non, mon ami. » En vingt-trois ans de vie conjugale, madame Babbitt avait vu le journal avant son mari juste soixante-sept fois. « Quantité de nouvelles. Terrible tornade dans le Sud, mais par chance, pas de malheurs. Mais ça, écoutez, ça c’est épatant ! C’est le commencement de la fin pour ces gaillards-là. L’Assemblée de New York a voté des textes qui devraient mettre les socialistes complètement hors la loi. Et puis : à New York, grève des garçons d’ascenseurs, des tas de collégiens les remplacent. À la bonne heure ! À Birmingham, meeting monstre pour demander la déportation de ce Mick, cet agitateur, le fameux de Valera. Par Dieu, c’est rudement bien fait ! Tous ces révolutionnaires sont payés par les Allemands, bien sûr. Et nous n’avons rien à voir avec les Irlandais ou avec aucun gouvernement étranger : nous n’avons qu’à nous tenir strictement en dehors. Encore un bruit venant de Russie et qui paraît authentique : la mort de Lénine. Tant mieux ! Je ne comprends pas pourquoi nous n’allons pas tout simplement là-bas pour flanquer dehors à coups de pied ces salauds de bolchevistes. – Bien sûr ! dit madame Babbitt. – Et on raconte ici qu’on a installé un maire qui était en salopette… et un pasteur encore. Qu’est-ce que vous dites de ça ? – Hum ! ma foi… » Il chercha une attitude, mais ni comme républicain, ni comme presbytérien ou comme Élan, ni comme agent immobilier, il n’avait de théorie toute prête sur les maires-pasteurs ; aussi, après un grognement, poursuivit-il sa lecture. Elle prit un air de sympathie et n’entendit pas un mot. Plus tard, elle lirait les articles de tête, les échos mondains et les annonces des grands magasins. « Écoutez-moi un peu ça : voilà Charley Mac Kelvey qui jette plus que jamais de la poudre aux yeux par ses réceptions. Voici ce que raconte sur celle d’hier soir la rédactrice intarissable : « Jamais la Société, par une grande, une très grande S, n’est plus flattée que quand elle est invitée à une joyeuse fête comme celle d’hier dans la demeure si distinguée et si hospitalière de monsieur et madame Charles L. Mac Kelvey. S’élevant au milieu de vastes pelouses et d’un beau paysage, l’un des plus magnifiques parmi ceux qui couronnent Royal Ridge, mais plaisante et intime, malgré ses puissants murs de pierre et la taille de ses salons, fameux pour leur décoration, leur maison s’ouvrait hier soir pour un bal en l’honneur de Miss J. Sneeth de Washington, en ce moment invitée de madame Mac Kelvey. Le grand hall est de proportions si magnifiques qu’il faisait une parfaite salle de bal, dont le parquet étincelant de bois précieux réfléchissait un charmant spectacle. Mais les attraits de la danse eux-mêmes pâlissaient devant les séduisantes occasions de tête-à-tête qui invitaient les âmes à s’abandonner, dans la longue bibliothèque, devant la cheminée moyenâgeuse, ou dans le salon aux moelleux et profonds fauteuils, aux lampes voilées, faites pour les chuchotements à deux de jolis riens, ou même dans le billard, où l’on pouvait prendre une queue et montrer son talent à un autre jeu que ceux auxquels président Cupidon et Terpsichore. » Il y en avait encore beaucoup, beaucoup plus, dans le meilleur style journalistique de miss Eleonora Pearl Bates, rédactrice fameuse des mondanités de l’Advocate Times. Mais Babbitt ne put y tenir, il grogna, il froissa le journal, il protesta : « On ne fait pas mieux. Je suis prêt à accorder tout le crédit du monde à Charley Mac Kelvey. Quand nous étions au collège ensemble, il était aussi à court d’argent que n’importe lequel d’entre nous et il a gagné un bon million de dollars dans les adjudications, sans être plus malhonnête ou acheter plus de conseils municipaux qu’il n’était nécessaire. Et il a une belle maison, quoiqu’elle n’ait pas de « puissants murs de pierre » et ne vaille pas les quatre-vingt-dix mille qu’elle lui a coûtés. Mais qu’on en arrive à parler de Charley Mac Kelvey et de toute sa bande de buveurs comme d’une brillante réunion de… de… de… Vanderbilt, ça, ah ! non, ça me porte sur les nerfs. – J’aimerais pourtant bien voir leur intérieur, risqua timidement madame Babbitt : ce doit être ravissant. Je n’y suis jamais entrée. – Moi si, des tas de fois, pour voir Charley, à propos d’affaires, le soir. Ce n’est pas si extraordinaire. Je ne voudrais pas y aller dîner avec toute cette clique de gens extravagants. Et je parierais que j’ai plus d’argent que beaucoup de ces farceurs prétentieux qui dépensent tout ce qu’ils ont en vêtements de soirée et qui n’ont pas à eux un caleçon convenable. Tiens ? Qu’est-ce que vous dites de ceci ? » Madame Babbitt resta étrangement indifférente aux avis de la colonne « Immeubles et constructions » de l’Advocate Times. Rue Ashtabula 496. – J. K. Dawson à Thomas Mullally. Avril 17, 15,7 X 112,2. Hypoth. $ 4.000……………………… Nom Ce matin-là, d’ailleurs, Babbitt était trop troublé pour entretenir sa femme de machines en gage, d’enregistrement d’hypothèques et d’entreprises en adjudication. Il se leva. Quand il la regarda, ses sourcils semblèrent se hérisser. Brusquement : « Oui, peut-être bien… c’est un peu dommage de ne pas rester en relation avec des gens comme les Mac Kelvey. Nous pourrions essayer de les inviter à dîner un soir. Mais non, tonnerre, ne perdons pas un temps précieux à nous occuper d’eux. Notre petit groupe passe de bien meilleurs moments que tous ces richards. Comparez un peu un véritable être humain comme vous à ces poupées névrosées comme Lucile Mac Kelvey… rien que des propos guindés, et habillée… comme une châsse. Vous êtes une brave et digne femme, non ! » Il corrigea cette manifestation de tendresse par une plainte. « Dites-moi, ne laissez pas Tinka continuer à s’empoisonner avec toutes ces sucreries. Au nom du Ciel, tâchez de l’empêcher de s’abîmer l’estomac. Je vous l’assure, la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point il est important d’avoir de bonnes digestions et des habitudes régulières. Je rentrerai sans doute vers l’heure ordinaire. » Il l’embrassa… ou presque : il posa des lèvres inertes sur une joue indifférente. Puis il courut au garage en murmurant : « Bon Dieu, quelle famille ! Voilà que Myra va m’en vouloir parce que nous ne pouvons pas suivre le train de ces millionnaires. Sacrebleu ! j’aurais envie quelquefois d’envoyer tout promener… et les embêtements du bureau sont encore pires. Mon humeur s’en ressent, malgré moi… je n’y peux rien… je suis si fatigué ! »
CHAPITRE III
Pour George F. Babbitt, comme pour la plupart des gens à leur aise de Zénith, son automobile représentait à la fois la poésie et le drame, l’amour et l’héroïsme. Le bureau était son navire de pirate, mais son auto la périlleuse descente à terre. Parmi les redoutables crises de chaque jour, aucune n’était aussi tragique que la mise en marche de la machine. Le moteur était lent à démarrer par les matins froids, il fallait écouter son long et inquiétant bourdonnement ; quelquefois il fallait verser de l’éther dans les purgeurs des cylindres, et c’était si passionnant qu’à déjeuner il racontait l’opération, goutte à goutte, et calculait de tête combien chacune lui avait coûté. Ce matin-là, comme il était au noir, il était préparé à trouver que quelque chose ne marchait pas et il fut désappointé quand le mélange explosa aussitôt avec force et que la voiture n’effleura même pas le jambage de la porte, déjà éraflé et écorché tant de fois par les ailes, quand il sortait en marche arrière. Il en était confondu. Il lança à Sam Doppelbrau un bonjour plus cordial qu’il n’en avait l’intention. La maison coloniale blanche et verte de Babbitt faisait partie d’un groupe de trois sur Chatham Road. À sa gauche était l’habitation de M. Samuel Doppelbrau, secrétaire d’une excellente maison d’installation pour salles de bains. C’était un bâtiment confortable, sans aucune prétention à l’architecture : une grande boîte en bois avec une tour trapue, un large porche, le tout couleur jaune d’œuf. Babbitt blâmait monsieur et madame Doppelbrau, qu’il considérait comme des « bohèmes ». On entendait chez eux jusqu’à plus de minuit de la musique et des rires bruyants ; on chuchotait, dans le voisinage, à propos du whisky de contrebande et de courses folles en automobile. Ils fournissaient à Babbitt matière à discussion pour des soirées entières, où il déclarait énergiquement : « Je ne suis pas collet monté et je ne dis rien quand je vois un gaillard s’enfiler un verre de temps à autre, mais quand on en arrive à essayer délibérément de ne pas se faire pincer tout en faisant continuellement la bombe, comme les Doppelbrau, alors, ça, je n’en suis plus. » De l’autre côté de chez Babbitt habitait Howard Littlefield, docteur en philosophie ; sa maison était résolument moderne, le bas en briques d’un rouge foncé avec fenêtres en ogives et à vitraux, le haut en stuc clair, avec un toit en tuiles rouges. Littlefield était le grand savant du quartier, une autorité en toutes choses, excepté les bébés, la cuisine et les moteurs ; bachelier ès arts du collège Bladgett et docteur en philosophie et sciences économiques de Yale. Chef du personnel et directeur de la publicité de la Compagnie des transports en commun de Zénith, il était capable, après quelques heures de préparation, de se présenter devant le conseil municipal ou l’assemblée législative de l’État, et de prouver péremptoirement, avec chiffres à l’appui, en s’appuyant sur des précédents de Pologne ou de Nouvelle-Zélande, que la Compagnie des tramways adorait le public et choyait ses employés ; que toutes ses actions étaient entre les mains de veuves et d’orphelins, et que, quoi qu’elle désirât faire, cela profiterait aux propriétaires en augmentant la valeur des immeubles et serait avantageux pour les pauvres en faisant baisser les loyers. Toutes les relations de Littlefield se tournaient vers lui quand elles voulaient savoir la date du siège de Saragosse, la définition du mot « sabotage », l’avenir du mark allemand, la traduction de hinc illœ lacrymœ, ou le nombre des sous-produits du goudron. Il effarait Babbitt en lui avouant qu’il restait souvent jusqu’à minuit à lire les chiffres et notes des rapports officiels ou à parcourir – pour s’amuser des fautes de l’auteur – les plus récents volumes de chimie, d’archéologie ou d’ichtyologie. Mais le grand mérite de Littlefield, c’était son exemple intellectuel. Malgré son extraordinaire érudition, il était aussi strict presbytérien et aussi ferme républicain que George F. Babbitt. Il confirmait les hommes d’affaires dans leur foi. Alors qu’ils savaient, uniquement par un instinct passionné, que leur système, leurs procédés industriels étaient excellents, le docteur Howard Littlefield le leur prouvait par l’histoire, la science économique et les aveux de radicaux convertis. Babbitt éprouvait une grande et honorable fierté à être le voisin d’un tel savant et à voir l’intimité de Ted et d’Eunice Littlefield. À seize ans, Eunice ne s’intéressait à aucune statistique, sauf à celles qui concernaient l’âge et les cachets des « stars » de cinéma, mais, comme le constatait Babbitt, d’un mot définitif : « C’était la fille de son père. » La différence qui sépare un homme léger comme Sam Doppelbrau d’une vraiment belle nature comme Littlefield se révélait dans leur extérieur. Doppelbrau était d’une jeunesse troublante pour un homme de quarante-huit ans. Il portait son melon rejeté en arrière et sa face rouge était plissée par un rire niais. Littlefield, lui, paraissait vieux pour un homme de quarante-deux ans : grand, large, épais, il avait des lunettes d’or enchâssées dans sa longue figure, ses cheveux formaient une masse mouvante grise et noire, il soufflait en parlant d’une voix grondante, son insigne de « Phi Beta Gamma » brillait sur un gilet noir tout taché et il sentait la vieille pipe. Il avait, avec un air funèbre, quelque chose d’un archidiacre, et, pour le courtier en immeubles et l’entrepreneur de salles de bains, il s’y mêlait une odeur de sainteté. Ce matin-là, il se tenait devant sa maison, examinant le gazon qui poussait entre le trottoir et la large chaussée en ciment. Babbitt arrêta son auto et se pencha pour crier : « Bonjour ! » Littlefield s’approcha et posa un pied sur le marchepied de la voiture. « Belle matinée ! dit Babbitt, en allumant – trop tôt – son second cigare de la journée. – Oui, très belle ! dit Littlefield. – Le printemps va venir vite, maintenant. – Oui, c’est déjà le vrai printemps. – Les nuits sont encore froides, pourtant. J’ai dû prendre deux couvertures pour dormir sur ma véranda hier soir. – Oui, il n’a pas fait très chaud la nuit dernière. – Mais je ne crois pas que nous ayons encore de vrais froids. – Non, mais pourtant il y a eu de la neige hier à Tiflis, dans le Montana, et vous vous rappelez cette tempête glaciale qu’ils ont eue dans l’Ouest il y a trois jours : trente pouces de neige à Greeley, dans le Colorado, et il y a deux ans nous avons eu une rafale de neige ici même, à Zénith, le 23 avril. – C’est vrai. Dites-moi, mon cher, que pensez-vous du candidat républicain ? Qui va-t-on nommer président ? Ne croyez-vous pas qu’il serait temps d’avoir un véritable gouvernement d’affaires ? – À mon avis, ce qu’il faut avant tout au pays, c’est une bonne direction des affaires, purement commerciale. Ce dont nous avons besoin, appuya Littlefield, c’est d’une administration commerciale. – Je suis heureux de vous l’entendre dire, ma foi, oui, très heureux. Je ne savais pas ce que vous en penseriez, vous, l’homme des associations, des collèges, etc., et je suis bien content que vous ayez la même opinion que moi. Ce qu’il faut au pays, dans les circonstances actuelles, ce n’est ni un président homme de culture, ni toutes ces simagrées au sujet des affaires étrangères, mais une bonne, une saine administration commerciale et économique, qui nous donnera le moyen de faire d’heureuses transformations. – Oui. On ne se rend généralement pas compte que, même en Chine, les hommes d’études cèdent maintenant la place à des esprits plus pratiques, et vous voyez naturellement ce que cela signifie. – Oh ! vraiment ? Eh bien ! eh bien ! respira fortement Babbitt, qui se sentait bien plus calme et bien plus heureux de savoir comment les choses allaient dans le monde. Allons, je suis bien aise de m’être arrêté à bavarder une seconde avec vous. Maintenant il faut que je descende à mon bureau pour « avoir » quelques clients. Sur ce, à bientôt, mon cher. Je vous reverrai ce soir. Au revoir ! » Ils avaient bien travaillé, ces braves citoyens. Vingt ans plus tôt, la colline sur laquelle s’éparpillaient les maisons des « Hauteurs Fleuries » avec leurs toits brillants, leurs gazons impeccables et leur confort stupéfiant, n’était qu’une vaste solitude plantée d’ormes, de chênes et d’érables de belle venue. Dans certaines rues restaient encore quelques lots de terrain boisé vacant et une parcelle d’un ancien verger. Il faisait beau ce jour-là : les branches de pommiers s’éclairaient de feuilles nouvelles, semblables à des flammes vertes. Dans un ravin tremblotait la première blancheur des fleurs de cerisier, et les rouges-gorges chantaient à tue-tête. Babbitt humait l’odeur de la terre, riait en entendant les oiseaux, comme il aurait fait devant des poussins ou à un film comique. On reconnaissait à le voir le parfait patron allant à son bureau : un homme bien nourri, sur la tête un joli chapeau brun en feutre mou, avec des lunettes sans monture, fumant un gros cigare en conduisant une bonne voiture dans une allée de demi-banlieue. Mais il portait en lui, comme un don, un amour authentique pour son entourage, sa ville, son clan. L’hiver fini, la saison était venue des constructions, cette moisson palpable, son triomphe. La dépression ressentie à l’aube disparut : il était plein d’entrain quand il s’arrêta dans Smith Street pour déposer son pantalon brun et faire le plein d’essence. Les rites familiers accrurent son impression de bien-être : la vue de la grande pompe rouge, le garage en terre et briques creuses, la vitrine remplie des accessoires les plus séduisants : enveloppes éblouissantes, bougies d’allumage en porcelaine immaculée, chaînes de pneumatiques en or ou en argent. Il fut flatté de l’empressement amical avec lequel Sylvestre Moon, le plus sale et le plus adroit des mécaniciens, s’avança pour le servir. « Bonjour, monsieur Babbitt », lui dit Moon, et il eut conscience d’être un personnage important, dont tous les garagistes bien achalandés retenaient le nom, et non pas un de ces chauffards qui circulent dans des tacots de quatre sous. Il admira l’ingéniosité du cadran automatique qui marquait gallon par gallon, il admira l’à-propos de l’enseigne : « Évitez la panne d’essence ! Remplissez à temps. Essence : aujourd’hui 31 cents », il admira le glouglou rythmé du liquide coulant dans le réservoir et la régularité mécanique avec laquelle Moon tournait la manivelle. « Combien en prenez-vous aujourd’hui ? » demanda Moon d’un ton où s’alliaient l’indépendance du grand spécialiste, la familiarité d’un propos amical et le respect dû à un homme qui tenait dans la société la place d’un George F. Babbitt. – Faites le plein. – Qui soutenez-vous comme candidat républicain, monsieur Babbitt ? – Il est trop tôt pour établir des pronostics. Après tout il y a encore un bon mois et demi, non, trois quarts, – ça doit faire près de trois semaines – enfin plus de six semaines en tout avant la Convention républicaine, et je trouve qu’on doit ouvrir l’œil et considérer les candidats, les examiner sur toutes les coutures, les peser, et puis alors, décider avec soin. – Très juste ! monsieur Babbitt.