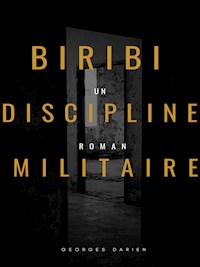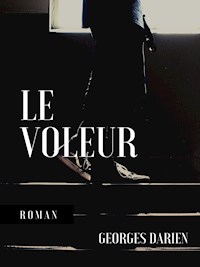Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "La guerre a été déclarée hier. La nouvelle en est parvenue à Versailles dans la soirée. M. Beaudrain, le professeur du lycée qui vient me donner des leçons tous les jours, de quatre heures et demie à six heures, m'a appris la chose dès son arrivée, en posant sa serviette sur la table. Il a eu tort. Moi qui suis à l'affût de tous les prétextes qui peuvent me permettre de ne rien faire, j'ai saisi avec empressement celui qui m'était offert."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La guerre a été déclarée hier. La nouvelle en est parvenue à Versailles dans la soirée.
M. Beaudrain, le professeur du lycée qui vient me donner des leçons tous les jours, de quatre heures et demie à six heures, m’a appris la chose dès son arrivée, en posant sa serviette sur la table.
Il a eu tort. Moi qui suis à l’affût de tous les prétextes qui peuvent me permettre de ne rien faire, j’ai saisi avec empressement celui qui m’était offert.
– Ah ! la guerre est déclarée ! Est-ce qu’on va se battre bientôt, monsieur ?
– Pas avant quelques jours, a répondu M. Beaudrain avec suffisance. Un de mes amis, capitaine d’artillerie, que j’ai rencontré en venant ici, m’a dit que nous ne passerions guère le Rhin avant une huitaine de jours.
– Alors, nous allons passer le Rhin ?
– Naturellement. Il est nécessaire de franchir ce fleuve pour envahir la Prusse.
– Alors, nous envahirons la Prusse ?
– Naturellement, puisque nous avons 1813 et 1815 à venger.
– Ah ! oui, 1813 et 1815 ! Après Waterloo, n’est-ce pas, monsieur ? Quand Napoléon a été battu ?…
– Napoléon n’a pas été battu. Il a été trahi, a fait M. Beaudrain en hochant la tête d’un air sombre. Mais donnez-moi donc votre devoir ; c’est un chapitre des Commentaires, je crois ?
– Oui, monsieur… J’ai vu chez M. Pion…
–… Les Commentaires… Ah ! c’était un bien grand capitaine que César ! Eh ! eh ! nous suivons ses traces. Seulement nous n’aurons pas besoin de perdre trois jours, comme lui, à jeter un pont sur le Rhin ; nous irons un peu plus vite, eh ! eh !… Qu’est-ce que vous avez vu, chez M. Pion ?
– Une gravure qui représente Napoléon partant pour Sainte-Hélène et prononçant ces mots : « Ô France… »
Le professeur m’a coupé la parole d’un geste brusque ; et, passant la main droite dans son gilet, la main gauche derrière le dos, il a murmuré d’une voix lugubre en levant les yeux au plafond :
– « Ô France, quelques traîtres de moins et tu serais encore la reine des nations ! »…
– C’est sur le Bellérophon, n’est-ce pas, monsieur, que l’Empereur était embarqué ?
– Je vous apprendrai cela plus tard, mon ami. Pour le moment, nous n’en sommes qu’à l’histoire grecque… à la Tyrannie des Trente… Mais donnez-moi votre devoir.
J’ai tendu sans peur la feuille de papier. M. Beaudrain me l’a rendue dix minutes après avec un trait de crayon bleu à la onzième ligne et une croix en marge :
– Un non-sens, mon ami, un non-sens. Hier, vous n’aviez qu’un contresens. Somme tout, ce n’est pas mal, car le passage n’est pas commode. Je m’étonne que vous vous en soyez si bien tiré.
Ça ne m’étonne pas, pour une bonne raison : je copie tout simplement mes versions, depuis deux mois, sur une traduction des Commentaires que j’ai achetée dix sous au bouquiniste de la rue Royale. Les jours pairs, je glisse traîtreusement un tout petit contresens dans le texte irréprochable ; les jours impairs, j’y introduis un non-sens. Hier, c’était le 17.
Mon père est entré.
– Bonjour, monsieur Beaudrain. Eh bien ! votre élève ?…
– Ma foi, monsieur Barbier, j’en suis vraiment bien content, je lui faisais justement des éloges… À propos, dites donc, ça y est.
– Ça y est, a répété mon père, et ce n’est vraiment pas trop tôt. Ces canailles de Prussiens commençaient à nous échauffer les oreilles. Ça ne vaut jamais rien de se laisser marcher sur les pieds. Avant un mois nous serons à Berlin.
– Un mois environ, a fait M. Beaudrain. Il faut bien compter un mois. Un de mes amis, capitaine d’artillerie, que j’ai rencontré en venant ici, m’a dit que nous ne passerions guère le Rhin avant une huitaine de jours.
– Oui, oui, les préparatifs… les… les… les préparatifs. On n’a jamais pensé à tout…
– Oh ! pardon, pardon, papa ! s’est écriée ma sœur Louise qui a ouvert la porte, un journal déplié à la main, le maréchal Le Bœuf a affirmé que tout était prêt et, dans quatre ou cinq jours…
– Eh ! eh ! a ricané M. Beaudrain en saluant ma sœur, les dames sont toujours pressées. J’apprenais justement à monsieur votre père, mademoiselle, qu’un de mes amis, capitaine d’artillerie, que j’ai rencontré en venant ici, m’a dit…
Ce matin, à neuf heures, mon père m’a envoyé chercher le journal à la gare.
– Tu demanderas le Figaro.
J’ai demandé le Figaro.
– Vous ne préféreriez pas le Gaulois ou le Paris-Journal ? insinue la marchande qui est justement en train de lire, derrière sa table, le dernier numéro qui lui reste.
– Non, non, le Figaro.
Elle replie lentement la feuille et me la tend en soupirant. Comme ça doit être intéressant !
Au coin de la rue, je déplie à demi le journal. On me défend de le lire, à la maison ; mais tant pis, je risque un œil – un œil que tire un titre flamboyant : La Guerre.
Je dévore l’article. Non plus furtivement, comme je fais quelquefois, un œil déchiffrant les lignes aperçues dans l’entrebâillement du papier, un œil explorant les environs, mais sans gêne, tranquillement, coram populo, portant le journal tout déplié devant moi, à bras tendus, comme une affiche que je vais coller le long d’un mur. Et, quand je le ferme, à vingt pas de la maison, des phrases dansent encore devant moi, pesantes comme des massues, des lignes longues, droites comme des épées, les petites lignes des alinéas acérées comme des couteaux ; j’ai dans la tête comme un remuement d’armes, un cliquetis de ferrailles. Je réciterais l’article d’un bout à l’autre, j’indiquerais la place des virgules et même des points d’exclamation :
« Le tambour bat, le clairon sonne, – c’est la guerre ! Aux armes ! Aux armes !
… Aux armes ! Sus à ces beaux fils de la sabretache, qui épient à l’horizon les baïonnettes de la France !…
… Place au canon ! Et chapeau bas ! Il va faire la trouée à la civilisation ! À l’humanité !… C’est sa voix qui va chanter l’hosanna de la victoire !
… La France reculer ?… C’est le soleil qui s’arrête… Et quel est le nouveau Josué qui fera reculer le soleil de la France ?… Moltke, peut-être ?… ! ! ! ― »
Je suis empoigné…
– Tu as l’air tout chose, Jean, me dit mon père à déjeuner.
– C’est probablement la déclaration de guerre qui le tracasse, répond ma sœur en ricanant.
Je ne réplique pas. À quoi bon ? Cette pimbêche de Louise se figure que je suis trop petit pour m’occuper de politique et, à deux ou trois questions, que je lui ai posées ce matin elle m’a fait des réponses moqueuses. Mais, attends un peu, ma belle, dans cinq ou six ans je m’en occuperai, de politique ; et tant que je voudrai, encore. Tandis que toi, tu n’es qu’une femme ; et les femmes… Quand j’en aurai une, je ne lui permettrai de lire que les faits-divers, dans mon journal. Et si Jules n’est pas un imbécile, il fera comme moi. Il faudra que je le lui dise, tout à l’heure.
Je le lui dis. Je le retiens dans un coin de sa maison de l’avenue de Villeneuve-l’Étang où nous avons été lui rendre visite, l’après-midi, et je lui explique mon système. Il m’écoute en souriant.
– Tu n’as peut-être pas tort, mon ami. Seulement, tu oublies une chose : c’est que je ne suis pas encore ton beau-frère et que…
– Oh ! c’est tout comme, Jules, car dans deux mois Louise et toi vous serez mariés.
– Et si la guerre tourne mal ?
Je répondrais bien que ce n’est pas possible, mais il faudrait avouer que j’ai lu le journal qui prédit la victoire, et j’aime mieux ne pas répondre, passer pour manquer d’informations.
Je suis Jules au jardin où Léon, le frère de Jules, un garçon de mon âge, et Mlle Gâteclair, leur tante, causent avec mon père et ma sœur. Ils parlent de certains changements à apporter à l’arrangement du terrain.
– Il faudrait avant tout, dit Louise, un massif d’arbres verts pour cacher le réservoir.
– Jules y a songé ce matin, répond Mlle Gâteclair.
– Et que penseriez-vous, fait mon père qui vient de réfléchir profondément, sa canne sous le bras, son menton dans la main, que penseriez-vous d’une jolie corbeille de verveines ou de géraniums au milieu de cette pelouse ?
– Ce serait gentil, dit Jules.
– Adorable, s’écrie Louise.
– Maintenant, continue mon père en se pourléchant les lèvres et en arrondissant les bras, on pourrait égayer un peu la façade en plaçant, par exemple, à droite une boule rouge, à gauche une boule verte et au milieu une boule dorée. Hein ? Ce serait-il gentil ?
– Charmant ! Charmant !
Ça me paraît bête, tout simplement. On ferait bien mieux de conserver cette grande pelouse où l’on peut se rouler à son aise et faire de bonnes parties de quilles. Depuis un mois, chaque fois que nous venons chez Jules, c’est pour dresser des plans dont l’exécution doit révolutionner sa propriété. Il n’est question que de changement, de transformation, de dérangement. Et Jules qui trouve ça tout naturel ! Il renverserait sa maison pour les beaux yeux de Louise. Ah ! s’il la connaissait comme moi…
– Viens-tu arroser les fleurs avec moi ? me demande Léon.
– Mais non. Il fait encore trop chaud.
La vérité, c’est que je ne veux pas quitter les grandes personnes. Elles vont certainement parler de la guerre, des Prussiens, et je ne veux pas perdre un mot de ce qu’elles vont dire.
J’attends une bonne heure, prêtant l’oreille, tout en faisant semblant de m’intéresser aux fleurs, aux arbustes. Rien ; ils n’ont parlé de rien ; ça a joliment l’air de les occuper, la guerre ! Dieu de Dieu ! comme je m’ennuie !
Nous nous en allons, quand mon père se tourne vers Jules.
– Croyez-vous ? Cette vieille canaille de Thiers qui ne trouvait pas de motif avouable de guerre ?
– Ah ! Gambetta a marché, lui, répond Jules. Décidément, c’est mon homme.
– Peuh ! un drôle de pistolet !
Et mon père fait un geste de mépris pendant que ma sœur pince les lèvres.
– Oh ! moi, vous savez, reprend vivement Jules tout rougissant, je m’occupe si peu de politique…
– C’est comme moi, dit Mlle Gâteclair.
J’ai demandé la permission de rester une heure de plus pour aider Léon à arroser les fleurs. Je l’entraîne dans un coin du jardin.
– Est-ce que Jules t’a parlé de la guerre ?
– Oui.
– Qu’est-ce qu’il t’a dit ?
– Que c’était bien embêtant.
– Et ta tante t’en a-t-elle parlé ?
– Oui.
– Qu’est-ce qu’elle t’a dit ?
– Que c’était bien malheureux.
Ah ! comme on voit qu’ils ne s’occupent pas de politique !
Le soir, après dîner, j’ai ma revanche. Les voisins font invasion chez nous. M. Pion, d’abord, le capitaine en retraite qui entre en criant :
– Hein ! qu’est-ce que je vous disais, Barbier ? Ça finit-il par la guerre, oui ou non, cette question Hohenzollern ?
Et Mme Pion ajoute, en retirant son chapeau :
– Les Prussiens se figuraient, parce qu’ils ont été vainqueurs à Sadowa, qu’ils allaient nous avaler d’une bouchée ! On n’a pas idée d’une pareille insolence.
Et s’asseyant à côté de ma sœur, près de la fenêtre :
– Vous comprenez bien, mon enfant, qu’à Sadowa, comme le dit si bien mon mari, les Prussiens n’avaient aucun mérite à vaincre : ils avaient le fusil à aiguille. Nous, avec le Chassepot, je vous réponds…
Puis, c’est M. Legros, l’épicier, qui entre en riant aux éclats.
– Avez-vous vu comme le marquis de Piré a cloué le bec à Thiers, au Corps législatif ? Il lui a dit : « Vous êtes la trompette des désastres de la France. Allez à Coblentz ! » Il lui a dit : « Allez à Coblentz ! » Elle est bien bonne ?
– Savez-vous ce qu’on leur promet, là-dedans, aux opposants ? demande M. Pion en frappant sur un numéro du Pays qu’il tire de sa poche : le bâillon à la bouche et les menottes au poignet. Si j’étais quelque chose dans le gouvernement, ce serait déjà fait, ajoute-t-il en caressant sa grosse moustache.
– Bah ! laissez-les donc faire, dit Mme Arnal, qui fait son entrée à son tour. Tenez, j’arrive de Paris. Savez-vous ce qu’on fait dans les rues ? On crie : « À Berlin ! à Berlin !… » Près de la gare, je vois un rassemblement. J’approche. Savez-vous ce que c’était ? Un médaillé de Sainte-Hélène, messieurs, qui pleurait à chaudes larmes au milieu de la foule… Il pleurait de joie, le brave homme ! Vrai, j’ai eu envie de l’embrasser.
Ah ! je comprends ça. Ça devait être beau. Mon enthousiasme augmente de minute en minute. Il est près de déborder. Je voudrais être assez grand pour crier : à Berlin ! dans la rue. Oh ! il faudra que je me paye ça un de ces jours.
Les idées guerrières tourbillonnent dans mon cerveau comme des papillons rouges enfermés dans une boîte. J’ai le sang à la tête, les oreilles qui tintent, il me semble percevoir le bruit du canon et des cymbales, de la fusillade et de la grosse caisse ; ce n’est que peu à peu que j’arrive à comprendre M. Pion qui donne des détails.
Ah ! les Prussiens peuvent venir. Nous les attendons. Nous sommes prêts : jamais le service de l’intendance n’a été organisé comme il l’est, nos arsenaux regorgent d’approvisionnements de tout genre ; nous pouvons armer cinq cent mille hommes en moins de dix jours et notre artillerie est formidable.
– Et puis, s’écrie M. Legros, nous avons la Marseillaise !
– Bravo ! Bravo ! s’écrient Mme Arnal et ma sœur.
Et elles se précipitent vers le piano.
– Non, non, je vous en prie, murmure Mme Pion qui se pâme. Pas de musique ce soir, je vous en prie. Je suis tellement énervée ! Tout ce qui touche à l’armée, à la guerre, voyez-vous, ça me remue au-delà de toute expression. Ah ! l’on n’est pas pour rien la femme d’un militaire…
– Vive l’Empereur ! crie M. Pion.
– Tiens ! j’ai une idée, fait mon père qui disparaît et revient au bout de cinq minutes avec un grand carton à la main et plusieurs boîtes sous le bras.
– Qu’est-ce que c’est, papa ?
– Tu vas voir, curieux. Louise, va donc dire à Catherine de tendre un drap blanc, le long du mur.
Je hausse les épaules dédaigneusement. C’est la lanterne magique qu’on veut nous montrer.
– À notre âge, dis-je tout bas à Léon qui vient d’entrer.
– C’est rudement bête, mais ça ne fait rien. Pendant qu’il fera noir, je pincerai ta sœur.
– Pince-la fort.
Il ne la pince pas du tout. Il n’y pense pas, moi non plus ; le spectacle est trop intéressant. Ah ! mon père est un malin. Ce ne sont pas les verres représentant l’histoire du Chaperon Rouge ou du Chat Botté qu’il glisse dans la lanterne ; ceux qu’il a choisis peignent en couleurs vives les épisodes divers des campagnes de Crimée et d’Italie, de bons vieux verres que j’avais oubliés, qui m’ont amusé autrefois, qui aujourd’hui m’émeuvent.
Et puis, décidément, mon père a le chic pour montrer la lanterne magique. Il ne vous place pas le verre, bêtement, entre les rainures du fer-blanc, pour le laisser là, immobile, jusqu’à ce que le spectateur lui crie : Assez ! – Il a un système à lui. Les premiers tableaux – le départ des régiments, – il les pousse lentement, peu à peu, dans la lanterne, et l’on croit voir défiler, au pas accéléré, le long du drap, les lignards à l’allure ferme et les lourds grenadiers ; pour les chasseurs à pied, le verre va un peu plus vite : du pas gymnastique. Quand nous arrivons aux escarmouches, aux combats précurseurs des grandes rencontres, le verre prend une allure fantaisiste, il court avec les bersagliers, rampe avec les highlanders et bondit avec les zouaves. Pour les batailles, c’est terrible. C’est à peine si, dans le va-et-vient rapide des personnages qui s’égorgent sur le drap blanc, on arrive à distinguer les formes humaines, à voir autre chose qu’une effrayante mêlée, une masse informe et bariolée éclaboussée de boue rouge. Comme ça donne l’idée d’une bataille ! j’en tremble. Et je n’ai même pas la force de hurler comme les autres spectateurs qui, dans l’ombre, poussent des cris de cannibales, des hurlements d’anthropophages.
Heureusement, pour me calmer, des tableaux moins chargés apparaissent. Trois ou quatre personnages tout au plus : des turcos hideusement noirs et des zouaves effrayants, aux longues moustaches en croc, embrochant des Russes qui joignent les mains et des Autrichiens tombés à terre.
– Pas de pitié pour les Autrichemards ! crie M. Legros. Et il faudra en faire autant aux Prussiens.
– Tiens ! sale Prussien, crie M. Pion, absolument emballé, et dont je perçois dans l’obscurité la longue silhouette tendant le poing vers l’orbe où un soldat blessé agonise, un coup de baïonnette au ventre.
Mon père glisse le dernier verre dans la lanterne et se croise les mains derrière le dos. Il sait que ce tableau-là n’a pas besoin d’être agité comme les autres, que tous les artifices sont inutiles cette fois-ci. Il est sûr de son effet : on a peint sur le verre l’incendie d’un bateau où des malheureux se tordent dans les flammes.
C’est épouvantable.
– Magnifique ! crie Mme Arnal. Ah ! ces brigands de Prussiens, si l’on pouvait les faire griller tous comme ça !
J’ai douze ans. Mon père en a quarante-cinq. Ma sœur dix-neuf. Catherine, notre bonne, n’a pas d’âge.
Elle nous sert depuis dix ans. C’est elle qui m’a promené en lisières dans les allées du parc et qui a guidé mes premiers pas le long des charmilles du Roi-Soleil. C’est elle qui me rapportait à la maison dans ses bras quand j’étais fatigué d’avoir traîné mes souliers bleus sur les tapis verts de Le Nôtre.
Je ne devais pas lui peser lourd : elle est forte comme un bœuf et dure au travail comme un cheval de limon. Je l’ai vue un jour, mise au défi par les ouvriers du chantier, porter vingt-cinq kilos à bras tendu. Elle est longue comme un jour sans pain et ça l’ennuie parce qu’elle est obligée de faire elle-même ses tabliers bleus : ceux qu’on achète tout confectionnés sont très bons et coûtent moins cher, mais on n’en trouve pas à sa taille. Elle est plate comme une limande et ça lui est à peu près égal. Quand on la taquine là-dessus, elle se borne à fournir une explication très simple : elle a monté en graine tout d’un coup – comme les asperges – et ce qu’elle a gagné en hauteur, elle l’a perdu en largeur. Elle ressemble à un gendarme : un gendarme qui aurait un gros nez rouge, qui mangerait de la bouillie avec son sabre et qui aurait, en guise de moustaches, un gros poireau poilu de chaque côté du menton.
Les poireaux, voilà le malheur de Catherine. Elle en a trois à la figure et trois douzaines sur les mains. Elle affirme n’en pas avoir autre part.
– Pas un seul ! s’écrie-t-elle en roulant de gros yeux. J’en fournirai les preuves à qui voudra.
Personne ne lui en a jamais demandé.
Elle a essayé de différents remèdes qui devaient faire disparaître en un clin d’œil ses végétations importunes. Ils ont échoué. Quelqu’un, il y a six mois, lui en a indiqué un nouveau : les artichauts sauvages. Depuis ce temps-là, elle en cherche ; elle leur fait la chasse partout ; elle y passe ses heures de liberté, elle y dépense ses demi-journées du dimanche, jusqu’à l’heure de la messe – qu’elle passe au bleu.
Si Catherine a une haine et un dégoût : les poireaux, elle a une admiration et un amour : son frère. Il existe en chair et en os, ce frère, aux cuirassiers – au 8e de l’arme ― ; et, en effigie, tout le long des murs de la chambre de sa sœur. Il est là debout, assis, à pied, à cheval, en veste d’écurie, en grande tenue, tête nue, cuirassé et casqué. Chaque fois qu’elle touche ses gages, Catherine lui en envoie les deux tiers et lui réclame une photographie. La dernière qu’elle a reçue est superbe : elle a vingt centimètres de haut, elle est peinte et la tête du cuirassier, un point de carmin aux joues et aux lèvres, a été délicatement collée par le photographe entre le casque et la cuirasse d’un cavalier acéphale, comme on en fabrique d’avance, à la grosse.
Catherine ne tarit pas d’éloges sur son frère.
– Vous auriez dû vous engager dans son régiment, fait mon père. Vous avez la taille, je crois ?
– Ah ! monsieur, si ç’avait été possible ! Comme je l’aurais soigné !
Mon père et ma sœur rient aux éclats. Je ne sais pas pourquoi, mais je leur en veux de leur rire.
À vrai dire, je leur en veux de moins en moins. J’ai eu beaucoup d’affection pour Catherine, autrefois, mais je m’en suis détaché insensiblement. M’ayant connu au berceau, elle a continué à me traiter en enfant ; elle ne peut arriver à se figurer que je vais être bientôt un homme. Il y a dans sa tendresse pour moi quelque chose qui sent la nounou, le lange, le hochet. Elle a, en nouant ma cravate, le matin, des petits tapotements très doux, des lissages d’étoffes, de ces gestes qui ajustent les robes de bébés – qui arrangent les bavettes. – Et puis, au point de vue intellectuel, nous avons cessé toutes relations. Elle a un mot qui explique tout et qui a fini par me déplaire. À toutes mes questions sur les chiens écrasés, les aveugles et les boiteux, les chevaux qui se cassent une jambe et les morts qu’on mène au cimetière, elle faisait la même réponse : « C’est le bon Dieu qui l’a puni. »
– Catherine, sais-tu pourquoi le poisson rouge qui était dans l’aquarium est mort ?
– C’est le bon Dieu qui l’a puni.
Ça m’a paru insuffisant – et douteux.
Aujourd’hui, je me demande comment j’ai pu arriver à trouver du plaisir dans la société d’un être aussi borné. Je la méprise un peu. Elle m’ennuie beaucoup. Elle s’en est aperçue, et en souffre.
Tant pis.
Ma sœur est une pimbêche. C’est une petite poupée, pas vilaine, si l’on veut, mais pas jolie, jolie. Poseuse, hypocrite, égoïste, rapporteuse, pincée. Orgueilleuse comme un paon.
– Pourquoi ?
J’ai entendu un ouvrier du chantier dire d’elle, une fois :
– On dirait qu’elle a pondu la colonne Vendôme.
Ma foi, oui.
Elle m’embête.
Mon père est entrepreneur de charpente et de menuiserie ; il est propriétaire, à Versailles, de l’établissement du Vieux Clagny. C’est, lui qui a fait poser ces longues planches qui portent son nom : Barbier, le long de la ligne du chemin de fer, avant d’arriver à la gare. Il possède aussi un chantier à Paris, rue Saint-Jacques. Ce chantier est tout voisin d’un autre : le chantier des Grands Hommes, qui lui fait une concurrence désastreuse. Mon père a essayé de reprendre le dessus, plusieurs fois, sans aucun résultat appréciable. À chaque échec, une envie folle lui venait de se débarrasser de son établissement parisien.
– J’y mange de l’argent ! criait-il. J’y mange tout ce que je gagne à Versailles !
Pourtant, il ne pouvait se résoudre à vendre. À la fin, une idée, une idée fixe, l’a possédé : acheter les Grands Hommes.
Il y a sept ans qu’il rêve à cette acquisition – qu’il sait impossible – et ç’a été le sujet de discussions terribles que je me rappelle vaguement, avec ma mère. Mon père lui reprochait, de plus en plus âprement, avec brutalité dans les derniers temps, de ne pas avoir payé sa dot. Il l’accusait de l’avoir volé, de s’être entendue avec son père à elle, le grand-père Toussaint, pour le filouter.
– Oui, tu savais qu’il me mettait dedans, le vieux brigand !… Tu n’as même pas pensé à tes enfants !… Tu t’en moques, de tes enfants !… Comme de ton mari, n’est-ce pas ?… Tout pour ta famille ! Une famille de fripons, de canailles !… De canailles !…
J’ai encore de ces cris-là dans les oreilles, de ces cris haineux, mal étouffés par les murs, et qui venaient souvent, la nuit, me terrifier dans mon petit lit. Je savais que mes parents se disputaient et s’insultaient, que mon père bousculait ma mère pour de l’argent. Et depuis ce temps-là j’ai le dégoût et la peur de l’argent. J’ai presque deviné, à douze ans, tout ce que peut faire commettre d’horrible et d’infâme une ignoble pièce de cent sous.
J’ai grandi au milieu de discussions d’intérêt coupées de scènes de plus en plus violentes jusqu’à la mort de ma mère. Ces scènes ont effacé en moi, à la longue, son image douce et bonne, et je ne peux plus la voir quand j’évoque son souvenir, que pâle et craintive, baissant la tête, pauvre bête maltraitée sans pitié par son maître, et fuyant sous les coups. J’ai gardé aussi, de ce temps-là, une grande frayeur de mon père.
Non pas qu’il soit mauvais pour moi. Mais il y a dans son regard quelque chose de méchant qu’il ne peut arriver à adoucir.
– Monsieur n’est pas commode, dit Catherine.
C’est à peu près ça : pas commode, raboteux, à angles droits. Il me gêne. Je me contrains devant lui. Son regard, que je sens peser sur moi, m’a rendu un peu sournois. Paresseux au possible, je joue les studieux – en truquant de toutes les façons. – Je lui désobéis rarement. Je n’ai pas peur qu’il me mette à mort, comme Brutus. Je crains qu’il ne me fasse remarquer, de son ton froid, qu’il a la bonté de ne pas me priver de dessert.
À part les deux heures de leçons que me donne M. Beaudrain, le soir je suis à peu près libre. Je ne m’amuse guère. Sans Léon qui vient souvent jouer avec moi, et le père Merlin, notre voisin, que je vais voir presque tous les jours, je crèverais d’ennui. J’aimerais bien aller m’amuser au chantier ; mais mon père me défend de parler aux ouvriers. Un jour, Louise m’a vu causer à l’un d’eux. Elle a mouchardé. J’ai reçu un savon et l’ouvrier aussi.
– Ça t’apprendra à parler à ces gens-là, m’a dit Louise. Avec ça que tu es déjà si bien élevé !
Je voudrais demeurer à Paris. J’ai envie de Paris. Chaque fois que j’y vais, je voudrais y rester, ne jamais retourner à Versailles. C’est ennuyeux comme tout, Versailles, ennuyeux comme tout. On dirait que c’est mort.
– Une ville charmante, dit M. Beaudrain.
Et il parle des souvenirs historiques en passant un bout de langue sur ses lèvres, qui pèlent comme de l’écorce de bouleau.
M. Beaudrain a l’air d’un croque-mort. Ils sont tous comme lui, les gens qui habitent Versailles : drôles comme des enterrements. M. Legros, seul de toutes les personnes qui viennent chez nous, rit toujours ; seulement il est bête comme une oie. Il a des yeux en boules de loto, des narines poilues, des oreilles en feuilles de chou et un gros menton rasé de près, tout piqué de trous, qui ressemble à une pomme d’arrosoir.
Il y a aussi Mme Arnal, qui est bien gentille. Elle va souvent à Paris où son mari tient un magasin, et ça se voit. J’aimerais bien me marier avec une femme comme elle. À condition qu’elle sautât un peu moins, par exemple. Elle est toujours en l’air. On dirait qu’elle a du vif-argent quelque part. Mais je n’en suis pas encore là. J’ai le temps d’attendre.
Pour le moment, mon père me gêne. Catherine m’ennuie. Louise m’embête. Versailles m’assomme.
Voilà.
Nous finissons de déjeuner. Mme Arnal entre.
– Vous ne savez pas ?
– Quoi donc ?
– Le père Merlin est revenu.
– Bah ! Vous êtes sûre ?
– Comment donc ! Il est dans son jardin, en train d’arroser ses fleurs.
Et, plus bas :
– Il a un linge blanc autour de la tête ; le front tout entortillé… Il y a quelque chose là-dessous.
– Oh ! oui, fait ma sœur ; quelque chose de louche. Il vaudrait mieux savoir à quoi s’en tenir, car enfin on ne peut pas fréquenter toute sorte de monde. N’est-ce pas, papa ?
– Sans doute, sans doute ; mais…
– Oh ! tu sais, tu ne m’ôteras pas de l’idée qu’il a attrapé ses horions à la manifestation… tenez, madame, j’ai gardé le journal. Le voilà.
Elle lit :
– « À la hauteur de la Porte-Saint-Martin, une bande composée de quelques centaines de voyous, escortant un grand drôle portant un drapeau, se dirige vers le Château-d’Eau, aux cris de : Vive la paix ! Cette manifestation est accueillie par des sifflets partis des bas-côtés des boulevards. Et bientôt la foule, ne pouvant plus contenir son indignation, se précipite sur ces stipendiés de Bismarck et les disperse, non sans avoir administré à quelques-uns des plus acharnés une correction bien méritée. »
Mme Arnal hoche la tête.
– Dame ! vous comprenez bien qu’avec des idées comme les siennes…
– Oh ! il faut savoir à quoi s’en tenir, répète Louise très surexcitée. Et si tu veux, Jean, tu vas t’en aller chez le père Merlin pour lui tirer les vers du nez.
Ce rôle d’espion ne me convient pas beaucoup. Je me tourne vers mon père.
– Mais papa ne voudra peut-être pas…
– Avec ça que tu as besoin de la permission de papa pour y passer des demi-journées entières, chez le père Merlin ! Allons, tâche de faire ce qu’on te dit.
Je ferai ce qui me plaira. Et d’abord je ne lui demanderai rien, au père Merlin, rien du tout ; je ne lui tirerai pas les vers du nez. Et s’il me raconte ses affaires, je garderai tout pour moi, je ne répéterai rien, rien.
Je sonne à sa porte. Il vient m’ouvrir, un bâton de frotteur à la main et un pied déchaussé. Il frotte. Gare à mes oreilles si je fais des bêtises.
– Ah ! c’est toi ! Ton ami Léon n’est pas avec toi ? C’est dommage. La première fois que je le verrai, ce garnement-là, je lui donnerai de mes nouvelles ; il m’a cassé un pied de dahlia… Tu veux aller au jardin ? Va au jardin. Tu peux bêcher la troisième plate-bande, celle du fond.
– Oui, monsieur Merlin ; et vous…
– Je frotte !
Il rentre dans la maison dont il fait claquer la porte et j’entends bientôt le va-et-vient de la cire sur le plancher, suivi du frottement de la brosse qui, à temps égaux, heurte les plinthes.
C’est un brave homme, le père Merlin, mais il a ses manies. Quand il est en colère, quand il a quelque sujet de contrariété ou d’affliction, vite, il attrape sa cire et sa brosse et s’enferme dans sa maison ; il ne faudrait pas choisir ce moment-là pour le taquiner. Quand il vous a dit : « Je frotte ! » il n’y a plus qu’à le laisser tranquille. « Je frotte ! » c’est un avertissement, une menace ; ce n’est pas, comme on pourrait le croire, l’énoncé d’une occupation domestique. Ça veut dire : « Je suis en colère. Je passe ma colère sur mon plancher. J’aime mieux ça que de la passer sur vous, pourvu que vous me laissiez tranquilles. » Ça veut dire : « Fichez-moi la paix. »
On sait à quoi s’en tenir là-dessus, dans le voisinage. Mais on continue à le fréquenter, à lui faire bon visage, malgré ça, malgré ses opinions ultra-républicaines qu’il affiche très ouvertement. Il a de si belles fleurs ! Au dernier concours horticole, comme on couronnait Gédéon, l’horticulteur, pour ses hortensias, le père Merlin, plein de dédain pour les produits primés, a traduit son opinion par un mot qui a fait rougir les dames. Il a dit :
– C’est de la fouterie.
Les dames qui ont rougi ont dû se rendre compte qu’il n’y avait rien d’exagéré dans cette appréciation, car elles ont continué à demander au bonhomme des bouquets qu’il leur offre gracieusement.
Car il est gracieux quand il veut, le père Merlin, très gracieux même. On voit qu’il a été bien élevé. Il est fort comme un Turc, aussi, malgré ses cinquante ans passés. Je l’ai entendu dire, à propos d’un jeune homme de vingt-deux ans, bien râblé, qui le tournait en ridicule :
– Si ce galopin continue, je le casserai en deux comme une allumette.
Et le jeune homme s’est tenu coi.
Il aime beaucoup les enfants. Il paraît qu’il en a eu, mais qu’ils sont morts. Sa femme aussi. Quand je dis : sa femme… On prétend qu’il n’a jamais été marié et qu’il vivait en concubinage. Ça m’intrigue fort. J’ai demandé des renseignements à Catherine qui m’a répondu, mais avec un grand accent de conviction cette fois :
– Le père Merlin ! C’est le bon Dieu qui l’a puni.
Un jour que le vieux m’avait parlé longtemps de ses enfants et de sa femme, comme si de rien n’était, en se déclarant même très malheureux de les avoir perdus, j’ai osé demander à Mme Arnal ce que c’était que le concubinage. Elle a commencé une explication vague, s’est troublée et a fini par me dire, en me fouillant de ses yeux profonds, qu’il ne fallait jamais parler de ces choses-là, que tout ça « c’était bien vilain ».
Ce qui est vilain, aussi, c’est de ramasser du crottin dans la rue. Pourtant le père Merlin, tous les soirs régulièrement, recueille celui du quartier. Il se promène dans les rues, pendant une petite heure, avec une pelle et une brouette. Quand il rentre, sa brouette est toujours pleine. On dirait que les chevaux le connaissent et qu’ils tiennent à lui faire plaisir.
J’ai voulu l’aider autrefois dans sa chasse à l’engrais, dans ses pérégrinations à la recherche de la fiente chevaline. Mais Louise m’a rencontré un soir, précédant la brouette, la pelle sur l’épaule, faisant le service d’éclaireur ; elle a prévenu mon père qui m’a formellement défendu de continuer à me compromettre. Un Barbier ramasser du crottin ! Est-ce que j’aurais l’intention de devenir républicain, par hasard ? Ma sœur en rougissait jusqu’aux oreilles.
Le lendemain soir, comme je voyais le père Merlin rôder autour de sa brouette et que je cherchais un prétexte pour ne pas l’accompagner, il m’a dit lui-même de ne pas venir avec lui.
– Car on te l’a défendu, n’est-ce pas ?
– Oui, monsieur.
Il a haussé les épaules. C’est son habitude. Que je lui parle de mes parents, des voisins, de ce qui se passe dans le quartier ou dans la ville, il hausse les épaules. C’est surtout lorsque je lui demande un bouquet de la part de ma sœur qu’il a un petit mouvement d’épaules accompagné d’un mince sourire railleur – toujours le même – qui en dit long. Il ne doit guère se tromper sur le compte de Louise. Il ne m’en a jamais parlé mal, c’est vrai – il ne cancane pas – mais on voit qu’il est fixé à son sujet. Au sujet de bien d’autres aussi, sans doute. Il doit savoir juger les hommes, le père Merlin, avec ses yeux clairs, et c’est peut-être pour cela qu’il les méprise un peu – et qu’il n’en dit rien.