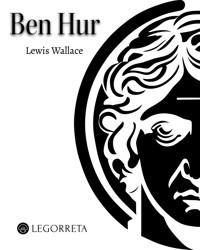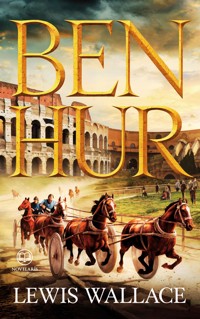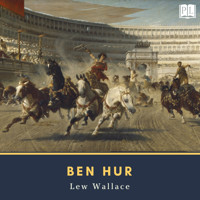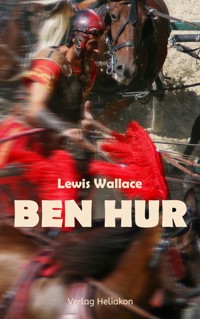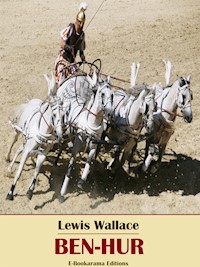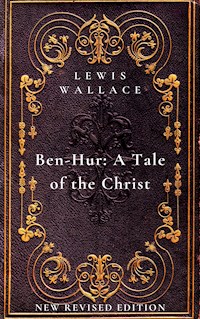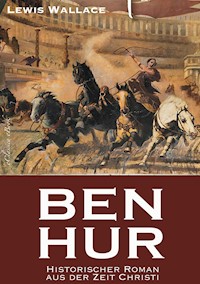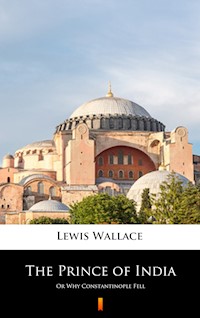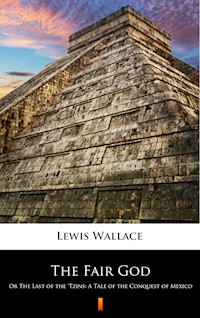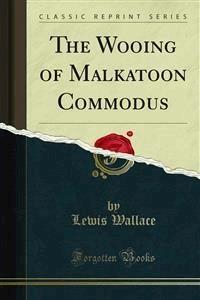Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Ben-Hur : le gladiateur qui était roi" est un roman historique captivant qui plonge le lecteur dans l'univers tumultueux de la Palestine au début de l'ère chrétienne. L'histoire suit Juda Ben-Hur, un jeune prince juif de Jérusalem, dont la vie bascule lorsque son ancien ami, Messala, devenu officier romain, le trahit. Accusé à tort de tentative de meurtre sur le gouverneur romain, Ben-Hur est condamné à l'esclavage sur une galère. Sa quête de vengeance et de rédemption le mène à travers des épreuves épiques, des courses de chars palpitantes à des rencontres avec des figures historiques comme Jésus de Nazareth. Le roman explore des thèmes universels tels que la justice, la foi et la rédemption, tout en offrant une critique poignante de la domination romaine et des tensions religieuses de l'époque. Grâce à une narration riche et détaillée, Lewis Wallace réussit à immerger le lecteur dans une époque fascinante, tout en tissant une intrigue pleine de rebondissements et d'émotions. Ce chef-d'oeuvre de la littérature classique continue d'inspirer et de captiver les lecteurs par sa profondeur et son humanité. L'AUTEUR : Lewis Wallace, né le 10 avril 1827 à Brookville, dans l'Indiana, est un écrivain et avocat américain surtout connu pour son roman "Ben-Hur : A Tale of the Christ", publié en 1880. Avant de se consacrer à l'écriture, Wallace a eu une carrière variée, servant comme avocat et homme politique. Il a également joué un rôle important pendant la guerre de Sécession, où il a atteint le grade de général de brigade dans l'armée de l'Union. Après la guerre, Wallace a été nommé gouverneur du territoire du Nouveau-Mexique et ambassadeur des États-Unis auprès de l'Empire ottoman. Ces expériences ont enrichi sa perspective et influencé son écriture. "Ben-Hur" est devenu un succès monumental, salué pour sa recherche historique méticuleuse et sa narration captivante. Le livre a été adapté à plusieurs reprises au cinéma, renforçant la notoriété de Wallace. Bien que ses autres oeuvres n'aient pas atteint la même renommée, Wallace reste une figure marquante de la littérature américaine du XIXe siècle, reconnu pour sa capacité à mêler fiction et histoire avec brio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
CHAPITRE V
CHAPITRE VI
CHAPITRE VII
CHAPITRE VIII
CHAPITRE IX
CHAPITRE X
CHAPITRE XI
CHAPITRE XII
CHAPITRE XIII
CHAPITRE XIV
CHAPITRE XV
CHAPITRE XVI
CHAPITRE XVII
CHAPITRE XVIII
CHAPITRE XIX
CHAPITRE XX
CHAPITRE XXI
CHAPITRE XXII
CHAPITRE XXIII
CHAPITRE XXIV
CHAPITRE XXV
CHAPITRE XXVI
CHAPITRE XXVII
CHAPITRE XXVIII
CHAPITRE XXIX
CHAPITRE XXX
CHAPITRE XXXI
CHAPITRE XXXII
CHAPITRE XXXIII
CHAPITRE XXXIV
CHAPITRE XXXV
CHAPITRE XXXVI
CHAPITRE XXXVII
CHAPITRE XXXVIII
CHAPITRE XXXIX
CHAPITRE XL
CHAPITRE XLI
CHAPITRE XLII
CHAPITRE XLIII
CHAPITRE XLIV
CHAPITRE XLV
CHAPITRE XLVI
CHAPITRE XLVII
CHAPITRE PREMIER
Le Jébel es Zubleh est une chaîne de montagnes peu élevée, longue d’environ cinquante kilomètres. Du haut des rochers de grès rouge qui la composent, la vue ne découvre au levant, si loin qu’elle peut s’étendre, que le désert d’Arabie. Les sables, charriés par l’Euphrate, s’amoncellent au pied de la montagne, qui forme ainsi un rempart sans lequel les pâturages de Moab et d’Ammon feraient, eux aussi, partie du désert. Une vallée, partie de l’extrémité du Jébel et se dirigeant de l’est au nord, pour devenir le lit du Jabok, traverse la route romaine, qui n’est plus aujourd’hui qu’un simple sentier, suivi par les pèlerins qui se rendent à la Mecque.
Un voyageur venait de sortir de cette vallée. Il paraissait avoir quarante-cinq ans. Sa barbe, jadis du plus beau noir, commençait à s’argenter. Son visage, à demi caché par le kefieh, mouchoir rouge qui recouvrait sa tête, était brun comme du café brûlé, et ses yeux, qu’il levait par moments, étaient grands et foncés. Il portait les vêtements flottants en usage dans l’Orient, mais on ne pouvait en distinguer les détails, car il était assis sous une tente en miniature, disposée sur le dos d’un grand chameau blanc.
C’était un animal digne d’admiration, que ce chameau. Sa couleur, sa hauteur, la largeur de son pied, sa bosse musculeuse, son long col de cygne, sa tête, large entre les yeux et terminée par un museau si mince, qu’il aurait tenu dans un bracelet de femme, son pas égal et élastique, tout prouvait qu’il était de cette pure race syrienne dont l’origine remonte aux jours de Cyrus et, par conséquent, absolument sans prix. Une frange rouge s’étalait sur son front, des chaînes de bronze, terminées par des sonnettes d’argent, entouraient son cou, mais il n’avait ni brides, ni licol, pour le conduire.
En franchissant l’étroite vallée, le voyageur avait dépassé la frontière d’El Belka, l’ancien Ammon. C’était le matin. Devant lui montait le soleil, noyé dans une brume légère, et s’étendait le désert. Ce n’était point encore le désert de sable, mais la région où la végétation commence à s’étioler, où le sol est jonché de blocs de granit et de pierres brunes ou grises, entre lesquelles croissent de maigres mimosas et des touffes d’alfa.
De route ou de sentier, plus trace. Une main invisible semblait guider le chameau ; il allongeait son pas et, la tête tendue vers l’horizon, il aspirait, par ses narines dilatées, des bouffées de vent du désert. La litière où se reposait le voyageur se balançait sur son dos, comme un navire sur les flots. Parfois un parfum d’absinthe embaumait l’air. Des alouettes et des hirondelles s’envolaient devant eux et des perdrix blanches fuyaient à tire d’aile, avec de petits cris éperdus, tandis que de temps à autre un renard ou une hyène précipitait son galop, pour considérer de loin ces intrus. À leur droite s’élevaient les collines du Jébel, enveloppées d’un voile gris perle qui prenait aux rayons du soleil levant des teintes violettes, d’une incomparable intensité. Au dessus de leur sommet le plus élevé un vautour planait, en décrivant de grandes orbes. Mais rien de tout cela n’attirait l’attention du voyageur. Son regard était fixé sur l’espace ; il semblait, comme sa monture, obéir à un mystérieux appel.
Pendant deux heures, le dromadaire fila tout droit dans la direction de l’orient ; si rapide était son allure, que le vent lui-même ne l’aurait pas dépassé. Le paysage changeait peu à peu. Le Jébel ne paraissait plus être, à l’horizon occidental, qu’un simple ruban bleu. Les pierres diminuaient. Du sable, rien que du sable, ici uni comme une plage, là ondulé comme des vagues, ou bien encore s’élevant en longues dunes. Le soleil, débarrassé maintenant des brumes qui l’entouraient à son lever, réchauffait la brise, jetait sur la terre une lumière blanche, aveuglante, et faisait flamboyer l’immense voûte du ciel.
Deux autres heures passèrent encore. Plus trace de végétation sur le sable durci, qui se fendait sous les pas du dromadaire. On ne voyait plus le Jébel, et l’ombre, qui jusqu’alors les avait suivis, s’inclinait maintenant vers le nord et courait sur la même ligne qu’eux ; cependant le voyageur ne paraissait pas songer à s’arrêter encore.
À midi, le dromadaire fit halte de son propre mouvement. Son maître se redressa, comme s’il s’éveillait, considéra le soleil, puis scruta attentivement tous les points de l’horizon. Satisfait de son inspection, il croisa ses mains sur sa poitrine, baissa la tête et se mit à prier silencieusement. Quand il eut terminé sa prière, il ordonna au dromadaire de s’agenouiller, en poussant ce ikh, ikh guttural, déjà familier, sans doute, aux chameaux favoris de Job. Lentement l’animal obéit. Le voyageur posa un pied sur son cou frêle ; un instant plus tard, il se trouvait debout sur le sable.
CHAPITRE II
Cet homme, on pouvait s’en apercevoir maintenant, était d’une stature admirablement proportionnée, plus puissante qu’élevée. Il détacha le cordon de soie qui retenait son kefieh sur sa tête et le rejeta en arrière, découvrant ainsi son visage énergique, presque aussi noir que celui d’un nègre. Son nez aquilin, les coins légèrement relevés de ses yeux, son front large et bas, entouré d’une profusion de cheveux aux reflets métalliques, retombant en tresses nombreuses sur ses épaules, trahissaient son origine. Tels devaient avoir été les Pharaons et les Ptolémées, tel aussi Mizraïm, le fondateur de la race égyptienne. Il portait une chemise de coton blanc aux manches étroites, sur laquelle il avait jeté un manteau de laine ; ses pieds étaient chaussés de sandales, assujetties par de longues courroies. Il était absolument sans armes, chose étrange pour un voyageur traversant le désert, hanté par les bêtes fauves et par des hommes plus féroces qu’elles. Il fallait donc qu’il eût en vue une mission pacifique, qu’il fût exceptionnellement brave, ou peut-être qu’il se sentît l’objet d’une protection toute spéciale. Il fit plusieurs fois le tour de son fidèle serviteur, frappant ses mains l’une contre l’autre, et ses pieds sur le sol, pour les dégourdir après ces longues heures d’immobilité, et souvent il s’arrêtait pour interroger l’espace, en abritant ses yeux sous sa main. Évidemment, il avait donné rendez-vous, en cet endroit perdu, à quelqu’un qui tardait à paraître, mais sur lequel il comptait, à en juger par les préparatifs auxquels il se livrait.
Il prit dans la litière une gourde pleine d’eau et une éponge, avec laquelle il lava les yeux et les narines du chameau, après quoi il dressa sur le sable une tente, au fond de laquelle il étendit un tapis. Cela fait, il examina, une fois encore, la plaine sans limites, au milieu de laquelle il se trouvait. Mais à l’exception d’un chacal, galopant au loin, et d’un aigle qui dirigeait son vol vers le golfe d’Akaba, aucun être vivant ne se dessinait sur le sable blanc, ni sur le ciel bleu.
Il se tourna vers le chameau, en disant à voix basse : « Nous sommes bien loin du lieu de notre demeure, ô coursier plus rapide que les vents, mais Dieu est avec nous. Sachons être patients. » Puis il suspendit au cou de l’animal un sac de toile, plein de fèves. Et toujours il épiait l’océan de sable, sur lequel les rayons du soleil tombaient verticalement. « Ils viendront, disait-il avec calme. Celui qui me guidait les guide également. »
Il tira d’une corbeille en osier, déposée dans une des poches de la litière, trois assiettes en fibres de palmier, du vin, renfermé dans de petites outres, du mouton séché et fumé, des grenades de Syrie, des dattes d’El Shelebi, du fromage, du pain. Il disposa le tout sur un tapis qui garnissait le fond de la tente, puis il plaça à côté des provisions trois de ces serviettes de soie dont se servent les Orientaux de distinction, pour se couvrir les genoux durant les repas.
Tout était prêt maintenant et il sortit de la tente. Ah ! là-bas, à l’orient, un point noir venait de paraître ! Les pieds comme rivés au sol, les yeux dilatés, il semblait se trouver en face d’une chose surnaturelle. Le point grandissait, il prenait une forme. Bientôt, il distingua clairement un dromadaire blanc, absolument semblable au sien et portant sur son dos la litière de voyage des Indous. Alors l’Égyptien croisa ses mains sur sa poitrine, et leva les yeux vers le ciel en s’écriant : « Dieu seul est grand ! »
L’étranger approchait, enfin il s’arrêta. Lui aussi semblait sortir d’un rêve. Il vit le chameau agenouillé, la tente dressée, l’homme debout à sa porte, dans l’attitude de l’adoration, et lui-même, baissant la tête, pria silencieusement, après quoi il mit pied à terre et s’avança vers l’Égyptien, qui venait à sa rencontre. Ils se regardèrent un instant, puis, chacun d’eux passa son bras droit sur l’épaule de l’autre et ils s’embrassèrent.
– La paix soit avec toi, ô serviteur du vrai Dieu ! dit l’étranger.
– Et avec toi, ô frère en la vraie foi ! Sois le bienvenu, répondit l’Égyptien.
Le nouveau venu était grand et maigre. Il avait un visage émacié, des cheveux comme sa barbe, des yeux enfoncés, un teint bronzé. Lui aussi était sans armes. Il portait le costume de l’Indoustan. Un châle s’enroulait en turban autour de sa tête, ses vêtements ressemblaient à ceux de l’Égyptien, mais son manteau était plus court et laissait passer de larges manches flottantes, serrées aux poignets. Ses pieds étaient chaussés de pantoufles rouges, aux pointes relevées, la seule chose, dans son costume, qui ne fût pas blanche. Il semblait être la personnification de Vinistra, le plus grand des héros de l’Iliade de l’Orient, la dévotion incarnée.
– Dieu seul est grand ! s’écria-t-il, quand ils eurent fini de s’embrasser.
– Bénis soient ceux qui le servent ! répondit l’Égyptien. Voici, celui que nous attendons encore approche.
Et, les yeux tournés vers le nord, ils regardaient un dromadaire blanc, qui se dirigeait vers eux, avec un balancement de navire. Debout à côté l’un de l’autre, ils attendirent jusqu’au moment où le nouvel arrivant, quittant son coursier, vint à eux pour les saluer.
– La paix soit avec toi, ô mon frère ! dit-il en embrassant l’Indou, et l’Indou répondit : « La volonté de Dieu soit faite ! »
Le dernier arrivé ne ressemblait pas à ses amis. Il était plus finement membré qu’eux, il avait la peau blanche, ses cheveux clairs et bouclés formaient une auréole autour de sa tête, petite, mais belle. Ses yeux bleus foncés réfléchissaient une âme tendre et délicate, une nature à la fois douce et brave. Il semblait ne posséder ni coiffure, ni armes. Sous les plis d’une couverture de Tyr, qu’il portait avec une grâce inconsciente, apparaissait une tunique sans manches, retenue à la taille par une ceinture et qui laissait libres le cou, les bras et les jambes ; des sandales protégeaient ses pieds. Cinquante années, peut-être davantage, avaient passé sur lui, sans effets apparents, si ce n’est qu’elles avaient empreint ses manières de gravité et donné du poids à sa parole. Si lui-même ne venait pas d’Athènes, ses ancêtres, certainement, devaient en être.
Quand il eut fini de saluer l’Égyptien, celui-ci dit d’une voix émue : « C’est moi que l’Esprit a fait arriver ici le premier, j’en conclus qu’il m’a choisi pour être le serviteur de mes frères. La tente est dressée, le pain prêt à être rompu. Laissez-moi remplir les devoirs de ma charge. » Et les prenant par la main, il les introduisit dans la tente, enleva leurs chaussures et lava leurs pieds, puis il versa de l’eau sur leurs mains et les essuya avec un linge. Ayant ensuite lavé ses mains, il dit : « Mangeons maintenant, afin de reprendre des forces pour accomplir notre tâche. Pendant notre repas, nous nous raconterons les uns aux autres qui nous sommes, d’où nous venons, comment nous avons été appelés. »
Il les fit asseoir en face l’un de l’autre. Simultanément leurs têtes s’inclinèrent, leurs mains se croisèrent et, tous ensemble, ils rendirent grâce à haute voix.
« Père de tout ce qui vit – Dieu ! ce que nous avons ici vient de toi ; reçois nos hommages et bénis-nous, afin que nous puissions continuer à faire ta volonté. »
Ils se regardèrent avec étonnement, quand ils se furent tus ; chacun d’eux avait parlé dans sa propre langue et pourtant ils s’étaient compris. Leurs âmes tressaillirent d’émotion, car ce miracle leur prouvait qu’ils se trouvaient en la présence de Dieu.
CHAPITRE III
Pour parler le langage du temps, ceci se passait en l’an 747 de l’ère romaine. On était au mois de décembre, et en cette saison, une course à travers le désert aiguise singulièrement l’appétit. Les trois hommes réunis sous la tente en faisaient l’expérience. Ils avaient faim et pendant un moment ils mangèrent en silence, puis, après avoir goûté au vin, ils se mirent à causer.
– Rien n’est plus doux aux oreilles d’un homme qui se trouve en pays étranger, que d’entendre son propre nom prononcé par la voix d’un ami, dit l’Égyptien. Nous serons pendant bien des jours compagnons de voyage, il est temps que nous fassions connaissance. Si vous le jugez bon, que le dernier venu soit le premier à parler !
Lentement d’abord, comme un homme habitué à peser ses paroles, le Grec commença son discours :
– Ce que j’ai à vous dire, mes frères, est si étrange que je ne sais pas où je dois commencer mon histoire et en quels termes il faut que je la narre, à peine la comprends-je moi-même ; une seule chose m’est certaine, c’est que j’accomplis la volonté de mon maître et que son service est une constante extase. Lorsque je songe à la tâche qui m’est confiée, une joie si inexprimable s’empare de mon âme, que, par cette joie, je reconnais dans la volonté qui me guide celle de Dieu lui-même.
Il s’arrêta, incapable de poursuivre. Ses compagnons comprenaient son émotion et la partageaient.
– Bien loin, à l’ouest du lieu où nous sommes, reprit-il enfin, se trouve un pays dont le nom ne tombera jamais dans l’oubli, car le monde entier demeurera toujours son débiteur, et c’est à lui que l’humanité devra, jusqu’à la fin des âges, ses joies les plus pures. Je ne parle point ici des artistes, des philosophes, des orateurs, des guerriers de ma patrie ; ce qui sera ma gloire, ô mes frères, c’est que, dans sa langue sera, un jour, proclamée dans tout l’univers la doctrine de Celui que nous cherchons. Ce pays, c’est la Grèce. Je suis Gaspard, le fils de Cléanthe d’Athènes. Mon peuple s’adonne de préférence à l’étude et j’ai hérité de cette passion. Or il se trouve que nos deux plus grands philosophes ont proclamé, l’un que chaque homme possède une âme immortelle, l’autre, l’existence d’un seul Dieu, infiniment juste. Dans tous les systèmes philosophiques discutés par nous, je n’ai trouvé que ces deux affirmations qui me parussent dignes d’être étudiées, car je devinais qu’entre l’âme et ce Dieu devait exister une relation dont j’ignorais encore la nature. Mais je n’arrivais pas à comprendre en quoi elle consistait. Il me semblait qu’une muraille se dressait entre la vérité et moi. Je criai, demandant à être éclairé, mais aucune voix d’au-delà ne me répondit et, désespérant de trouver la solution de ce problème, je quittai la ville et les écoles.
Il y a dans la partie septentrionale de mon pays, en Thessalie, une montagne fameuse, l’Olympe ; mes compatriotes la considèrent comme la demeure des dieux, le domicile de Jupiter, le plus grand d’entre eux. Ce fut là que je me rendis. Sur le versant méridional de la montagne, je découvris une grotte, dans laquelle je m’établis pour méditer ou plutôt pour attendre la révélation dont mon âme avait soif et que je sollicitais par d’ardentes prières. Je croyais en un Dieu invisible, mais suprême, et comme je désirais le connaître de toutes les puissances de mon être, je croyais aussi qu’il aurait compassion de moi et qu’il me répondrait.
– Et voilà, il l’a fait ! s’écria l’Indou en levant ses mains vers le ciel.
– Écoutez-moi encore, mes frères, reprit le Grec. La porte de mon ermitage était tournée du côté d’un bras de mer, appelé le golfe Thermaïque. Un jour je vis un homme tomber par dessus le bord d’un navire, qui passait près de la côte. Il nagea jusqu’au rivage, je le recueillis et pris soin de lui. C’était un Juif, versé dans la connaissance de l’histoire et de la loi de son peuple, et j’appris de lui que le Dieu que je priais existait réellement et que, depuis des siècles, il était leur législateur, leur chef, leur roi. Qu’était-ce donc, sinon la révélation après laquelle je soupirais ? Ma foi n’avait pas été vaine. Dieu me répondait.
– Il répond à tous ceux qui crient ainsi à Lui avec foi, dit l’Indou.
– Mais combien sont rares, hélas ! ceux qui comprennent ses réponses, ajouta l’Égyptien.
– Ce n’est pas tout, poursuivit le Grec. Le messager qu’il m’envoyait m’en dit plus encore. Il m’apprit que les prophètes qui, après la première révélation, marchèrent et parlèrent avec Dieu, ont annoncé qu’il reviendra. Il m’a nommé les prophètes et m’a cité les paroles contenues dans leurs livres. Et voici, il m’a dit même que sa seconde venue est proche et qu’on l’attend à Jérusalem. D’après cet homme, ainsi que la première révélation n’avait été que pour les seuls Juifs, ainsi en serait-il de la seconde. « Celui qui doit venir sera roi des Juifs, » me disait-il. « Et nous, m’écriai-je, nous les autres hommes, n’aura-t-il rien pour nous ? » « Non, me répondit-il avec fierté, nous sommes son peuple élu. » Cependant je ne me décourageais point, car je ne comprenais pas pourquoi un Dieu pareil aurait mis une limite à son amour et à ses bienfaits, en les réservant à un seul peuple, pour ainsi dire à une seule famille. Je voulais en savoir davantage et je parvins, enfin, à vaincre l’orgueil du Juif et à découvrir que ses pères avaient été choisis pour être les dépositaires de la vérité, afin de la transmettre un jour à d’autres, pour que le monde entier soit sauvé par elle. Lorsque le Juif m’eut, quitté, je me remis à prier, demandant maintenant qu’il me soit permis de voir le roi et de l’adorer, quand il sera venu. Une nuit que j’étais assis à la porte de ma caverne, songeant à ces mystères, je vis soudain une étoile s’allumer dans l’obscurité qui s’étendait sur la mer. Lentement elle s’éleva dans le ciel et s’approcha de moi, enfin elle brilla au-dessus de la montagne, au-dessus de ma porte même et sa lumière m’éclaira. Je tombai à terre et m’endormis et j’entendis en rêve une voix qui disait : « Ô Gaspard, ta foi a remporté la victoire ! Tu es béni ! Avec deux hommes, venus des extrémités de la terre, tu verras Celui qui doit venir et tu lui serviras de témoin. Lève-toi de grand matin et va-t’en à leur rencontre, en mettant ta confiance dans l’Esprit qui te guidera. »
Et vers le matin, je m’éveillai, l’âme illuminée par l’Esprit comme par un soleil brillant. Je jetai loin de moi la robe d’ermite et repris mes anciens vêtements, ainsi que le trésor que j’avais emporté avec moi, en quittant la ville, et gardé jusqu’alors dans une cachette.
Un navire à voile passait non loin du rivage. Je le hélai, il me prit à son bord et me déposa à Antioche. Là, j’achetai mon dromadaire et son équipement, puis je continuai mon voyage en suivant le cours de l’Oronte et je passai par Émèse, Damas, Bostra et Philadelphie pour arriver enfin ici. Maintenant vous savez mon histoire, faites-moi connaître les vôtres.
L’Égyptien et l’Indou se regardèrent. Le premier fit signe de la main, le second s’inclina en s’écriant :
– Notre frère a bien parlé, puissé-je faire de même. Sachez, mes frères, que je me nomme Melchior. Je vous parle en une langue qui, si elle n’est pas la plus vieille du monde, a cependant été la première qui ait été rendue par la lettre écrite, c’est-à-dire le Sanscrit de l’Inde. Je suis Indou de naissance. Mon peuple a précédé tous les autres dans l’exploration du champ de la science. Quoi qu’il arrive, nos Védas, nos livres saints vivront, car ils sont les sources primitives de la religion. Ce n’est point par orgueil que je fais allusion à ces choses, vous le comprendrez quand vous saurez que ces livres nous enseignent qu’il existe un Dieu suprême nommé Brahma, et qu’ils nous parlent de la vertu, des bonnes œuvres et de l’âme. Ainsi, que mon frère ne prenne point en mauvaise part cette remarque – il s’inclina du côté du Grec – des siècles avant que son peuple fût né, les Indous étaient en possession de ces deux vérités fondamentales : Dieu et l’âme. Brahma est considéré comme le créateur de notre race. De sa bouche sont sortis les Brahmanes, les plus semblables à lui, seuls dignes d’enseigner les Védas ; de ses bras sont issus les guerriers ; de sa poitrine ceux qui produisent : les bergers, les agriculteurs, les marchands ; de ses pieds, enfin, ceux auxquels sont réservés les travaux serviles, les serfs, les domestiques, les laboureurs, les artisans. Et retenez ceci, c’est que la loi défend de passer d’une caste dans l’autre ; le Brahmane qui viole les ordres attachés à la sienne, devient un être méprisé, déchu, rejeté par tous, excepté par ceux qui sont bannis comme lui.
Je suis né Brahmane. Ma vie, par conséquent, était réglée jusque dans ses moindres détails. Je ne pouvais ni marcher, ni boire, ni manger, ni dormir, sans courir le risque d’enfreindre un commandement précis, ce qui eût mis mon âme elle-même en péril, car suivant le degré de gravité de ces omissions, elle devait s’en aller dans un des cercles du ciel, dont le plus élevé est celui de Brahma, ou bien elle serait condamnée à devenir un ver de terre, un insecte, un poisson, une brute. La récompense suprême pour quiconque a observé toutes les ordonnances de la loi, c’est l’absorption de l’âme par Brahma – non pas l’existence, mais le repos absolu. – La première partie de la vie d’un Brahmane, appelée le premier ordre, est consacrée à l’étude. Quand je fus prêt à entrer dans le second ordre, c’est-à-dire à me marier et à fonder une famille, je doutais de tout, même de l’existence de Brahma ; j’étais un hérétique. Mais du sein de l’abîme, j’entrevoyais des hauteurs où brillait la lumière et je désirais avec ardeur m’élever jusqu’à elle pour en être éclairé. Enfin, après des années d’angoisse, le jour se fit en moi et je compris que le principe de la vie, l’élément de la religion, le lien qui relie l’âme à Dieu, c’est l’amour !
Le bonheur, pour celui qui aime, réside dans l’action ; on peut juger de la somme d’amour qu’il possède d’après ce qu’il est prêt à faire pour les autres. Je ne pouvais rester oisif en face des maux sans nombre dont Brahma a rempli le monde, et je me rendis dans l’île de Ganga Lagor, située à l’endroit où les eaux sacrées du Gange se jettent dans l’océan Indien. Deux fois par an, de nombreux Indous y viennent, en pèlerinage, chercher la purification dans les eaux du fleuve. La vue de leur misère affermissait l’amour que je sentais en moi, et pourtant je résistais au désir que j’avais de leur parler. Un mot prononcé contre Brahma me perdrait, un seul acte de compassion envers un des Brahmanes déchus qui, de temps à autre, se traînaient sur le sable pour y mourir, une parole de pitié, un verre d’eau tendu et je deviendrais un des leurs, un être dépossédé de tous ses privilèges de famille et de caste. Mais l’amour fut le plus fort ! Je parlai aux disciples réunis dans le temple du sage Kapila ; ils m’expulsèrent. Je parlai aux pèlerins, ils me chassèrent de l’île à coups de pierres. Sur les grands chemins, j’essayai de prêcher ; ceux qui m’entendaient s’enfuyaient loin de moi ou cherchaient à m’ôter la vie. Dans l’Inde entière, il n’y eut bientôt plus de place pour moi. Réduit à cette extrémité, je cherchai un endroit assez solitaire pour m’y cacher à tous les yeux, excepté à ceux de Dieu. Je remontai le Gange jusqu’à sa source, qui se trouve bien haut dans l’Himalaya et là, je demeurai seul avec Dieu, priant, jeûnant, désirant la mort.
Une nuit, que je marchais sur le rivage d’un lac, je criai dans le grand silence dans lequel tout autour de moi était plongé : « Quand donc Dieu viendra-t-il chercher ce qui lui appartient ? N’y aura-t-il jamais de rédemption ? » Tout à coup une lumière se réfléchit sur le miroir de l’eau, bientôt une étoile s’en éleva, elle se dirigeait vers moi et s’arrêta au-dessus de ma tête. J’en fus ébloui, et tombant à terre, j’entendis une voix d’une douceur infinie qui disait : « Ton amour a remporté la victoire. Tu es béni, fils de l’Inde. La rédemption va s’accomplir. Avec deux autres hommes, venus des confins du monde, tu verras le Rédempteur et tu seras témoin de sa venue. Lève-toi avec le matin et va à leur rencontre. Mets ta confiance dans l’Esprit qui te conduira. » Depuis ce moment, l’étoile est demeurée avec moi et j’ai compris que c’était l’Esprit devenu visible. À l’aube, je partis par le même chemin que j’avais suivi jadis, quand je cherchais la solitude. Je trouvai, dans une fente de la montagne, une pierre d’une grande valeur que je vendis en arrivant à Hurdwar. De là, je me rendis par Lahore, Caboul et Yezd à Ispahan, où j’achetai mon chameau. Quelle gloire est la nôtre, ô frères ! Nous verrons le Rédempteur, nous lui parlerons, nous l’adorerons ! J’ai dit ! »
– Je m’incline devant toi, mon frère, car tu as beaucoup souffert, mais ton triomphe fait ma joie, dit l’Égyptien, avec la gravité qui le caractérisait. Et maintenant, s’il vous plaît de m’entendre, je vous apprendrai qui je suis et comment j’ai été appelé.
Je suis Balthasar, l’Égyptien. Je suis né à Alexandrie, je suis né prince et prêtre, et j’ai reçu une éducation conforme à mon rang. Mais de bonne heure la croyance que l’on cherchait à m’imposer cessa de me suffire. L’on m’enseignait qu’après la mort et la destruction du corps l’âme recommence une éternelle migration, s’élevant progressivement de la bête la plus infime jusqu’à l’humanité, et cela sans aucune acception de ce qu’a été sa conduite ici-bas. Un jour, j’entendis parler du Paradis des Persans, où seuls les bons ont droit de cité, et dès lors je fus hanté par la pensée de ces deux alternatives : transmigration sans fin ou vie éternelle dans le ciel. Si, comme mes maîtres me l’assuraient, Dieu était juste, pourquoi n’y aurait-il aucune distinction entre les bons et les méchants ? Le résultat de mes méditations fut que j’arrivai à la persuasion que le corollaire obligatoire de la loi à laquelle je réduisais la religion pure, c’est que la mort est simplement le point où s’opère le triage entre les bons et les méchants. Ceux-ci sont abandonnés, perdus ; ceux qui ont été fidèles parviennent à une vie supérieure, non pas, ô Melchior, à une béatitude négative dans le sein de Brahma ; non pas, ô Gaspard, à l’existence dans cet enfer tolérable, qui représente le ciel dans l’imagination des adorateurs des dieux de l’Olympe, mais à la vie, à la vie active, éternelle, à la vie avec Dieu ! Cette découverte fit naître en moi une autre question. Pour-quoi les prêtres, qui connaissaient l’existence d’un seul Dieu, laissaient-ils le peuple dans l’ignorance et la superstition dans lesquelles ses maîtres l’avaient plongé à dessein, afin de pouvoir plus facilement dominer sur lui ? Les Ramsès ne régnaient plus en Égypte, Rome avait pris leur place et la philosophie nous avait enfin acquis la tolérance. Un jour, dans le quartier le plus magnifique et le plus populeux d’Alexandrie, je me levai et me mis à prêcher. L’Orient et l’Occident se rencontraient dans mon auditoire. Des étudiants se rendant à la Bibliothèque, des prêtres sortant du temple de Sérapis, des flâneurs venant du musée, des gens de toutes sortes s’arrêtaient pour m’entendre ; ils furent bientôt une multitude. Je leur parlai de Dieu, de l’âme, du bien, du mal, du ciel, récompense d’une vie vertueuse. Tu fus lapidé, ô Melchior, mes auditeurs commencèrent par s’étonner, puis se mirent à rire. J’essayai de poursuivre, ils m’accablèrent d’épigrammes, couvrirent mon Dieu de ridicule et obscurcirent mon ciel à force de moqueries. Je ne puis m’étendre davantage là-dessus, qu’il vous suffise de savoir que je succombai sous leurs sarcasmes.
Pendant plus d’une année, la montagne m’offrit un asile. Le fruit des palmiers nourrissait mon corps, la prière soutenait mon âme. Une nuit que je me promenais dans un bosquet, sur les bords d’un petit lac, je disais dans ma prière : « Le monde se meurt. Quand viendras-tu, ô mon Dieu ? Ne verrai-je pas la Rédemption ? » La surface de l’eau réfléchissait des myriades d’étoiles. Une d’entre elles me sembla quitter sa place et s’élever au-dessus de ma tête, si près que j’aurais pu la toucher de ma main. Je tombai la face contre terre, et une voix qui n’était pas de ce monde me dit ; « Tes bonnes œuvres ont remporté la victoire, ô fils de Mizraïm ! La Rédemption s’approche. Avec deux autres hommes, venus des pays les plus éloignés de la terre, tu verras le Sauveur et tu lui rendras témoignage. Lève-toi, à l’aube du jour, et va à leur rencontre. Et quand vous serez arrivés en la sainte cité de Jérusalem, demandez à chacun : « Où est le roi des Juifs, qui est né ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l’adorer ». Mets toute ta confiance dans l’Esprit qui te conduira. » Et la lumière devint une illumination intérieure, de la réalité de laquelle je ne pouvais douter ; elle est demeurée avec moi, m’instruisant, me guidant. Elle m’a conduit, en suivant le fleuve, jusqu’à Memphis, où je me préparai pour la traversée du désert. J’achetai mon chameau et je me rendis ici, sans prendre aucun repos, en passant par Suez et Kufilek et par les territoires de Moab et d’Ammon. Dieu est avec nous, ô mes frères !
Il se fit un long silence ; la joie qui les remplissait n’aurait pu s’exprimer par des paroles. C’était l’inexprimable joie d’âmes arrivées sur les rives du fleuve de la vie, où elles se reposent en la présence de Dieu, avec les rachetés. Leurs mains unies se détendirent, ils se levèrent ensemble et sortirent de la tente. Le désert était sans voix, comme le ciel. Le soleil baissait rapidement à l’horizon, les chameaux dormaient.
Un moment plus tard la tente était pliée, les restes du repas serrés dans la corbeille d’osier, et les trois amis reprenaient leur course, guidés par l’Égyptien. Ils se dirigeaient vers l’ouest, dans la fraîcheur de la nuit. Les chameaux filaient, de leur trot allongé, en se suivant sur une ligne si droite, et à intervalles si réguliers, que les deux derniers semblaient poser leurs pieds dans les empreintes mêmes de celui qui marchait en avant. Bientôt la lune se leva et les trois formes blanches qui passaient, éclairées par sa lumière opaline, semblaient des ombres, fuyant devant on ne sait quel fantôme. Tout à coup, en face d’eux, à la hauteur d’une colline peu élevée, une flamme s’alluma dans l’espace, et tandis qu’ils la considéraient, elle se concentra en un foyer d’une clarté éblouissante. Leurs cœurs battaient à coups précipités, leurs âmes tressaillaient, et d’une seule voix ils s’écrièrent : « L’étoile, l’étoile ! »
CHAPITRE IV
C’était la troisième heure du jour, et un grand nombre de personnes avaient déjà quitté la place, située en dehors de la porte de Jaffa, à Jérusalem, qui, depuis les jours de Salomon, sert de lieu de marché. Cependant la foule qui l’encombrait ne diminuait guère, sans cesse de nouveaux arrivants venaient se joindre à elle. Parmi ceux-ci se trouvaient un homme et une femme, montée sur un âne.
L’homme se tenait debout à la tête de l’animal, qu’il conduisait par la bride. Il s’appuyait sur un bâton et son costume, semblable à celui des Juifs du commun peuple, paraissait encore presque neuf. Probablement le manteau qui encapuchonnait sa tête et la robe qui recouvrait sa personne, de la naissance du cou jusqu’aux talons, étaient ceux qu’il mettait pour se rendre à la synagogue, les jours de sabbat. À voir son visage, on lui eût donné cinquante ans, supposition que ne démentaient point les fils blancs entremêlés dans sa barbe noire. Il regardait autour de lui de l’air à la fois curieux et indifférent d’un étranger et d’un provincial. L’âne mangeait tout à son aise une poignée d’herbe verte, qui se trouvait en abondance sur le marché, et ne paraissait pas s’occuper de la femme voilée et vêtue d’une robe de laine, de couleur sombre, qui se trouvait assise sur son dos. Au bout d’un moment, quelqu’un accosta l’homme, en lui disant : « N’es-tu pas Joseph de Nazareth ? »
– On m’appelle ainsi, répondit Joseph en se retournant lentement. Et toi ? – Ah ! que la paix soit avec toi, Rabbi Samuel.
– Et avec toi.
Le Rabbi s’arrêta, regarda la femme et ajouta : « avec toi, avec ta maison et avec tous les tiens, soit la paix ! » Il plaça une de ses mains sur sa poitrine et s’inclina devant la femme, en prononçant ces dernières paroles. Elle écarta légèrement son voile, afin de le voir, et l’on put apercevoir le visage d’une jeune fille à peine sortie de l’enfance.
– Il y a si peu de poussière sur tes vêtements, reprit le Rabbi, que j’en conclus que tu as passé la nuit dans cette cité de nos pères.
– Non, répondit Joseph, nous n’avons pu aller plus loin que Béthanie, où nous avons passé la nuit, et nous nous sommes remis en route au point du jour.
– Vous avez donc devant vous un long voyage. Vous n’allez point, cependant, jusqu’à Joppe, j’espère ?
– Seulement à Bethléem.
L’expression du Rabbi s’assombrit.
– Oui, dit-il, je comprends. Tu es né à Bethléem et maintenant tu t’y rends avec ta fille, pour y être enregistrés, ainsi que César l’ordonne. Les enfants de Jacob sont aujourd’hui comme étaient les tribus en Égypte, seulement ils n’ont plus ni Moïse, ni Josué.
Joseph répondit, sans changer de posture : « Elle n’est pas ma fille ». Le Rabbi ne fit pas attention à cette interruption et continua, poursuivant son idée :
– Que font les zélotes, là-bas, en Galilée ?
– Je ne suis qu’un charpentier et Nazareth est un village, dit Joseph, prudemment. Je n’ai pas le temps de m’occuper des querelles de parti.
– Mais tu es Juif, dit le Rabbi, et de la lignée de David, il est impossible que tu prennes plaisir à payer une taxe autre que le schekel dû à Jéhovah.
Joseph resta silencieux.
– Je ne me plains pas du montant de la taxe, – un denier est une bagatelle – l’offense, c’est l’imposition. La payer, n’est-ce pas se soumettre à la tyrannie ? Dis-moi s’il est vrai que Juda prétend être le Messie – tu vis au milieu de ses disciples ?
– Je leur ai entendu dire qu’il l’est, dit Joseph.
À ce moment la jeune femme retira son voile et pendant un instant on put voir un visage d’une exquise beauté, sur lequel se lisait une intense curiosité.
– Ta fille est agréable à la vue, s’écria le politicien, oubliant ses préoccupations.
– Elle n’est pas ma fille, répéta Joseph, et voyant que sa curiosité était éveillée, il se hâta d’ajouter : Elle est la fille de Joachim et d’Anne de Bethléem, dont tu dois avoir entendu parler, car leur réputation était grande.
– Oui, dit le Rabbi respectueusement. Je les connaissais bien, ils descendaient en ligne directe de David.
– Ils sont morts à Nazareth, continua le Nazaréen. Joachim n’était pas riche, cependant il laissait une maison et un jardin, à partager entre ses deux filles, Marianne et Marie. Celle-ci en est une et la loi exigeait que pour conserver sa part de la propriété, elle épousât son parent le plus proche. Elle est ma femme.
– Tu étais ?
– Son oncle.
– Et comme vous êtes tous deux de Bethléem, vous allez vous faire enregistrer tous deux par les Romains. Le Dieu d’Israël est vivant, la vengeance lui appartient !
Joseph, qui ne désirait pas continuer cette conversation, ne parut pas avoir entendu. Il rassembla l’herbe que l’âne avait dispersée autour de lui, puis reprenant sa bride, il tourna à gauche, et s’engagea sur la route de Bethléem. Silencieusement, tendrement, le Nazaréen veillait sur sa jeune femme, guidant sa monture le long du sentier mal tracé, intercepté ça et là par des branches d’oliviers sauvages, qui descend dans la vallée d’Hinnom. Ils avançaient lentement et quand ils commencèrent à remonter vers la plaine de Rephaïm, le soleil dardait en plein ses rayons sur eux. Marie enleva entièrement son voile, car il faisait chaud, et Joseph, qui marchait à côté d’elle, lui racontait l’histoire des Philistins, surpris autrefois par David en cet endroit même.
La tradition nous a transmis un portrait charmant de la jeune femme qui se rendait ainsi dans la cité du roi pasteur. Elle n’avait pas plus de quinze ans, son visage était d’un ovale gracieux, son teint plus pâle que rosé, ses traits d’une régularité parfaite. De longs cils ombrageaient ses grands yeux bleus, et ses cheveux blonds, arrangés selon la coutume des mariées juives, atteignaient le coussin sur lequel elle était assise. À tous ces charmes s’en ajoutaient d’autres, d’une nature plus indéfinissable – surtout une expression telle que seule une âme pure peut la communiquer au visage. Souvent ses lèvres tremblaient, elle levait vers le ciel ses yeux bleus comme lui, puis elle croisait ses mains sur sa poitrine et semblait s’absorber en de muettes actions de grâce, ou encore elle paraissait écouter des voix mystérieuses. De temps à autre Joseph interrompait son récit pour la regarder, et voyant son expression, il oubliait de quoi il parlait et se prenait à songer.
Ils traversèrent ainsi la grande plaine et atteignirent, enfin, l’élévation de Mar Elias, d’où ils purent apercevoir Bethléem, dont une vallée les séparait encore. Ils trouvèrent celle-ci tellement encombrée de gens et d’animaux que Joseph, craignant de ne plus trouver de place pour Marie dans la ville, se hâta d’avancer, sans prendre le temps de saluer aucun de ceux qu’il rencontrait sur son chemin.
Les caravansérails de l’Orient ne sont souvent que de simples enclos, sans toit, même sans porte, placés en des endroits où l’on trouve de l’ombre, de l’eau, et qui offrent quelques garanties de sécurité. Tels devaient avoir été ceux où s’arrêta Jacob, lorsqu’il se rendit en Padan-Aram, pour y chercher une femme. L’autre extrême était représenté par certains établissements, situés principalement au bord des grandes routes qui conduisaient à des villes importantes comme Jérusalem ou Alexandrie, constructions princières, servant de monuments à la piété des rois qui les avaient fait construire, mais le plus fréquemment c’était tout simplement la demeure d’un cheik, ou sa propriété, ou le quartier général d’où il gouvernait sa tribu, qui en tenait lieu. Loger les voyageurs constituait la moindre utilité d’un caravansérail de cette espèce, qui était tout à la fois une place de marché, une factorerie, un fort.
L’aménagement intérieur d’une de ces hôtelleries ne laissait pas que d’être singulier. Il ne s’y trouvait ni hôte, ni hôtesse, ni serviteur, ni cuisinier, ni cuisine. Seul, un intendant, qui se tenait à la porte, représentait le propriétaire et faisait respecter l’ordre. Les étrangers y séjournaient selon leur bon plaisir, sans avoir de compte à rendre à personne. Une des conséquences de ce système, c’est qu’il fallait apporter avec soi sa nourriture et ses ustensiles de cuisine, ou les acheter sur place, aux marchands établis dans l’enceinte du caravansérail. Il en était de même des lits et du fourrage pour le bétail. Tout ce que le propriétaire fournissait c’était l’eau, l’abri et la protection, et on les recevait gratuitement.
L’hôtellerie de Bethléem devant laquelle Joseph et Marie s’arrêtèrent appartenait à ce genre intermédiaire. Elle devait être la seule de l’endroit, qui ne possédait qu’un unique cheik. Joseph, bien qu’il fût né en cette ville, l’avait quittée depuis si longtemps qu’il ne connaissait plus personne à qui demander l’hospitalité. D’ailleurs le recensement pour lequel il revenait pouvait durer plusieurs semaines, même des mois, vu la proverbiale lenteur des autorités romaines en province, et il ne pouvait songer à imposer sa présence et celle de sa femme, pour un temps si long, à des amis ou à des parents. Sa crainte de ne pas trouver de place s’était accrue pendant qu’ils gravissaient la colline, et son alarme fut grande lorsqu’il découvrit que la foule assaillait la porte de l’hôtellerie et que dans l’enclos destiné aux animaux l’espace faisait déjà défaut.
– Je vais essayer de parler à l’intendant, dit Joseph, je reviendrai le plus promptement possible.
L’intendant était assis sur un bloc de bois de cèdre, placé à côté de la porte, un javelot s’appuyait derrière lui à la muraille, un chien se tenait couché à ses pieds.
– Que la paix de Jéhovah soit avec toi ! lui dit Joseph.
– Que ce que tu me souhaites te soit rendu en une grande mesure ! répondit le gardien d’un ton grave et sans faire un mouvement.
– Je suis un Bethléémite, dit Joseph, n’y a-t-il pas de place pour moi ici ?
– Il n’y en a pas.
– Tu dois avoir entendu parler de moi, Joseph de Nazareth. Cette maison est celle de mes pères, je suis de la race de David !
Tout l’espoir de Joseph reposait sur ces paroles. Si elles restaient sans effet, il lui serait inutile d’essayer d’obtenir, même à prix d’argent, ce qu’il demandait. C’était une grande chose d’appartenir à la maison de Juda ; être de la maison de David, cela signifiait bien plus encore, cela constituait le titre d’honneur par excellence, aux yeux des Hébreux. Plus de mille ans avaient passé depuis le temps où le petit berger prenait la place de Saül et fondait une dynastie. Les guerres, les calamités de tout genre, avaient fait tomber ses descendants au niveau des plus humbles d’entre les Juifs ; ils devaient au travail le pain qu’ils mangeaient, mais leur généalogie représentait un privilège pieusement conservé. Ils ne pouvaient devenir des inconnus au sein de leur peuple, où qu’ils allassent, on leur témoignait un respect touchant à l’adoration.
S’il en était ainsi à Jérusalem, combien plus un membre de cette famille pouvait-il espérer trouver une place dans l’hôtellerie de Bethléem ! Joseph disait littéralement la vérité lorsqu’il prononçait ces simples paroles : « Ceci est la maison de mon père, » car c’était la maison même où commandait Ruth, femme de Booz, celle où naquirent Jessé et ses fils, dont le cadet fut David, celle où Samuel entra, cherchant un roi, et le trouva, celle que David donna à Barzillaï, le Galaadite, celle enfin, où Jérémie, par la force de la prière, rassembla les restes de son peuple, fuyant devant les Babyloniens. L’intendant se leva et dit respectueusement :
– Rabbi, je ne saurais t’apprendre quand cette porte s’est ouverte pour la première fois devant un étranger, mais, certainement, ce fut il y a plus de mille ans. Si, dès lors, jamais un homme de bien n’a été mis dehors, lorsqu’il s’est trouvé de la place, combien faut-il qu’il en manque pour que je dise non à un descendant de David ? Quand es-tu arrivé ?
– Tout à l’heure.
L’intendant sourit.
– Rabbi, la loi ne nous commande-t-elle pas de considérer l’étranger qui demeure sous notre toit comme un frère et de l’aimer comme nous-mêmes ?
Joseph restait silencieux.
– Pourrais-je donc renvoyer ceux qui attendent une place depuis l’aube ?
– Qui sont ces gens ? demanda Joseph, pourquoi sont-ils ici ?
– Pour la même raison qui t’amène, sans doute, Rabbi : le dénombrement ordonné par César. En outre, la caravane allant de Damas en Arabie et dans la Haute-Égypte est arrivée hier. Ces gens et les chameaux que tu vois leur appartiennent.
– Je ne crains pas l’air de la nuit pour moi, dit Joseph en s’animant, mais bien pour ma femme. Elle ne peut rester dehors. N’y a-t-il plus de place dans la ville ?
– Aucune, dit l’intendant qui paraissait réfléchir. Je ne saurais te renvoyer, Rabbi, dit-il tout à coup. Il ne sera pas dit que je t’ai laissé sur la route. Va-t’en promptement quérir ta femme, car le soleil baisse et la nuit approche.
Joseph obéit.
– Voilà celle dont je te parlais, dit-il quand il fut de retour auprès de l’intendant.
Celui-ci regarda Marie, dont le voile était levé.
– Des yeux bleus et des cheveux d’or, murmura-t-il. Ainsi devait être le jeune roi, lorsqu’il allait chanter devant Saül. Puis il ajouta, en prenant la bride de l’âne des mains de Joseph : « La paix soit avec toi, fille de David. »
Ils traversèrent lentement la cour pleine de monde et prirent un sentier qui se dirigeait vers un rocher crayeux, situé à l’ouest du caravansérail.
– Tu nous mènes à la caverne, fit observer Joseph.
Le guide, qui marchait à côté de Marie, se tourna vers elle.
– La caverne à laquelle nous nous rendons, dit-il, a servi jadis de lieu de refuge à ton ancêtre David. Il y mit plusieurs fois ses troupeaux à l’abri et l’on assure que, devenu roi, il lui arriva d’y revenir avec une grande suite d’hommes et d’animaux. Les crèches existent encore, telles qu’elles étaient alors. Mieux vaut coucher sur le sol sur lequel il a dormi que sur celui des grands chemins. Mais voici la maison qui est construite devant la caverne.
Cette maison, étroite et basse, ne dépassait guère le rocher contre lequel elle était appliquée et servait uniquement de porte à la caverne.
– Entrez, dit leur guide, en l’ouvrant devant eux.
Ils se trouvèrent bientôt dans une grotte naturelle, ayant une quarantaine de pieds de long, douze ou quinze de large et environ dix de haut. La lumière, qui pénétrait au travers de la porte, permettait encore de distinguer, sur le sol inégal, des tas de blé, de foin, de paille, des ustensiles de ménage. Le long des parois se trouvaient disposées des crèches de pierre, assez basses pour que des brebis pussent y manger.
– Tout ce que vous voyez là, dit le guide, est destiné à des voyageurs comme vous. Prenez ce dont vous aurez besoin.
Se tournant vers Marie, il lui demanda si elle pensait pouvoir se reposer là. Elle répondit :
– Ce lieu-ci est un lieu saint.
– Je vous laisse. La paix soit avec vous. – Quand il les eut quittés, ils s’occupèrent à rendre la caverne habitable.
Or, vers minuit, celui qui veillait sur le toit de l’hôtellerie s’écria : « Qu’est-ce donc que cette lumière que je vois dans le ciel ? Éveillez-vous et regardez ! À demi éveillés, ceux qui l’entourèrent s’assirent, puis ils ouvrirent tout grands leurs yeux et demeurèrent comme frappés de stupeur. La nouvelle qu’il se passait quelque chose d’étrange se répandit autour d’eux. Ils voyaient au ciel une lumière qui semblait infiniment plus rapprochée d’eux que celle des étoiles les moins éloignées. Elle éclairait obliquement la terre ; son sommet semblait n’être qu’un point, tandis que sa base s’étendait sur les montagnes, sur une longueur de plusieurs stades ; sur ses côtés elle allait se dégradant doucement, se confondant avec l’obscurité de la nuit.
Cela dura pendant quelques minutes, et chez ceux qui considéraient ce phénomène extraordinaire, l’étonnement se changeait en crainte. Les plus timides tremblaient, les plus braves parlaient au souffle.
– Vit-on jamais chose semblable ? demanda quelqu’un.
– Je ne saurais dire ce que c’est, jamais je n’entendis parler de rien de pareil, répondit une voix. On dirait que cette lumière repose sur la montagne.
– Ne serait-ce point une étoile tombée du ciel ?
– Quand une étoile tombe, elle s’éteint.
– J’ai trouvé, moi ! Les bergers ont vu un lion et ils ont allumé des feux pour l’empêcher d’approcher du troupeau.
Les hommes debout à côté de celui qui venait de parler poussèrent un soupir de soulagement.
– C’est cela, c’est cela, dirent-ils, les troupeaux paissaient aujourd’hui dans cette direction !
Un des assistants ébranla leur assurance.
– Non ! non ! Quand même toutes les forêts de Juda brilleraient, elles ne projetteraient pas une lueur si intense, ni si haute.
– Frères, exclama un Juif à l’aspect vénérable, ce que nous voyons maintenant, c’est l’échelle que notre père Jacob vit en songe. Béni soit l’Éternel, le Dieu de nos pères !
CHAPITRE V
Les collines qui s’élèvent au-delà de Bethléem abritent contre les vents du nord une plaine, plantée de sycomores, de chênes verts et de pins, d’oliviers et de ronces, où paissaient alors les troupeaux. À l’extrémité de cette plaine, opposée à la ville, s’élevait une fort ancienne bergerie, qui n’était plus guère qu’une ruine sans toit, entourée d’un enclos dans lequel les bergers avaient coutume de rassembler leurs troupeaux vers le soir.
Le jour même où Joseph et Marie arrivaient à Bethléem, quelques bergers, au coucher du soleil, se dirigeaient vers cette bergerie. À la nuit close, ils allumèrent un feu près de la porte, prirent leur repas du soir et s’assirent pour se reposer et causer, tandis que l’un d’entre eux montait la garde. Ils étaient six, sans compter celui qui veillait. Comme ils ne portaient habituellement pas de coiffures, leurs cheveux se dressaient sur leurs têtes en touffes épaisses et rudes, leurs barbes incultes descendaient jusque sur leurs poitrines. Des manteaux, faits de peaux de moutons, tournés la toison en dedans, les couvraient des pieds à la tête et ne laissaient de libre que leurs bras ; de larges ceintures retenaient ces vêtements grossiers autour de leur taille ; leurs sandales étaient sordides. À leur côté pendaient des gibecières, contenant du pain et des pierres soigneusement choisies, pour les frondes dont ils étaient armés. Près de chacun d’eux gisait le bâton recourbé qui symbolisait leur charge, en même temps qu’il leur servait à se défendre.
Tels étaient les bergers de Judée, des hommes en apparence aussi féroces que les chiens couchés avec eux autour du feu, en réalité des êtres simples d’esprit et tendres de cœur, ce qui tenait en partie à la vie primitive qu’ils menaient, mais surtout à ce qu’ils étaient sans cesse occupés à soigner des agneaux doux et faibles.
Ils se reposaient et causaient. Ils parlaient de leurs troupeaux, un sujet que d’autres eussent jugé monotone, mais qui, pour eux, représentait l’univers. Pourtant ces hommes simples et rudes étaient aussi des croyants et des sages. Les jours de sabbat, ils se purifiaient et se rendaient à la synagogue, où ils s’asseyaient sur les bancs réservés aux pauvres et aux humbles, et nul ne prêtait au service plus d’attention qu’eux, ou n’y songeait davantage durant la semaine. Ils savaient une chose, c’est que l’Éternel était leur Dieu et qu’ils devaient l’aimer de tout leur cœur, et ils l’aimaient, puisant dans cet amour une intelligence des choses spirituelles qui dépassait celle des rois de la terre.
Peu à peu leurs voix se turent, et avant que la première veille fût passée, tous dormaient autour du feu. La nuit, comme la plupart des nuits d’hiver dans la région des collines, était claire et brillamment étoilée. Aucun vent ne soufflait. L’atmosphère était d’une si parfaite limpidité, le silence si profond, qu’on eût dit que le ciel se penchait vers la terre pour lui annoncer tout bas de mystérieuses nouvelles.
Devant la porte le garde allait et venait. Il lui semblait que minuit tardait ; pourtant il finit par terminer sa veille. Il se dirigeait vers le feu, heureux de pouvoir se reposer à son tour, quand une lumière, douce et pâle comme celle de la lune, perça l’obscurité de la nuit. Il s’arrêta, n’osant respirer. La lumière devenait d’instant en instant plus brillante, elle éclairait les objets cachés jusqu’alors à ses yeux. Un frisson, causé non par la fraîcheur de l’air, mais par la crainte, le secoua. Il leva les yeux et voilà, les étoiles semblaient s’en être allées et la lumière paraissait descendre d’une porte ouverte dans la voûte des cieux ; elle prenait un éclat splendide. Saisi de terreur, il s’écria : « Éveillez-vous, éveillez-vous ! » Les chiens s’élancèrent dans la plaine en hurlant, les brebis épouvantées se serraient les unes contre les autres. Les bergers se levèrent en sursaut et saisirent leurs armes en criant tous à la fois :
– Qu’y a-t-il ?
– Regardez, le ciel est en feu.
Soudain la lumière devint si éblouissante qu’ils tombèrent sur les genoux, leurs fronts s’inclinèrent jusqu’en terre et ils auraient rendu l’âme de frayeur si une voix ne leur avait dit : « N’ayez point de peur, car voici, je vous annonce une grande joie, qui sera pour tout le peuple ! » La voix, une voix pure et claire, d’une douceur infinie, pénétra jusqu’au plus profond de leurs cœurs et calma leur frayeur. Ils virent, au centre d’une grande gloire, un homme vêtu d’une robe éclatante de blancheur. Au-dessus de ses épaules s’élevaient les extrémités de deux grandes ailes, ployées et lumineuses ; sur son front brillait une étoile, ses mains s’étendaient vers eux, pour les bénir, son visage était d’une beauté et d’une sérénité divines.
Ils avaient maintes fois entendu parler des anges et souvent ils en parlaient entre eux. Maintenant ils se disaient : « La gloire de Dieu est sur nous et celui-ci est le même qui est apparu autrefois au prophète, sur les rives de l’Ullaï. » Et l’ange continua :
« Car aujourd’hui, en la ville de David, le Sauveur, qui est le Christ, vous est né. »
Il y eut encore un silence durant lequel ces paroles se gravaient dans leur cœur.
« Et ceci vous servira de signe, c’est que vous trouverez le petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. »
Le héraut ne parla plus, il s’était acquitté de son message, mais il demeurait encore près d’eux, et tout à coup la lumière dont il semblait être le centre devint toute rose et se mit à trembler. Alors, aussi loin que la vue des bergers pouvait s’étendre, ils virent aller et venir des ailes blanches et des formes radieuses, et ils entendirent des multitudes de voix qui chantaient à l’unisson :
« Gloire soit à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre et bonne volonté envers les hommes ! »
Après cela le héraut leva les yeux comme pour solliciter l’approbation d’un être invisible, puis il déploya ses grandes ailes, toutes blanches dans les bords, irisées comme la nacre, dans les parties ombrées, s’éleva sans effort et disparut aux regards. Tout redevint obscur autour d’eux, mais longtemps encore, ils entendirent descendre du ciel ce refrain, toujours plus atténué par la distance :
« Gloire soit à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes ! »
Quand les bergers eurent repris pleine possession de leurs sens, l’un d’eux dit aux autres :
– C’était Gabriel, le messager de Dieu.
– N’a-t-il pas dit que Christ, le Seigneur, est né ?
– Oui, c’est là ce qu’il a dit.
– N’a-t-il pas dit aussi que c’est dans la ville de David, dans notre Bethléem, que nous le trouverions, un petit enfant enveloppé dans des langes ?
– Et couché dans une crèche.
Celui qui avait parlé le premier, réfléchit un moment, puis il s’écria, comme s’il venait de prendre une soudaine résolution :
– Il n’y a qu’un endroit à Bethléem où se trouvent des crèches, c’est la caverne. Frères, allons voir ce qui s’y est passé. Il y a longtemps que les docteurs et les sacrificateurs attendent le Christ. Maintenant qu’il est ici, allons l’adorer.
– Mais les troupeaux ?
– Le Seigneur en prendra soin. Hâtons-nous de partir !
Alors, s’étant levés tous ensemble, ils quittèrent la bergerie. Ils traversèrent la montagne, puis la ville, et arrivèrent à la porte de l’hôtellerie, où veillait un homme qui leur demanda ce qu’ils cherchaient.
– Nous avons vu et entendu de grandes choses cette nuit, répondirent-ils.
– Nous aussi nous avons vu quelque chose, mais nous n’avons rien entendu. Que savez-vous ?
– Le Christ est né !
L’homme se mit à rire, d’un rire ironique.
– Le Christ ! Vraiment ! Et où se trouve-t-il ?
– Il est né cette nuit et il est maintenant couché dans une crèche, voilà ce qui nous a été annoncé. Or il n’y a de crèches qu’en un endroit, à Bethléem !
– Dans la caverne ?
– Oui, viens-y avec nous et nous t’apprendrons en route ce qui nous est arrivé.
Ils traversèrent la cour, sans attirer l’attention, bien que quelques personnes fussent encore éveillées, parlant de la lumière miraculeuse. La porte de la caverne était ouverte, une lanterne en éclairait l’intérieur et ils entrèrent sans cérémonies.
– Que la paix soit avec toi, dit le veilleur à Joseph, voici des gens à la recherche d’un enfant qui serait né cette nuit. Ils disent qu’ils le reconnaîtront à ceci, qu’il doit être emmailloté et couché dans une crèche.
Une vive émotion se peignit sur le visage placide de Joseph.
– L’enfant est là, dit-il.
Il les conduisit vers l’une des crèches et voilà, l’enfant s’y trouvait. Il approcha la lanterne pour le montrer aux bergers, qui restaient debout, sans prononcer une parole. L’enfant dormait, il ressemblait à tous les autres nouveaux-nés.
– Où est la mère ? demanda le veilleur.
Une femme, qui se trouvait là, prit l’enfant et le déposa dans les bras de Marie, autour de laquelle les assistants se groupèrent.
– C’est le Christ, dit enfin un des bergers.
– Le Christ ! s’écrièrent-ils tous et ils tombèrent à genoux, tandis que l’un d’eux répétait à plusieurs reprises : « C’est le Seigneur et sa gloire dépassera celle du ciel et de la terre. »
Sans éprouver un instant de doute, ces hommes simples baisèrent le bas de la robe de la mère et s’en allèrent, racontant leur histoire à tous les hôtes du caravansérail, qui, éveillés maintenant, se pressaient pour les entendre, puis ils reprirent le chemin de leur bergerie, et tout le long du chemin ils chantaient le refrain des anges : « Gloire soit à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre et bonne volonté envers les hommes. »
Le récit de cet événement se répandit dans la ville, confirmé par tous ceux qui avaient été témoins de l’illumination du ciel, et, durant les jours qui suivirent, un grand nombre de personnes visitèrent la caverne. Il s’en trouva, parmi elles, quelques-unes qui crurent, mais le plus grand nombre riaient et se moquaient.
Onze jours après la naissance de l’enfant, les trois mages approchaient de Jérusalem, par la route de Sichem.
La Judée, enserrée entre la mer et le désert, ne pouvait guère prétendre à être autre chose qu’une sorte de carrefour international, que devaient forcément traverser les caravanes qui allaient et venaient entre les pays d’Orient et d’Occident, mais cela constituait pour elle une source de grande prospérité, et les richesses de Jérusalem provenaient des droits prélevés sur les marchandises qui passaient dans ses murs. Nulle part ailleurs, si ce n’est à Rome, on ne rencontrait un aussi constant assemblage de gens venus de toutes les parties du monde, nulle part un étranger n’était chose plus commune et n’attirait moins l’attention. Et cependant ces trois hommes excitaient la curiosité de tous ceux qui les rencontraient.
« Voyez, voyez quels grands chameaux, quelles belles clochettes ! » criait un enfant à quelques femmes assises au bord du chemin. Mais ce qui les faisait remarquer ce n’étaient pas leurs chameaux, malgré leur surprenante beauté, ni le son clair de leurs clochettes d’argent, ni la richesse évidente des trois étrangers, c’était la question que posait, à tous ceux qu’ils rencontraient, celui qui marchait le premier.
– Bonnes gens, disait-il en caressant sa barbe tressée, et en se penchant hors de sa litière, la ville de Jérusalem n’est-elle pas proche ?