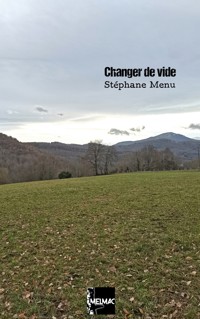
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Changer de vide" est à la fois une réflexion sur l'écriture, sur la vie, et sur le vide. Le vide de la vie et celui de l'écriture. La difficulté de l'écriture et celle de plonger dans le vide. Le personnage du roman change de vie. Change-t-il aussi de vide ? Comment affirmer que notre vie a un sens, un intérêt. Les questionnements philosophiques de l'auteur, au fil des pages de sa création, dans une maison isolée, croisent ses questionnements humains, sa rencontre avec une femme, le souvenir de celle qu'il a quittée. Des vides bien remplis finalement, plus hypothétiques que réels.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Il y va pour la dernière fois.
Sans enthousiasme, à vrai dire, il en a un peu marre de traîner ce texte qui ressemble à un boulet. Il faut qu’il s’en débarrasse, d’une manière ou d’une autre. Un ami accepte de le publier, avec un enthousiasme symétrique ; qu’il en soit remercié.
On ne sait jamais : les textes ont de telles destinées… Une fois lâchés, ils n’appartiennent plus à leurs auteurs, ils deviennent ce que les autres en font. Ce n’est pas spécifique à la littérature d’ailleurs : le monde n’est fait que de regardeurs avisés… Le visible est fait par ceux qui voient, pas par ceux qui sont vus…
Les récits du moi n’ont pas bonne presse. Les critiques littéraires, qui ne vivent que sur la détestation des autres, leur ridiculisation, et ne s’engouent que très rarement, détestent ce qu’ils appellent le nombrilisme. Lui, il n’aimerait presque que ça et comprend bien de ce fait que la route menant à la reconnaissance, si fragile, si injuste, est escarpée. De plus, il ne connaît personne dans ce milieu, ce qui peut être aussi une difficulté : disons qu’un livre moyen, selon des critères bien difficiles à établir, aura plus de chance d’être publié s’il entre dans un circuit de validation parallèle lui permettant de sauter les premiers cercles de certification, composés, il le suppose, de quelques licenciés ès lettres chargés, selon des méthodologies bien éprouvées, d’opérer le premier tri.
Il ne faut pas s’émouvoir de la présence de pistons, de petites entraides entre amis. Ce n’est injuste que de l’extérieur. De l’intérieur, dans le réseau, ça se justifie. On prend plaisir à aider ceux que l’on aime.
Il était tombé sur le chiffre des manuscrits retenus via le simple envoi postal, sans piston et autres stratégies de contournement ; c’est effrayant… Autant jouer au loto et créer derrière sa propre maison d’édition si la chance sourit…
Mais bon, il faut bien avancer. Tenter quelque chose. Ceux qui n’arrivent pas à passer le premier cercle des licenciés ont aussi le droit, comme ceux que la reconnaissance honore, de croire en leur étoile. Il n’en est plus là, même vis-à-vis des critiques dont la raison d’être est de dégommer tout ce qu’ils considèrent comme médiocre. Il n’en est plus là puisqu’il sait qu’il va être publié, dans des circonstances certes particulières, mais que les lecteurs n’ont pas à prendre en compte.
Aimer c’est toujours un malentendu. Ou un pari sur l’autre, pari que lui-même fait sur vous. Il n’est donc pas idiot de s’interroger sur les causes de ce que l’on aime, plutôt que d’essayer d’aimer comme les autres s’aiment.
Il écrit pour lui, tous les matins, comme d’autres font leur footing. Il est comme eux, mais il ne court pas vite, il traîne sa lourdeur mais ça lui fait du bien. Il sent bien que ça ne va pas, qu’il court parce que ça ne va pas, pour voir si le corps tient. Oui, il court pour ça, il force même parfois ; est-ce qu’il peut mourir au bout du sprint ? Le cœur pourrait-il le lâcher ? Car la vie c’est un peu tout ça en vrac : le bonheur d’écrire, l’alcool, les filles, le coucher du soleil…
Mais pour vivre ça, il faut que le cœur tienne, partant du principe philosophique que tout ce qui est bon est mal. Que la batterie cardiaque soit solide. Alors, il force, il sprinte, il lui arrive presque parfois d’espérer que ça pète, pour voir si ça pète vraiment, et jusqu’où, ou pour de faux comme disent les gosses… Il se réjouit de tenir la distance, de pactiser avec le corps, en espérant que les rouillures de ce dernier feront leur involution le plus tard possible. Cette sueur grasse qui coule sur sa peau, qu’il a du mal parfois à faire partir sous la douche, il la boirait presque.
Je sue donc j’existe !
C’est parfois dommage de s’entêter de cette manière ; le ridicule n’est jamais loin. C’est la faute à l’époque, sans doute, à cette croyance futile et diffuse que le soleil se lève pour tout le monde, ce qui est faux, les damnés savent qu’ils sont destinés à rester dans l’ombre.
Dans le même temps, qu’en ferait-il de ces limites auto-perçues aux odeurs de renoncement ? A quoi sert-il de savoir ce que l’on est si ce que l’on est n’est qu’un champ d’excroissances banales ? Peut-on se dire banalement heureux ?
Il va donc falloir lâcher le morceau, ce qu’il fait au bout d’une énième réécriture…
C’est un sacré iniéniste ! Il écrit depuis des années le même livre !
Ce texte se cherche une histoire, écrite en pointillés, palimpseste numérique, se déployant au gré des humeurs, des régurgitations mentales : cette vie nous expose à de trop nombreux moments où nous ne maîtrisons pas les choses, nous dépendons tellement des autres que nous finissons par ne plus savoir qui nous sommes.
L’âme fluctue à une telle vitesse : elle peut passer, dans la même journée, d’un état de délabrement complet à une élévation inexpliquée, transition dans laquelle les phrases se fluidifient et collent au plus près d’une heuristique hasardeuse mais joyeuse, esthétique en décalage obtenue par le croisement de phrases encore en couveuse, à peine expulsées du cerveau, et ce qu’elles deviennent dans la durée, dans le grand saut toujours déceptif vers l’apparence ; les mots trahissent toujours le ressenti, ce n’est pas une question de vocabulaire, juste le drame d’un décalage entre le dit montré et ce qu’il était supposé dire.
Ecrire c’est souvent passer à côté de ce que l’on voulait dire, c’est souvent ferrailler avec la difficulté de dire…
Car une question essentielle se pose : comment un texte atteint-il un niveau estimable de littérarité ? Existe-t-il une échelle de Richter de la littérarité ? Si la réponse est négative, pourquoi s’entêter à vouloir trouver un quelconque étalon ? Il a décidé de moins lire, pour éviter de s’exposer aux biais imitatifs, ceux qui poussent parfois à se mettre dans les pas de quelqu’un d’autre, de devenir son poisson pilote, ce qui dénature de fait l’écriture. Il a passé la cinquantaine. Il est en retard par rapport aux objectifs qu’il s’était savamment fixés. Il doit accélérer pour ne pas laisser les regrets prendre le dessus.
Il est ce livre et qu’importe ce qu’il renvoie.
Et s’il était possible d’écrire sa vie ?
C’est en ce sens que cette dernière relecture procède d’une terminale clarification.
S’il n’y a pas de modèle, si la référence n’est pas écrasante, le jeu en vaut subitement la chandelle. Pourquoi n’existerait-il pas une écriture visuelle, presque cubique ? Pourquoi la peinture aurait-elle seule ce privilège d’être regardée ?
Il veut une écriture qui se regarde. Qui s’apprécie comme on déplie un joli pull dans un magasin avant de l’acheter ; va-t-il l’acheter et donc aimer le porter ?
Il est si facile de se juger creux. C’est une forme de lucidité, ou d’exigence. Ce regard peut changer dans la durée : il suffit de décrire ce que l’on vit. Errer dans l’affouillement, ne rien faire d’essentiel, tripoter quelques concepts philosophiques ne suffit pas. L’homme restera toujours le moins bien placé pour se mesurer à lui-même. Le matin, il se lève, il va courir, il ne sait pas pourquoi, sans doute pour sentir son corps, le fatiguer et donc l’éprouver ; il place son casque sur les oreilles, il écoute les cours de Deleuze sur Spinoza, il est heureux de les comprendre, la compréhension est une première étape dans la fortification du soi, celui qui écrit, qui ose, il y a beaucoup d’humour chez Deleuze, l’humour est ce qui rend l’hermétisme encore plus doux, seule la difficulté mérite d’être appréhendée, le reste n’est qu’un lissage vers le désappointement.
Comprendre Spinoza, ou pas, Heidegger, enclenche le mécanisme d’écriture. Il a toujours lu dans l’idée d’écrire. L’écriture n’est que la caisse de résonance de ce qui précède. Tout est à réécrire, tout le temps.
Les mots gardent en mémoire une forme musicale de la résonance. Les mots sont des notes sans son.
Il ne peut pas renoncer à cette envie d’écrire. Le renoncement est une forme de facilité. Le plaisir du golf n’est pas dans le geste retransmis à la télé. Il est dans la pratique multiple du golf. Après le corps, l’écrit. La conquête des grands alpages. Le soi qui se met à y croire, à avoir faim. Ça ne dure pas longtemps. Il écrit quand ça vient. Il sait qu’à un moment donné, l’envie sera moins forte. Il accepte le deal. Il ne sert à rien d’insister. Comment maintenir un niveau acceptable de littérarité ? Comment garder avec soi le lecteur butineur ?
Le soi a mal au dos. Le soi ne se trouve pas beau. Le soi est chiant. Le soi est un bloc de viscères et le cerveau sert à enregistrer les bugs que cette machine trop imparfaite pour durer provoque.
Il ne sait écrire qu’à travers des petits commencements de texte. Il y a toujours comme un zéphyr rafraîchissant dans les voiles du commencement. Le même effet sur la peau qu’un courant d’air au milieu d’une nuit de canicule… Il ne sait pas écrire d’histoire, autant le dire tout de suite. Il avance par reptations, tel un escargot bourguignon traçant sa route au milieu de l’humus. Il couche des discontinuités majeures récupérées au fil des marches, de la fréquentation des marges, avançant donc à coup de petits récits. Quelques milliers de signes à pondre régulièrement, sans pression, quand ça vient. Littérature du gicleur. On garde ce qui sort, en misant sur le fait que le style fera le reste, que le nez cassé sur le visage de Javier Bardem fait sa beauté, que le bec de lièvre disparu sur celui de Joachin Phoenix a contribué à illuminer son visage. Des morceaux du puzzle à raboter, stockés depuis des lustres, dont la poussière semble avoir mâchouillé les bords, qu’il valide avec dégoût ou ravissement, c’est étonnant ce changement du regard d’un jour à l’autre, comme s’il y avait plusieurs lecteurs en lui, comme si l’encombrement mental d’un instant pesait radicalement sur la réceptivité d’un texte, lu pourtant jouissivement quelques heures plus tôt. Sidérant d’imaginer que l’émerveillement face un texte ne sera pas le même à 8 h 14 et à 22 h 54 ! Le tri commence et ira au bout. On ne change pas de vie, mais de vide, en racontant comment le grenier des désillusions se vide. C’est en ce sens qu’il faut apprécier le titre : changer de vide, à défaut de vie, ce qui mène fatalement à la déception ; la vie ne change pas, elle s’évide de l’intérieur et c’est l’absence de défis qui pose la jauge du bien-être. Etre soi, c’est prendre conscience de la simplicité de ce vide qui tend les bras.
Boire un café au soleil.
Manger une pizza.
Boire du vin.
Fumer.
Aimer, faire l’amour, le refaire.
On ne peut pas imaginer à quel point l’essentiel est là, à quel point ce qui paraît futile est très loin de l’être.
Il ne sait pas s’il est doué pour l’écriture. Il sait seulement que les retours postaux des éditeurs à ces expéditions sont négatifs, qu’il n’a pas réussi à séduire le premier cercle des étudiants en lettres. Il est légitimiste. Il ne conteste pas la sanction formulée par les regardeurs professionnels. Un bon éditeur est un marchand de noix ; ce sont les noix choisies en amont, auprès des bons fournisseurs, qui font sa réputation. Sa seule médiation est celle de l’exigence du choix. C’est là que la situation devient intéressante : quand on quitte ce stade médiateur, rien n’empêche, de fait, celui qui écrit de se considérer comme tel. Que fait-il ? Il écrit. Est-il publié ? Non… Mais en quoi cette non-publication l’empêcherait-elle de se considérer comme écrivain ?
Le paragraphe autorise des sauts de cabri. C’est une relance, comme une virgule musicale dans une émission de radio.
Tout le monde peut écrire. On écrit même pour les enfants et on explique savamment qu’il s’agit d’une façon d’écrire qui n’est pas donnée à tout le monde. Sa grand-mère écrivait ; sa mère le fait, de temps en temps, dans un style émouvant et fragile qui n’entre pas dans le champ de ce qui pourrait ressembler à quelque chose de publiable. Mais ces écritures-là, pauvres en mots, à l’orthographe hasardeuse, cherchent le même effet que celles dont les membres du premier cercle, hyper-violents dans leur moquerie, poursuivent : la réconciliation entre le soi, parure sociale, reflet total de tous les regards posés sur le moi, forcément marqués par une errance de désaxement (tout ce que les autres voient de lui ne le concerne pas), et ce moi en quête d’une authenticité uniquement atteinte quand, par exemple, on prend le temps de se poser à la terrasse d’un café ensoleillé et de vivre ce moment comme le fait le lézard quand le soleil chauffe la pierre sur laquelle il aime à se poser.
La littérature est un entre-soi très commode, où un livre doit ressembler à un autre pour être publié. La littérature est un processus essoufflé de reproduction de mêmetés flétries. Il préfère le hors-cadre, non pour y être, pour le plaisir onaniste de la singularité. Mais parce que c’est là où il perçoit le mieux le vide se remplir de désencombrements factices, d’authenticités fugitives, de suspensions chorégraphiées. Le meilleur texte est celui qui reste en l’état giclé du premier jet et dont la maladresse ne devient qu’un élément du débat en s’esthétisant dans sa primalité.
Il veut écrire comme personne ne l’a fait. Sinon ça ne sert à rien. Quitte à être ridicule.
Il est pareil au golfeur du dimanche qui golfe pour le seul plaisir d’enchaîner ses trous, seul au milieu d’un green merveilleusement tondu, généreusement arrosé (les riches se conçoivent au-dessus du monde, c’est humain, le capitalisme ne se vit que dans l’hyperbole, dans le séparatisme, le plaisir du riche est d’être sorti de la pauvreté rêche et de jouir des plaisirs que lui offre sa richesse sans compter), trous qu’il bouche à son rythme, finissant le parcours quand les autres ont déjà rejoint le bar pour prendre l’apéro. Il écrit comme le grimpeur à vélo qui teste ses coronaires dans les pentes alpines qui n’en finissent pas de se tendre vers le haut et se réjouit d’être arrivé à bonne altitude sans avoir fait sauter la tuyauterie cardiaque, regardant sans s’en émouvoir les autres filer devant, dans la position comique dite « en danseuse », sans le moindre salut, les muscles des jambes tendus à l’extrême, le sang filant dans les veines comme des rivières au printemps, farouchement libres et dont les débordements spumeux forment des splashs de chantilly, le ventre si plat qu’il s’est toujours demandé comment les six mètres en moyenne de l’intestin grêle pouvaient se glisser dans une anatomie si ramassée sur elle-même. Si la vie est ce que l’on en fait, alors, il écrit, c’est acté, la publication devenant dans une telle optique très secondaire.
Le style ne naît qu’après, quand les authenticités ont été aboutées, quand l’écrivain fonce, quand il ne se pose plus la question d’étalonner ce qu’il écrit, quand il se dit qu’il ne sert à rien de se demander si ça se tient, mais par rapport à quoi, l’écriture doit-elle avoir une tenue exigée ? Doit-elle ressembler à quelque chose qui préexistait à elle-même ? Le style doit trembler comme les feuilles le font quand l’orage arrive et que le ciel fait sa mauvaise tête. Il ne s’agit pas de créer artificiellement cette vivacité-là. L’ennui lui-même doit être accueilli comme un élément constitutif du style. Il décrit des états mentaux en rodage, porte-mentaux sur lesquels l’indécision glisse ou se fait la belle ; il écrit pour faire taire les détraquements biologiques qui imposeraient des IRM quotidiens. Ecrire à l’aveugle. Carburer aux images captées et finement percolées. Ecrire, c’est parler du vide effrayant. De l’évidence du vide, qui absolutise l’absurdité, et de ce que l’on en fait.
A-t-il déjà eu de l’ambition ? L’ambition suppose qu’à talent équivalent, l’un s’en sorte mieux qu’un autre, suppose-t-il, parce qu’il veut plus ardemment ce qu’il convoite. Mais comment mesurer le talent ? Un tel paramétrage repose-t-il sur un algorithme précis ? Le talent est-il toujours extérieur à celui qui en serait doté, résultant uniquement du regard posé sur lui, avec tout ce que cela comporte en termes de subjectivité ? Si tel est le cas, le succès de ce livre ne serait lié qu’à sa capacité à lui donner une visibilité adossée à une carrure commerciale !
S’il payait, comme certains le font, cent influenceurs bien en place, dont le seul travail consiste à dire du bien de quelque chose qu’ils ignorent, est-ce que leur travail collectif suffirait à inverser le regard sur une quelconque manifestation de la médiocrité ? La réussite serait-elle liée à la capacité à produire un effet d’adhésion massif à quelque chose ? La médiocrité n’est-elle qu’un état transitoire auquel il ne manquerait que l’activation du mécanisme commercial pour la transformer en une « médiocrité » bankable ou plutôt une réalité appréciée en dehors de toute perception personnelle ?
Si le talent naît de la seule médiation qualitative, cette dernière est-elle plus importante que la qualité intrinsèque de l’œuvre ? Comment le talent apparaît-il à la lumière de l’évidence ? Y a-t-il une évidence de la beauté, du talent ? Ces questions tournent en rond et n’ont pas de réponses. Il en conclut donc qu’il doit se contenter d’écrire, en veillant à créer seulement les conditions de la monstration, laissant ainsi percer à jour le résultat d’une percolation mentale suivant sa logique, sans la juger ou lui attribuer une quelconque qualité ; il lui faut installer de la fluidité là où l’abrasivité l’empêche. Il est un homme basique dont la caractéristique principale est de ne jamais savoir vraiment où il va, appréciant finalement le zigzag qu’impose le ballot incertain de la vie, incapable de tenir d’une poigne ferme le gouvernail d’une route qui ne fait que dévier de direction et dont la seule destination précise est celle qui mène à la mort, ce qui est d’une monstrueuse banalité. L’instinct éclairera le chemin et la balle finira par atteindre son trou. C’est le trajet qui compte, jamais la performance. L’atteinte est la fin, le récit en est la route, épousant la courbe du zigzag. Le zigzag fait le style.
C’est ainsi que le moi doit sauter dans les bras du soi. Le moi doit se charger de réduire les négativités engendrées par le soi.
Il est journaliste. C’est pour manger.
Il pense souvent au début de l’article de son ex-consœur, Dominique Allard, malheureusement décédée trop tôt – le « malheureusement » étant de trop au regard de la souffrance endurée, le décès s’apparentant en l’occurrence plutôt à une heureuse délivrance que les vivants ne peuvent comprendre, on ne dira jamais assez que ceux qui souffrent veulent en finir au plus vite, mais on ne peut décréter décemment en effet qu’un décès soit « heureusement » survenu, décence qui permet de tendre collectivement vers la vie – : sans citer littéralement ce début d’article, il s’agissait du portrait d’un homme de théâtre, mettant en scène un homme tellement soucieux de ne point être contrariant qu’il aurait pu grimper dans un bus si la porte de ce dernier s’était ouverte devant lui sans qu’il eut manifesté d’une quelconque manière l’intention d’y monter ; il aurait ainsi grimpé mécaniquement dans le bus pour éviter de contrarier le chauffeur, pour en redescendre deux à trois arrêts plus tard et revenir ainsi à pied au point de départ. Sa vie ressemble à cette belle métaphore : il monte dans des bus sans vraiment le vouloir, parce qu’ils se sont ouverts devant lui alors qu’il ne les attendait pas. Il écrit des bouts de choses dont il espère qu’ils feront leur route. Ne sachant pas écrire une histoire claire, il livre des séquences.
Il ne s’agit pas de sombrer ici dans le dolorisme. Il est né ainsi, dans une forme d’en-deçà qu’il perçoit ainsi, avec laquelle il livre un combat épique, il se demande souvent s’il suffit de vouloir devenir écrivain pour l’être ; si l’homme, finalement, n’est pas plus heureux malheureux que le contraire. Car il se fait du bien, somme toute, à se décrire barré pour l’à-peu-près, né faiblard ou mou du genou, dont le seul panache qu’il se reconnaît est d’avoir su créer une stratégie d’éviction efficace pour mener une vie dont il sait qu’elle n’est ni heureuse ni malheureuse ; vie stationnaire, inscrite dans un flux où il n’attend rien.
On écrit que sur les bas-fonds. Le bonheur, c’est un coquelicot dans un champ de printemps, c’est un mode mineur… Les gens heureux manquent de fond. Ils nous emmerdent avec leur épanouissement. Les plus grands artistes sont, tous, des ravagés du cerveau. Les gens heureux sont ennuyeux.
Sa vie consiste à éviter les obstacles qui se présentent, doué qu’il est pour auto-analyser ses faiblesses et les surmonter avec une grande maîtrise artistique, convaincu que seule l’appropriation de ses limites lui offrirait la possibilité de se sortir de ce terrible accul narcissique.
Ni boulet, ni consécration, l’envie d’écrire est une élévation proportionnée à sa satisfaction fluctuante. L’objectif inouï se dérobe avec le temps. Il a pris la mauvaise habitude de le raffermir en lisant les autres, pas les étoiles d’essence houellebecquienne bien sûr, mais le flot des livres dont l’encensement dans la presse lui paraît démesuré. Ne ressentant que très rarement de l’émerveillement pour les livres qu’il lit, il s’autorise en quelque sorte à croire que l’ajout du sien à la pile des livres moyens publiés et appelés à rejoindre rapidement les déchèteries des rêves littéraires inaboutis ne constitue en rien un véritable scandale écologique.
Il y a une émotion cynique. Le cynique montre une fausse apparence de froideur. Si le cynique ne s’aime pas, c’est parce qu’il n’est pas aimé, qu’il n’a pas trouvé les raisons de se consoler de vivre. Or, cette consolation est plus savoureuse qu’il n’y paraît. Quand la vie se débarrasse du fardeau de sa justification, quand vivre ne consiste plus à poursuivre un but, voire à la réussir, elle devient lumineuse.
Il espère seulement que le lecteur l’accompagnera le long de ce chemin escarpé. Ce fameux lecteur inidentifiable, au front d’aurochs, pour reprendre une jolie appellation du poète Jean-Roger Caussimon, perdu dans le brouillard et qui reste l’instance qui valide.
L’alcool permet parfois de tenir. Quand il garde la bouteille trop près de lui, le style prend alors le large, il ne s’interroge plus, il est dans une forme d’auto-validation immédiate, évite de revenir sur lui, les mots sont l’errance, en coalescence avec le vide bercé par l’ivresse qui place ses pas dans le trajet d’une boule de flipper. Extinction des foutaises sur le sens de la vie : les souvenirs ne se cherchent plus des trophées au cœur d’un passé dépassé par l’embellissement que produit la nostalgie. L’homme est sommé de donner une consistance plus ou moins tenable du sens de la vie qu’il a parcouru jusqu’au moment de se poser cette question, il doit, même de façon minimaliste, se forcer à croire en lui et ce d’autant plus que le monde tridimensionnel dans lequel il vit – lui et la manière dont il se porte, ce qu’il essaie d’être et ce que l’immense barnum revendicatif de la croyance en soi lui impose, cette horde de criminels en puissance qui font croire aux ratés essentiels qu’ils ont une existence à revendiquer, que leur bêtise notoire mérite d’être écoutée alors qu’eux-mêmes ont conscience d’être définitivement affectés par une vie en berne qui fort heureusement les anonymise.
L’alcool est une lune facilement décrochable, deux à trois verres suffisent à installer une station spatiale spéciale, à partir de laquelle la Terre ne tourne plus vraiment comme avant, où elle se met à danser, où la destruction que l’on s’inflige finit par avoir du sens. Pareil au golfeur sans talent perdu sur son green, errant avec ses baballes que personne ne regarde finir dans des trous rarement atteints, qui ralentit les autres… Il est ce joueur moyen que l’on ne veut pas dans son équipe mais qui prend plaisir à taquiner l’objet du désir, seul, face à un mur dont il est le seul à louer la complicité. L’autre est le mur.
Il faut être fou car c’est le long de cette frontière interstitielle que les fous deviennent ce qu’ils sont, occupant un hinterland mental dont ils définissent seuls les contours, abolissant d’un seul coup la distance entre la vraie vie, synthèse triste d’un désir rarement assouvi, et celle dont ils rêvent, qui finit par s’installer, dans la mégapole de leur petitesse. Le fou est celui qui se passe d’une quelconque validation de l’autre. Il est, dans une totalité délicieuse à voir, peu importe ce que l’autre cubiste en pense ; le fou ratiboise l’interrelation ; l’autre n’est plus, ou plutôt il est ce que le fou décide qu’il sera. Certains lui reprochent d’esthétiser la folie. Il se sent si proche d’elle, pourtant.
La folie rend possible l’accès à la supposée inaccessibilité.
Il écrit généralement le matin avec la même naïveté et, chaque fois, les mêmes questions reviennent face à cet écran chargé de bonnes intentions qu’il se force à valider sans trop y croire, sachant qu’un texte n’est jamais achevé, qu’il restera toujours dans une cinétique improbable et qu’il lui faut admettre, à rebours de l’évidence, de le « lâcher » à un moment ou un autre, pour éviter de tourner toujours en rond avec lui, pour passer un cap, quitte à laisser l’insatisfaction dans un état gazeux, plane et ébaubie, imparfaitement géniale, parfaitement délaissée. Telle une tortue retournée sur sa coque, les pattes battant l’air dans une indifférence folle, que seul le hasard repère et qui ne doit sa survie qu’à une inversion inespérée du sens du vent. Ces écrits ne sont que des commencements destinés à le rester… On n’écrit pas seulement quand ça vient car ça vient rarement ; écrire dans l’adversité produit aussi des moments étonnants. C’est mécaniquement qu’il se place devant l’écran. Il lui reste ce seul petit chemin intime : se créer une façon d’être, afin de déjouer la triste réalité qui est sienne. Un raté passera son temps à se convaincre soit qu’il ne l’est pas, soit que ce n’est pas si grave ; il a choisi la deuxième option. Il souhaite ainsi se focaliser sur la réussite de sa vie de raté, en devenant par exemple un lecteur conséquent, en faisant des maraudes avec la Croix Rouge, le soir, à discuter avec ceux tombés plus bas que lui et qui le fascinent dans leur manière de tenir (quel est le sens de la vie d’un paumé premium qui sait qu’il ne peut finir plus bas ? Quelle est la finalité de l’existence ? Ne pas se voir dépérir ? Est-ce que se poser la question n’est pas une preuve absolue d’immaturité ? Le présent, c’est le passé coagulé au futur et cherchant à s’annuler) ou en devenant le spécialiste de quelque chose : il pense naïvement que l’expert de Van Gogh, par exemple, doit mieux supporter son existence qu’un autre, que vivre sa vie à travers quelqu’un qui l’a réussie, du moins sur un plan artistique, doit être une manière de mieux se considérer. Sa vie aurait ainsi été rythmée de colloques et de séminaires consacrés à l’émotion artistique procurée par Van Gogh. A défaut d’être Van Gogh, il aurait voyagé à travers lui car on regarde toujours la vie des autres de biais, avec une forme de jouissance perverse : la vie de Van Gogh était horrible, il était le seul à ne pas savoir qu’il était Van Gogh !
Il aurait aimé s’écraser au plus bas pour voir si ça valait le coup de remonter, pour retrouver ainsi le chemin de la reconquête de soi, retrouver ses dix-huit ans bourrés de suc, d’envie, de naïveté, de cette crédulité à croire que l’on a le temps d’échouer, que l’échouage est initiatique. Il faut garder cette capacité à tout dévorer de la vie, en évitant de se plaindre de la survenue du moindre obstacle. Affecté par l’évidence d’une discontinuité, le texte cahote et se remplume au gré des paliers qu’il franchit sans s’en rendre compte.
Il tourne en rond parce que tout est facile pour lui. On le félicite même de sa médiocrité, qui s’appuie sur ses facilités de cabotinage. Il a du fric, de quoi en tout cas voir venir pour les quelques années qu’il lui reste à vivre. Et il pourrait renflouer l’acquis si ce dernier était amené à présenter des fissures. N’oubliez jamais cette évidence : le monde n’est pas médiocre dans une simple intention de jouissance perverse ; il l’est ! C’est fou ce qu’il l’est. Il ne faut pas être trop compétent pour s’en sortir, s’assurer un petit matelas financier, etc. Tout est si facile… donc médiocre.
Un soir, il a vécu une drôle de situation : il était à Bourg-en-Bresse, la veille d’un débat à animer (il adore animer les débats, il le fait d’ailleurs plutôt bien, autant le reconnaître, avec cette petite pointe d’humour qui ravit la salle, il aime animer les débats parce que ça lui évite d’écrire journalistiquement, activité qui massacre les dernières vitalités de ses liaisons synaptiques)… Il est souvent d’ailleurs à Bourg-en-Bresse et dîne généralement le soir au Café français, brasserie au charme désuet, où toute la bourgeoisie locale se montre, avec des serveurs affectés et délicats, sortis tout droit d’une belle époque.
Face à la carte de restaurant pleine de promesses – le restaurant est délicieux – il ne sut quel choix faire et fit d’ailleurs le plus mauvais, une cervelle de veau aux câpres, merveilleusement préparée mais très lourde à digérer, finissant le repas avec un ventre macérant dans une graisse de garage, tirant sur une chemise décidément désajustée à l’extension progressive de sa panse (il adore parler de son ventre). L’affaire aurait pu n’être qu’anecdotique et elle l’était foncièrement ; mais elle trotta dans sa tête des jours et des jours : et s’il était tout simplement affecté d’une incapacité à faire les bons choix ? Qu’est-ce qu’il aime au juste ? A-t-il réellement un but ? L’errance est-elle un projet ? Est-ce que sa vie n’est pas qu’une série frénétique de mauvais choix ? Comment font les autres ? Sont-ils maîtres de ce qui leur arrive ? Donner au hasard le soin de mener la danse… Apprendre à se tromper… La culpabilité le ronge, tout le temps : ses enfants, ses parents, Marco, etc. Il manque de consistance. Il ne sait pas se protéger. Il ne sait pas être dur. Il se croit responsable de tout ce qui arrive, que les autres n’y sont pour rien, il endosse tout.
Il rêve de hauteur mais ne s’élève que très rarement d’un sol aux odeurs émétiques de goudron. Les mots entrent dans le texte comme les gens le font dans une bouche de métro parisienne, têtes basses, hébétés, harassés, ramassés sur eux-mêmes, connectés à des playlists zen, la douceur musicale pour éviter la violence de la promiscuité, pressés d’écourter la durée gluante du trajet dans laquelle ils sont pris malgré eux. Il regarde les gens lire dans la sardinade, écrasés par les autres, sauvant un brio individuel dans la masse anonyme. L’écrivain restera toujours ce que l’autre en fait ; haï, l’autre est le sauveur, celui qui fait que celui qui se juge écrivassier se découvre sans savoir pourquoi dans le miroir de l’autre comme un écrivain notable. Enfin montré, le publié passe ou casse. Ça tient à rien. La cardinalité est dans la monstration (il se répète). L’encensoir médiatique sert à ça, à l’adoubement, à l’évacuation des derniers doutes ; dix critiques littéraires français incontournables chargés de désigner ceux qui peuvent quitter le camp des anonymes pour prendre un peu de lumière.
Il n’y a pas de ratés, il n’y a que des regardeurs, qui s’ignorent regardeurs !
Le style ne gambade jamais seul. Au fin fond du Vercors, le lecteur-miroir rôde toujours, le sourire moqueur, le regard carnassier et ensorceleur, raté majeur qui vote sur son portable pour valider la suite du Koh-Lanta littéraire. Ce sont les lecteurs et la masse des ratés qui sauvent l’écrivain de l’errance sur le green. Qu’est-ce qu’être écrivain ? Suffit-il d’écrire pour l’être ? Questions âpres et fugaces, stupides et essentielles. Ne pas rechercher la plénitude : elle n’existe pas et ceux qui ont cru la trouver sont aujourd’hui en hôpital psychiatrique. L’essentiel du temps, nous marchons sur des franges inauthentiques. Loin de nous-mêmes, à attendre quelque chose que l’on ne nomme jamais, les livres réécrivant toujours la même chose, parfois plus brillamment, c’est certain…





























