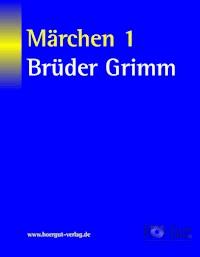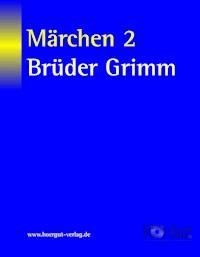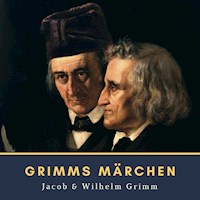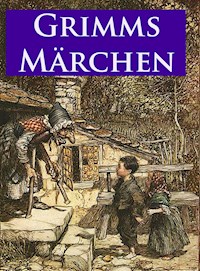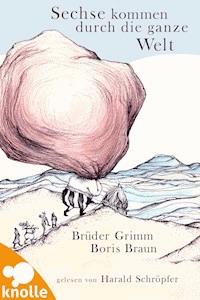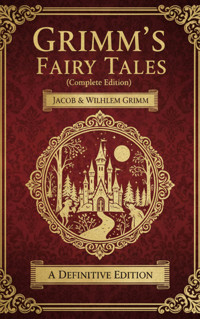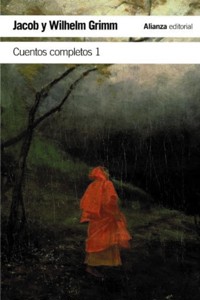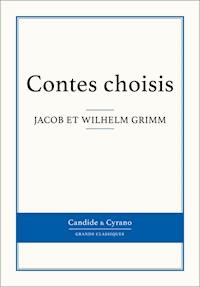
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Candide & Cyrano
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une édition de référence de Contes choisis de Jacob et Wilhelm Grimm, spécialement conçue pour la lecture sur les supports numériques.
Ce livre recueille les Contes moraux, les Petites légendes pieuses et les Contes fantastiques et contes facétieux.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le plus grand soin a été apporté à la mise au point de ce livre numérique de la collection Candide & Cyrano, afin d’assurer une qualité éditoriale et un confort de lecture optimaux.
Malgré ce souci constant, il se peut que subsistent d’éventuelles coquilles ou erreurs. Les éditeurs seraient infiniment reconnaissants envers leurs lectrices et lecteurs attentifs s’ils avaient l’amabilité de signaler ces imperfections à l’adresse [email protected].
Contes choisis
Jacob et Wilhelm Grimm
Traduits par Frédéric Baudry.
Préface du traducteur
Tout le monde sait que Charles Perrault n’a pas inventé les contes qui portent son nom, et qu’il n’a fait que les rédiger à sa manière. Les sujets qu’il a traités se transmettaient oralement de génération en génération, depuis le moyen âge. Ce qu’il avait fait pour la France à la fin du dix-septième siècle, les frères Grimm, ces Ducange de l’Allemagne, l’ont fait pour leur pays au commencement du dix-neuvième. Ils ont recueilli avec soin tous les contes, les légendes, les facéties, les apologues que la tradition avait conservés dans les campagnes allemandes. Mais Perrault, qui ne se proposait d’autre but que d’amuser ses petits-enfants, s’était permis sur le fonds légendaire des broderies galantes, conformes au goût de son temps, et inspirées par l’influence de l’Astrée. Les frères Grimm, qui voulaient faire une œuvre sérieuse d’érudition, ont traité leurs récits avec plus de discrétion et de respect. Autant que possible, ils ont écrit purement et simplement ce qu’ils avaient entendu, sans rien modifier, sauf pour mettre, comme on dit, les choses sur leurs pieds, et en poussant le scrupule jusqu’à conserver le patois dans lequel chaque histoire leur était racontée.
Tel est en effet l’état où l’archéologie est parvenue de nos jours : heureusement descendue dans des régions où elle n’avait jamais pénétré au dix-septième siècle, elle étudie le passé dans ses moindres détails ; dialectes, légendes, traditions locales, chansons, elle ne dédaigne rien, car tous les matériaux ont leur valeur pour la construction de l’édifice historique. Les contes populaires tiennent dans ce genre de recherches une place importante à plus d’un égard. Déjà plusieurs d’entre eux ont une origine certaine, et on y peut constater les modifications que l’imagination de la foule a fait subir aux faits : témoin ce sire de Retz, terreur de la Bretagne au quinzième siècle, dont la légende a fait la Barbe-Bleue ; témoin encore l’Ogre du Petit-Poucet, souvenir du nom même des Hongrois, dont les invasions épouvantèrent l’Occident.
Mais, si c’est intérêt historique se rencontre rarement, et si la plupart de ces contes ne sont que des produits de l’imagination pure, à ce point de vue encore il n’est pas moins curieux de les étudier, comme des monuments de l’état des esprits parmi les générations et dans les pays qui leur ont donné naissance. La langue populaire y a conservé tout son charme et toute sa naïveté. Dumarsais, qui allait chercher ses tropes à la halle, en eût trouvé de plus poétiques encore, s’il les avait poursuivis jusque dans les récits légendaires des campagnes.
La faculté de bien conter les légendes est un don qui n’appartient pas précisément aux plus spirituels, mais aux plus impressionnables et aux mieux doués du côté de la mémoire. C’est ordinairement chez des femmes de la campagne que cette aptitude se développe le mieux. Dans leur préface, les frères Grimm en décrivent un type remarquable :
« Nous avons eu le bonheur de connaître, au village de Niederzwehrn, près de Cassel, une paysanne à laquelle nous devons les plus beaux contes de notre second volume. C’était la femme d’un petit éleveur de bestiaux : elle était pleine encore de vigueur et n’avait guère plus de cinquante ans. Ses traits avaient quelque chose de net et d’arrêté, avec une expression agréable et intelligente ; ses grands yeux étaient clairs et perçants. Elle gardait parfaitement dans sa mémoire toutes les anciennes légendes, en avouant que cette faculté n’était pas donnée à tout le monde et que beaucoup de gens ne pouvaient pas les retenir. Elle les racontait posément, sans hésitation, avec une animation extraordinaire ; on voyait qu’elle y prenait un plaisir extrême ; quand on le lui demandait, elle répétait ses récits assez lentement pour qu’on pût les recueillir sous la dictée. Plusieurs de nos contes ont été conservés ainsi mot pour mot. Ceux qui croient que les traditions se perdent vite, et que la négligence qu’on met à les transmettre empêche qu’elles ne puissent jamais avoir une longue durée, auraient été bien détrompés s’ils avaient entendu notre conteuse, tant elle restait toujours dans les mêmes termes et veillait avec soin à leur exactitude ; jamais, en répétant un conte, elle n’y changeait rien, et, si elle s’était permis une variante, elle se reprenait aussitôt pour la corriger. Les hommes qui vivent toute leur vie de la même façon tiennent bien plus à la tradition que nous ne pouvons nous l’imaginer, nous qui changeons sans cesse. »
Si les frères Grimm, en composant cette collection, ont eu surtout l’érudition en vue, ils n’en ont pas moins réussi à faire un livre charmant, qui n’amuse pas seulement les petits enfants de leur pays. En effet, la littérature légendaire (il y a bien peu de temps qu’on s’en doute) a des mérites tout particuliers. Entièrement spontanée et naïve, elle ne contient aucune de ces prétentions personnelles, de ces exhibitions du moi artistique, de ces digressions philosophiques qui sont le fléau de la littérature de nos jours, et qui ont trouvé le moyen de se glisser jusque dans les contes pour l’enfance.
De plus, tandis que les actualités offrent toujours, par la force des choses, un mélange de bon et de mauvais où le mauvais l’emporte souvent, dans les légendes le choix est tout fait. La tradition a agi comme un crible, se délivrant de ce qui était insignifiant, et conservant seulement ce qui la frappait, ce qui éveillait à un titre quelconque l’attention de ces auditoires, dont le goût n’est pas bien épuré, il est vrai, mais aussi qui n’ont pas de complaisance. Elle a fait plus encore : elle a corrigé, poli, perfectionné ce qui était bon, jusqu’à ce qu’elle l’ait fait parvenir à un état aussi précis et aussi formulé que possible. Ceux qui examineront à fond, comme nous l’avons fait, les originaux de ces contes, seront étonnés de la perfection littéraire de leur composition. Tout y est habilement calculé et prévu ; les incidents sont amenés de longue main par des circonstances bien choisies ; le surnaturel même est, pour ainsi dire, introduit naturellement. On retrouve partout les caractères spéciaux de la poésie populaire, la symétrie, les antithèses, les répétitions dues parfois au calcul, souvent à une heureuse négligence ; quelquefois même des indications et des nuances d’une grande délicatesse ; partout enfin cette attention appliquée qui est l’esprit, comme on a dit que la patience est le génie. Par là cet art naïf des conteurs anonymes se rapproche de l’art raffiné des plus grands maîtres.
Le mouvement dramatique n’est pas moins remarquable : quoi de plus parfait à cet égard que le Pêcheur et sa femme ? Presque toujours la narration marche au plus vite et sans s’arrêter en chemin ; quelquefois elle s’amuse sur un détail en apparence inutile et insignifiant ; mais c’est ce détail qui donne au reste un cachet de réalité. L’invention pure a toujours quelque chose de vague ; la vérité observée peut seule arriver à la précision.
Les personnages ordinaires de ces contes sont les animaux parlants, et, parmi les hommes, le Tailleur loustic, le Forgeron envieux et brutal, le Géant crédule, le Nain fantasque, la Méchante sorcière, la Petite fille pieuse, etc. Les bons sentiments triomphent toujours, et l’espièglerie est le seul genre de méchanceté qui reste impuni. On y trouve un amour profond de la famille, et une autre vertu, malheureusement plus commune en Allemagne qu’en France, la douceur envers les animaux. Le génie allemand se révèle aussi dans le sentiment intime de la nature et des beautés de la campagne, qui sont souvent décrites en quelques mots avec un rare bonheur.
Toutes ces qualités, que nous détaillons avec la complaisance d’un traducteur, ne toucheraient peut-être pas beaucoup les plus jeunes d’entre nos lecteurs. Il en est une à laquelle ils seront plus sensibles qu’au pur mérite littéraire : ces récits sont toujours divertissants, pleins de gaieté, de bonhomie, de cette humour naïve qui est particulière aux Allemands.
Nous sommes loin d’avoir traduit tous les contes recueillis par le zèle infatigable des frères Grimm : nous avons fait un choix parmi les plus amusants au point de vue de l’enfance, et aussi parmi ceux qui ressemblaient le moins aux contes de fées qui circulent chez nous. Nous avons cru devoir introduire une sorte de classification, mettant d’un côté ceux qui offrent une leçon, ou au moins une impression morale bien déterminée, et aussi quelques petites légendes où se révèle un vif sentiment religieux ; et de l’autre les contes fantastiques ou facétieux qui n’ont d’autre but que d’amuser.
Tous ces récits ont été traduits aussi littéralement que possible, sauf deux petites légendes pieuses, Dieu nourrit les malheureux, et le Festin céleste, dont les éditeurs ont adouci le dénouement, parce qu’ils craignaient l’effet par trop lugubre des originaux sur l’imagination des enfants auxquels ce petit livre est destiné.
Contes moraux
Les présents des gnomes
Un tailleur et un forgeron voyageaient ensemble. Un soir, comme le soleil venait de se coucher derrière les montagnes, ils entendirent de loin le bruit d’une musique qui devenait plus claire à mesure qu’ils approchaient. C’était un son extraordinaire, mais si charmant qu’ils oublièrent toute leur fatigue pour se diriger à grands pas de ce côté. La lune était déjà levée, quand ils arrivèrent à une colline sur laquelle ils virent une foule de petits hommes et de petites femmes qui dansaient en rond d’un air joyeux, en se tenant par la main ; ils chantaient en même temps d’une façon ravissante, et c’était cette musique que les voyageurs avaient entendue. Au milieu se tenait un vieillard un peu plus grand que les autres, vêtu d’une robe de couleurs bariolées, et portant une barbe blanche qui lui descendait sur la poitrine. Les deux compagnons restaient immobiles d’étonnement en regardant la danse. Le vieillard leur fit signe d’entrer, et les petits danseurs ouvrirent leur cercle. Le forgeron entra sans hésiter : il avait le dos un peu rond, et il était hardi comme tous les bossus. Le tailleur eut d’abord un peu de peur et se tint en arrière ; mais, quand il vit que tout se passait si gaiement, il prit courage et entra aussi. Aussitôt le cercle se referma, et les petits êtres se remirent à chanter et à danser en faisant des bonds prodigieux ; mais le vieillard saisit un grand couteau qui était pendu à sa ceinture, se mit à le repasser, et quand il l’eut assez affilé, se tourna du côté des étrangers. Ils étaient glacés d’effroi ; mais leur anxiété ne fut pas longue : le vieillard s’empara du forgeron, et en un tour de main il lui eut rasé entièrement les cheveux et la barbe ; puis il en fit autant au tailleur. Quand il eut fini, il leur frappa amicalement sur l’épaule, comme pour leur dire qu’ils avaient bien fait de se laisser raser sans résistance, et leur peur se dissipa. Alors il leur montra du doigt un tas de charbons qui étaient tout près de là, et leur fit signe d’en remplir leurs poches. Tous deux obéirent sans savoir à quoi ces charbons leur serviraient, et ils continuèrent leur route afin de chercher un gîte pour la nuit. Comme ils arrivaient dans la vallée, la cloche d’un monastère voisin sonna minuit : à l’instant même le chant s’éteignit, tout disparut, et ils ne virent plus que la colline déserte éclairée par la lune.
Les deux voyageurs trouvèrent une auberge et se couchèrent sur la paille tout habillés, mais la fatigue leur fit oublier de se débarrasser de leurs charbons. Un fardeau inaccoutumé qui pesait sur eux les réveilla plus tôt qu’à l’ordinaire. Ils portèrent la main à leurs poches, et ils n’en voulaient pas croire leurs yeux quand ils virent qu’elles étaient pleines, non pas de charbons, mais de lingots d’or pur. Leur barbe et leurs cheveux avaient aussi repoussé merveilleusement. Désormais ils étaient riches ; seulement le forgeron qui, par suite de sa nature avide, avait mieux rempli ses poches, possédait le double de ce qu’avait le tailleur.
Mais un homme cupide veut toujours avoir plus que ce qu’il a. Le forgeron proposa au tailleur d’attendre encore un jour et de retourner le soir près du vieillard pour gagner de nouveaux trésors. Le tailleur refusa, disant : « J’en ai assez, et je suis content ; je veux seulement devenir maître en mon métier et épouser mon charmant objet (il appelait ainsi sa promise) ; et je serai un homme heureux. » Cependant pour faire plaisir à l’autre, il consentit à rester un jour encore.
Le soir, le forgeron prit deux sacs sur ses épaules pour emporter bonne charge, et il se mit en route vers la colline. Comme la nuit précédente il trouva les petites gens chantant et dansant ; le vieillard le rasa et lui fit signe de prendre des charbons. Il n’hésita pas à emplir ses poches et ses sacs, tant qu’il y en put entrer, s’en retourna joyeux à l’auberge et se coucha tout habillé. « Quand mon or commencera à peser, se dit-il, je le sentirai bien ; » et il s’endormit enfin dans la douce espérance de s’éveiller le lendemain matin riche comme un Crésus.
Dès qu’il eut les yeux ouverts, son premier soin fut de visiter ses poches ; mais il eut beau fouiller dedans, il n’y trouva que des charbons tout noirs. « Au moins, pensait- il, il me reste l’or que j’ai gagné l’autre nuit. » Il y alla voir ; hélas ! cet or aussi était redevenu charbon. Il porta à son front sa main noircie, et il sentit que sa tête était chauve et rase ainsi que son menton. Pourtant il ne connaissait pas encore tout son malheur : il vit bientôt qu’à la bosse qu’il portait par derrière s’en était jointe une autre par devant.
Il sentit alors qu’il recevait le châtiment de sa cupidité et se mit à pousser des gémissements. Le bon tailleur, éveillé par ses lamentations, le consola de son mieux et lui dit : « Nous sommes compagnons, nous avons fait notre tournée ensemble ; reste avec moi, mon trésor nous nourrira tous deux. »
Il tint parole, mais le forgeron fut obligé de porter toute sa vie ses deux bosses et de cacher sous un bonnet sa tête dépouillée de cheveux.
Blancheneige et Rougerose
Une pauvre veuve vivait dans une chaumière isolée ; dans le jardin qui était devant la porte, il y avait deux rosiers, dont l’un portait des roses blanches et l’autre des roses rouges. La veuve avait deux filles qui ressemblaient aux deux rosiers ; l’une se nommait Blancheneige et l’autre Rougerose. C’étaient les deux enfants les plus pieux, les plus obéissants et les plus laborieux que le monde eût jamais vus ; mais Blancheneige était d’un caractère plus tranquille et plus doux. Rougerose courait plus volontiers dans les prés et dans les champs, à la recherche des fleurs et des papillons. Blancheneige restait à la maison avec sa mère, l’aidait aux travaux du ménage, et lui faisait la lecture quand l’ouvrage était fini. Les deux sœurs s’aimaient tant, qu’elles se tenaient par la main toutes les fois qu’elles sortaient ensemble ; et quand Blancheneige disait : « Nous ne nous quitterons jamais, » Rougerose répondait : « Tant que nous vivrons ; » et la mère ajoutait : « Tout devra être commun entre vous deux. » Elles allaient souvent seules au bois pour cueillir des fruits sauvages ; les animaux les respectaient et s’approchaient d’elles sans crainte. Le lièvre mangeait dans leur main, le chevreuil paissait à leurs côtés, le cerf folâtrait devant elles, et les oiseaux perchés sur les branches voisines chantaient leurs plus jolies chansons. Jamais il ne leur arrivait rien de fâcheux : si la nuit les surprenait dans le bois, elles se couchaient sur la mousse l’une près de l’autre et dormaient jusqu’au lendemain, sans que leur mère eût aucune inquiétude.
Une fois qu’elles avaient passé la nuit dans le bois, quand l’aurore les réveilla, elles virent près d’elles un bel enfant vêtu d’une robe d’un blanc éclatant ; il attachait sur elles un regard amical, mais il disparut dans le bois sans dire un mot. Elles s’aperçurent alors qu’elles s’étaient couchées tout près d’un précipice, et qu’elles seraient tombées si elles avaient fait seulement deux pas de plus dans les ténèbres. Leur mère leur dit que cet enfant était sans doute l’ange gardien des bonnes petites filles.
Blancheneige et Rougerose tenaient la cabane de leur mère si propre qu’on aurait pu se mirer dedans. En été, Rougerose avait soin du ménage, et chaque matin sa mère trouvait à son réveil un bouquet dans lequel il y avait une fleur de chacun des deux rosiers. En hiver, Blancheneige allumait le feu et accrochait la marmite à la crémaillère, et la marmite était en cuivre jaune qui brillait comme de l’or, tant elle était bien écurée. Le soir, quand la neige tombait, la mère disait : « Blancheneige, va mettre le verrou. » Ensuite elles s’asseyaient au coin du feu ; la mère mettait ses lunettes et faisait la lecture dans un grand livre, et les deux petites écoutaient tout en filant leur quenouille. Auprès d’elles était couché un petit agneau, et derrière, une tourterelle dormait sur son perchoir, la tête sous l’aile.
Un soir qu’elles étaient réunies tranquillement, on frappa à la porte. « Rougerose, dit la mère, va vite ouvrir ; c’est sans doute quelque voyageur égaré qui cherche un abri pour la nuit. »
Rougerose alla tirer le verrou, et elle s’attendait à voir entrer un pauvre homme, quand un ours passa sa grosse tête noire par la porte entr’ouverte. Rougerose s’enfuit en poussant des cris ; l’agneau se mit à bêler, la colombe à voler par toute la chambre, et Blancheneige courut se cacher derrière le lit de sa mère. Mais l’ours leur dit : « Ne craignez rien ; je ne vous ferai pas de mal. Je vous demande seulement la permission de me chauffer un peu, car je suis à moitié gelé.
– Approche-toi du feu, pauvre ours, répondit la mère ; prends garde seulement de brûler ta fourrure. »
Puis elle appela : « Blancheneige, Rougerose, revenez ; l’ours ne vous fera pas de mal, il n’a que de bonnes intentions. »
Elles revinrent toutes deux, et peu à peu l’agneau et la tourterelle s’approchèrent aussi et oublièrent leur frayeur.
L’ours dit : « Enfants, secouez un peu la neige qui est sur mon dos ! »
Elles prirent le balai et lui nettoyèrent toute la peau ; puis il s’étendit devant le feu en faisant des grognements d’aise et de satisfaction. Elles ne tardèrent pas à se rassurer tout à fait et même à jouer avec cet hôte inattendu. Elles lui tiraient le poil ; elles lui montaient sur le dos, le roulaient dans la chambre, lui donnaient de petits coups de baguette, et, quand il grognait, elles éclataient de rire. L’ours se laissait faire ; seulement, quand le jeu allait trop loin, il leur disait : « Laissez-moi vivre ; ne tuez pas votre prétendu. »
Quand on alla se coucher, la mère lui dit : « Reste là, passe la nuit devant le feu ; au moins tu seras à l’abri du froid et du mauvais temps. »
Dès l’aurore, les petites filles lui ouvrirent la porte, et il s’en alla dans le bois en trottant sur la neige. À partir de ce jour, il revint chaque soir à la même heure ; il s’étendait devant le feu et les enfants jouaient avec lui tant qu’elles voulaient. On était tellement accoutumé à sa présence qu’on ne mettait pas le verrou à la porte avant qu’il fût arrivé.
Quand le printemps fut de retour et que tout fut vert au dehors, l’ours dit un matin à Blancheneige : « Je m’en vais et je ne reviendrai pas de l’été.
– Où vas-tu donc, cher ours ? demanda Blancheneige.
– Je vais dans le bois ; il faut que je garde mes trésors contre les méchants nains. L’hiver, quand la terre est gelée, ils sont forcés de rester dans leurs trous sans pouvoir se frayer un passage ; mais à présent que le soleil a réchauffé la terre, ils vont sortir pour aller à la maraude. Ce qu’ils ont pris et caché dans leurs trous ne revient pas aisément à la lumière ! »
Blancheneige était toute triste du départ de l’ours. Quand elle lui ouvrit la porte, il s’écorcha un peu en passant contre le loquet ; elle crut avoir vu briller de l’or sous sa peau, mais elle n’en était pas bien sûre. L’ours partit au plus vite, et disparut bientôt derrière les arbres.
Quelque temps après, la mère ayant envoyé ses filles ramasser du bois mort dans la forêt, elles virent un grand arbre abattu, et quelque chose qui s’agitait çà et là dans l’herbe près du tronc, sans qu’on pût bien distinguer ce que c’était. En approchant, elles reconnurent que c’était un petit nain au visage vieux et ridé, avec une barbe blanche longue d’une aune. La barbe était prise dans une fente de l’arbre, et le nain sautillait comme un jeune chien après une ficelle, sans pouvoir la dégager. Il fixa des yeux ardents sur les deux petites et leur cria : « Que faites-vous là plantées, plutôt que de venir à mon secours ?
– Pauvre petit homme, demanda Rougerose, comment t’es-tu ainsi pris au piège ?
– Sotte curieuse, répliqua le nain, je voulais fendre cet arbre afin d’avoir du petit bois en éclats pour ma cuisine ; car nos plats sont mignons et les grosses bûches les brûleraient ; nous ne nous crevons pas de mangeaille comme votre engeance grossière et goulue. J’avais donc déjà introduit mon coin dans le bois, mais ce maudit coin était trop glissant ; il a sauté au moment où je m’y attendais le moins, et le tronc s’est refermé si vite que je n’ai pas eu le temps de retirer ma belle barbe blanche ; maintenant elle est prise et je ne peux plus la ravoir. Les voilà qui se mettent à rire, les niaises figures de crème ! Fi ! que vous êtes laides ! »
Les enfants eurent beau se donner du mal, elles ne purent dégager la barbe, qui tenait comme dans un étau. « Je cours chercher du monde, dit Rougerose.
– Appeler du monde ! s’écria le nain de sa voix rauque ; vous êtes déjà trop de vous deux, imbéciles bourriques !
– Un peu de patience, dit Blancheneige, nous allons vous tirer d’affaire. »
Et, sortant de sa poche ses petits ciseaux, elle coupa le bout de la barbe. Dès que le nain fut libre, il alla prendre un sac plein d’or qui était caché dans les racines de l’arbre, en murmurant : « Grossières créatures que ces enfants ! couper un bout de ma barbe magnifique ! Que le diable vous récompense ! » Puis il mit le sac sur son dos, et s’en alla sans seulement les regarder.
À quelques mois de là, les deux sœurs allèrent un jour pêcher un plat de poisson. En approchant de la rivière, elles aperçurent une espèce de grosse sauterelle qui sautait au bord de l’eau comme si elle avait voulu s’y jeter. Elles accoururent et reconnurent le nain. « Qu’as-tu donc ? dit Rougerose ; est-ce que tu veux te jeter à l’eau ?
– Pas si bête, s’écria le nain ; ne voyez-vous pas que c’est ce maudit poisson qui veut m’entraîner. »
Il avait jeté sa ligne ; mais malheureusement le vent avait mêlé sa barbe avec le fil, et, quelques instants après, quand un gros poisson vint mordre à l’appât, les forces de la faible créature ne suffirent pas à le tirer de l’eau ; le poisson avait le dessus et attirait à lui le nain. Il avait beau se retenir aux joncs et aux herbes de la rive, le poisson l’entraînait et il était en danger de tomber à l’eau. Les petites arrivèrent à temps pour le retenir, et elles essayèrent de dégager sa barbe, mais ce fut en vain, tant elle était mêlée avec le fil. Il fallut encore avoir recours aux ciseaux et en couper un tout petit bout. Dès que le nain s’en aperçut, il s’écria avec colère : « Est-ce votre habitude, sottes brutes, de défigurer ainsi les gens ? Ce n’est pas assez de m’avoir écourté la barbe une première fois, il faut aujourd’hui que vous m’en coupiez la moitié ; je n’oserai plus me montrer à mes frères. Puissiez-vous courir sans souliers et vous écorcher les pieds ! » Et, prenant un sac de perles qui était caché dans les roseaux, il le traîna après lui, sans ajouter un seul mot, et disparut aussitôt derrière une pierre.
Peu de temps après, la mère envoya ses filles à la ville pour acheter du fil, des aiguilles et des rubans. Il leur fallait passer par une lande parsemée de gros rochers. Elles aperçurent un grand oiseau qui planait en l’air, et qui, après avoir longtemps tourné au-dessus de leurs têtes, tout en descendant peu à peu, finit par fondre brusquement sur le sol. En même temps, on entendit des cris perçants et lamentables. Elles accoururent et virent avec effroi un aigle qui tenait dans ses serres leur vieille connaissance le nain, et qui cherchait à l’enlever. Les petites filles, dans la bonté de leur cœur, retinrent le nain de toutes leurs forces et se débattirent si bien contre l’aigle qu’il finit par lâcher sa proie ; mais, quand le nain fut un peu remis de sa frayeur, il leur cria de sa voix glapissante : « Ne pouviez-vous pas vous y prendre un peu moins rudement ? Vous avez si bien tiré sur ma pauvre robe qu’elle est maintenant en lambeaux, petites rustres maladroites que vous êtes ! » Puis il prit son sac plein de pierres précieuses et se glissa dans son trou au milieu des rochers. Les petites étaient accoutumées à son ingratitude : elles se remirent en chemin et allèrent faire leurs emplettes à la ville.
En repassant par la lande à leur retour, elles surprirent le nain qui avait vidé devant lui son sac de pierres précieuses, ne songeant pas que personne dût passer par là si tard. Le soleil couchant éclairait les pierreries, qui lançaient des feux si merveilleux que les petites s’arrêtèrent immobiles à les considérer. « Pourquoi restez-vous là à bayer aux corneilles ? » leur dit-il ; et son visage, ordinairement gris, était rouge de colère.
Il allait continuer ses injures quand on entendit un grognement terrible, et un ours noir sortit du bois. Le nain, plein d’effroi, voulut fuir, mais il n’eut pas le temps de regagner sa cachette : l’ours lui barra le chemin. Alors, il le supplia avec un accent désespéré : « Cher seigneur ours, épargnez-moi et je vous donnerai tous mes trésors, tous ces joyaux que vous voyez devant vous. Accordez-moi la vie : que gagneriez-vous à tuer un misérable nain comme moi ? Vous ne me sentiriez pas sous vos dents. Prenez plutôt ces deux maudites petites filles ; ce sont deux bons morceaux, gras comme des cailles ; croquez-les, au nom de Dieu. » Mais l’ours, sans l’écouter, donna à cette méchante créature un seul coup de patte qui l’étendit raide mort.
Les petites s’étaient sauvées ; mais l’ours leur cria : « Blancheneige, Rougerose, n’ayez pas peur ; attendez-moi. »
Elles reconnurent sa voix et s’arrêtèrent, et, quand il fut près d’elles, sa peau d’ours tomba tout à coup et elles virent un beau jeune homme, tout revêtu d’habits dorés. « Je suis prince, leur dit-il ; cet infâme nain m’avait changé en ours, après m’avoir volé mes trésors ; il m’avait condamné à courir les bois sous cette forme, et je ne pouvais être délivré que par sa mort. Maintenant il a reçu le prix de sa méchanceté. »
Blancheneige épousa le prince et Rougerose épousa son frère ; ils partagèrent entre eux les grands trésors que le nain avait amassés dans son trou. La vieille mère vécut encore de longues années, tranquille et heureuse près de ses enfants. Elle prit les deux rosiers et les plaça sur sa fenêtre ; ils portaient chaque été les plus belles roses, blanches et rouges.
La reine des abeilles
Il y avait une fois deux fils de roi qui s’en allèrent chercher les aventures et se jetèrent dans les dérèglements et la dissipation, si bien qu’ils ne revinrent pas à la maison paternelle. Leur frère cadet, qu’on appelait le petit nigaud, se mit à leur recherche ; mais, quand il les eut retrouvés, ils se moquèrent de lui, qui, dans sa simplicité, prétendait se diriger dans un monde où ils s’étaient perdus tous deux, eux qui avaient bien plus d’esprit que lui.
S’étant mis ensemble en chemin, ils rencontrèrent une fourmilière. Les deux aînés voulaient la bouleverser pour s’amuser de l’anxiété des petites fourmis, et les voir courir de tous côtés en emportant leurs œufs ; mais le petit nigaud leur dit : « Laissez en paix ces animaux, je ne souffrirai pas qu’on les trouble. »
Plus loin ils trouvèrent un lac sur lequel nageaient je ne sais combien de canards. Les deux aînés en voulaient prendre une couple pour les faire rôtir ; mais le jeune s’y opposa en disant : « Laissez en paix ces animaux ; je ne souffrirai pas qu’on les tue. »
Plus loin encore, ils aperçurent dans un arbre un nid d’abeilles, si plein de miel qu’il en coulait tout le long du tronc. Les deux aînés voulaient faire du feu sous l’arbre pour enfumer les abeilles et s’emparer du miel. Mais le petit nigaud les retint et leur dit : « Laissez ces animaux en paix ; je ne souffrirai pas que vous les brûliez. »
Enfin les trois frères arrivèrent dans un château dont les écuries étaient pleines de chevaux changés en pierre ; on n’y voyait personne. Ils traversèrent toutes les salles et parvinrent à la fin devant une porte fermée par trois serrures. Au milieu de la porte, il y avait un petit guichet par lequel on apercevait un appartement. Ils y virent un petit homme à cheveux gris, assis devant une table. Ils l’appelèrent une fois, deux fois, sans qu’il parût entendre ; à la troisième, il se leva, ouvrit la porte et sortit au-devant d’eux ; puis sans prononcer une parole, il les conduisit à une table richement servie, et, quand ils eurent bu et mangé, il les mena chacun dans une chambre à coucher séparée.
Le lendemain matin, le petit vieillard vint à l’aîné des frères, et lui faisant signe de le suivre, il le conduisit devant une table de pierre, sur laquelle étaient écrites trois épreuves dont il fallait venir à bout pour désenchanter le château. La première était de chercher dans la mousse, au milieu des bois, les mille perles de la princesse, qu’on y avait semées ; et, si le chercheur ne les avait pas trouvées toutes avant le coucher du soleil, sans qu’il en manquât une seule, il serait changé en pierre. L’aîné passa tout le jour à chercher les perles ; mais, quand arriva le soir, il n’en avait pas trouvé plus de cent, et il fut changé en pierre, comme il était écrit sur la table. Le lendemain, le second frère entreprit l’aventure ; mais il ne réussit pas mieux que son aîné : il ne trouva que deux cents perles, et il fut changé en pierre.
Enfin vint le tour du petit nigaud. Il chercha les perles dans la mousse. Mais comme c’était bien difficile et bien long, il s’assit sur une pierre et se mit à pleurer. Il en était là, quand le roi des fourmis auquel il avait sauvé la vie, arriva avec cinq mille de ses sujets, et il ne fallut qu’un instant à ces petits animaux pour trouver toutes les perles et les réunir en un seul tas.
La seconde épreuve consistait à repêcher la clef de la chambre à coucher de la princesse, qui était au fond du lac. Quand le jeune homme approcha, les canards qu’il avait sauvés vinrent à sa rencontre, plongèrent au fond de l’eau et en rapportèrent la clef.
Mais la troisième épreuve était la plus difficile : il fallait reconnaître la plus jeune et la plus aimable d’entre les trois princesses endormies. Elles se ressemblaient parfaitement, et la seule chose qui les distinguât était qu’avant de s’endormir l’aînée avait mangé un morceau de sucre, tandis que la seconde avait bu une gorgée de sirop, et que la troisième avait pris une cuillerée de miel. Mais la reine des abeilles que le jeune homme avait sauvées du feu vint à son secours : elle alla flairer la bouche des trois princesses, et resta posée sur les lèvres de celle qui avait mangé du miel : le prince la reconnut ainsi. Alors, l’enchantement étant détruit, le château fut tiré de son sommeil magique, et tous ceux qui étaient changés en pierres reprirent la forme humaine. Le prétendu nigaud épousa la plus jeune et la plus aimable des princesses, et il fut roi après la mort de son père. Quant à ses deux frères, ils épousèrent les deux autres sœurs.
Le vieux grand-père et le petit-fils
Il était une fois un pauvre homme bien vieux, qui avait les yeux troubles, l’oreille dure et les genoux tremblants. Quand il était à table, il pouvait à peine tenir sa cuillère ; il répandait de la soupe sur la nappe, et quelquefois même en laissait échapper de sa bouche. La femme de son fils et son fils lui-même en avaient pris un grand dégoût, et à la fin ils le reléguèrent dans un coin derrière le poêle, où ils lui donnaient à manger une chétive pitance dans une vieille écuelle de terre. Le vieillard avait souvent les larmes aux yeux, et regardait tristement du côté de la table.
Un jour, l’écuelle, que tenaient mal ses mains tremblantes, tomba à terre et se brisa. La jeune femme s’emporta en reproches : il n’osa rien répondre et baissa la tête en soupirant. On lui acheta pour deux liards une écuelle de bois dans laquelle désormais on lui donnait à manger.
Quelques jours après, son fils et sa belle-fille virent leur enfant, qui avait quatre ans, occupé à assembler par terre de petites planchettes. « Que fais-tu là ? lui demanda son père.
– C’est un auget, répondit-il, pour donner à manger à papa et à maman quand ils seront vieux. »
Le mari et la femme se regardèrent un instant sans rien dire, puis ils se mirent à pleurer, reprirent le vieux grand-père à table, et désormais le firent toujours manger avec eux, sans plus jamais le rudoyer.
Le fidèle Jean
Il était une fois un vieux roi qui tomba malade. Sentant qu’il allait mourir, il fit appeler le fidèle Jean ; c’était son plus cher serviteur, et on le nommait ainsi parce que toute sa vie il avait été fidèle à son maître. Quand il fut venu, le roi lui dit : « Mon fidèle Jean, je sens que ma fin s’approche, je n’ai de souci qu’en songeant à mon fils ; il est encore bien jeune ; il ne saura pas toujours se diriger ; je ne mourrai tranquille que si tu me promets de veiller sur lui, de l’instruire de tout ce qu’il doit savoir, et d’être pour lui un second père.
– Je vous promets, répondit Jean, de ne pas l’abandonner ; je le servirai fidèlement, dût-il m’en coûter la vie.
– Je peux donc mourir en paix, dit le vieux roi. Après ma mort, tu lui feras voir tout le palais, toutes les chambres, les salles, les souterrains avec les richesses qui y sont renfermées ; seulement tu ne le laisseras pas entrer dans la dernière chambre de la grande galerie, où se trouve le portrait de la princesse du Dôme d’or. Car, s’il voit ce tableau, il ressentira pour elle un amour irrésistible qui lui fera courir les plus grands dangers. Tâche de l’en préserver. »
Le fidèle Jean réitéra ses promesses, et le vieux roi, tranquillisé, posa sa tête sur l’oreiller et expira.
Quand on eut mis le vieux roi au tombeau, Jean raconta au jeune successeur ce qu’il avait promis à son père, au lit de mort. « Je le tiendrai, ajouta-t-il, et je vous serai fidèle comme je l’ai été à votre père, dût-il m’en coûter la vie. »
Après que le grand deuil fut passé, Jean dit au roi : « Il est temps que vous connaissiez votre héritage. Je vais vous faire voir le palais de votre père. »
Il le conduisit partout, de haut en bas, et lui fit voir toutes les richesses qui remplissaient les splendides appartements, en omettant seulement la chambre où était le dangereux portrait. Il avait été placé de telle sorte que, lorsqu’on ouvrait la porte, on l’apercevait aussitôt, et il était si bien fait qu’il semblait vivre et respirer et que rien au monde n’était si beau ni si aimable. Le jeune roi vit bien que le fidèle Jean passait toujours devant cette porte sans l’ouvrir, et il lui demanda pourquoi. « C’est, répondit l’autre, parce qu’il y a dans la chambre quelque chose qui vous ferait peur.
– J’ai vu tout le château, dit le roi, je veux savoir ce qu’il y a ici ; » et il voulait l’ouvrir de force.
Le fidèle Jean le retint encore et lui dit : « J’ai promis à votre père, à son lit de mort, de ne pas vous laisser entrer dans cette chambre : il en pourrait résulter les plus grands malheurs pour vous et pour moi.
– Le malheur le plus grand, répliqua le roi, c’est que ma curiosité ne soit pas satisfaite. Je n’aurai de repos que lorsque mes yeux auront vu. Je ne sors pas d’ici que tu ne m’aies ouvert. »
Le fidèle Jean, voyant qu’il n’y avait plus moyen de s’y refuser, alla, le cœur bien gros et en soupirant beaucoup, chercher la clef au grand trousseau. Quand la porte fut ouverte, il entra le premier, tâchant de cacher le portrait avec son corps ; tout fut inutile : le roi, en se dressant sur la pointe des pieds, l’aperçut par-dessus son épaule. Mais en voyant cette image de jeune fille si belle et si brillante d’or et de pierreries, il tomba sans connaissance sur le parquet. Le fidèle Jean le releva et le porta sur son lit, tout en murmurant : « Le malheur est fait ; grand Dieu ! qu’allons-nous devenir ? » et il lui fit prendre un peu de vin pour le réconforter.
Le premier mot du roi, quand il revint à lui, fut pour demander quel était ce beau portrait. « C’est celui de la princesse du Dôme d’or, répondit le fidèle Jean.