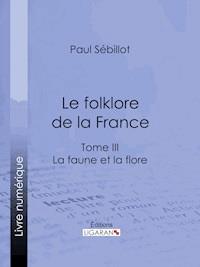Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "De même que beaucoup de ceux qui sont, ou ont été ou seront en ce monde; il y avait un roi, sa femme et leurs trois fils. Un jour que le roi était allé à la chasse, il rencontra un Tartaro : il l'emmena à son palais, l'enferma dans une écurie, et fit publier à son de trompe que tous ceux de sa cour se réuniraient le lendemain à sa demeure, qu'il leur donnerait un grand dîner, et qu'ensuite il leur montrerait un animal tel qu'ils n'avaient jamais vu son pareil."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le trésor légendaire de la France a été formé lentement, et dans cette voie nous avons été devancés par presque tous nos voisins. Tandis que partout en l’Europe on recueillait avec soin les récits populaires, chez nous on ne s’en occupait guère. Si parfois quelque lettre s’avisait d’imprimer un conte, il se croyait obliger de l’enjoliver et de lui faire subir une préparation littéraire ; les grossièretés, les défauts de goût disparaissaient sans doute ; mais ce n’était plus le récit naïf du peuple, c’était une sorte de création nouvelle. On n’osait être simple, comme l’avait été Perrault, comme le furent les frères Grimm, et l’on semblait généralement persuadé que si jadis il avait pu exister chez nous des récits merveilleux analogues à ceux que nos voisins du Nord et du Midi publiaient à l’envi, le temps de les recueillir était depuis longtemps passé.
On admettait toutefois qu’en certaines provinces reculées, on racontait encore au coin du feu : la Bretagne bretonnante passa longtemps pour le dernier refuge des conteurs. Il paraissait assez naturel qu’un pays qui avait conservé le costume d’un autre âge, qui parlait une langue réputée antique, prît encore plaisir à écouter les fables du temps passé ; mais on aurait été fortement surpris d’apprendre que les paysans en blouses et en pantalons des provinces les plus anciennement françaises conservaient l’amour du merveilleux aussi fidèlement que les hommes à bragou et à longs cheveux.
Grâce à ce préjugé les contes de Souvestre furent bien accueillis du public : c’est lui et ses imitateurs qui marquent la première période du conte populaire en France au XIX° siècle, celle qu’on pourrait qualifier de romantique. Le thème recueilli de la bouche du peuple subissait de profondes modifications : d’une fable simple on faisait une sorte de petit roman, où, au rebours de la narration populaire, les descriptions de paysage et la couleur locale jouaient un grand rôle.
Plus tard une évolution se produisit : les embellissements et les préoccupations littéraires furent laissés de côté, et l’on écouta parler le peuple pour reproduire ses récits avec une scrupuleuse fidélité. On osa être simple, ce qui est plus difficile qu’on ne croit. Il y avait d’ailleurs en France même des précédents : certains contes de Perrault ont l’allure véritablement populaire. Le Petit Chaperon rouge, par exemple, a pu être conté au jeune Perrault d’Armancour presque sous la forme que nous connaissons : l’enfant l’aura dit à son père, et, grâce à une légère et discrète mise au point, nous possédons un chef-d’œuvre de narration simple. Au siècle dernier, Restif de la Bretonne inséra dans ses Contemporaines par gradation cinq contes, qu’il avait sans doute bien écoutés, et qu’il reproduisit avec le souci du fond et de la forme qu’aurait aujourd’hui un folkloriste de profession. On en trouvera un plus loin, qui n’est pas dépaysé au milieu de ceux dont se compose ce recueil.
Stœber en Alsace, Luzel en Bretagne, furent les premiers à recueillir d’après cette méthode ; mais pendant longtemps les contes populaires français furent goûtés des seuls savants et de quelques délicats qui trouvaient à ces récits une bonne odeur de campagne et de plein air. Le public admirait la poésie des légendes du Nord, mais se refusait à l’admettre dans celles de la France. C’était à grand-peine que certaines revues voulaient bien donner une toute petite place aux écrivains qui s’étaient contentés d’être les sténographes du peuple. Quant aux éditeurs, ils connaissaient trop leur public pour se hasarder à publier des volumes de contes.
Depuis quelques années un revirement semble s’être produit : certains recueils ont eu quelque succès, et la cause des littératures populaires paraît enfin gagnée.
Maintenant que l’élan est donné, on songe un peu partout en France à recueillir des contes : ceux qui composent le présent recueil sont empruntés à plus de vingt de nos anciennes provinces. Parmi elles la Bretagne, le pays Basque et la Lorraine ont été les mieux explorées ; mais au Nord comme au Midi, à l’Est comme à l’Ouest, on a entrepris la moisson des contes. Souvent, surtout à leur début, ceux qui recueillent les récits du peuple y sont poussés par une sorte de patriotisme local, qui leur fait croire que tel ou tel d’entre eux est particulier à leur pays. C’est une illusion qui part d’un bon naturel ; mais il est bien rare de trouver des contes dont les similaires n’existent pas quelque part. S’ils n’ont pas été encore notés, ils le seront bientôt, parfois à l’autre extrémité du globe.
C’est que le fond semble commun aux peuples les plus éloignés, aux civilisations les plus différentes ; mais chaque groupe provincial ou national donne au thème primitif un développement qui lui est propre, et l’on pourrait presque dire qu’en ce sens les contes sont le miroir fidèle des vices et des vertus d’un peuple et de ses aspirations.
Si l’on excepte les récits comiques, où parfois la ruse peu scrupuleuse triomphe, chaque conte a sa part d’idéal. S’il peut paraître un peu terre à terre, cet idéal n’en existe pas moins. Pour les pauvres gens il consiste à avoir du repos à la fin de leurs jours et le pain quotidien assuré : aussi parmi les présents habituels des fées ou des divinités figure le don d’un pain inépuisable, d’une serviette magique. Quelquefois les aspirations sont plus hautes : un homme sorti du peuple, berger, marin ou soldat, devient prince ou roi ; mais presque toujours il a conquis ce haut rang par son courage ou son intelligence. Souvent le héros véritable, c’est le faible, le dernier enfant, qui vient à bout d’une entreprise dans laquelle ses aînés ou de plus forts que lui ont échoué. C’est lui qui délivre la princesse prisonnière après avoir vaincu les monstres que les rois et les guerriers ont vainement combattus. Et si les puissances supérieures lui viennent en aide, presque toujours il a mérité leur bienveillance en les respectant, alors qu’il les croyait pauvres ou vieilles. À ce point de vue, on peut dire sans paradoxe que les contes pris dans leur ensemble forment une véritable école de morale. Quelquefois même ils l’enseignent dans ce qu’elle a de plus raffiné : bien avant la loi Grammont les héros du peuple étaient bienveillants « pour les animaux du bon Dieu ».
Dans le présent Recueil, j’ai essayé de former une sorte d’anthologie des contes des provinces de France, en choisissant à la fois les types les plus populaires et les plus caractéristiques de chaque groupe. Pour cela j’ai puisé dans la plupart des recueils français, et sauf deux, tous ceux de quelque importance y sont représentés, au moins par une pièce. Souvestre n’y figure point, parce que ses contes sont avant tout littéraires, et que les arrangements de l’auteur ont parfois porté sur le fond lui-même ; le recueil de Luzel me fournissait d’ailleurs des versions plus pures et plus véritablement populaires. Bien que les contes flamands de Deulin soient d’une lecture très amusante, ils n’ont pu trouver place au milieu de récits recueillis de la bouche du peuple ; l’auteur avoue lui-même qu’ils ne sont flamands que de nom, et que, pour les compléter, il s’est assez fréquemment servi de versions étrangères.
Les savants ont émis bien des systèmes pour expliquer la quasi-universalité de la plupart des contes. Pour les uns, tout vient de l’Orient, patrie primitive de la race aryenne ; mais des doutes sont permis quand on retrouve des mythes semblables à ceux de l’Inde et de l’Europe chez des peuplades très éloignées et qui paraissent ne pas avoir eu de rapports avec ces pays. D’autres veulent que les contes soient une sorte de produit naturel qui se développe d’une manière identique chez les peuples. À un certain degré de civilisation, les mêmes objets, les mêmes aspirations, les mêmes besoins leur inspirent des mythes, qui, en raison de ce point de départ commun, présentent, sous les latitudes les plus diverses, de très grands points de similitude. La tradition orale les transmet de génération en génération, après que la faculté créatrice initiale a été perdue. C’est ainsi qu’ils se transforment quant au développement des épisodes et à la forme, les lignes générales étant conservées fidèlement.
Je n’ai ni la volonté ni le pouvoir d’essayer de trancher des questions si graves. Les contes sont pour le peuple qui les écoute et pour les lettrés qui les lisent, un amusement sans fatigue ; c’est ainsi que je les ai envisagés dans le présent Recueil, et, puisque nous sommes en plein pays légendaire, au lieu de rechercher les voies mystérieuses de leur transmission, j’aime assez à penser que tous ces récits merveilleux, terribles ou charmants, ont été imaginés par notre mère Ève pour amuser ses enfants : ceux-ci les ont transmis aux leurs, et c’est pour cela que, depuis que le monde est monde, petits et grands aiment à les entendre.
1. ALSACE.
* STŒBER.– Sœur et mi-sœur… 91
* STŒBER.– Le Compagnon tailleur… 291
* CHRISTOPHORUS.– La foire de Moos… 207
* FLAXLAND.– La tête de mort qui parle… 227
2. ANJOU.
** QUERUEAU-LAMERIE.– La fée… 171
3. AUVERGNE.
** PAULIN.– Les enfants des limbes… 194
** PAULIN.– La femme avare… 213
4. PAYS BASQUE.
* WEBSTER.– Le Tartaro reconnaissant… 3
* WEBSTER.– La Belle et la Bête… 117
* WEBSTER.– Mahistruba… 164
* WEBSTER.– Le Voleur habile… 273
VINSON.– Les douze mystères… 146
VINSON.– Le prêtre sans ombre… 241
CERQUAND.– La haie de joncs… 206
CERQUAND.– Les cinq sous des bohémiens… 217
5. BOURGOGNE.
RESTIF DE LA BRETONNE.– La marraine damnée… 261
BEAUVOIS.– Cadet Cruchon… 296
6. BRESSE.
** VINGTRINIER.– Le renard et le loup… 320
7. BASSE-BRETAGNE.
LUZEL.– La princesse de Tronkolaine… 37
LUZEL.– Le Morgan et la fille de la terre… 81
LUZEL.– Le Berger qui obtint la fille du roi… 131
LUZEL.– Jésus-Christ et le bon larron… 189
LUZEL.– La vache de la vieille femme… 209
LUZEL.– L’homme juste… 264
** LUZEL.– Les deux bossus… 243
FOUQUET.– Saint-Yves… 221
FOUQUET.– Le douanier emporté par le diable… 252
8. HAUTE-BRETAGNE.
SÉBILLOT (Paul). – Le château suspendu dans les airs… 15
SÉBILLOT – L’origine des vents… 64
** SÉBILLOT – Le navire des fées… 105
SÉBILLOT – Misère… 149
SÉBILLOT – La Sirène de la Fresnaye… 174
SÉBILLOT – Saint Pierre en voyage… 202
SÉBILLOT – Le papillon et le pauvre… 215
SÉBILLOT – Le pilote de mer… 231
SÉBILLOT – Les deux fiancés… 259
SÉBILLOT – Les Jaguens à la cour… 290
SÉBILLOT – Jeanne la Diote… 324
9. CHAMPAGNE.
MARELLE (Charles). – Le petit bonhomme Maugréant. 46
10. CORSE.
ORTOLI.– Il faut mourir… 56
ORTOLI.– La Fée amoureuse… 128
ORTOLI.– L’Anneau enchanté… 158
ORTOLI.– La mère de saint Pierre… 219
11. FOREZ.
SMITH (V.). – Le roi et ses trois fils… 143
12. GASCOGNE.
BLADÉ. – Le Prince des sept vaches… 29
BLADÉ. – Le jeune homme et la Grand-bête… 135
BLADÉ. – Le voyage de Notre-Seigneur… 195
BLADÉ. – L’innocent… 256
13. GUERNESEY.
* CLARKE (Louisa). – Histoire du p’tit Colinet… 74
14. LANGUEDOC.
MONTEL et LAMBERT.– Turlendu… 317
15. LORRAINE.
COSQUIN (E.). – Les deux soldats… 24
COSQUIN – La bourse, le sifflet et le chapeau… 112
COSQUIN – Le petit Bossu… 180
COSQUIN – Le Follet… 239
QUÉPAT.– Jean Bout d’homme… 313
16. NIVERNAIS.
** MILLIEN (Ach.). – Pourquoué qu’n’on dit que les chavans c’est du monde… 124
** MILLIEN – La fontaine rouge… 154
17. NORMANDIE.
FLEURY (Jean). – Le pays des Margriettes… 95
18. PICARDIE.
CARNOY.– Les trois frères… 66
CARNOY.– Le Souper du fantôme… 247
CROEDUR.– Trop gratter cuit… 311
19. POITOU.
POEY DAVANT (Clémentine). – La Mouété d’quêne… 281
20. PROVENCE.
* JAN DIS ESCANOURGUE.– Amen… 200
* CASCARELET (Mistral). – Le gros poisson… 306
21. QUERCY.
DEVIC (Marcel). – Le temps long… 308
22. CONTES DE MARINS.
SÉBILLOT (Paul). – Le château suspendu dans les airs… 15
SÉBILLOT – L’origine des vents… 64
** SÉBILLOT – Le navire des Fées… 105
SÉBILLOT – Le Pilote de mer… 231
* WEBSTER.– Mahistruba, le capitaine marin… 164
BEAUVOIS (E.). Contes populaires de la Norvège, de la Finlande et de la Bourgogne. Dentu, 1861, in-16.
Les contes bourguignons sont au nombre de 4.
BLADÉ (J.-F.). Contes populaires recueillis en Agenais. Paris, 1874, in-8°.
Contient 18 contes avec notes comparatives de R. Kœhler.
– Trois nouveaux contes recueillis à Lectoure. Agen, Noubel, 1880, in-8° (tiré à 50 exemplaires).
CARNOY (Il.). Littérature orale de la Picardie. Paris, Maisonneuve, 1883, petit in-12 elzévir.
Contient 58 contes.
CERQUAND.Légendes et récits populaires du pays Basque. Pau, 1876-1882, 4 fascicules in-8°.
Cette collection, accompagnée de commentaires, se compose de 110 contes : à la fin de chaque partie se trouve le texte basque.
COSQUIN.Contes populaires lorrains.
Cette collection, remarquable surtout par les commentaires et les notes comparatives qui l’accompagnent, a paru dans la Romania de 1876 à 1882. Les contes sont au nombre de 83.
FLEURY (J.). Littérature orale de la Basse-Normandie. Paris, Maisonneuve, 1883, petit in-12 elzévir.
La première partie se compose de 32 contes.
CLARKE (Louisa-Lane). Guide to Guernsey and Jersey. Guernosey, 1852, in-18.
FOUQUET (Dr). Légendes du Morbihan. Vannes, Cauderan, 1857, in-12.
Collection de 27 contes ou légendes.
LUZEL.Légendes chrétiennes de la Basse-Bretagne. Maisonneuve, 1882, 2 vol. petit in-12 elzévir.
Collection de 72 contes, quelques-uns avec commentaires.
MARELLE (Charles). Contes et chants populaires français dans Herrig’s Archiv für das Studium der neueren Sprachen. Braunschweig, 1876, v p. 363-82.
ORTOLI (J.-B.). Contes populaires de l’île de Corse. Maisonneuve, 1883, petit in-12 elzévir.
Collection de 53 contes.
MÉLUSINE.Recueil de mythologie, publié par H. Gaidoz et E. Rolland. Paris, 1878, in-4°.
SÉBILLOT (Paul). Contes populaires de la Haute-Bretagne, Ire série. Charpentier, 1880, in-18.
– Contes des paysans et des pêcheurs, 2e série des Contes populaires de la Haute-Bretagne. Charpentier, 1881, in-18.
– Contes des marins, 3e série des Contes populaires de la Haute-Bretagne. Charpentier, 1882, in-18.
Cette collection de trois volumes se compose de 200 contes environ.
SÉBILLOT (Paul). Littérature orale de la Haute-Bretagne. Maisonneuve, 1881, petit in-12 elzévir.
La première partie contient 44 contes, avec des rapprochements limités aux contes français.
– Traditions et superstitions de la Haute-Bretagne. Maisonneuve, 1882, 2 vol petit in-12 elzévir.
Contient un certain nombre de contes relatifs aux superstitions et aux animaux.
STŒBER (Auguste). Elsœssisches Volksbüchlein. Strasbourg, 1842, in-8°.
Contient dix contes en patois alsacien.
VINSON (Julien). Le Folk-Lore du pays basque. Paris, Maisonneuve, 1883, petit in-12 elzévir.
Contient 36 contes.
WEBSTER (W.). Basque legends. London, Griffith, 1877, in-8°.
Cette collection se compose de 47 contes, non compris les variantes ; quelques-uns sont accompagnés de commentaires.
(CONTE BASQUE)
De même que beaucoup de ceux qui sont, ont été ou seront en ce monde, il y avait un roi, sa femme et leurs trois fils. Un jour que le roi était allé à la chasse, il rencontra un Tartaro : il l’emmena à son palais, l’enferma dans une écurie, et fit publier à son de trompe que tous ceux de sa cour se réuniraient le lendemain à sa demeure, qu’il leur donnerait un grand dîner, et qu’ensuite il leur montrerait un animal tel qu’ils n’avaient jamais vu son pareil.
Le lendemain, deux des fils du roi jouaient à la balle contre les murailles de l’écurie où était enfermé le Tartaro ; leur balle vint à y tomber, et l’un des enfants dit au Tartaro :
– Renvoyez-moi ma balle, je vous prie.
– Oui, répondit-il, si vous voulez me délivrer.
– Oui, oui, dit l’enfant ; et le Tartaro lui renvoya sa balle. Un moment après, elle roula encore dans la prison du Tartaro ; l’enfant la lui redemanda et il répondit :
– Si vous voulez me délivrer, je vous la donnerai.
L’enfant dit : « Oui, oui », prit sa balle et sortit. Pour la troisième fois il la lança dans la prison du Tartaro ; mais celui-ci déclara qu’il ne la lui rendrait que lorsqu’il serait sorti de sa prison. L’enfant répondit qu’il n’avait pas la clé ; le Tartaro lui dit :
– Va trouver ta mère, et dis-lui de te regarder dans l’œil droit, que tu as quelque chose qui t’y fait mal ; elle a la clé dans sa poche gauche, et pendant qu’elle sera occupée tu la lui prendras.
L’enfant fit ce que le Tartaro lui avait dit : il prit la clé et le délivra ; quand le Tartaro fut sur le point de partir, l’enfant lui dit :
– Que faire maintenant de la clé ? je suis perdu.
– Non, répondit le Tartaro ; retourne à ta mère, dis-lui que ton œil gauche te fait mal ; pendant qu’elle le regardera, tu lui glisseras la clé dans la poche.
Le Tartaro lui dit, toutefois, que bientôt il aurait besoin de lui, mais qu’il n’avait qu’à l’appeler, car le Tartaro serait pour toujours son serviteur.
L’enfant alla reporter la clé ; bientôt chacun arriva pour le dîner ; lorsque les courtisans furent rassasiés, le roi leur dit de sortir avec lui parce qu’il allait leur montrer la curiosité promise. Ils l’accompagnèrent ; mais, en arrivant à l’écurie, le roi vit qu’elle était vide. Qu’on juge de sa colère et de sa honte ; il s’écria :
– Je voudrais manger le cœur, à moitié cuit et sans sel, de celui qui a laissé ma bête s’échapper !
Quelque temps après les deux frères eurent dispute en présence de leur mère, et l’un dit à l’autre :
– J’irai raconter à notre père l’affaire du Tartaro.
Quand la mère entendit cela, elle eut peur pour son fils, et lui dit :
– Prends autant d’argent que tu voudras. Et elle lui donna aussi la Fleur-de-lis, en ajoutant : – Par ce signe, tu pourras faire connaître à tout le monde que tu es fils de roi.
Petit-Yorge s’en alla loin, loin, bien loin : il dépensa et gaspilla tout son argent, et il ne savait plus comment faire. Alors il se souvint du Tartaro, et il l’appela aussitôt. Celui-ci vint, et Petit-Yorge lui dit qu’il était bien malheureux, car il n’avait pas un sou vaillant et ne savait que devenir.
Le Tartaro lui dit :
– Après avoir marché encore quelque temps, tu arriveras à une ville. Un roi y habite : tu iras à son palais, et on te prendra comme jardinier. Tu arracheras tout ce qu’il y a dans le jardin, et le lendemain tout y reviendra plus beau qu’auparavant. Il y poussera aussi trois belles fleurs ; tu les porteras aux trois filles du roi, et tu donneras la plus belle à la plus jeune.
Petit-Yorge se mit en route, ainsi que le lui avait dit le Tartaro, et alla demander si l’on avait besoin d’un jardinier : « Oui, certes, lui répondit-on, nous en avons grand besoin. » Il alla au jardin et se mit à arracher les plus beaux choux et les plus beaux poireaux. La plus jeune des filles du roi le vit et vint raconter à son père ce que faisait le jardinier ; le roi lui répondit :
– Laissez-le tranquille, nous verrons ensuite ce qu’il fera.
Et le lendemain il vit des choux et des poireaux plus beaux que tous ceux qu’il avait vus jusqu’alors. Petit-Yorge porta une fleur à chacune des filles du roi. L’aînée dit :
– J’ai une fleur que le jardinier m’a apportée, et elle n’a pas sa pareille au monde.
La cadette dit qu’elle en avait une aussi, et que jamais personne n’en avait vu de si belle. La plus jeune assura que la sienne était encore plus belle que les leurs, et les autres furent obligées d’en convenir.
La plus jeune des princesses trouvait le jardinier tout à fait à son goût, et chaque jour elle venait lui apporter son dîner. Au bout d’un certain temps elle lui dit :
– Vous devriez m’épouser.
– C’est impossible, répondit le garçon ; le roi ne voudra jamais d’un pareil mariage.
Alors la jeune fille lui dit :
– Bien ! pourtant il m’arrivera quelque chose de pis ; dans huit jours je dois être dévorée par le serpent.
Pendant huit jours elle continua à lui apporter son dîner : le soir du huitième, elle lui dit qu’elle le lui apportait pour la dernière fois, et le jeune homme lui répondit qu’elle le lui apporterait encore et que quelqu’un lui porterait secours.
Le lendemain à huit heures, Petit-Yorge sortit pour appeler le Tartaro et lui raconta ce qui était arrivé. Le Tartaro lui donna un beau cheval, des vêtements superbes et une épée, puis il lui dit d’aller à un certain endroit, d’ouvrir avec son épée la porte d’une voiture qu’il y verrait et de couper deux des têtes du serpent.
Petit-Yorge se rendit à l’endroit désigné ; il vit la jeune dame dans une voiture, et lui dit de lui ouvrir la porte. Elle lui répondit qu’elle ne le pouvait, qu’il y avait sept portes, et elle le supplia de s’en aller en disant que c’était bien assez qu’une seule personne fût dévorée.
Petit-Yorge ouvrit les portes avec son épée et s’assit à côté de la jeune dame ; il lui dit qu’il avait à l’œil quelque chose qui lui faisait mal, et la pria de voir ce que c’était ; pendant qu’elle le regardait, il coupa, sans qu’elle s’en aperçût, un morceau de chacune des sept robes qu’elle portait. Au même moment le serpent arriva et il cria :
– Au lieu d’un, j’en aurai trois à manger.
Petit-Yorge sauta sur son cheval et dit :
– Tu ne toucheras à aucun ; tu n’auras aucun de nous.
Ils commencèrent à se battre ; avec son épée, il coupa une des têtes, le cheval en coupa une autre, avec son pied ; et le serpent demanda quartier jusqu’au lendemain. Petit-Yorge prit congé de la jeune dame ; celle-ci était bien joyeuse, et elle voulait l’emmener avec elle ; mais il répondit qu’il ne le pouvait, parce qu’il avait fait vœu d’aller à Rome ; mais, ajouta-t-il, « demain mon frère viendra, et il sera aussi capable de faire quelque chose. »
La jeune dame revint au palais et Petit-Yorge à son jardin ; à midi, elle vint lui apporter son dîner et il lui dit :
– Vous voyez que ce que je vous avais prédit est arrivé ; il ne vous a pas mangée.
– Non, mais demain il me mangera. Comment pourrait-il en être autrement ?
– Non, non ! demain vous viendrez encore m’apporter mon dîner ; il vous arrivera sans doute quelque secours.
Le lendemain à huit heures, Petit-Yorge appela encore le Tartaro qui lui donna un nouveau cheval, un habillement différent, et une belle épée. À dix heures Petit-Yorge arriva à l’endroit où était la jeune dame, et il lui commanda d’ouvrir la porte ; mais elle lui répondit qu’il lui était impossible d’ouvrir quatorze portes, qu’il ferait mieux de passer son chemin, que c’était assez d’une victime, et qu’elle était peinée de le voir rester là. Mais aussitôt que Petit-Yorge eut touché les quatorze portes avec son épée, elles s’ouvrirent ; il s’assit à côté de la jeune dame, et lui dit de regarder derrière son oreille parce qu’il y avait mal. Pendant ce temps il coupa un morceau de chacune des quatorze robes que portait la princesse. Aussitôt le serpent arriva, disant d’un air joyeux :
– Je n’en mangerai pas seulement un, j’en mangerai trois.
– Pas même un seul ! répondit Petit-Yorge.
Il sauta sur son cheval et le combat commença. Le serpent faisait de terribles bonds, et la lutte fut longue ; mais, à la fin, Petit-Yorge fut vainqueur. Il coupa une des têtes, le cheval en coupa une autre avec son pied. Le serpent demanda quartier jusqu’au lendemain ; Petit-Yorge le lui accorda et le serpent s’en alla.
La jeune dame voulait emmener le jeune homme au palais pour le présenter à son père, mais il ne voulut point y consentir. Il lui dit qu’il devait aller à Rome, et qu’il était obligé de se remettre en route dès aujourd’hui, qu’il avait fait un vœu ; mais que le lendemain, il enverrait son cousin, un homme hardi, et qui n’avait peur de rien.
La jeune dame revint au palais de son père et Petit-Yorge à son jardin ; le roi était bien joyeux ; mais il ne comprenait rien à toute cette aventure. La jeune dame vint apporter le dîner du jardinier qui lui dit :
– Vous voyez que vous êtes encore revenue aujourd’hui : je vous l’avais bien dit ; et demain vous reviendrez encore.
– J’en serai bien aise, répondit la princesse.
Le lendemain matin Petit-Yorge sortit à huit heures pour appeler le Tartaro ; il lui dit qu’il restait encore trois têtes au serpent, et que pour les couper il avait besoin de toute son aide. Le Tartaro lui répondit :
– Sois tranquille, sois tranquille ; tu le vaincras.
Il lui donna un nouvel habit, plus beau que les autres, un cheval plus vigoureux, un chien terrible, une épée et une bouteille d’eau de senteur, puis il lui dit :
– Le serpent va te crier : « Ah ! si j’avais une étincelle entre ma tête et ma queue, comme je te brûlerais, toi, ta dame, ton cheval et ton chien ! » Et toi, tu lui répondras alors : « Moi, si je pouvais respirer l’eau de senteur, je couperais une de tes têtes, le cheval l’autre et le chien la troisième. » Tu donneras cette bouteille à la jeune dame qui la cachera dans son sein, et au moment où tu diras ces paroles, elle en jettera quelques gouttes sur ta tête, sur ton cheval et sur le chien.
Le jeune homme se mit en route sans peur, parce que le Tartaro l’avait rempli de confiance. Il arriva à la voiture, et la jeune dame lui dit :
– Où allez-vous ? bientôt le serpent va venir : c’est bien assez qu’il me mange toute seule.
Il lui répondit : « Ouvrez la porte. »
Elle lui dit que c’était impossible, et qu’il y avait vingt et une portes au carrosse. Il les toucha avec son épée, et elles s’ouvrirent d’elles-mêmes. Alors il lui dit en lui remettant la bouteille :
– Quand le serpent dira : « Si j’avais une étincelle entre ma tête et ma queue, je te brûlerais ! » je lui répondrai : « Et moi si j’avais sur le nez une goutte d’eau de senteur…, » alors vous prendrez la bouteille, et, à l’instant, vous en répandrez quelques gouttes sur moi.
Il la pria de regarder dans son oreille, et pendant qu’elle y jetait les yeux, il coupa un morceau de chacune des vingt et une robes dont la princesse était revêtue. Au même moment, le serpent arriva, en disant avec joie :
– Au lieu d’un seul, j’en aurai quatre à manger.
Le jeune homme lui répondit :
– À aucun prix, vous ne toucherez l’un de nous.
Il sauta sur son cheval plein d’ardeur, et ils se battirent avec plus d’acharnement que jamais. Le cheval sautait aussi haut qu’une maison, et le serpent en colère s’écria :
Si j’avais une étincelle de feu entre ma tête et ma queue, je te brûlerais, toi, ta dame, ce cheval et ce terrible chien.
Le jeune homme répondit :
– Et moi, si j’avais sur le nez une goutte de l’eau de senteur, je te couperais une de tes têtes, le cheval l’autre et le chien la troisième.
Au moment où il parlait ainsi, la jeune dame se leva, ouvrit la bouteille, et avec beaucoup d’adresse, jeta l’eau juste à l’endroit désigné. Le jeune homme coupa une tête avec son épée, le cheval en coupa une autre et le chien la troisième ; et c’est ainsi qu’ils vinrent à bout du serpent. Le jeune homme ramassa les sept langues et laissa là les têtes. Qu’on juge de la joie de la jeune dame ! Elle voulait, disait-elle, retourner tout de suite chez son père avec son sauveur, afin que son père pût aussi le remercier, puisqu’il lui devait la vie de sa fille. Mais le jeune homme répondit que cela lui était tout à fait impossible, parce qu’il fallait qu’il se trouvât à Rome avec son cousin pour accomplir le vœu qu’ils avaient fait ; mais il promit que tous les trois, à leur retour, se présenteraient au palais du roi.
La jeune dame était contrariée ; toutefois, elle alla sans perdre de temps raconter à son père ce qui était arrivé. Celui-ci fut très joyeux d’apprendre que le serpent était désormais détruit, et il fit publier dans tout le pays que celui qui avait tué le monstre pouvait se présenter avec des preuves à l’appui.
La jeune dame vint ce jour-là porter le dîner au jardinier. Il lui dit :
– Ne vous avais-je pas dit la vérité en assurant que vous ne seriez pas dévorée ? Sans doute quelqu’un a tué le serpent.
Elle lui raconta comment cela s’était passé.
Mais, hélas ! quelques jours après, se présenta un noir charbonnier qui assura que c’était lui qui avait tué le serpent et qui venait pour réclamer la récompense. Lorsque la jeune dame le vit, elle s’écria que sûrement ce n’était pas lui, que son libérateur était un beau gentilhomme à cheval, et non un vilain homme tel que lui. Le charbonnier montra les têtes du serpent, et le roi dit qu’en vérité ce devait être l’homme qui l’avait tué, et il ordonna à sa fille de l’épouser. Elle répondit qu’elle ne le voulait pas ; mais son père voulut l’y forcer en disant qu’aucun autre homme ne s’était présenté. Mais, comme sa fille ne consentait pas au mariage, pour gagner du temps, le roi fit publier dans tout le pays que celui qui avait tué le serpent devait être capable d’accomplir un autre exploit semblable ; qu’à un jour fixé, tous les jeunes gens se rassembleraient, qu’on attacherait à une cloche une bague de diamant, et que celui qui, passant au-dessous, enfilerait son épée à travers la bague, aurait certainement sa fille.
Au jour fixé, il arriva de tous côtés des jeunes gens. Notre Petit-Yorge appela le Tartaro, lui raconta ce qui se passait et lui dit qu’il avait encore besoin de lui. Le Tartaro lui donna un beau cheval, un habit superbe et une épée splendide. Petit-Yorge, ainsi équipé, vint se placer parmi les autres et se tint prêt. La jeune dame le reconnut aussitôt, et le dit à son père. Il eut la bonne fortune de prendre la bague au bout de son épée ; mais il ne s’arrêta pas là, et se mit à fuir de toute la vitesse de son cheval. Le roi et sa fille étaient à leur balcon et regardaient tous ces gentilshommes ; ils virent que le vainqueur s’en allait, elle dit à son père :
– Papa, appelle-le !
Son père lui répondit d’un ton courroucé :
– S’il s’en va, c’est sans doute qu’il ne désire pas t’épouser.
Et il lui jeta sa lance. Le jeune homme fut atteint à la jambe, mais il continua à s’enfuir. Vous pouvez vous imaginer quel chagrin avait la jeune dame.
Le lendemain, quand elle vint porter le dîner à son jardinier, elle s’aperçut qu’il avait la jambe enveloppée d’un bandage, et elle lui demanda ce qu’il avait.
Elle commençait à se douter de quelque chose, et elle vint dire à son père, que le jardinier avait la jambe enveloppée et qu’il fallait lui demander pourquoi ; car il lui avait répondu que ce n’était rien.
Le roi n’avait pas envie de s’en informer, et il lui dit qu’elle ferait bien de laisser le jardinier tranquille ; mais pour plaire à sa fille, il dit qu’il irait lui parler. Il y alla et dit au jardinier : « Qu’avez-vous ? » Celui-ci répondit qu’il s’était enfoncé une épine noire dans la jambe. Mais le roi se mit en colère, et dit qu’il n’y avait pas une seule épine noire dans tout son jardin, et qu’il voulait savoir ce qu’il avait.
Sa fille lui dit :
– Demandez-lui de nous montrer son mal.
Le jardinier découvrit sa jambe et ils furent étonnés de voir que le dard était encore dans la plaie. Le roi ne savait trop ce que penser de tout cela ; ce jardinier l’avait trompé, et il était forcé de lui donner sa fille. Mais Petit-Yorge, découvrant sa poitrine, montra la fleur-de-lis qui y était gravée. Le roi ne savait que dire ; mais la princesse s’écria :
– C’est lui mon sauveur, et je n’aurai point d’autre mari que lui.
Petit-Yorge demanda au roi d’envoyer chercher cinq tailleurs, les meilleurs de la ville, et cinq bouchers.
Le roi y consentit, et quand ils furent venus, Petit-Yorge demanda aux tailleurs si jamais ils avaient fait des habits neufs auxquels manquait un morceau, et lorsqu’ils eurent répondu non, il compta les morceaux, et les remit aux tailleurs en leur demandant si c’était comme cela qu’ils avaient livré les vêtements de la princesse.
– Certainement non, répondirent-ils.
Il se tourna alors vers les bouchers et leur demanda si jamais ils avaient tué des bêtes sans langue ? – Non, répondirent-ils. Il leur dit alors de regarder dans les têtes du serpent, et ils virent qu’il n’y avait point de langues dans les bouches ; alors il montra les langues qu’il avait coupées.
Après avoir vu tout cela, le roi n’avait plus rien à dire, et il donna sa fille à Petit-Yorge. Celui-ci le pria d’inviter son père au mariage, mais en lui disant que c’était de la part du père de la jeune fille, et il recommanda de lui servir au repas un cœur de mouton, à moitié cuit et sans sel. On fit un grand festin, et l’on plaça ce cœur devant le père de Petit-Yorge. On le laissa le découper lui-même, et il en fut très offensé. Alors son fils lui dit :
– Je m’y attendais ; et il ajouta : « Ah ! mon pauvre père, avez-vous oublié ce que vous avez dit jadis, que vous vouliez manger à moitié cuit et sans sel le cœur de celui qui avait laissé le Tartaro s’échapper ? Ceci n’est pas mon cœur, mais celui d’un mouton. Je vous l’ai fait servir pour vous rappeler ce que vous aviez dit, et me faire reconnaître à vous. »
Ils s’embrassèrent, puis ils se dirent l’un à l’autre tout ce qui leur était arrivé, et Petit-Yorge raconta tous les services que le Tartaro lui avait rendus. Son père retourna très heureux chez lui, et Petit-Yorge vécut très heureusement dans le palais du roi avec sa jeune femme, et ils ne manquèrent jamais de rien, parce qu’ils avaient toujours le Tartaro à leur service.
Traduit de W. WEBSTER.Basque Legends.
(CONTE DE MARIN)
Il était une fois un pêcheur qui possédait pour tout bien une petite cabane au bord de la mer, son bateau et ses filets. Il avait un fils qui allait avec lui à la pêche, et c’était un garçon de si bonne mine que, lorsqu’il passait, tout le monde se détournait pour le regarder. Il avait aussi trois filles presque du même âge, et toutes les trois jolies comme des jours.
Le pêcheur qui était âgé mourut ; son fils devint le chef de la famille, et à toutes les marées il allait à la pêche dans son bateau, afin de gagner de quoi donner à manger à toute sa maisonnée.
Un jour qu’il sortait pour aller à la grève, il vit devant sa porte trois beaux seigneurs qui lui demandèrent la permission d’entrer dans sa cabane pour s’y reposer quelques instants, car ils venaient de loin et ils étaient fatigués. Il y consentit très volontiers, et les reçut de son mieux. Ils s’assirent dans la cabane, et furent si frappés de la beauté des sœurs qu’ils en devinrent tous les trois amoureux. Quelques jours après, ils se marièrent avec elles, et le lendemain de la noce, les trois seigneurs, qui étaient le roi des Poissons, le roi des Oiseaux et le roi des Rats et des Souris, voulurent emmener leurs épousées dans leur royaume. Avant de quitter leur beau-frère, ils lui firent chacun un présent : deux lui donnèrent de grosses bourses pleines d’or, mais le cadeau du troisième n’était qu’une vieille tabatière ; le pêcheur la mit dans la poche de sa vareuse, sans même avoir envie de l’ouvrir, car il pensait que son beau-frère avait voulu se moquer de lui.
Le pêcheur s’ennuya fort après le départ de ses sœurs, et comme il avait la bourse bien garnie, il quitta sa cabane, s’habilla comme un bourgeois cossu et alla à Paris. Pendant deux ans il y mena joyeuse vie, car il ne manquait de rien, ayant de l’argent plein ses poches ; mais il finit tout de même par voir la fin de ses écus, et quand il n’eut plus rien que des dettes, ses amis lui tournèrent le dos, et il fut mis à la porte de sa maison. Il se souvint alors de son village et de sa petite cabane, et il résolut d’y retourner pour recommencer à mener son métier de pêcheur. Mais quand il arriva à la petite anse où il avait laissé son bateau, il ne le vit plus, car Mistrau l’avait enlevé, et il ne retrouva que son grappin et des bouts d’amarres à moitié pourris. Il entra dans sa cabane qui avait aussi bien souffert du vent et de l’hiver, et il se mit à fouiller dans les poches de sa vareuse pour voir s’il n’y découvrirait pas quelque pièce de cent sous ; mais il eut beau retourner les poches, il n’y avait même pas une pauvre pièce de deux sous : il n’y restait plus que la vieille tabatière que son beau-frère lui avait donnée. Il fut sur le point de la jeter dans un coin ; mais il pensa qu’elle contenait peut-être du tabac, et il l’ouvrit. Dès qu’il eut soulevé le couvercle, il entendit une petite voix qui disait :
– Maître, qu’y a-t-il pour votre service ?
– Ce qu’il y a pour mon service ? murmura le pêcheur bien étonné d’ouïr parler sans voir personne ; il y a beaucoup de choses ; pour le moment, je voudrais bien une table avec un bon dîner dessus.
Aussitôt se dressa devant lui une table couverte de pain et de viandes ; il y avait aussi des bouteilles de vin et même le café et l’eau-de-vie n’étaient pas oubliés. Le pêcheur, qui avait un peu jeûné depuis quelque temps, mangea de bon appétit, puis, quand il n’eut plus faim, il rouvrit sa tabatière et lui ordonna de le transporter dans la chambre où dormait la fille du roi. Aussitôt il s’éleva doucement au-dessus des nuages, comme s’il était porté sur les ailes des vents ; bientôt il fut déposé sur un lit bien souple, et il vit à côté de lui une princesse belle comme un jour, et qui dormait si tranquillement qu’on entendait à peine son souffle. Le pêcheur resta en extase à la regarder, et au matin il rouvrit sa tabatière pour retourner à sa cabane avant que la princesse fût réveillée. Pendant trois jours, il se fit servir de bons repas, et pendant trois nuits il resta à regarder la fille du roi qui dormait ; mais il ne voulait point la réveiller, de peur de l’effrayer et de lui faire de la peine.
Cependant le père de la princesse fit bannir à son de trompe dans tout son royaume et dans les pays voisins que sa fille était en âge d’être mariée, et qu’il la donnerait à celui qui lui amènerait la plus grande quantité de grains ; car la récolte avait été mauvaise et ses sujets étaient menacés de la famine. De tous côtés on vit sur les routes des charrettes chargées de grains, et dans tous les ports des navires dont la cale était remplie de blé. Le jeune pêcheur fut content d’apprendre la promesse du roi, car il pensait que, grâce à sa tabatière, il pourrait peut-être devenir le mari de la princesse qui lui plaisait tant.
Il ouvrit sa tabatière, et aussitôt il entendit la petite voix qui disait :
– Maître, qu’y a-t-il pour votre service ?
– Je voudrais des mille et des mille charrettes chargées de blé, afin que personne ne pût en amener autant que moi au palais du roi.
Aussitôt, à perte de vue, les routes furent couvertes de chariots, et le pêcheur les amena au roi qui trouva qu’à lui seul il apportait plus de grain que tous les autres ensemble. Huit jours après le pêcheur épousa la princesse, qui n’en fut point marrie, parce qu’il était joli garçon.
Le lendemain de ses noces, il ouvrit sa tabatière, et lui demanda un beau château qui devait être suspendu du ciel par quatre chaînes d’or auprès du palais de son beau-père. Aussitôt qu’il eut parlé, il vit dans le ciel un château suspendu aux nuages par quatre chaînes d’or ; il était si beau que jamais on n’avait vu son pareil, et il brillait comme s’il avait été tout en or. Quand le roi vit ce beau palais qui reluisait au soleil, il demanda à son gendre ce que cela pouvait être :
– Sire, répondit le pêcheur, c’est mon château que mes ouvriers invisibles ont bâti cette nuit au-dessus de votre jardin. Si vous voulez venir le visiter, vous verrez que rien n’y manque.
Le roi embrassa son gendre, car il était ravi de lui voir un aussi beau château, et, quand il l’eut visité de la cave au grenier, il lui proposa de faire une partie de chasse, et ils se mirent en route tous les deux.
Cependant un des anciens amoureux de la princesse entra au château suspendu par des chaînes d’or, et en le visitant, il aperçut dans un coin une vieille tabatière tout usée. Bien étonné de la voir en cet endroit, il voulut l’ouvrir pour savoir ce qu’il y avait dedans : aussitôt il entendit une petite voix qui disait :
– Maître, qu’y a-t-il pour votre service ?
– Ce qu’il y a pour mon service ? répondit le seigneur ; je veux que ce château soit transporté à plus de quatre cent cinquante lieues d’ici.
À l’instant il sentit remuer le château, et il le vit passer au-dessus des grandes forêts et des vastes mers qu’il traversait en un clin d’œil. Enfin il le vit s’arrêter au milieu d’un pays où aussi loin que la vue pouvait porter on n’apercevait âme qui vive.
En revenant de la chasse avec son beau-père, le jeune pêcheur arriva sur un tertre d’où il pensait qu’il apercevrait son château ; mais il fut bien surpris de ne plus le voir. Il tâta ses poches et n’y trouva plus sa tabatière. Quand le roi sut que le château où était sa fille avait disparu, il entra dans une grande colère et jura sa parole de roi que, si avant deux mois, son gendre ne lui ramenait pas la princesse, il le ferait écarteler par quatre chevaux.
Le pêcheur était bien triste d’avoir perdu sa femme et son château ; mais il pensa que ses beaux-frères pourraient l’aider, et il se mit en route pour aller les voir. Il commença par aller trouver le roi des Poissons ; en entrant au palais, il embrassa sa sœur qui était heureuse comme une princesse qu’elle était, puis il raconta son malheur à son beau-frère et lui demanda s’il n’avait pas entendu parler d’un château suspendu au ciel par quatre chaînes d’or.
– Non, répondit le roi des Poissons, je n’en ai pas eu connaissance ; mais attends, je pense que dans un instant je pourrai te dire où il est.
Il plongea dans la mer, et il assembla tous ses sujets, depuis la baleine jusqu’à la puce de mer, et leur demanda s’ils n’avaient point vu un château suspendu aux nuages par quatre chaînes d’or ; mais ils déclarèrent tous qu’ils en entendaient parler pour la première fois. Comme le roi finissait de les interroger, il vit arriver un vieux marsouin qui avait essuyé bien des coups de feu et bien des tempêtes.
– Et toi, marsouin, lui demanda le roi, n’as-tu pas vu le château suspendu dans les airs par quatre chaînes d’or ?
– Non, répondit-il, je ne l’ai pas vu ; mais comme je me jouais sur les vagues, j’ai rencontré un aigle qui m’a parlé d’un château suspendu par quatre chaînes d’or ; un mariage doit y être célébré dans huit jours, et on y amène tant de viandes pour les invités, que l’aigle m’a dit que jamais il n’en avait vu autant.
Le roi des Poissons remercia le vieux marsouin ; puis il sortit de la mer et vint raconter à son beau-frère ce qu’il avait appris. Le pêcheur en fut bien aise, puis il partit aussitôt pour aller voir son autre beau-frère, le roi des Oiseaux. En arrivant à son palais, il embrassa sa sœur, puis il raconta ses aventures au roi des Oiseaux et lui demanda s’il n’avait pas ouï parler d’un château suspendu dans les airs par quatre chaînes d’or. Le roi assembla ses sujets et leur demanda s’ils avaient vu le château. L’aigle répondit :
– Oui, je l’ai vu, il brille comme de l’or, et un mariage doit y être célébré dans sept jours ; ce sera une belle noce, car, dès maintenant, il y a tant de viandes de toutes sortes qu’hier j’ai pu en manger tant que j’ai voulu.
– Pourrais-tu, demanda le roi, transporter un homme jusque-là ?
– Oui, répondit l’aigle ; mais auparavant il faut que je mange beaucoup, car la route sera longue.
Pendant toute la nuit, on servit des viandes à l’aigle, et il s’en reput jusqu’à la pointe du jour. Au matin, il prit le pêcheur sur son dos et s’envola pour aller au château suspendu dans les airs par des chaînes d’or.
Durant plusieurs heures l’aigle vola au-dessus d’une grande mer, si grande qu’on n’y voyait ni terre ni île, rien que le ciel et l’eau ; mais ses forces faiblissaient, et il déposa le pêcheur sur un rocher que la marée venait de laisser à découvert, puis il partit à tire d’aile pour le château aux quatre chaînes d’or, afin de remplir de nouveau son ventre de viandes, et de pouvoir reprendre l’homme sur son dos.
Le pêcheur resta seul sur le rocher, et le temps lui semblait long, car l’aigle ne revenait point, et il savait que la mer haute couvrait le rocher. Cependant, la marée montait, montait, et il avait beau regarder de tous ses yeux, il ne voyait point revenir l’aigle. Il se mit debout sur la pointe la plus élevée du rocher ; bientôt l’eau vint l’y trouver, elle baigna ses pieds, puis son genou, elle atteignit sa taille, puis ses épaules, et il ne voyait rien venir. Au moment où la vague lui arrivait jusqu’au menton, l’aigle parut ; et, l’ayant pris sur son dos, il le déposa dans la cour du château où les noces devaient être célébrées le lendemain.
La femme du pêcheur était à sa fenêtre ; elle reconnut son mari et fut bien aise de le voir, car elle l’aimait bien, et c’était contre son gré qu’elle avait été enlevée. Elle trouva moyen de lui parler secrètement et lui dit :
– Le seigneur qui m’a enlevée ne quitte jamais la tabatière magique, et tous les soirs en se couchant, il la met sous son oreiller, de sorte qu’il est malaisé de la prendre sans l’éveiller. Il faut que l’aigle aille trouver le mari de ta troisième sœur, celui qui commande aux rats et aux souris, et qu’il lui dise d’ordonner à quelques-uns de ses sujets de venir ici. Quand le seigneur ronflera, une petite souris ira lui fourrer la queue dans sa bouche entrouverte ; alors il toussera, et pendant qu’il sera sur son séant, tu pourras reprendre la tabatière.