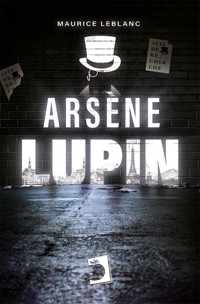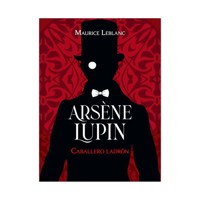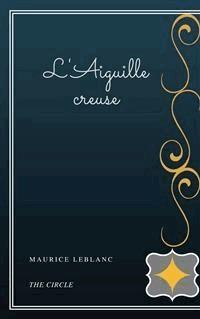0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
L’auteur de Voici des Ailes, le premier roman où la bicyclette ait joué un rôle important, naquit à Rouen, comme Flaubert dont il se réclame avec ferveur.
M. Maurice Leblanc fit ses débuts littéraires en 1893 au Gil Blas, par une série de contes qui se prolongea jusqu’en 1897, et la publication d’un roman qui eut beaucoup de succès : Une Femme.
Puis d’autres romans : Œuvre de Mort — Armelle et Claude — l’Enthousiasme — des contes très remarqués au Journal, au Figaro et dans diverses revues (les contes du Journal furent réunis en un volume qui fut très goûté : Les Lèvres jointes.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
CONTESDU SOLEIL ET DE LA PLUIE
Regroupement de
contes publiées par
Maurice LEBLANC
(Contes et articles parus entre 1902 et 1907)
© 2021 Librorium Editions
ISBN : 9782383832058
CONTES DU SOLEIL ET DE LA PLUIE
L’ENCHANTEMENT
À Madame Thérèse de Grèves,
château de Grèves.
J’étais heureuse, tu le sais, Thérèse, toi, ma meilleure amie. J’aimais bien mon mari. La situation de Charles, son nom et sa fortune me valaient dans le monde une place que plus d’une enviait. Ma vie était conforme à mes goûts et à mes rêves. Il n’y avait dans l’avenir que certitude et sécurité.
Or, hier… Mon Dieu, quand je pense que tout ce bonheur existait encore hier, et qu’aujourd’hui, je ne sais rien, je ne vois rien, j’ignore où je vais et vers qui je vais !
À l’heure dite, M. d’Argense, dont la famille a loué cette année le château voisin du nôtre, attendait en automobile devant les marches du perron. — Tu te rappelles Bertrand d’Argense, n’est-ce pas, qui m’a fait la cour cet hiver, mais une cour discrète, sans apparence de passion, accidentelle pour ainsi dire, en somme un de ces flirts comme nous en avons toutes et qui n’engagent à rien. — Je montai près de lui, un peu craintive, car c’était ma première sortie. Mon mari s’installa dans le tonneau avec le mécanicien. Mais, au dernier moment, Charles s’aperçut qu’il avait oublié son portefeuille, et il redescendit, suivi du mécanicien.
Autour de nous, pour assister à notre départ, il y avait mes tantes et mes cousines, le père et la mère de Charles, et quelques amis. On s’entendait à peine, tellement le bruit de la machine couvrait les voix. Elle haletait, comme une énorme bête, impatiente et furieuse d’être enchaînée.
⁂
Quelques minutes passèrent. L’attente m’énervait. Je murmurai :
— Comme il est long !
M. d’Argense resta silencieux, agacé sans doute aussi de ce retard. Puis je sentis qu’il me regardait, et cela me mit mal à l’aise. Il dit :
— Si nous partions sans lui ?
Je me mis à rire, mais ayant levé les yeux, j’eus un frisson. Il ne riait pas, lui ; sa figure avait une expression étrange, et comme un air d’égarement. Il était penché sur moi ainsi que sur une proie. Sa main chercha la mienne. Il répéta, d’une voix altérée :
— Si nous partions ? Si je vous enlevais ? Oui, oui, vous êtes si belle, je vous aimerais tant !… la vie serait si délicieuse !
Ma gorge se serra, un vent de folie passait sur cet homme, j’eus la vision soudaine, complète, de ce qu’il pouvait faire, de ce qu’il allait faire peut-être en un geste de démence, et je m’écriai, éperdue :
— Charles ! Charles ! viens-tu ? Dépêche-toi…
Il me regarda encore en silence, il regarda mes lèvres, mes mains, mes épaules, il regarda jusqu’au fond de mes yeux épouvantés, balbutia mon nom comme s’il cherchait à l’apprendre : Régine, Régine… puis violemment, en trois gestes résolus, tourna des choses, en leva et en baissa d’autres… Nous étions partis…
Partis ! Des appels derrière nous, la voix de Charles qui domine, les arbres du parc contre lesquels nous allons certainement nous jeter, et la grille surtout, la grille si étroite et que nous ne pourrons franchir… Oh ! j’ai peur ! À peine s’il ralentit et nous voilà dehors…
— Mais vous êtes fou ! lui dis-je, mais vous êtes fou !
Et dans un sursaut de révolte, je prends son bras pour l’arrêter. Un écart brusque… nous frôlons le mur de la ferme, à droite, puis revenons à gauche brutalement, éventrant une haie. Alors je me cache la tête entre les mains, toute courbée sur moi-même, et je ne bouge plus.
⁂
Une heure peut-être, oui, une heure a dû s’écouler de la sorte, dans cet engourdissement peureux. Je ne veux pas ouvrir les yeux, je ne veux pas réfléchir, je ne veux pas prendre conscience de l’événement invraisemblable que le hasard a produit, je ne veux pas voir… Et cependant, comme je vois bien, comme je vois clairement de mes deux yeux clos l’espace qui vole autour de moi ! Il n’y a ni arbres, ni prairies, ni champs, ni maisons, ni route, il n’y a que de l’espace, en dessus et en dessous, d’un côté et de l’autre, à l’infini, de l’espace où je suis emportée par quelque miracle incompréhensible.
Et c’est le bruit de l’espace que j’entends, ce bruit à la fois si proche et si lointain, tantôt courroucé et tantôt joyeux, paisible et surexcité, qui s’enfle, s’exaspère, se contient, et s’apaise, et S’immobilise, puis gronde, siffle, chante, se repose, se détire, repart avec des plaintes déchirantes de sirène, et s’endort en un ronflement monotone et continu. Et je suis dans ce bruit et dans cet espace comme dans une prison de rêve, une prison illimitée d’où je ne puis m’évader.
J’y songe un instant, je songe à cette fuite scandaleuse dont il est impossible que mon mari et les autres ne me croient pas complice, et je cherche les mots à dire et les gestes à faire pour m’échapper. Mais autour de moi, gardienne agile qui m’enferme dans un cercle de vide plus infranchissable qu’une enceinte de murs, court la vitesse, la vitesse désordonnée, illogique et formidable.
Et puis… et puis… oh ! Thérèse, je l’avoue, tout cela est d’une douceur qui me pénètre à la longue. Je n’ai plus ni colère ni révolte. Je voudrais seulement le supplier.
J’ai ouvert les yeux et je l’ai regardé. Il n’a pas remué depuis le départ. Il fixe l’horizon, le buste droit, les mains au volant. Son visage, si doux à l’ordinaire, est dur, presque mauvais à force de tension et de volonté implacable. Quelle est sa pensée secrète ? A-t-il un but ? Où me mène-t-il ? Est-ce contre lui-même qu’il lutte, contre ses propres hésitations et son incertitude, ou bien contre moi dont il attend les reproches et les larmes ?
Une prière expire sur mes lèvres. Toute tentative me paraît si vaine que je ne profite même pas d’un arrêt que nécessite la voiture. À quoi bon ? Il me retiendrait.
Et comme lui je regarde l’horizon. Voici des arbres, voici des prairies, et des champs, et des rivières. Voici toute la nature qui s’unit à l’espace et l’emplit de joie et d’éclat. Je reçois tout cela d’un coup, en pleine figure, comme une vague de parfums, de formes et de couleurs. Et je ne sais pas, je ne sais vraiment pas ce qui s’est passé en moi. Étrange sensation. Au premier choc, je suis bouleversée, éblouie, plus forte et plus faible à la fois, plus simple et plus complexe. Il me semble soudain que tous mes sens sont mêlés, et que je n’en ai plus qu’un, vaste et multiple, par où se précipite en moi, comme en un vase qui s’offre, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est odorant, tout ce qui est harmonieux, toute la beauté, toute la grâce et toute la fraîcheur de l’univers.
⁂
Et peut-être est-ce l’imprévu et la nouveauté de ce que j’éprouve qui agit sur moi avec le plus de violence. J’ai l’impression d’entrer dans un monde étranger où rien ne s’accomplit de la même manière, et où l’on vit d’une autre vie, merveilleuse et jamais vécue. Ce village, je l’ignorais, et celui-là aussi, et ces collines, et cette route bordée d’acacias, et j’ignorais également toutes les puissances et toutes les réserves de mon être. Je ne sais où je vais, je ne sais ce que je vais découvrir en moi et autour de moi. C’est la sensation affolante de l’inconnu. On glisse, on vole, on plane, on n’est plus soi, mais une grande force qui se meut sans effort, un nuage que le vent emporte, une vague qui roule sur l’Océan, et l’on n’en sait pas plus que le nuage ou la vague, pas plus que les forces aveugles de la nature. Qu’y a-t-il au tournant de ce chemin ? De quel royaume approchons-nous ? À quelle félicité, à quelle détresse suis-je destinée ? On ne sait rien. Le passé est mort, il n’y a que l’avenir attirant et mystérieux.
Cela devenait douloureux à la fin. Je murmurai :
— Où allons-nous ?
Il n’entendit pas, toujours immobile et impénétrable. J’aurais bien voulu pourtant qu’il me regardât et qu’il sourît. Dans ce monde nouveau, dans cette vie nouvelle de l’âme et des sens, n’était-ce pas lui qui me conduisait ? Il n’y avait que lui qui ne me fût point totalement inconnu. Il faisait partie du passé, lui ; c’était lui qui m’avait ouvert l’avenir. Pourquoi ne parlait-il pas ?
On monta une côte très longue, et l’on redescendit rapidement l’autre penchant de la montagne. En bas, au détour d’une falaise abrupte, un troupeau de bœufs nous barra la route. Pourquoi n’ai-je pas eu peur ? Aucun danger ne pouvait-il m’atteindre auprès de Bertrand ? J’admirai son adresse et son calme. Il me dépassait de toute la tête, son buste était large et vigoureux ; malgré moi, je subis la domination de son audace et de sa volonté. J’avais foi en lui pour me guider, comme en un compagnon qui conaît toutes les voies et tous les obstacles.
⁂
Le soleil se couchait. L’air devint plus léger encore et plus grisant. Caresse adorable, qui pénètre notre chair, enveloppe notre vie elle-même, et l’imprègne de jeunesse et de santé. On est comme une âme sensible et toute frémissante qui, dans une course vertigineuse à travers l’immensité, serait fécondée par l’essence même de toutes choses, par la brise la plus pure, par le rayon le plus tiède, par la source la plus claire, par l’aurore la plus ardente. Oh ! comme j’aurais voulu ouvrir mes deux bras et presser contre ma poitrine cette infinité de petites choses et de grands spectacles qui venaient s’y blottir ! Comme j’aurais voulu crier mon allégresse, rire, pleurer et chanter, avoir un souffle plus profond, une étreinte plus puissante, une âme plus accueillante ! Comme j’aurais voulu rendre en amour tout ce qui m’arrivait du dehors, et me délivrer par des paroles et par des actes de tout ce qui palpitait en moi !
Désir impossible et surhumain, effervescence de ma vie centuplée ! C’était un besoin irrésistible de quelque chose que je n’aurais su préciser, besoin de dévouement, besoin de protection, besoin d’expansion et de confiance. J’étais ivre… oui… sinon comment expliquer ?… j’étais ivre comme si j’avais goûté à quelque vin magique ; la nuit m’exaltait, je me dispersais dans l’ombre naissante et dans les lueurs expirantes du jour, je me soulevais vers les premières étoiles, je tremblais d’émotion et de tendresse, je voulais, je voulais éperdument… Et en même temps je me semblais si faible, si lasse, si fragile, si seule, que ma tête s’inclina sur l’épaule de Bertrand…
Un grand silence, un apaisement inouï, le bruit monstrueux a cessé, la force aveugle se repose. Je descends, libre enfin !
Libre ? Ah ! moins que jamais, puisque son bras entoure ma taille, et que, sans un mot, il m’entraîne dans la nuit profonde, sous les étoiles claires, et que je m’abandonne, humble, soumise, inconsciante, vaincue…
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Ma Thérèse chérie, je t’écris d’une auberge où il m’a conduite une heure plus tard. Je ne l’ai pas vu depuis hier soir, et je me demande maintenant si je n’ai pas fait un rêve, oh ! un rêve dont je ne puis renier la douceur infinie. Nous avons été fous tous deux, moi peut-être plus encore que lui. Mais pourrai-je jamais comprendre ? Ai-je obéi à un sentiment antérieur qui m’attachait à lui à mon insu ? Ou bien ne dois-je pas chercher d’autres causes que les sensations nouvelles qui m’ont troublée, anéantie, rendue incapable de toute résistance, les sensations formidables que j’ai voulu t’écrire pour que tu m’excuses, pour que tu me comprennes, au moins, toi !
Je l’attends. Il va venir, cet homme que je connais à peine et qui est mon maître. Qu’est-il ? Quelle est sa nature, quels sont ses goûts et ses désirs ? Est-ce un destin de souffrance et d’angoisse qu’il m’apporte, ou de joie, de bonheur et d’amour ? Hélas ! je ne peux même pas dire qu’il m’aime, puisque c’est par une impulsion de hasard, un geste irréfléchi qu’il m’a conquise… Et cependant, après, durant cette course invraisemblable, pourquoi m’a-t-il regardée si attentivement ? Quelle vision radieuse s’est-il formée subitement de moi et de notre avenir commun, et quelle certitude magnifique a-t-il découverte en lui, pour montrer tant d’audace, tant d’énergie et tant de volonté ?
Le voici. Il frappe à ma porte. Il entre… Thérèse ! Il est à genoux, ses mains se joignent respectueusement… Oh ! Bertrand, Bertrand…
Maurice LEBLANC
CONTES DU SOLEIL ET DE LA PLUIE
LE GLOBE-TROTTER
L’étang de la Forge, entre Rennes et Ploermel, au milieu de l’antique forêt de Brocéliande, est un des endroits les plus délicieux que je connaisse. J’étais assis là, au pied d’un sapin qui trempe dans l’eau glacée ses racines nerveuses, lorsque déboucha de la route un grand vieillard à barbe grise, couvert de haillons et porteur d’une lourde besace d’où émergeaient les ustensiles les plus divers. Il descendit sur la berge, d’un coup d’épaule jeta négligemment à terre son paquetage, se débarrassa des morceaux de toile et de laine qui lui servaient de veste et de culotte et, ainsi dévêtu, entra lentement dans l’étang.
Il en fit deux ou trois fois le tour à longues brasses rapides, revint à son point de départ et sortit. Je remarquai l’apparence extraordinairement vigoureuse de son corps aux muscles saillants et bien tendus. La marche était puissante à la fois et légère, et contribuait à lui donner un aspect vraiment surprenant de force et de souplesse.
S’étant rhabillé, il passa près de moi et me salua de la tête, mais la vue de ma bicyclette l’arrêta.
— Ah ! une bicyclette, dit-il ; c’est assez rare dans cette région.
Il la souleva, la fit tourner, puis, la reposant, me dit, non sans quelque dédain :
— C’est commode, mais il y a mieux.
L’agrément de sa voix m’étonna. Je lui demandai :
— Il y a mieux ?
— Cela, dit-il en frappant ses deux jambes.
— Cela, c’est autre chose, le plaisir n’est pas le même, les sensations diffèrent.
— Et celles de la bicyclette l’emportent, n’est-ce pas ?
Il éclata de rire.
— Vrai, vous m’amusez, vous et tous ceux d’aujourd’hui, avec vos bicyclettes et vos automobiles, et tous vos moyens de locomotion. Un de vos journaux me tombe quelquefois sous les yeux ; il y a de quoi se divertir de toutes vos belles phrases sur les touristes, sur les globe-trotters, sur les hommes de sport. On croirait, Dieu me pardonne, que vous avez découvert quelque chose de nouveau, et qu’avant vous personne ne se mouvait sous la calotte des cieux. Et votre ahurissement devant la nature, votre air de dire qu’on ne pouvait jouir de rien de tout cela au temps infortuné où il n’y avait ni pneumatiques ni moteurs ! La bonne plaisanterie ! Mais, mon petit monsieur, le premier vagabond qui a imaginé de s’en aller tendre la main de par le monde, au lieu de travailler comme une brute, celui-là en a vu plus que vous tous. Les secrets de la nature, les secrets de l’entraînement et du sport, c’est nous qui les avons, c’est moi, oui, moi, Jean Martin.
Il continua :
— Le sport pour vous autres, c’est de la distraction, des vacances, de l’extra, ou pour certains un métier. Pour moi c’est la vie elle-même, et voilà cinquante ans qu’il en est ainsi, depuis le jour béni où j’ai pu m’échapper du collège. Voilà cinquante ans que je marche, faisant huit, dix, douze lieues par jour, avec rien dans le ventre quelquefois, et couchant la nuit à la belle étoile. Est-ce de l’entraînement cela, monsieur ? Si je vous disais que je ne connais pas la limite de mes forces… Tâtez mes muscles… Le froid, le chaud, j’ignore ce que c’est. J’ai dormi dans la neige, monsieur. Et c’est une vie admirable, oui, admirable.
Il s’était penché sur moi, et ses yeux brillaient d’un éclat surprenant.
— La nature est à moi, monsieur, c’est ma mère, ma maîtresse. Pensez donc, je ne l’ai pas quittée une seconde depuis cinquante ans. Je vis en elle, dans ses bras. La nuit même ne nous sépare pas. Je l’adore. J’adore la caresse de son soleil, la morsure de sa bise, la bousculade de son vent. Je connais tous ses oiseaux, toutes ses fleurs, toutes ses étoiles, non pas par leur nom, mais pour les avoir vus et contemplés indéfiniment. Ce sont des milliers d’amis que j’ai parmi elle. Et elle est si bonne ! Chaque gorgée d’air que j’aspire, c’est une volupté, à croire qu’elle a pour moi de l’air spécial, plus pur et plus frais. Ah ! monsieur, songez au bonheur d’un homme qui aimerait une femme et dont toute la vie ne serait qu’une longue, qu’une interminable possession. C’est mon bonheur, et c’est bien celui-là que vous cherchez, n’est-ce pas, quand vous courez sur les routes ? C’est la sensation de dominer, de posséder, de pénétrer dans l’inconnu, de saisir un peu de l’immensité, de vous unir à l’espace, de vous mêler au mouvement. Heures fugitives, éclairs de joie dont vous avez à peine le temps de prendre conscience. La nature n’appartient qu’à ceux qui ont, comme moi, le loisir et la force de l’étreindre sans une minute de répit ! Et si vous saviez ce que j’éprouve ; mais c’est à devenir fou, monsieur ! Quand je marche, j’ai toujours l’impression d’aller à un rendez-vous d’amour. Chaque pas me rapproche du but. On m’attend là-bas, et je vais, je vais… Ah ! monsieur, le soir… si vous saviez, le soir… quand j’arrive à l’étape…
Il se mit à genoux, s’étendit sur l’herbe profonde, et à pleins bras, à pleine bouche, ardemment, il baisa la terre.
S’étant relevé il s’éloigna, mais il revint et me dit encore :
— La terre a de belles filles, monsieur, et je les aime aussi, et elles m’accueillent volontiers. Mes rendez-vous sont souvent de vrais rendez-vous. La femme ne dédaigne pas l’homme qui passe, quand il a des bras solides et un peu d’audace. Ah ! les femmes, j’en ai eu ma bonne part, et des plus belles et des plus jeunes. Je les cueille sur ma route comme des fleurs. C’est si bon, si doux à respirer, ces fleurs-là !
Il réfléchit et prononça :
— Peut-être n’y a-t-il rien de meilleur dans la nature… oui, peut-être… ainsi…
Et tout bas, à l’oreille, il me dit :
— Vous allez à Josselin, n’est-ce pas, monsieur ? Eh bien, descendez à l’auberge Beaumanoir, demandez l’hôtelière, une belle créature comme vous verrez, et qui passe dans le pays pour farouche aux galants, et donnez-lui des nouvelles de Jean Martin, le vagabond qu’elle est venue cette nuit retrouver dans le chemin creux…
Le soir j’étais à Josselin. Je vis l’hôtelière. C’est une belle créature, en effet, avenante et désirable. Je lui dis :
— J’ai rencontré Jean Martin…
Elle rougit, puis me regarda droit dans les yeux.
— Eh bien ! pourquoi pas ? il en vaut d’autres.
Et elle ajouta en souriant :
— Si vous le rencontrez encore, dites-lui donc de repasser par ici, l’an prochain.
Maurice LEBLANC
CONTES DU SOLEIL ET DE LA PLUIE
LA PROIE
C’est le hasard d’un voyage à bicyclette dans l’âpre et rude pays de l’Orne qui me la fit connaître. Au cœur de la vieille forêt d’Andaine, elle se trouva soudain devant moi, svelte et fine, le buste un peu penché sur son guidon, les hanches souples dans la gaine collante de la jupe. L’ayant dépassée, je vis un clair visage, heureux et souriant. Il y avait en elle une grâce très spéciale.
Vingt minutes plus tard, je pénétrais à sa suite dans la petite ville de la Ferté-Macé. Au seuil d’une des maisons en brique rose de la Grand’Place, un gros pomme, vêtu de coutil et d’alpaga, l’attendait. Elle lui jeta sa bicyclette comme à un domestique, et ils disparurent. Le soir même, j’appris à l’hôtel des Trois-Empereurs que M. Dorézy, percepteur, ne faisait pas bon ménage avec sa femme, et que Marie-Henriette Dorézy, bien que l’on ne pût rien dire sur son compte, passait pour une petite femme excentrique, autoritaire et acariâtre.
Elle n’était rien de tout cela, je le sus bientôt, une après-midi que je me risquai à l’aborder dans la forêt, après quelques jours de manœuvres et de travaux préparatoires. Et je le sus bien mieux encore lorsque quatre ou cinq promenades lui eurent donné plus de confiance et d’abandon. Je trouvai tout au contraire en elle un être de douceur, de charme et de simplicité. Elle fut très vite une amie grave et enjouée, très vite aussi une maîtresse délicieuse.
Mois adorables que ces deux mois d’été où nous courûmes comme des fous au travers du vieux pays normand, visitant ces antiques petites villes et ces manoirs légendaires dont il est paré comme de reliques précieuses, Domfront, Mortain, Argentan, Séez, et le château de Rânes, et le stupéfiant Carrouge, et la Motte-Fouquet aux eaux mystérieuses, et Couterne, et le Logis de Saint-Maurice et tant d’autres… Je n’ai peut-être pas dans ma vie d’heures plus exaltantes que celles où, ma main sur son épaule, nous roulions dans le silence troublant du crépuscule, unis par la caresse de la même brise, par l’admiration des mêmes spectacles, par l’ivresse des mêmes émotions.
Elle avançait avec un rythme régulier de ses deux jambes fines, en un mouvement à la fois fort et léger, et de l’air sérieux, d’un enfant qui s’applique. Parfois je l’arrêtais soudain, avide de baiser sur ses lèvres toute la joie et toute la fraîcheur de la nature. En vérité, je l’aimais bien. Elle m’eût rendu très heureux. Et je le savais… Alors pourquoi ?
⁂
Ce fut si brusque, si imprévu ! Je n’eus pas le temps de réfléchir, elle non plus. Nous étions assis l’un près de l’autre dans les bois qui entourent Bagnoles. Elle me disait la jalousie de son mari, ses craintes, l’humeur qu’il montrait à propos de ces promenades quotidiennes, et, tout à coup, elle poussa un cri :
— Lui… lui… le voilà… vite… partons !…
Elle était déjà à machine et s’enfuyait. J’hésitai une seconde, regardant l’homme qui s’en venait vers moi, pédalant à toutes jambes et gesticulant. Puis je sautai sur ma bicyclette et la rejoignis. Instinctivement, ma main se posa sur son épaule, en signe de possession, et aussi de promesse. C’était ma vie que j’engageais. Le gros homme ne nous rejoindrait pas. À la prochaine station, nous prenions le train, libérés.
J’eus envie de lancer vers le ciel des clameurs de triomphe. Il me semblait que j’avais conquis sur le destin une proie merveilleuse et que je l’emportais par ma seule énergie, par ma seule volonté. Je la tenais au bout de mon bras tendu en une étreinte dont la puissance n’avait pas de borne, et je me mis à ricaner :
— Qu’il vienne donc, le malheureux ! Qu’il te reprenne à moi !
Mais je n’avais pas achevé, qu’une crainte sourde fit tomber mon allégresse : on eût dit que les forces de Marie-Henriette la trahissaient. Était-ce possible ? Pour m’illusionner j’activai l’allure. Elle murmura :
— Je ne peux plus, je ne peux plus.
— Tu ne peux plus, m’écriai-je avec une certaine âpreté, ah ! ce serait drôle !
Mais comment douter ? Ne sentais-je pas la résistance de plus en plus grande qu’elle m’opposait ? C’était la surprise, la peur, l’émotion qui tuaient ses jambes, si agiles d’ordinaire et si opiniâtres. Je m’écriai :
— Un peu de courage, voyons, cela va se remettre.
Elle se courba davantage. Je la vis qui pesait alternativement de tout son poids sur chaque pédale. Moi, mon bras se raidit jusqu’à l’effort. Mais un bruit de ferraille sonna derrière nous. Je me retournai. Trente mètres au plus nous séparaient de l’homme. À sa position, je le devinai épuisé, à bout de forces, lui aussi.
Je doublai, je triplai mon effort. Les muscles de mon bras étaient comme les ressorts prêts à se rompre. L’espace aurait dû fuir sous nous. Au contraire, des arbres à droite et à gauche se déplaçaient avec une lenteur désespérante. Et l’homme gagnait…
J’étouffai un juron. Vraiment je lui en voulais, à cette femme, d’une telle défaillance, et d’autant plus qu’à mon tour et peu à peu je faiblissais, que mon étreinte s’amollissait et que mes jambes mouraient, devenaient comme des fardeaux que j’avais du mal à mouvoir. comme des choses étrangères sur lesquelles je n’avais plus ni droit ni contrôle.
Marie-Henriette balbutia :
— C’est fini… laisse-moi…
Un sursaut d’énergie me secoua. Je la soulevai, et notre élan, une seconde, fut si vif que j’eus l’impression d’ailes miraculeuses qui m’emportaient par bonds énormes. Élan passager, surexcitation nerveuse… Comment y eût-elle répondu ? Nous restâmes presque sur place. Elle me supplia :
— Arrêtons-nous, je t’en prie, je souffre.
J’eus comme une envie étrange de la brutaliser, de la battre, oui, et de lui crier des injures, ainsi qu’un charretier qui rudoye sa bête.
— Marche donc, avance… eh bien, quoi ?
Et l’autre, l’autre qui venait… Ah ! c’était ma défaite… j’étais vaincu dans ma lutte contre cet homme… Plus vigoureux et plus agile, il allait me reprendre ma proie.
— Sacré nom !… veux-tu avancer ! m’écriai-je, fou de rage impuissante, et la secouant violemment par l’épaule. Elle gémit :
— Oh ! tu me fais mal, tu me fais mal.
C’était fini. Je n’en pouvais plus. Une minute encore de combat suprême, avec le bruit de ferraille contre nous, et puis elle s’aplatit lentement de côté, sur le talus de la route, m’obligeant à descendre.
Un fracas, quelque chose qui s’écroule à nos pieds, qui se relève à demi, et qui demeure là, sur l’herbe, à genoux… C’était lui. Il haletait comme une bête à l’agonie, rouge, congestionné, les yeux en sang, de l’écume au menton. Des mots inachevés agitaient ses lèvres. Son col paraissait l’étrangler, et, de son petit bras, court comme une nageoire, il battait l’air avec des mouvements de poisson sorti de l’eau.
Près de lui Henriette suffoquait, le visage luisant de sueur et sali de poussière, les cheveux en mèches droites et tristes, la bouche contractée, les yeux. mornes, et laide, oui, vraiment laide, et disgracieuse, et mal habillée…
Nous restâmes ainsi à nous regarder, peut-être bien dix minutes, dix longues minutes absurdes et silencieuses, chacun essayant de reprendre son souffle et de rassembler ses forces éparses. Et je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui s’est passé en moi. Ce fut irréfléchi, irrésistible, immédiat, ce fut le dénouement simple, logique, fatal de la situation ridicule où nous nous trouvions : je montai sur ma bicyclette et, sans tourner la tête, je m’en allai sur la grande route, tout doucement, tout lâchement, en bon promeneur qui n’aime pas se mêler des affaires d’autrui.
Maurice LEBLANC
CONTES DU SOLEIL ET DE LA PLUIE
Monsieur Quemin, athlète
Au journal où j’ai débuté voilà tantôt dix ans, M. Quemin, employé aux écritures, était bien l’homme le plus paisible, le plus endormi, le plus veule, le plus flasque, le plus immobile qu’il fût possible de voir. Or, M. Quemin s’étant marié il y a cinq ans, ayant eu un fils l’année suivante et une fille quinze mois après, est devenu l’homme le plus énergique, le plus actif, le plus exercé, le plus averti des choses de sport que l’on puisse rencontrer.
Oui, telle est l’exacte vérité : l’existence de M. Quemin repose entièrement sur le culte du muscle. C’est une religion, de l’idolâtrie. M. Quemin a beau remplir à merveille les devoirs de sa profession, on devine aisément que son cerveau ne s’arrête pas une seconde de secréter des idées musculaires. Il le prouve d’ailleurs. Debout devant la haute table qui lui sert de pupitre, M. Quemin écrit de la main droite, et de l’autre soulève de temps en temps, et tient à bout de bras pendant quelques minutes, une chaise placée là à cet effet, et cela gravement, méthodiquement, sans se distraire de son travail, et comme si cet acte en faisait partie essentielle. Ou bien, cessant toute besogne, il colle violemment ses deux poings sur sa poitrine, les jette en l’air de toutes ses forces, tout en pliant à fond sur les deux genoux, puis se relève vivement, ramène lesdits poings contre sa poitrine, et après avoir exécuté ce petit assouplissement à diverses reprises, se remet à sa tâche. Jamais il ne consulte les grands registres sans jongler avec eux comme avec des haltères. Ses collègues parlent avec un étonnement respectueux de la massue de fer qui lui tient lieu de porte-plume et du pavé qu’il emploie en guise de presse-papier.
Mais la gloire de M. Quemin réside surtout dans ce fait que chaque jour, et quatre fois par jour, il effectue au pas gymnastique le trajet qui sépare le journal de son domicile de Passy. D’un trait, les coudes serrés au corps, le torse en avant, la tête légèrement en arrière, M. Quemin file vers l’Arc de Triomphe, dégringole le boulevard Haussmann, fonce à travers les rues Aubert et du Quatre-Septembre et, maintes fois on l’a constaté, arrive au bureau sans être essoufflé. Ses vêtements sont naturellement appropriés à ce genre de vie. Été comme hiver, un simple veston, très léger et très usé d’ailleurs. Jamais de paletot, M. Quemin ignore le froid.
⁂
J’avoue que de telles singularités ne laissèrent point de m’intriguer infiniment. Quel miracle avait pu opérer dans ce placide bonhomme une métamorphose aussi radicale ? Comment le rond-de-cuir primitif, au ventre prématuré, aux habitudes de mollusque, avait-il produit ce type étrange d’athlète bien musclé, ma foi, puissant et souple, et assez entraîné pour couvrir quotidiennement de longues distances au pas gymnastique ?
Or, dimanche dernier, j’ai rencontré M. Quemin au bois de Boulogne. Il poussait une petite voiture où dormait un enfant, et de son bras libre portait un autre enfant. Près de lui marchait une jeune femme d’aspect sympathique et de mise gracieuse. Il me salua d’un air très fier. Je l’abordai carrément, pensant que l’occasion était peut-être bonne d’en savoir plus long.
Nous causâmes. Mme Quemin est vraiment charmante, instruite et d’un tour d’esprit qui donne à sa conversation beaucoup d’agrément. Son mari l’écoute la bouche ouverte, avec des sourires ébahis. Elle s’en divertit, mais gentiment et d’une manière où l’on sent beaucoup d’affection et d’estime. S’il l’entoure de soins excessifs et la couve de ses regards extasiés, elle lui témoigne, de son côté, une sollicitude toute maternelle.
Et c’est même à ce propos que le hasard me mit sur le chemin de la vérité. On revenait vers Passy, elle me dit :
— Ne trouvez-vous pas, monsieur, que mon mari habite trop loin de son journal ? Il a beau dire, je suis sûre que c’est une corvée pour lui de faire ce trajet-là en omnibus quatre fois par jour.
— En omnibus !… m’écriai-je étonné.
— Mais oui, le Passy-Bourse quatre fois par jour, n’est-ce pas un voyage ? Cela lui donne un quart d’heure pour déjeuner.
M. Quemin déposa à terre l’enfant qu’il portait, confia la voiture à sa femme, me prit le bras et dit :
— Taisez-vous, monsieur, je vous en supplie.
— Mais l’omnibus ?…
— Je ne le prends jamais… ça ferait douze sous par jour, vingt-quatre les mois d’hiver, plus de deux cent cinquante francs par an ; j’aime autant les économiser. Seulement je ne le dis pas à ma femme, elle n’accepterait pas…
— Alors, le pas gymnastique ?
— Eh bien, voilà : j’y suis venu peu à peu, sans m’en apercevoir, pour économiser trois sous une fois, six sous l’autre, jusqu’au moment où, somme toute, j’ai vu que ce n’était pas la mer à boire.
— Et vous ne l’avez dit à personne ?
— Oh ! monsieur, on ne parle pas de ces choses-là. Pensez donc, raconter qu’on ne prend pas l’omnibus parce l’on veut tout garder pour sa femme et pour ses mioches, non, ce que l’on rirait de moi ! Alors j’ai posé pour l’athlète, pour le monsieur qui fait cela par hygiène, par entraînement, par amour du sport. Oh ! le sport, monsieur, ce que je m’en fiche !
— Mais la chaise à bout de bras, la massue de fer ?…
— C’est la conséquence. Il m’a fallu soutenir mon rôle. L’athlète ne se borne pas à courir, il a du biceps, des muscles.
— Mais le veston d’été, l’absence de paletot ?
— Un athlète n’a jamais froid. D’ailleurs ça coûte moins cher.
Et il ajouta :
— Ah ! monsieur, que ne ferait-on pas pour une créature comme celle-ci !
Il la rejoignit, lui reprit les enfants, et la regarda une seconde avec une expression de tendresse folle.
Et je compris la vie de M. Quemin, athlète par amour. Mais l’amour n’est-il pas la cause unique et profonde de tout ?
J’avais les larmes aux yeux. Ce bonhomme m’avait remué le cœur avec sa façon de dire les choses, si simple, si naïve, si noble. Je saisis les deux mains de sa femme, et lui dis d’une voix qui tremblait :
— Vous avez comme mari un homme excellent, madame, oui, un homme comme il y en a peu… Aimez-le bien, aimez-le beaucoup, il le mérite…
Maurice LEBLANC.
CONTES DU SOLEIL ET DE LA PLUIE
L’UN VERS L’AUTRE
Geneviève d’Ambleval tressaillit. Elle était descendue de bonne heure ce matin-là, son frère Paul étant arrivé la veille au château avec trois de ses amis, Hugues de Lauzay et Jacques Stirbel, deux cousins qui tous deux prétendaient officiellement à sa main, et Stéphane Ardol qu’elle avait rencontré le printemps dernier à la ville voisine, et dont l’hommage discret et respectueux l’avait profondément troublée. Or, Stéphane Ardol, debout au bas du perron, s’apprêtait à monter à bicyclette.
— Comment ! ricana-t-elle, vous faites de cela ?
— Je fais de cela, répondit-il gaîment.
— Quelle drôle d’idée ! Mais c’est un instrument tout ce qu’il y a de plus vulgaire, disgracieux, vilain, et même démodé, d’après ce que j’ai entendu dire. C’est bon pour ceux qui n’ont pas le moyen d’avoir un cheval.
— Je n’aime pas le cheval.
— Vous ne l’aimez pas !
Elle fut stupéfaite, choquée en ses idées et ses habitudes de fille noble élevée à la campagne, dans ce vieux coin de France quelque peu arriéré.
— Et vous aimez cela !
— Énormément. Ce serait pour moi une véritable peine si j’en étais privé.
— Ah ! vraiment, fit-elle, et rien ne vous y ferait renoncer ?
Elle dit ces mots avec un accent où l’on sentait de l’agression, et aussi le besoin d’essayer son pouvoir.
Il sembla étonné, puis prononça très calmement :
— Ma foi non, rien.
Elle rougit, comme si cette réponse était un défi, un refus d’obéissance ; mais, se forçant à rire, elle s’écria :
— Et vous avez bien raison ! D’ailleurs, ici, chacun est libre. Allons, ne perdez pas une minute, je ne vous retiens pas.
Et elle s’accouda au balcon de pierre pour le voir partir, avec une intention évidente de raillerie qui eût déconcerté tout autre que Stéphane. Mais, fort tranquillement, sans plus de gêne que si elle n’eût pas été là, il se mit en selle et se dirigea vers la grille à petite allure.
Jamais Geneviève ne monta à cheval avec plus de passion que pendant les jours qui suivirent. Elle y mettait une sorte d’acharnement, entraînant son frère et ses deux prétendants, leur imposant des courses folles à travers plaines, forêts et vallées, se livrant aux excentricités les plus imprudentes, sautant les obstacles, galopant des heures entières.
Le soir à table, on racontait ses prouesses. Son père la grondait de ne pas assez ménager les chevaux. Elle riait :
— Bah ! un cheval, c’est infatigable… un cheval fait tout ce qu’on lui demande.
Elle ne parlait guère à Stéphane, et semblait ne point s’occuper de lui. À peine parfois lui lançait-elle quelque pointe.
— Eh bien, nous avons roulotté aujourd’hui ?
— Mais oui, une petite promenade de digestion.
Pour lui faire plaisir autant que par conviction, ses deux prétendants dénigraient la bicyclette. Stéphane ripostait, sans jamais s’emporter, mais avec une ferveur et une sincérité qui forçaient l’attention. Elle-même se prenait à l’écouter. Souvent il sentait son regard peser sur lui. Que pensait-elle ?
Une fois, au déjeuner, elle parla d’une fleur curieuse qu’ils avaient vue la veille au col des Lautars et qu’elle regrettait de n’avoir point cueillie. Stéphane s’offrit à l’aller chercher. Elle se moqua.
— Mais, par la grand’route, il vous faudrait faire un détour énorme ! C’est horriblement loin. Nous irons directement, nous, par le raccourci, n’est-ce pas Jacques, n’est-ce pas Lauzay ?
Ils partirent à cheval, tandis que Stéphane commençait un écarté avec le père de Geneviève. Mais au col ils cherchèrent vainement la fleur.
Geneviève la trouva, le soir, à table, dans son verre. Elle dit à Stéphane :
— C’est vous, sans doute ?
— Oui.
Elle prit la fleur et la froissa sans un mot.
Un des soirs suivants, quoique un peu souffrante, elle organisa une expédition en ville pour le lendemain matin à six heures.
— J’ai perdu le collier de mon chien, il y a le pareil en ce moment chez le bijoutier, je ne veux pas qu’on me l’enlève.
Son père protesta, alléguant sa fatigue et les six lieues qui séparaient le château de la ville. Elle ne céda point.
Le lendemain matin, à six heures, au moment où elle s’apprêtait, sa femme de chambre lui apporta un paquet. Elle l’ouvrit, c’était le collier neuf.
On eût dit que ces attentions l’irritaient ainsi que des leçons infligées à son orgueil par un orgueil plus fort. Elle se sentait humiliée, et devint de plus en nerveuse, volontaire et d’humeur inégale. Ce qui l’exaspérait par-dessus tout, c’était le calme de Stéphane. Elle ne pouvait s’empêcher de rendre justice à sa dignité et à sa courtoisie parfaite dans ce milieu qui lui était nettement hostile et dont toutes les idées contrastaient avec les siennes. En outre, elle le trouvait plus simple d’allures, moins tapageur et moins poseur en sa tenue de cycliste que ses deux prétendants. Ceux-là lui semblaient lourds auprès de lui. Ils avaient cette morgue des cavaliers auxquels on croirait que le fait d’avoir des bottes, des éperons qui sonnent et une cravache confère le privilège de parler plus haut et de faire du bruit en marchant,
Elle devait choisir entre eux deux cependant, son père l’en pressait, et elle ne pouvait tarder davantage, s’étant engagée à prendre une résolution au cours de l’été.
Le départ approchait. Jacques Stirbel lui demanda carrément une réponse. Elle ne savait pas, elle hésitait, indécise et anxieuse.
Un matin elle chevauchait dans la forêt, quand elle rencontra Stéphane à bicyclette,. Contrairement à son habitude en ces cas-là, elle ne l’évita point. Elle se mit à trotter près de lui, ralentissant parfois, puis rattrapant son retard.
Au bout d’une heure ils s’arrêtèrent et descendirent. Ils n’avaient pas échangé un mot. Quelques minutes encore ils restèrent silencieux sous la voûte des arbres et dans la grande paix de la nature, et elle lui dit :
— Il faut que je vous apprenne mon mariage.
— Ah ! fit-il.
— Oui, mon père veut que je choisisse entre Jacques et Lauzay.
— Et qui choisissez-vous ?
Je ne sais pas… Donnez-moi un conseil… Qui dois-je épouser ?
Il la regarda dans les yeux longuement, et d’une voix douce murmura :
— Moi, Geneviève.
Elle fondit en larmes, vaincue soudain et dominée par cet homme qu’elle aimait. Mais, essayant de résister :
— Pourtant, Stéphane, dit-elle, nous sommes si loin de nous comprendre… Nos goûts sont si différents !…
Il lui prit les mains avec une tendresse un peu autoritaire.
— Enfant que vous êtes, vous pensez encore à cette petite querelle du premier jour !
Elle fit la moue :
— Vous avez mis tant d’obstination à faire une chose qui me déplaisait.
— Ah ! Geneviève, soyons plus graves l’un et l’autre. Il faut respecter ceux que l’on aime jusque dans les plus petites choses, jusque dans leurs goûts les plus insignifiants, fussent-ils entièrement différents des nôtres. Notre goût plus ou moins violent pour la bicyclette ou pour le cheval, cela ne compte pas, n’est-ce pas ? c’est une misère, et, pour ma part, je vous sacrifierais bien davantage, mais il y a sûrement d’autres goûts qui diffèrent en nous, et de plus sérieux. Eh bien, acceptons-les. Ce sont peut-être les différences de caractères et d’habitudes qui rendent agréable la vie commune.
Elle se mit à rire.
— Oui, vous venez de voir comme c’est drôle, la vie commune ainsi comprise : l’un roule, l’autre galope, et on ne se dit pas un mot.
— On ne s’entend que mieux, Geneviève. Et puis ce ne sont pas, comme vous le croyez, nos natures qui différent, mais certains côtés de ces natures. Ainsi, vous préférez le cheval, moi la bicyclette, mais nous aimons tous deux le mouvement, le grand air, l’espace, l’odeur des forêts, la couleur des horizons, et c’est là l’essentiel. Le reste est affaire de goûts, et puisque je vous aime et que vous m’aimerez, nous en trouverons bien un troisième qui nous sera commun.
— L’automobile, peut-être, dit-elle en lui tendant la main.
Maurice LEBLANC.
CONTES DU SOLEIL ET DE LA PLUIE
Les Deux Monstres
Ce fut, certes, le match le plus étrange, le plus macabre et le plus passionnant…
Au bas de la grand’route qui descend de la ville de Saint-Jores à la rivière, il y a une vieille église romane, Notre-Dame-sur-l’Eau, célèbre dans le pays comme lieu de pèlerinage. Criquioche, cul-de-jatte, était mendiant attitré à la porte de cette église.
Chaque matin, Criquioche arrivait bruyamment dans un superbe sans-ressort attelé en poste de deux magnifiques lévriers russes mâtinés de roquet. Il conduisait à double corde et d’une main, l’autre tenant par prudence un frein automatique composé d’un sabot à garniture de clous. Tout cela était de bonne tenue et sentait l’aisance, le bien-être du monsieur dont le lendemain, tout au moins, est assuré. De fait, la place était excellente, tous les fidèles devant passer par là. Il leur souriait et les saluait du buste, les sous pleuvaient.
Or, il advint un beau jour qu’à trois mètres de Criquioche, sur la marche inférieure du parvis, un concurrent s’installa, et qui plus est, un cul-de-jatte. Il est vrai que l’intrus ne jouissait, pour tout attelage, que d’une boîte à roues de fer traînée par un misérable caniche. Mais, outre que cela lui donnait un air bien propre à inspirer la pitié, n’avait-il pas choisi sa place de manière à ce que l’on passât d’abord devant lui ! Criquioche en fit la dure expérience : sa recette du matin diminua des trois quarts,
Furieux, il apostropha le nouveau venu. Vitcoq — c’était son nom — exhiba, sans mot dire, une autorisation signée de l’archevêché.
⁂
Le lendemain Criquioche, au lieu de venir à sept heures, selon son habitude, vint une heure plus tôt et prit la place de Vitcoq. La recette fut bonne, mais, le surlendemain, quand il arriva, Vitcoq était là. La récolte fut dérisoire.
Dès lors, ce fut un duel de chaque jour. Qui arriverait le premier ? Cinq heures et demie, cinq heures, quatre Heures et demie, quatre heures… il n’y eut pas de limites. Et, il faut bien le dire, dans cette lutte acharnée, c’était Vitcoq, plus matinal et plus résolu, qui remportait les avantages les plus fréquents.
Criquioche enrageait. Il n’y avait point 1à qu’une question de gros sous, et Dieu sait cependant si les conditions matérielles de sa vie avaient changé — on le voyait assez à sa tenue moins soignée, à ses chiens moins gras — il y avait aussi une question d’amour-propre. Il lui semblait qu’on l’avait délogé d’un poste en quelque sorte officiel. Il n’était plus rien. Vitcoq prenait sa place et le narguait.
Situation intolérable qui provoquait des querelles incessantes et un duel d’injures presque ininterrompu. Cela ne pouvait durer. Les deux hommes en seraient tombés malades. D’un commun accord, ils prirent comme arbitre Malatiré, le manchot qui exerçait en face, à la porte du marchand de cierges.
Malatiré conseilla, un match (il prononçait metch, comme les Anglais, disait-il).
— Oui, un metch. Vous habitez tous deux au haut de Saint-Jores. Eh bien, une supposition : demain matin, à cinq heures, vous vous alignez sur la place, et le premier museau de chien qui s’amène ici décidera du gagnant. Moi, je serai juge à l’arrivée, ça vous va-t-il ?
Criquioche accepta d’emblée. Il avait dépassé bien souvent Vitcoq dont le lamentable caniche s’arrêtait tous les cent mètres, exténué, et se couchait à terre. Pourtant Vitcoq accepta aussi, en riant.
Et le lendemain, à six heures, les deux culs-de-jatte s’alignaient sur la place de Saint-Jores.
⁂
Une, deux, trois !… Sur cent mètres, Criquioche en prit vingt à Vitcoq. Cinq minutes après, il gagnait le haut de la côte et l’attaquait hardiment. Ce fut vraiment beau de le voir descendre à fond de train, sans aucun souci de prudence. Dressé sur la pointe extrême de son derrière, il avait l’air d’un Romain sur son char de course.
Le premier tournant s’effectua à merveille, le second aussi ; au troisième, il aperçut les clochetons de l’église, distingua le porche, Malatiré. De Vitcoq il n’était plus question. Heureusement, car ses chiens commençaient à faiblir… Et, tout à coup, ayant tourné la tête, il le vit à ses côtés !
Vitcoq près de lui ! Une seconde, il voulut douter. Pourtant, c’était bien Vitcoq, mais un Vitcoq incroyable, courbé en deux, les mains armées de pointes de fer, et les agitant à tours de bras, et si vite qu’on aurait dit deux mécaniques d’une agilité et d’une adresse miraculeuses.
Un grand coup de fouet à ses lévriers russes, et Criquioche, dépassé, le rejoignit. Et ce fut le dernier effort, les foulées suprêmes. Déjà on entendait la voix de Malatiré qui excitait les concurrents. Vitcoq passa, puis Criquioche, puis Vitcoq. Tous deux hurlaient. Encore cent mètres… Criquioche en tête… puis Vitcoq… puis tous deux nez à nez… Et soudain un effondrement, les roues qui se sont accrochées, les voitures, les chiens, les hommes pêle-mêle, des cris de rage, des aboiements, deux êtres qui se prennent à bras-le-corps, des bêtes furieuses qui se mordent… Et puis, de ce tourbillon de poussière, voici qu’il sort deux choses étranges, informes, innomables, deux moitiés d’hommes qui se mettent à rouler vers l’église. Et cela se démène, se traîne, rampe, gesticule, s’efforce, sautille, dégringole, tombe, se relève et repart avec des airs de monstres inachevés et qui ne savent pas se mouvoir, d’oiseaux sans ailes, d’animaux sans pattes, de poissons sortis de l’eau, de larves…
— Criquioche !… Vitcoq !… vocifère Malatiré, hors de lui. Criquioche dans un fauteuil… non, Vitcoq sur un sofa… Hourrah pour Vitcoq !… Bravo, Criquioche… Criquioche comme il veut… Criquioche tout seul… je prends Criquioche !…
Et de fait Criquioche, dont la course au début avait été moins pénible, semblait sur le point de gagner. Il touchait au but. Maïs un chien lui sauta à la gorge, le caniche de Vitcoq, l’arrêta un instant. Vitcoq passa, gagna.
Il y eut contestation. Les deux choses humaines furent près de s’empoigner à nouveau. Mais Malatiré s’interposa. Il exultait :
— Un metch splendide, comme il n’y en a jamais eu !… Ah ! mes enfants, à la bonne heure ! Quels gaillards vous faites ! En voilà des lapins ! de vrais pur-sang… ce que vous détallez !… Un vainqueur ? un vaincu ? Allons donc ! Dead-heat, oui, je vous proclame dead-heat. C’est mon droit, je suis juge. Vous entendez, chacun son tour aura la bonne place, un jour l’un, un jour l’autre… Ah ! mes fistons, quel beau metch !…
Maurice LEBLANC.
CONTES DU SOLEIL ET DE LA PLUIE
Lucienne et Clotilde
— Certes, nous dit à propos de son premier divorce ce modeste et grand savant qu’on appelle André Sauverny, certes ma femme était une haute intelligence et les derniers romans philosophiques qu’elle a signés de son nom de jeune fille, Lucienne Bréhan, attestent un noble esprit et un curieux effort d’originalité. Mais vraiment ces sortes de femmes, chez qui le cerveau a pris, au détriment de l’équilibre physique, une place trop prépondérante, ne sont pas faites pour la vie conjugale, du moins telle que nous l’entendons. Lucienne était bizarre, fantasque, difficile, indifférente aux soins du ménage, désordonnée. Nos natures se choquaient. L’existence devint bientôt impossible. Et puis, je l’avoue à ma grande honte, j’étais humilié, oui, profondément humilié. À valeur égale, la femme est supérieure à l’homme, et cette supériorité m’était insupportable. Je la sentais préoccupée d’idées plus graves que les miennes, en quête d’un idéal plus beau que le mien. Elle pensait mieux que moi. Elle était plus sensible, plus inquiète, plus enthousiaste, plus consciente. Bref, j’étais jaloux de son cerveau. Le divorce, auquel elle m’obligea par ses défauts de caractère, me fut donc un soulagement.
Libre, j’allai chercher le repos et l’oubli à la campagne, et c’est là que je connus celle qui devint ma seconde femme.
Clotilde d’Orsère habitait le château voisin. Veuve et indépendante, elle vivait à sa guise, montait à cheval et à bicyclette, faisait de l’automobile, s’adonnait enfin passionnément à tous les sports. Elle m’attira sans doute par l’absolu contraste qu’elle formait avec celle que je venais de quitter. Aussi grande et aussi forte que Lucienne était mignonne et faible, c’était une créature de plein air et d’effervescence physique. Je l’aimai et l’épousai.
Je n’insisterai pas sur notre bonheur durant les premiers mois. Clotilde se montra la femme charmante et docile, la ménagère attentive, la maîtresse de maison entendue que nous rêvons tous. D’ailleurs, n’avions-nous pas les mêmes goûts ? Moi aussi j’aime les sports, et les ayant pratiqués tous avec plus ou moins de ferveur, je puis dire que je me suis maintenu en bon état de souplesse et d’entraînement. Jours délicieux où nous errions à l’aventure par les champs et par les bois, mangeant au hasard des auberges, nous endormant sur le revers des fossés ! Oh ? comme tout cela était loin des heures fiévreuses et solitaires où Lucienne et moi pensions l’un en face de l’autre avec une sorte d’antagonisme pénible !
⁂
Ma première sensation désagréable — d’autres évidemment avaient dû déjà m’égratigner sans que j’y prisse garde — je l’éprouvai un matin que nous allions à bicyclette vers la ville voisine. Yves Lessart et son frère le romancier, Georges Valoise, d’Estrieux, nous accompagnaient, lorsque l’un d’eux, apercevant la vieille porte qui marque l’entrée de la villa, s’écria :
— Une course, voulez-vous, pour nous ouvrir l’appétit ? Au premier qui atteindra la vieille porte…
— J’accepte, ripostai-je, me courbant sur mon guidon et brutalisant mes pédales.
Et je partis, suivi des autres.
Ma victoire était certaine, sur cinq cents mètres surtout. Les deux frères ne comptaient pas. Valoise manquait de souffle, et d’Estrieux, qui avait du fond, était lent au démarrage. Et déjà je ressentais cette joie particulière que donne la supériorité, si insignifiante qu’elle soit et de quelque manière qu’elle se manifeste. Cependant, à cinquante pas du but, ayant tourné à demi la tête, je distinguai derrière moi, dans mon sillage, une forme…
Je redoublai, apportant à mon effort l’excitation d’un lutteur qui veut vaincre à tout prix. À trente mètres, mon rival parvint à ma hauteur. À quinze mètres il me dépassa. J’étouffai un cri. C’était ma femme.
⁂
Cette petite défaite inattendue qui, soyons franc, me vexa plus que de raison, fut suivie le lendemain d’une autre blessure d’amour-propre. Il pleuvait. On fit des armes dans la grande salle. Je me défendis facilement contre Yves Lessart qui passe pour un bon amateur ; mais Clotilde ayant pris le fleuret, me domina nettement. Trois fois de suite je fus touché.
Le jour suivant, à cheval tous deux, il me fallut constater mon infériorité devant un obstacle que ma femme sauta, et que je n’osai pas, non, que je n’osai pas affronter.
Et je me rendis compte ainsi, soit par des expériences réitérées, soit en me remémorant certains faits, que Clotilde l’emportait sur moi dans tous les exercices du corps, dans ceux mêmes où je pouvais prétendre à quelque mérite. Comme chauffeuse, elle montrait certes plus d’adresse, de décision et d’audace. Dans nos excursions à bicyclette, c’était toujours elle la plus vaillante et la plus infatigable. À Luchon où nous primes les eaux, je dus prétexter la défense du docteur, une nuit que nous partions avec des guides pour notre sixième ascension : j’étais fourbu. Au tennis, elle me refait deux sets. Je renonçai à chasser avec elle : corrigeant mon tir, sans viser presque, elle tirait les perdreaux et les lièvres que je venais de manquer.
De retour à Paris, l’ayant conduite au Palais de Glace afin de l’éblouir par mon habileté de patineur, je subis l’échec le plus mortifiant : Clotilde était la grâce même. On fit cercle autour d’elle.
J’affectai d’abord de rire à chacune de ces petites épreuves, ou même de n’y point prêter attention. Mais leur répétition commença bientôt à m’énerver, et je ne pus toujours cacher mon amertume. Clotilde s’en amusa, sans penser à mal. Irrité, je fis quelques scènes. Dès lors, par taquinerie, elle chercha les occasions de m’humilier, ce qui lui fut facile. Il y eut des querelles. L’accord était rompu.
Et c’est ainsi que moi, qui me pique d’une certaine élévation morale, j’en arrivai à souffrir auprès de ma seconde femme parce qu’elle me dominait physiquement, de même que j’avais souffert auprès de la première par jalousie cérébrale. Et pourtant, je vous assure que je ne suis pas un enfant, que j’ai l’habitude d’étouffer en moi toute pensée vilaine et que je ne me laisse pas envahir, sans combattre courageusement, par des sentiments. que je juge indignes. Mais que voulez-vous ! l’homme ne peut vivre auprès d’une femme qu’il reconnait supérieure à lui. Et cette fois, ma souffrance était peut-être plus aiguë, car elle provenait d’une infériorité physique. Et cela c’est la blessure la plus cruelle. Sous peine de déchéance, nous devons être les plus forts.
⁂
Je répéterai ce que j’ai dit pour Lucienne : la vie n’était plus supportable dans de telles conditions. Un peu de mépris se mêlait aux façons de Clotilde avec moi. Je la détestais. Chaque manifestation de vigueur, d’agilité, de résistance, m’était odieuse chez elle. Je regardais cela comme une injure volontaire, comme une provocation, et, chaque fois, je rêvais de l’humilier à mon tour et de prendre ma revanche par quelque moyen que ce fût. Ah ! la vaincre, la réduire, la briser comme une esclave, devenir son maître enfin, quelle joie !
Et un jour — vraiment je ne puis m’expliquer mon geste que par un coup de folie — un jour, malgré moi, après une scène plus violente, perdant la tête, je levai la main sur elle. Elle me regarda d’un air étrange que je n’oublierai jamais, avec une expression d’étonnement un peu dédaigneux, et très lentement elle vint à moi et m’empoigna à bras le corps, Et ce fut entre nous une lutte silencieuse, âpre, haineuse de ma part, implacable et grave de la sienne.
Tâtez mes muscles. Ils sont solides, n’est-ce pas ? Je suis dans la force de l’âge, robuste, nerveux, large de poitrine, carré sur ma base, hein, qu’en dites-vous ? Et, de plus, je vous jure que l’orgueil et la rage décuplaient mon énergie. Eh bien, elle me ploya en deux, me renversa, et avec un flegme de vieil athlète rompu aux assauts, sans à-coup, sans brusquerie, par le seul effort de ses muscles, elle me fit toucher les deux épaules…
Une heure après, je partais. Nous avons divorcé…
Maurice LEBLANC.
CONTES DU SOLEIL ET DE LA PLUIE
Sur la Piste
Il n’est personne qui ne se rappelle l’effroyable accident qui fit tant de bruit cette année, vers le milieu de la saison sportive. Une épreuve de cinquante kilomètres se disputait entre trois des premiers champions du demi-fond. Au dernier tour l’un d’eux tomba, entraînant dans sa chute ses concurrents et leurs entraîneurs. Il y eut deux hommes de tués, un troisième se cassa les deux jambes, un quatrième est devenu fou.
On en parla beaucoup, les causes de la catastrophe, dont tous les spectateurs du reste avaient pu se rendre compte, furent minutieusement expliquées.
C’est hier seulement qu’un hasard étrange m’a fait voir ce drame — le mot n’est pas trop fort — sous un jour tout nouveau et si imprévu que je doute encore de la vérité.
Dans un de ces restaurants de la Porte-Maillot que fréquentent les coureurs, je me trouvais assis près d’une table où quelques-uns d’entre eux finissaient de dîner. C’est une aubaine que je recherche volontiers, rien n’étant plus amusant et plus pittoresque que ce petit monde où l’on potine comme dans toutes les coteries, où l’on se vante, où l’on se jalouse, où l’on se hait, où l’on est plein de fiel et d’envie, mais de jeunesse aussi, d’entrain, d’insouciance et, souvent, de véritable bonté.
de connaissais de vue tous mes voisins : l’illustre Craquelin, Jacques Lambert, Bonjour, Domince, Marie Houstay etc. Ils étaient fort gais et fort bruyants, riant, pérorant et buvant en toute joie. Seul se tenait à l’écart, taciturne et distrait, quoique buvant sec, le fameux Bartissol, celui-là précisément dont la chute provoqua l’accident que je viens de rappeler, Bartissol que la mort de son ami Redeuil a laissé sans concurrent dans le demi-fond.
— Eh bien vrai, lui dit un de ses camarades, tu n’es pas drôle. Quel air de croque-mort ! Et voilà plus de six mois que ça dure.
— Oui, fit un autre, depuis la grande pelle du vélodrome.
Je remarquai le regard irrité de Bartissol. Un troisième continua :
— Ce pauvre diable de Redeuil ! Je comprends, vous étiez deux copains, unis comme les deux doigts de la main, mais enfin, il faut se faire une raison !
— Voulez-vous que je vous dise le fin fond de ma pensée ? reprit le premier. Eh bien, s’il se fait des idées noires, ce n’est pas tant pour cela, ça vient d’autre chose.
— D’autre chose ?
— Oui, une histoire de femme. Eh ! tu dresses l’oreille ? Bah ! tout le monde sait bien qu’elle ne veut pas de toi.
— Qui ? demanda-t-on.
— Adrienne Aubrée, parbleu, la fille d’Aubrée, le directeur du grand garage ; c’était aussi la cousine de Redeuil.
Bartissol frappa violemment la table d’un coup de poing.
— Assez ! cria-t-il.
On se tut, sans que personne cependant parût prêter grande importance à sa colère. La conversation changea.
Au bout de dix minutes, il se versa deux pleins verres de rhum et les avala coup sur coup. Il recommença dix minutes après, emplissant aussi à chaque fois le verre de son voisin, Alfred Hédouin, qui lui tenait tête.
Quelqu’un lui dit :
— Heureusement que tu n’es plus à l’entraînement.
Les autres s’étaient levés, car l’heure s’avançait. Ils partirent. Hédouin et Bartissol restèrent. Celui-ci proposa :
— Encore un verre ?
— Encore un.
Une demi-heure se passa. De temps à autre ils échangeaient des phrases quelconques d’une voix pâteuse. Leurs yeux avaient cette expression vague des gens dont l’ivresse est intérieure. Puis Hédouin dit :
— C’est vrai, ton histoire avec la fille d’Aubrée ?
— Oui, elle ne veut pas.
— Pourquoi ?