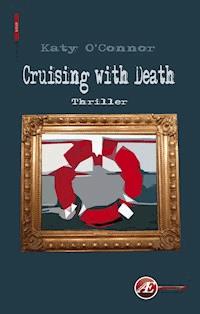Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Ex Aequo
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Rouge
- Sprache: Französisch
Derrière le rideau de velours pailleté, l’univers du personnel... Ici, le crime rode.
Si le Sultan vous invite, il faut accepter. C'est un paquebot luxueux qui promène avec fierté ses charmes entre l’Atlantique et la Méditerranée. Dans ses salons, des acheteurs d’art sans scrupules qui conversent avec fébrilité. Dans ses cales, des œuvres fabuleuses, introuvables qui attendent leur destin : une vente aux enchères très privée, sur l’océan. Et derrière le rideau de velours pailleté, l’univers du personnel... Ici, le crime rode. Les ambitions s’aiguisent. Les dangers se déchaînent.
Un musicien idéaliste et sa complice intriguent pour sauver l’art de l’argent ; ils se heurtent au drame intime d’une cuisinière et à l’inoxydable instinct de gagnant d’un directeur de croisière.
Dès lors, ces hommes et ces femmes vivent une formidable odyssée où la force des sentiments et du passé n’a d’égal que la puissance de la mer. Crime au long cours est un vibrant portrait en miniature de la croisière moderne comme symbole du village global avec ses affrontements inévitables, ses surprenantes rencontres et ses amours inattendues. Et c'est surtout un thriller haletant. Montez à bord. Il est l’heure.
Grâce à thriller haletant, découvrez un vibrant portrait en miniature de la croisière moderne comme symbole du village global avec ses affrontements inévitables, ses surprenantes rencontres et ses amours inattendues.
EXTRAIT
Javier entra dans le restaurant qui jouxtait les arènes avec la même résolution que celle du taureau devant la cape : forte et idiote. Il alla droit au bar.
— Lupe n’a pas fini ?
— Elle travaille, fiche-lui la paix, dit Juan sans le regarder.
Il servit un touriste, puis un autre et encore un autre. Javier le fixait toujours. Comme s’il le transperçait de part en part, à la recherche de son cœur (ou de quelque chose de ressemblant) afin de l’occire. Bredouille, il leva son verre comme une menace et marcha droit sur une table en terrasse.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Katy O’Connor est née en Afrique. Elle a passé son enfance en France et a ensuite vécu en Espagne et au Moyen Orient. Elle réside actuellement en Californie avec sa famille. Ses livres expriment son intérêt pour les voyages et le défi d'être “de partout et de nulle part.”
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Résumé
Crime au long cours
Résumé
Si le Sultan vous invite, il faut accepter. C'est un paquebot luxueux qui promène avec fierté ses charmes entre l’Atlantique et la Méditerranée. Dans ses salons, des acheteurs d’art sans scrupules qui conversent avec fébrilité. Dans ses cales, des œuvres fabuleuses, introuvables qui attendent leur destin : une vente aux enchères très privée, sur l’océan. Et derrière le rideau de velours pailleté, l’univers du personnel... Ici, le crime rode. Les ambitions s’aiguisent. Les dangers se déchaînent.
Un musicien idéaliste et sa complice intriguent pour sauver l’art de l’argent ; ils se heurtent au drame intime d’une cuisinière et à l’inoxydable instinct de gagnant d’un directeur de croisière.
Dès lors, ces hommes et ces femmes vivent une formidable odyssée où la force des sentiments et du passé n’a d’égal que la puissance de la mer.
Crime au long cours est un vibrant portrait en miniature de la croisière moderne comme symbole du village global avec ses affrontements inévitables, ses surprenantes rencontres et ses amours inattendues. Et c'est surtout un thriller haletant.
Montez à bord. Il est l’heure.
Crime au long cours
Katy O’Connor
Dépôt légal novembre 2011
ISBN : 978-2-35962-215-7
Collection Rouge
ISSN : 2108-6273
©Couverture de Hubely
© 2011 - Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, interdits.
Éditions Ex Aequo
6 rue des Sybilles
Dans la même collection
L’enfance des tueurs – François Braud – 2010
Du sang sur les docks - mai 2010
Crimes à temps perdu – Christine Antheaume - 2010
Résurrection – Cyrille Richard - 2010
Le mouroir aux alouettes – Virginie Lauby – 2011
La verticale du fou – Fabio M. Mitchelli – 2011
Le jeu des assassins – David Max Benoliel – 2011
Tueurs au sommet – Fabio M. Mitchelli – 2011
Le carré des anges – Alexis Blas – 2011
Sans mobile apparent – Arnaud Papin – 2011
Le pire endroit du monde – Aymeric Laloux – 2011
Le théorème de Roarchack – Johann Etienne – 2011
Enquête sur un crapaud de lune – Monique Debruxelles et Denis Soubieux 2011
Blood on the docks – octobre 2011
« Du sang sur les docks » traduit en anglais par Allison Linde
Timbres-poste
12 février 2003
Saint-Pétersbourg, Russie,
latitude 59° 56' nord, 30° 18' est.
Dix-sept heures
Le cœur d’Elan tombait en miettes. Comme celui de sa mère devant le corps de son père lardé de coups de couteau, cinq ans auparavant, quand il avait douze ans. Et comme le morceau de pain, ce matin, dans sa main, qui avait agrémenté sa soupe. Son estomac n’avait rien pris depuis et hurlait à la mort ; les clés qui pendaient à son cou suivaient le rythme de ses longues foulées, s’affrontant rageusement sur sa poitrine humide ; l’ensemble faisait un bruit de chantier qui frappait ses tympans, prêts à jeter l’éponge… Tant mieux s’il n’entendait plus rien, si la ville s’effaçait de ses yeux où tombaient des larmes de sueur acides. Le circuit était dans sa chair, passé en lui. Il allait atteindre le pont suivant.
Là… maintenant ! Il faisait signe aux touristes qui passaient dessous en bateau, ils l’encourageaient, mains levées, il courait encore. Jusqu’à un autre pont. C’est ce qui comptait – non. Pas tout à fait. Le bon compte, c’était celui des billets d’un euro ou d’un dollar qu’ils allaient lui laisser après le dernier pont. Si toutefois ce lot-là était bien luné, assez riche, assez généreux, si on avait de la monnaie… enfin si lui, Elan, avait de la chance aujourd’hui.
Le dernier pont. Les gens qui arrivaient dessous l’accueillirent comme un héros sportif. Ils ne regardaient plus les monuments qui bordaient la Neva et dont ils étaient las. À cet instant, ils préféraient l’homme. À Elan, ça lui faisait plaisir. Il s’assit sur le muret, pas trop proche du débarcadère, mais pas trop loin quand même de l’escalier que remontaient les visiteurs d’Europe de l’Ouest et d’Amérique. Il regardait droit devant lui le fleuve qui glissait vers la mer. Un jour, il le suivrait sur la Baltique et après, l’océan.
Cinquante dollars et vingt-deux euros. Pas mal. Maintenant, il pouvait aller à la messe. Ensuite, il aurait encore le temps d’acheter à manger. Quelque chose de bon, ce soir, quelque chose d’importé. Il prélèverait sa part pour ses cours de musique et pour sa dent, devant, qu’il devait remplacer (ou plutôt faire poser) afin de sourire franchement aux gens qui le payaient et aussi à ceux qui l’embaucheraient, un jour, comme pianiste. Le reste, il le donnerait à sa mère.
L’immeuble bâti au temps des Soviétiques affichait un orgueil terreux, noirci, avec une faucille et un marteau sur la façade comme une immense breloque démodée. À l’intérieur pourtant, on y donnait dans l’air du temps qui voulait qu’on soit fier de posséder des chiens, chers et puissants. Un de ces musclés canidés avait déposé dans l’entrée une sentinelle : belle envergure, encore fumante, odeur mordante. Elan la contourna, grimpa au second étage, poussa la porte de gauche qui grinça méchamment.
Le pasteur hocha la tête d’un air qui voulait dire « je sais » tandis que le garçon s’insérait sur un banc dans le fond de la salle, avec ses deux mains sur ses cuisses, le nez sur ses genoux et l’âme haute. Il avait retrouvé la religion de ses ancêtres, avant qu’ils se convertissent à l’islam, avant qu’ils en aient marre des Russes (déjà !). Sa mère et ses sœurs ne pourraient même pas imaginer qu’il était là, lui, le Tcherkesse. Si elles l’apprenaient, elles en concevraient du chagrin (encore !) Mais il n’y avait aucune raison pour que sa famille sache – et puis, si jamais son secret sortait comme un cafard… il passerait. C’était grâce à lui, Elan, que l’ordinaire s’améliorait.
L’homme l’observait, de temps à autre. Elan le savait. À force de courir en regardant devant lui, il avait l’habitude de connaître les choses et les gens du coin de l’œil. L’étranger l’attirait, lui aussi, comme un aimant. Costume gris bleu à l’originalité élégante, cheveux d’acier, ongles limés, la cinquantaine, sûr de lui, mais bienveillant. Elan aurait aimé être lui ; mais pas tout de suite. Il se leva et marcha résolument jusqu’au piano. Le pasteur lui sourit et annonça ce qu’il allait jouer pendant que Nina et Varia prenaient place pour chanter. Le garçon se concentra. C’était sa deuxième performance, après les ponts.
Tout le monde parlait en même temps, des murmures excités, joyeux. Elan ferma le piano. Il hésitait entre fendre la foule pour se précipiter dans un supermarché et échanger quelques paroles aimables et encourageantes avec ses coreligionnaires évangélistes. La petite Olga bondit sur lui et s’accrocha à sa jambe. Elle leva son visage piqué de taches de rousseur et fronça le nez dans une parfaite imitation de sa maman les fois où elle voulait parler très sérieusement :
— Un monsieur étranger m’a dit de te donner ça.
Elan regarda la carte de visite sur laquelle on avait griffonné : « vous jouez très bien du piano. » Suivait le numéro de téléphone d’un hôtel de luxe en ville. Ce n’était pas une carte professionnelle, car seulement le nom et l’adresse du propriétaire y étaient imprimés : Christopher Donomarenko, 1202 San Pablo Avenue, Palm Desert, California… USA… Ça sonnait bien.
Le garçon descendit l’escalier de ciment ébréché. La sentinelle avait séché ; le froid s’engouffrait par la porte restée ouverte. Demain, il neigerait. Plus de bateaux, plus de touristes – pour de longs mois. Palm Desert. Elan voyait de hauts rameaux suivre un mince cours d’eau et derrière, des rochers, avec des fleurs jaunes au milieu. Si elles n’étaient pas jaunes, il serait déçu.
***
Ronda, Espagne,
latitude 36° 44' nord, longitude 5° 10' ouest.
17 heures trente
« Le Palacio de la Virgen Mora peut générer quatre-vingt mille euros par an rien qu’avec les chambres et les petits-déjeuners. Alors si vous comptez y établir un restaurant de luxe en plus ! »
La petite dame en gris, avec son chignon assorti à son tailleur se déplaçait vite d’une pièce à l’autre, si vite que ses chaussures noires à barrette avaient l’air de la soulever du sol par magie. Elles étaient tellement cirées qu’on les aurait crues vernies. « Même la semelle », constata Sauveur Selva en montant avec peine l’escalier à vis d’une tour derrière la propriétaire des lieux. Il jeta un coup d’œil derrière lui à Suzette, sa femme, qui fit un signe de tête approbateur et à sa fille, Joline qui fermait la marche, les yeux évaluant l’albâtre et le bois du plafond, le nez frémissant, car très sollicité quant à l’augure de l’affaire et le cerveau classant et reclassant des chiffres de toutes les couleurs. Ils débouchèrent dans une chambre ronde, bleue comme la mer et brillante comme les rêves. Sauveur sentait une irrésistible envie de s’aplatir sur les matelas de soie jetés sur des tapis. Il y roulerait avec une fille aux babouches bleues comme les étoiles, légère comme l’écume et comme son rire avant qu’elle le fasse voler dans son ciel (peut-être le septième ?) en le serrant bien fort…
— C’est là que je dors encore quelquefois, dit doña Clara. C’est pourquoi j’ai laissé l’ameublement. En même temps, ça vous donne un aperçu de ce qu’est le Palacio quand il est bien paré.
— Ça vous ressemble, dit Suzette, simplement.
Sauveur n’entendit pas clairement les mots qui s’ensuivirent. Il s’approcha de la fenêtre à plusieurs caissons, tira la vitre ouvragée et regarda Ronda. De haut. La petite ville arabo-andalouse s’animait. L’heure de la sieste était passée. Les touristes et les locaux s’emmêlaient comme des serpentins. Ils mangeaient encore des churros con chocolate ou étaient déjà passés aux tapas avant de commencer à choisir un restaurant. Certains finiraient la nuit dans les bras de leur conquête du jour, d’autres dans ceux de leur amoureux, les plus avisés enfouiraient leur tête dans le giron de leur meilleur ami (celui ou celle qu’ils avaient épousé ou avec qui ils s’apprêtaient à convoler, finalement). D’autres, comme Joline, seraient seuls. Enfin, pas tout à fait. Il y avait bien son chien Pralin (dit le Malin), un loulou de Poméranie beau comme un duc du même nom avant qu’il perde la bataille contre un chevalier teuton. Son surnom lui était venu depuis qu’il s’installait sur les pieds de sa maîtresse pendant qu’elle dormait. Sauveur espérait que Joline rencontrerait la même dévotion affective de la part d’un mâle de sa propre espèce parce qu’une fois l’affaire lancée, quand le Palacio de la Virgen Mora – si on l’achetait – rapporterait de l’argent au lieu de juste « faire son beau » comme avec sa propriétaire actuelle, il faudrait bien que sa fille se trouve un homme. Pour procréer.
Un doigt gratta légèrement le creux du dos de Sauveur. Il avait oublié ce geste affectueux… Il se retourna. Joline projeta vigoureusement son menton à fossette vers le vieux pont dont on apercevait les arches, royales encore, plongées dans les entrailles caillouteuses d’un ravin séché par le temps et la vie.
— Il faudra qu’on trouve le chemin pour descendre le voir par en dessous, dit Joline fermement. Ses yeux noirs et cogneurs brillaient comme des billes. Ils disaient à son père : « je prends », exigeant – plus qu’ils ne demandaient – son soutien.
Sauveur s’approcha de la dame grise comme une petite souris.
— Pourquoi vendez-vous votre palais ? demanda-t-il avec une voix qui semblait remonter lentement du fond d’un puits. Si j’ai bien compris, il a été votre compagnon, votre enfant. Pourquoi ne pas le garder encore un peu ?
Il jeta un regard presque furtif sur les mains très ridées porteuses de plusieurs diamants. Elles se mirent à trembler. La vieille femme baissa des yeux brumeux sur ses mains qui avaient toujours fait ce qu’elles voulaient. Mais plus pour très longtemps.
— Vous avez raison, dit-elle, je suis prête à mourir. Et ma maison à vivre. J’ai passé trente ans à la restaurer. J’ai découvert son âme.
Elle darda ses yeux gris sur Joline comme si elle avait le pouvoir de la désigner pour régner et ajouta :
— Je crois que vous êtes parmi les gens capables de rendre le Palacio au monde pour que je puisse m’en retirer.
Ce fut le moment de Suzette. Elle détacha de son cou un ruban de velours rouge avec sa médaille en cuivre doré, tendit l’ensemble à la dame grise et dit :
— Sainte Rita. Vous l’aimez, je vous la donne.
La dame hésita un instant puis pressa ses doigts déformés sur le visage de la Sainte qu’elle avait évoquée avec Suzette un instant plus tôt, remarquant ce bijou inhabituel. Elle ferma les yeux une longue seconde, les rouvrit et dit : « j’accepte votre prix. »
***
Javier entra dans le restaurant qui jouxtait les arènes avec la même résolution que celle du taureau devant la cape : forte et idiote. Il alla droit au bar.
— Lupe n’a pas fini ?
— Elle travaille, fiche-lui la paix, dit Juan sans le regarder.
Il servit un touriste, puis un autre et encore un autre. Javier le fixait toujours. Comme s’il le transperçait de part en part, à la recherche de son cœur (ou de quelque chose de ressemblant) afin de l’occire. Bredouille, il leva son verre comme une menace et marcha droit sur une table en terrasse. En traversant la piste de danse, il avisa son image dans le miroir mural et sourit largement : la paire d’anneaux d’or qui flambaient à ses lobes – cadeau d’un couple de clients qui en avaient payé chacun un – était du plus bel effet sur sa peau ambrée battue par ses longues boucles noires. Il pouvait séduire n’importe qui et n’avait besoin de personne.
Elle vint vers lui en courant, les seins serrés sous son chemisier de coton plus blanc que les murs du Palacio de la Virgen Mora (comment était-ce possible ?) Son jean était un peu large sur la croupe qu’elle gardait opulente. Un héritage de l’Indienne, de l’Ibère et de la Barbaresque et un fascinant point de mélange des styles et des cultures, selon Javier. Elle s’empêtra dans ses sandales dorées pas faites pour marcher (seulement pour être vues), trébucha, rattrapa au vol la mantille qui glissait de son col et se laissa tomber sur la chaise de métal encore chaude du soleil de l’après-midi, face à Javier. Selon elle, la petite émigrée péruvienne avait encore manqué son entrée parce que, même si elle ne sortait pas avec ce garçon, une femme est une femme ! Selon Javier, au contraire, Guadalupe Lopez avait été parfaite.
— Ma tante a vendu son palais, annonça-t-il, tout de go.
— Doña Clara ? Le Palacio ?
— Lui-même. Pour une somme inférieure à sa valeur, je crois, mais comme pour elle, il n’avait pas de prix, quelle importance ? D’ailleurs, sans ça, j’y aurais mis le feu.
Guadalupe rit doucement, un bout de langue rose entre ses dents.
— Tu m’avais dit que tu aimais vivre là-bas quand tu étais petit ?
— Grimper dans les tours, courir dans les salles vides en m’inventant des aventures sans limites, chercher les passages secrets, c’était plus excitant que les manèges, surtout qu’il n’y en avait pas souvent à Ronda. Qu’est-ce que tu bois ?
— Comme toi. Une manzana.
— Non, choisis quelque chose toi-même.
— J’ai choisi. Aujourd’hui, je t’accompagne.
Javier haussa les épaules et fit signe au garçon occupé à fourguer un maximum de tapas à une bande de touristes dont les garçons adoraient le son de leurs voix et les filles celui de leurs rires, pétants comme la foire agricole.
— Je veux juste que tu fasses preuve de personnalité.
— C’est exactement ce que je fais, riposta Lupe.
Javier hocha la tête. Son regard allait de sa compagne à un oiseau à l’aile blessé qui essayait quand même de s’envoler depuis le trottoir aux petits pavés nets et luisants.
— J’ai une autre bonne nouvelle, dit-il pendant que ses yeux étaient sur Lupe. J’ai pris du galon.
Elle sourit, la bouche entrouverte et quand elle faisait ça, elle devenait un ange. Comme celui de la gravure qui servait de marque-page à Javier, petit. Quand doña Clara lui lisait encore des histoires. Avant qu’elle ne s’occupe plus que de pierres et l’abandonne, lui, son filleul, aux nonnes, aux voisines, aux touristes.
— Après mes vacances, je reprends du service sur un nouveau bateau, un gros : deux mille huit cents passagers – comme animateur en chef.
Lupe leva son verre.
— Cul sec, dit-elle, en même temps !
Elle avala de travers et se mit à rire et à tousser. Des larmes coulaient sur ses joues qu’elle essuyait avec sa serviette en riant plus encore.
— Si tu veux, je parlerai pour toi, dit Javier. J’ai l’oreille d’un cadre de ma compagnie – et même la bouche d’une directrice ! ajouta-t-il avec un clin d’œil.
Lupe cessa de rire et de pleurer.
— Tu n’as pas recommencé ?
— À prendre du plaisir et en donner aux autres ? Je crois que je n’ai jamais cessé.
— Ils te payent !
— Je reçois des bienfaits.
— En liquide.
— Pas toujours. En nature aussi. Tu es une gosse, Lupe… tiens ! Tu me rappelles ma tante ! Enfermée dans un conte au temps des califes – dans un palais en ruine.
Lupe avait le vertige. Qu’est-ce que ce petit bourgeois provincial de l’après-franquisme savait de ses luttes à elle, Guadalupe ? Pourquoi elle avait quitté Lima ? Comment elle était devenue bonniche à Barcelone puis serveuse à Ronda ? Son compagnon lui prit le menton. Il lui souriait avec ses yeux brun clair où crépitaient parfois, comme aujourd’hui, des verdeurs inattendues, avec sa bouche aussi, de toutes ses dents très blanches… plus blanches qu’avant semblait-il. Lupe se demanda qui elles avaient mordu pour payer le dentiste cosméticien. Elle se leva. Javier la retint par le bras.
— Tu ne m’as pas répondu. Tu postules et je te recommande ou tu restes ici ?
Lupe déglutit lentement, poussant vers le bas l’écœurement que lui inspirait soudainement l’odeur des calamares a la romana sur la table et celle de Javier : bois, métal et alcool. Dommage, elle avait cru avoir un ami dans ce pays, dans cette ville si fière de son histoire et qui n’était finalement qu’une vieille pute qui se vend pour pas cher à n’importe quel rustaud.
— Pourquoi tu veux m’aider ?
— Parce que je n’ai ni mère, ni femme, ni fille. Seulement une vieille tante qui ne parle que d’art mauresque. Alors ?
Lupe dégagea son poignet de l’étreinte.
— Pourquoi pas ? Moi aussi, j’ai envie de prendre le large.
Javier ramassa l’oiseau, fit un grand moulinet avec son bras et le lança vers le vieil amandier qui couchait ses branches sur le toit du restaurant. L’oiseau battit des ailes, faillit s’éclater la tête sur la porte aux lourdes ferrures puis s’éleva droit vers la cime de l’arbre et la dépassa. Javier pensa qu’il y avait de ces moments dans la vie où on pouvait même tirer les faibles du trottoir et les pousser vers le firmament. Si on en avait envie. Une jeune touriste de la table d’à côté lui sourit. Un de ses compagnons glissa sa main gauche sous son chemisier et lui caressa le sein tandis que de l’autre main, il saisit un filet d’anchois par la queue et se l’envoya dans la bouche, tête en l’air. La fille sourit plus fort en regardant Javier. Il lui envoya un baiser et s’éloigna.
En longeant les arènes, le jeune homme se dit qu’il aimerait toujours sa ville natale. Ici, on venait boire aux sources de la corrida. On venait voir et prendre quelque chose du grand sacrifice, celui de la bestialité terrible et innocente par la fragilité rusée et ses artifices. Ici, le naturel se battait contre le savoir-faire et perdait. Même les hommes modernes aimaient ça.
La rue grimpait comme un serpent qui voudrait empêcher la ville de bouger. Le Palacio de la Virgen Mora dissimulait ses secrets derrière un mur couvert de glycines et de chèvrefeuille. Javier s’arrêta devant la porte de bois frappée de grands carrés de cuivre martelé. Il ne serait plus jamais obligé de venir ici. Il n’arrivait pas à y croire ; c’est pour ça qu’il était là. Il prit une grande inspiration, absorbant les effluves du jasmin voisin (plus fort que son eau de toilette à la résine et au tanin). Derrière ces murs, il avait été prince. Enfant solitaire, il jouait tous les personnages de sa cour. Quand d’aventure, il venait des copains, ils auraient contesté sa distribution des rôles, alors il préférait jouer à cache-cache. Comme ça, il était sûr de gagner sans avoir l’air de diriger.
Finalement, il s’en était bien sorti. Il s’en sortirait toujours. Il continuerait à voir du pays (c’est-à-dire des gens parce que, dès son deuxième tour du monde, il avait convenu que partout il y avait des arbres et des maisons). Les hommes gardaient des ombres et des flous. Pour mieux vous surprendre. C’était ce qu’il aimait. Bien sûr, un jour, il s’assagirait, se reposerait, la tête sur le ventre d’une fille à la cuisine piquante et aux yeux doux.
***
Danville, Afrique du Sud,
latitude 25° 44' sud, longitude 28° 8' est
13 heures
Violette se frotte les yeux. Ils sont grands et lui mangent le visage. Ils ont une couleur bizarre. Froide comme l’hiver. Sa main tremble, hésite puis se met à tracer des mots à l’encre verte sur le papier blanc. En séchant, ils prennent le ton brun rouge du chemin du Ponant et aussi le charme d’antan. Ils font penser aux cartes marines et aux trésors enfouis dans l’imagination.
Sa main veut signer, mais Violette l’arrête, juste à temps : son verbe ne lui appartient pas. Elle le vend. Elle survit. À Nativity Camp, c’est ce qu’on fait. Sauf Willem, le patron. Lui, il engrange : d’une main avec les habitants du camp, forcés d’acheter les repas qu’il leur sert, de l’autre grâce aux visiteurs étrangers, toujours plus nombreux à venir voir comment se débrouillent les Blancs assez imprévoyants, naïfs ou malchanceux pour avoir perdu leurs ressources en Afrique du Sud.
La jeune touriste belge ouvre grand et rond les yeux et la bouche :
— Vous avez déjà fini mon poème ?
— Lisez-le et dites-moi s’il vous convient.
La fille a avalé son repas en moins d’une demi-heure. Elle n’a presque pas parlé aux autres touristes. Elle voulait avoir au moins dix minutes de temps libre pour errer dans le camp. Elle a marché vite. Elle avait l’air de savoir où elle allait, de ne pas déranger. Elle a pris deux ou trois photos à la sauvette, un peu gênée. Violette sait tout ça parce qu’elle aussi, elle regarde. Maintenant, sa cliente plie proprement la feuille de papier en trois et la range dans une poche intérieure de son sac à dos d’où elle sort vingt-cinq euros en coupures neuves et odorantes. Elle les pose sur l’ancienne table de pique-nique devenue bancale. Il faut dire qu’elle en a vu de rudes depuis les jours anciens où elle regorgeait de victuailles pour une famille presque heureuse de trois personnes : la petite blonde aux yeux orageux qui ne pleuraient pas, la maman vieillissante et le papa handicapé qui se sentaient toujours coupables de ne pas s’occuper assez de l’enfant et de ne pas gagner assez d’argent.
Violette fait disparaître les billets.
— Ça ne vous dérange pas que vos poèmes se promènent dans le monde sans qu’on sache que vous en êtes l’auteur ?
— Si, un peu.
Elle lève les yeux sur sa cliente et ajoute :
— Vous pouvez toujours citer mon nom, mais… c’est seulement si vous n’avez pas l’intention de faire croire que vous avez écrit celui que vous m’avez acheté. Je m’appelle Violette, Violette Mullen.
Le teint blanc de la cliente vire au rose soutenu.
— Vous décrivez ce que je ressens… rapport à la personne à qui je veux le dire. Comment vous faites ça ?
Un haussement d’épaules, un sourire voilé. Pendant une seconde, même les yeux de Violette ont brillé « ou alors, j’ai des visions ! », pense la jeune Belge. Elle baisse la tête et se mord la lèvre. Elle s’était imaginé les poètes plus fraternels. Son sac est lourd. Elle le jette sur son dos, faisant choir au passage la gourde rose bonbon de la table de pique-nique. Violette la ramasse. La fille se retourne et dit :
— Je suis désolée.
Le soleil devient un tueur. Puissant, déterminé, sauvage. Les minibus réfrigérés ravalent leurs touristes et recrachent une poussière épaisse. Pendant un moment, elle efface Nativity Camp de la vue de ceux qui ne sont pas dedans. Il n’existe plus. Violette plonge la main dans sa poche et referme ses doigts sur les gains de la journée comme sur l’œuf de la poule pondeuse quand elle avait quatre ans. Elle allait chercher ce trésor tous les matins de vacances, chez sa grand-mère, dans l’enclos d’une petite maison blanche avec des fleurs rouges comme le sang qui grimpaient sur le mur.
Le chemin du Ponant s’enfuit loin vers la ville et, bien plus loin encore, l’océan.
1
La Moldau (Smetana)
Violette (pensées)
13 septembre 2010, matin
Je ne les aime pas et ils me détestent. Ne leur demandez pas pourquoi. Ils ne le savent pas. C’est trop diffus ; ça vient de trop loin. Quant à moi, je réagis. Je n’ai jamais fait autre chose de ma vie. Et vous ?
Sur le Sultan, les employés sont bien nourris. Je choisis mon repas : une grosse tranche de rôti de bœuf, du riz au lait, une crème brûlée, une glace au caramel léger. J’aime le sucre. Il me rappelle la douceur de ma petite enfance, celle de mes parents. De petites gens. Qui ne se battaient pas.
Je cherche une table seule, mais à cette heure-ci, c’est une gageure : le service du petit-déjeuner des passagers est terminé, celui du déjeûner pas encore commencé, presque tout le personnel du restaurant est là plus quelques autres.
Jose-Maria de Ara me fait un grand signe depuis une table du fond où il déjeune à côté de Joline, le chef pâtissier. Devant eux, les sièges sont vides. J’y vais au pas de charge en levant mon plateau à hauteur de mes yeux. On s’écarte, je m’assois.
— Tu n’as pas fermé la boutique à l’heure, dit Jose-Maria. Tu tenais une bonne vente ?
— Une parure d’émeraude.
Joline frémit de la tête aux pieds. C’est comme ça chaque fois qu’on parle d’argent. Ou de nourriture. Jose-Maria calcule le montant approximatif de ma commission, siffle et partage sa bière sans alcool avec moi pour fêter ça. Je bois et je souris aux anges… Pas à cause de mon bonus. À cause de Joline. Elle me regarde à la dérobée, le nez long comme sa peine ; elle ne veut pas engager une conversation avec nous, mais elle a envie de parler, c’est plus fort qu’elle et ce n’est pas peu dire parce que, même si elle m’arrive à l’épaule, elle mène sa cuisine d’une main de maître et ses marmitons regardent toujours plus bas qu’elle. Je sais qu’elle s’interroge : était-ce le bon choix de faire une école chère, cotée, difficile, pour être là, avec Jose-Maria, le chef steward et moi, une sans-diplôme qui touche un pour cent des gains de la boutique de bord ? Elle se demande pourquoi tous les jours elle dirige la préparation d’excellentes pâtisseries sans prendre sa part du gâteau. Maintenant elle se révolte ; ça se voit à sa façon de mâcher et d’engloutir chaque bouchée avant que la précédente soit passée. J’attaque mes desserts.
— Tu as passé une audition pour le spectacle donné par le personnel ? demande Jose-Maria
— Sûrement pas. Je ne suis pas dans un cirque.
Joline relève la tête. Décidément, je l’intrigue. Jose-Maria me couve d’un regard de grand frère et se penche vers moi comme pour me révéler qu’il y a une bombe à bord et que c’est lui qui contrôle l’explosion :
— Dommage. Je sais que tu peux tout faire ! Et aussi beaucoup plaire, quand tu veux.
Jose-Maria croit qu’il est mon ami parce que je l’attire sexuellement. Il est trapu, dodu, joufflu comme un nuage avec les grands yeux noirs de son ascendance hispanique prêts à se renverser sur les hautes pommettes de ses joues qu’il tient de sa mère, Philippine pur jus. Je suis grande (un peu trop), mince, blonde avec des yeux clairs. Mon chevalier servant jette sa serviette en papier sur son assiette avec les reliefs de son repas, s’appuie au dossier de skaï rouge de son siège, deux doigts sur l’estomac et enchaîne :
— Donomarenko me plaît même s’il est un peu jeune pour faire un directeur artistique.
Je continue à manger. Jose-Maria continue à parler.
— Enfin… si mon père avait investi dans la compagnie au lieu de perdre dans les tripots tout l’argent que ma mère et ma sœur gagnaient avec leur gargote à la plage, je ne serais pas steward !
Ç’en est trop pour Joline. Elle avale trop vite une boule de pommes de terre rôties en roulant des yeux exorbités, mais parvient à lancer sa balle :
— Vous oubliez l’érotisme ; il compte autant que la famille dans le fricot social. Qui vous dit que le prince du piano-bar n’est pas devenu artiste en chef en usant de séduction ?
Je regarde la nouvelle venue dans la conversation avec une prétendue surprise et une vraie joie qui m’émeut presque :
— Donc, pour toi, la séduction n’est pas un talent ?
Les petits yeux noirs de Joline me renvoient deux lasers en forme de point d’interrogation.
Je lui explique :
— Quand je vends un bijou, un vêtement, un parfum à quelqu’un, c’est que je l’ai séduit, si l’article est plus élaboré (et en général plus coûteux), je fais mieux : je l’aide à séduire. C’est comme si tout d’un coup… il ou elle parlait mieux.
Joline me toise sans complexe, l’air vaguement moqueur. Elle réfléchit. Et elle conclut : je suis une Africaine et une Blonde.
Jose-Maria revient dans le jeu et, en revanche, il m’offre une nouvelle carte gagnante :
— Je comprends pourquoi Javier t’aime bien !
Javier, c’est notre directeur de croisière et, en tant que tel, il se réserve l’autre boulot qui lui colle à la peau, celui d’animateur en chef. Il a besoin d’être celui qui vous fait rire, qui vous entraîne, qui vous conseille, qui vous répond. Il est le Guide. Shaman ou prince du palais mobile, c’est comme vous voudrez – celui qui vous fait rêver. Ou jouir. D’ailleurs, sur le Sultan