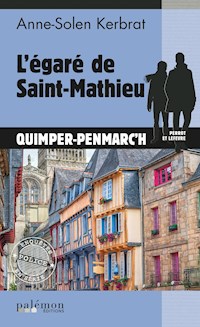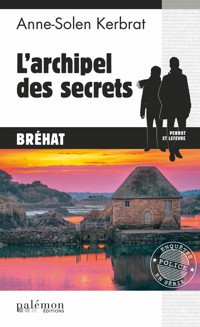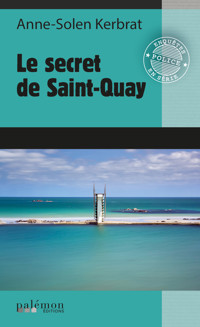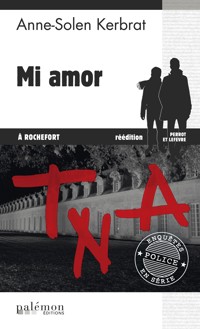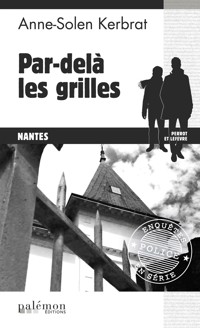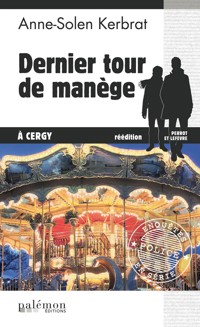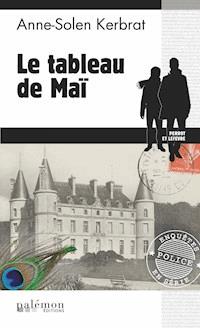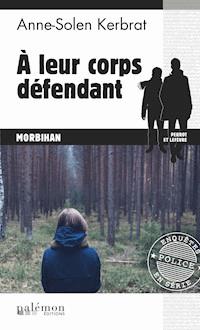Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Palémon
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commandant Perrot
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Deux meurtres lancent Perrot et Lefèvre dans une aventure médico-judiciaire !
À Nantes, un médecin puis un pharmacien trouvent brutalement la mort. L’un d’eux avait été l’amant de Camille, jeune fille dont l’état de santé se dégrade de jour en jour. Quel rapport entre les meurtres et cette frêle personne qui n’est plus que l’ombre d’elle-même ? Le commandant Perrot et son fidèle acolyte Lefèvre vont tenter de démêler le vrai du faux dans cet imbroglio médico-judiciaire. Avec ce roman policier hors-du-commun, Anne-Solen Kerbrat aborde la question des dangers de la vaccination.
La psychologie des personnages est fouillée, l’intrigue documentée… L’auteur nous offre ainsi un véritable roman de société qui vous captivera.
Avec cette nouvelle enquête de Perrot et Lefèvre, l'auteure nous propose un surprenant polar sociologique qui aborde la question des dangers de la vaccination.
EXTRAIT
Le sol est recouvert d’une épaisse moquette écrue et d’un tapis rond en bouclette dont le centre éclate d’un rouge chatoyant. Lefèvre promène un regard curieux sur la galerie de photos. On y voit la victime avec femme et enfants dans différentes villes étrangères. « On ne se refuse rien dans cette maison », commente le capitaine issu d’un milieu modeste, en son for intérieur. Puis il jette un œil circulaire sur la pièce qui lui confirme, s’il en était besoin, que le médecin gagnait très bien sa vie. Perrot est déjà occupé à fouiller les tiroirs du bureau sans savoir au juste ce qu’il doit chercher. Puis il avise des classeurs dans l’étagère derrière le bureau. Il les attrape et les pose l’un après l’autre devant lui. Il s’agit de relevés de compte, de bons de garantie et autres factures. Il décide de les emporter afin de les étudier tranquillement au service ou chez lui. Il débranche également l’ordinateur et le prend sous son bras.
— On y va ? fait-il à l’adresse du plus jeune, occupé à étudier la vidéothèque de la victime.
— Je te suis.
Perrot a demandé à madame Bacconière s’ils pouvaient emporter les classeurs et le PC de la victime. Elle a haussé une épaule indifférente pour toute réponse.
Pour éviter tout malentendu avec la femme et être en règle, Lefèvre lui fait signer une décharge. Lorsqu’ils s’en vont, madame Bacconière est toujours assise sur son canapé.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Anne-Solen Kerbrat est née en 1970 à Brest, et a d’abord vécu entre Côtes d’Armor et Finistère sud.
Professeur d’anglais dans le secondaire puis le supérieur, elle est passée par le Val d’Oise, la Charente-Maritime et le Bordelais avant de poser ses valises à Nantes.
Elle se consacre aujourd’hui à l’éducation de ses quatre enfants, à la traduction et… à l’écriture.
Son style féminin, à la fois sensible et incisif, et la qualité de ses intrigues sont régulièrement salués par la critique. Son premier roman a été récompensé par le Prix du Goéland Masqué en 2006.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 564
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANNE-SOLEN KERBRAT
Cure fatale
à Nantes
DU MÊME AUTEUR
n°1 - Dernier tour de manège à Cergy
n°2 - Mi amor à Rochefort
n°3 - Jour maudit à l’Île-Tudy
n°4 - Bordeaux voit rouge
n°5 - Saint-Quay s’inquiète
n°6 - Cure fatale à Nantes
n°7 - Par-delà les grilles
n°8 - Là où tout a commencé
Retrouvez ces ouvrages surwww.palemon.fr
Dépôt légal 1ertrimestre 2016
ISBN : 978-2-372601-28-3
CE LIVRE EST UN ROMAN.
Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres,
des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant
ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
Aux termes du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle de la présente publication, faite par quelque procédé que ce soit (reprographie, microfilmage, scannérisation, numérisation…) sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L’autorisation d’effectuer des reproductions par reprographie doit être obtenue auprès du Centre Français d’Exploitation du droit de Copie (CFC) - 20, rue des Grands Augustins - 75 006 PARIS - Tél. 01 44 07 47 70/Fax : 01 46 34 67 19 - © 2016 - Éditions du Palémon.
Chapitre 1
Elle l’embrasse, caresse sa joue d’un doigt léger. Distrait. Sa coupe dégradée laisse invariablement deux mèches danser devant ses yeux. Elle les repousse derrière son oreille. C’est devenu un tic, une coquetterie, presque une manière de meubler le vide. Elle est en retard. Comme d’habitude. Elle dira qu’elle suivait un papy avec deux de tension ou bien qu’un empoté avait trouvé le moyen de tomber en panne juste devant elle. Mais on l’excusera. Comme d’habitude. Tout le monde l’excuse. Elle passera une bonne journée. Comme d’habitude. Ce soir, à son retour, il la trouvera là, souriante dans sa tenue d’intérieur en molleton douillet. Elle sourira. La maison sentira bon. Elle lui demandera comment s’est passée sa journée. Il répondra : « Bien ». Qu’il est crevé. Que certaines patientes peuvent se montrer très pénibles. Elle sourira. Lui dira que Éva a eu 18 en maths et Pablo un A en sport. Pablo, lui, aura cassé ses lunettes pour la deuxième fois ce trimestre. Heureusement, il ne se sera pas ouvert le front cette fois-ci. Robert soupirera et se demandera pour la énième fois comment il peut lui faire ça.
*
Maxime ne l’a pas entendue monter. Cela fait quelque temps d’ailleurs que son retour ne s’accompagne plus du claquement de la porte d’entrée. Il fronce les sourcils, il guette le bruit des bottes qu’on laisse tomber, le cliquetis de la fermeture zippée de la veste jetée sur les marches de l’escalier. Il secoue la tête : non, depuis quelque temps – quelques semaines même peut-être – elle rentre sans bruit. À peine distingue-t-il le son de la porte qu’on referme doucement, comme à regret. Elle ne fait même plus de détour par la cuisine. Elle est peut-être au régime, toutes les filles sont au régime à cet âge-là, non ? Surtout celles qui n’ont pas un kilo à perdre, s’amuse-t-il. Mais il ne va pas se plaindre de ce changement : après tout, la maison est plus calme, plus propice aux études. Il hausse une épaule distraite, replonge le nez dans son manuel d’informatique.
*
Elle ôte son gant pour déverrouiller son mobile et le visage de sa fille s’affiche sur l’écran. C’est une photo que Caroline Costay aime beaucoup : on y voit une Capucine boudeuse refusant de prendre la pose. L’adolescente vient de découvrir le mascara et en a abusé. Son œil bleu se durcit sous le trait d’eye-liner. Mais elle garde les joues de l’enfance et le contraste a quelque chose d’attendrissant.
Caroline Costay répond :
— Oui, chérie ?
— T’es où, Maman, ronchonne Capucine, j’y comprends rien aux puissances et j’ai un contrôle demain !
— Je suis en bas, soupire la conductrice en se garant, j’arrive !
Il n’est encore que dix-sept heures et pourtant, il fait déjà bien sombre dans les rues de Nantes. Le ciel est bas, une pluie froide mouille l’asphalte. Un vent mauvais se glisse dans la nuque de Caroline Costay qui remonte frileusement le col en fausse fourrure de sa doudoune noire. Les passants pressent le pas, le buste plié en avant pour affronter la bourrasque. Les étudiants serrent contre leur torse leurs chemises de cours tandis que ballotte à leur épaule un sac à bandoulière. Les bus font crisser leurs pneus en marquant le stop. Un père Noël pousse sa ritournelle immuable à travers les haut-parleurs fixés à l’angle des rues. Caroline Costay attrape les deux sacs de courses posés sur la banquette arrière et ferme la petite Fiat 500. L’immeuble cossu situé rue Racine est encadré par l’échoppe d’un bottier sur la gauche et une boutique de lingerie sur la droite. Elle compose le numéro sur le digicode et pénètre dans le hall. Trois grands appartements composent l’immeuble. Les Costay occupent le dernier étage. Comme elle est chargée, elle appelle l’ascenseur. Quand elle sort de la cage, l’étage s’éclaire automatiquement. Du coude, elle appuie sur la poignée de la porte d’entrée et la pousse avec le pied. Elle aperçoit Amandine vautrée sur un des deux canapés de cuir blanc du salon. Elle regarde un dessin animé japonais. Trop fort comme toujours. Caroline Costay laisse tomber ses sacs et se dirige vers le salon. Sur la pointe des pieds, elle se glisse derrière sa fille qui, ravie, enlace le cou de sa mère. Caroline Costay s’assoit près d’elle et la serre dans ses bras. Les légers cheveux blonds sentent le shampooing à l’abricot. Sa mère lui susurre :
— Coucou, ma puce, tu vas bien ? Tu as passé une bonne journée ?
— Oui, très bonne. Même s’il y avait des épinards à la cantine !
— Pauvre chérie ! Et à part ça, tu t’es réconciliée avec Mathilde ?
— Bof, je crois qu’elle préfère vraiment jouer avec Lydie.
— Mais non, qu’est-ce que tu vas imaginer là ! Tu n’es pas restée seule, quand même ?
— Non, évidemment, j’ai joué avec Vanille !
Et la petite se retourne vers l’écran. « Que c’est facile à cet âge, rien n’est jamais grave ! Les tragédies sont oubliées aussi vite qu’elles sont nées ! C’est plus difficile en grandissant… » songe Caroline Costay, avec un coup d’œil involontaire vers la chambre de l’aînée. Elle se relève et va au bout du couloir. Elle entend à travers la porte les murmures étouffés d’un monologue. Elle frappe pour s’annoncer. Capucine est assise à son bureau, son portable vissé à l’oreille. La pièce est plongée dans l’obscurité, à l’exception du bureau placé près de la fenêtre. Une lampe à pied métallique éclaire les cahiers étalés et l’écran de l’ordinateur qui projette sa lumière blafarde sur le bureau. En entendant sa mère entrer, l’adolescente pianote rapidement sur le clavier de son ordinateur qui se met aussitôt en veille. Sur l’écran s’étalent à présent les visages souriants de la bande d’amis du lycée affalés sur les marches d’une église. Avec un bref « Salut, faut que j’te laisse », Capucine raccroche et se retourne vers sa mère en maugréant :
— J’ai un contrôle en maths et je capte rien !
— Bonjour, Maman, tu as passé une bonne journée… corrige Caroline Costay en s’approchant.
— Pardon, salut, m’man, ça va ?
— Ça va, oui, fait la mère en posant un baiser sur la joue de sa fille.
— Il faut vraiment que tu m’aides !
— D’accord, je vais ranger mes courses, je me fais un thé et je suis à toi.
— OK.
Machinalement, Caroline Costay ramasse le pot de yaourt vide sur le bureau ainsi que l’emballage de brioche.
Elle récupère ses sacs abandonnés dans l’entrée et gagne la cuisine. Elle met les produits frais au réfrigérateur, les fruits dans la coupe et les baguettes sur le billot.
Elle allume la bouilloire et feuillette le courrier. Rien d’intéressant. Elle se prépare un thé vert parfumé. Elle attrape un sachet de biscuits et emporte le tout dans la chambre de Capucine.
*
Il aperçoit le numéro qui s’affiche. Il va décidément falloir qu’il en change, ce harcèlement devient insupportable. Il repousse l’appareil et s’adresse à la femme assise devant lui :
— Ainsi donc, vous commencez à avoir des bouffées de chaleur ?
— Oui, et depuis deux nuits, je me réveille en sueur, c’est très pénible.
— Oui, je vous comprends. Écoutez, dans un premier temps, on va essayer de soulager ces gênes transitoires. Le temps que la ménopause s’installe définitivement. Tout en sachant que si l’inconfort vous paraît insupportable, on pourra recourir au traitement hormonal de substitution.
— Je préférerais m’en passer, prononce timidement la quinquagénaire.
— Ce sera à vous de voir en temps utile. Voici l’ordonnance, vous pouvez prendre rendez-vous avec ma secrétaire pour février…
*
Camille Lebon contemple le petit objet bombé qui tient dans le creux de sa main. « Comment mon espoir peut-il dépendre de ce truc ? » se demande-t-elle en se rongeant l’ongle du pouce. « Et pourquoi il ne me répond pas ? Qu’est-ce que je lui ai fait ? » Elle se lève, marche de long en large dans sa chambre aux murs tapissés de fleurettes roses. Un papier peint qu’elle a en horreur mais que sa mère refuse de changer parce qu’il est encore tout à fait correct. Machinalement, du bout du pied, elle accentue le décollement du papier un peu usé à l’intersection de deux lais. Elle fait la même chose deux mètres plus loin. Quand elle se rend compte de ce qu’elle a fait, il est trop tard, le papier est en piteux état. « Faudra bien qu’on le change maintenant. » Puis comme si ce geste l’avait épuisée, elle va s’allonger sur son lit, les jambes repliées sur sa poitrine. Elle se sent un peu nauséeuse et elle a la migraine aussi. Mais elle se sent si lasse qu’elle ne trouve pas l’énergie pour se lever et aller prendre de quoi la soulager dans l’armoire à pharmacie de la salle de bains. Elle n’a pas quitté son téléphone mobile qui se refuse à vibrer. Elle plonge aussitôt dans le sommeil.
*
« Eh oui, chers amis,
Ce n’est pas facile tous les jours, mais je m’accroche et c’est en grande partie grâce à vous. Grâce aux médecins aussi qui m’entourent et me rassurent. Aujourd’hui, j’ai réussi à sortir faire quelques pas. Je sais que j’ai une tête à faire peur mais tant pis, j’avais trop besoin de sentir le vent sur mon visage ! J’ai même envisagé de prendre le tram pour aller en ville mais j’ai dû renoncer ; trop fatiguée. À chaque jour suffit sa peine ! Et puis demain, j’ai une nouvelle séance, la septième, alors vaut mieux que je garde mon peu de forces. Je vais essayer de regarder la télévision quelques minutes avant de me coucher. Je ne vais sans doute pas dîner, je n’ai pas envie de me préparer à manger. Ce n’est pas bien mais que faire ? Je suis seule… Allons, ne cédons pas au découragement ! Rappelez-vous que vos messages de soutien sont ma bouffée d’oxygène (sans jeu de mots !) et que sans vous je ne serais sans doute déjà plus là…
Salut à tous, et pensez à moi, votre petite sœur de la Toile !»
*
Jacques Costay fait rouler ses épaules en arrière et essaie de détendre sa nuque ankylosée. La journée se termine, les employés sont tous partis. Les gardiens de nuit sont à leur poste. Certains résultats l’inquiètent un peu. Des réticences ont été émises. La prochaine étape sera, il le craint, celle des mises en garde. Et finalement celle de l’interdiction de mise sur le marché. On n’en est pas encore là, bien sûr, mais il sait dans quel monde frileux on vit. Il a envie de rentrer chez lui mais il préfère se replonger dans les statistiques qui lui sont parvenues en début d’après-midi. Les chiffres sont assez explicites. Pourtant, rien pour l’instant ne relie catégoriquement les symptômes observés à l’administration du produit. Et, Dieu merci, ceci n’est pas près d’arriver ! En effet, il faut plusieurs mois, voire plusieurs années, pour que les doutes se transforment en certitude. Et en attendant, il aura eu le temps de prendre les dispositions qui s’imposent. Avec un rictus, Costay masse ses yeux brûlants. Il se sent si fatigué, il ferait mieux d’y aller à présent. Caroline Costay aime qu’il rentre un peu plus tôt le vendredi soir. Pourtant, Costay reste assis sur son large fauteuil pivotant. Il repense à la discussion qu’il a eue avec son distributeur et ami, Paul Aundrin. Ce dernier est passé tout à l’heure et a fait part de ses inquiétudes :
— Écoute, Jacques, il vaut mieux être prudent et cesser la commercialisation.
— Pas question ! Tout est lancé, on a d’excellents débouchés et aucune raison de paniquer !
— Aucune, tu crois ? ironise Paul en faisant les cent pas dans le bureau moquetté.
Au-delà des clôtures d’enceinte, un flot continu de voitures se pressent sur le périphérique, leurs lumières jaunes trouant le crépuscule.
— Et ces stat’ qui sont arrivées aujourd’hui ? insiste Aundrin.
Costay se lève et va se planter dos à la fenêtre, les poings sur les hanches. L’éclat intermittent des phares de voitures et poids lourds l’éclaire comme s’il était sur scène. En martelant chaque mot, il interroge :
— Mais au fait, comment as-tu eu accès à ces données ? Elles ne relèvent pas de tes compétences, à ce que je sache !
Il a prononcé ces mots avec un ton méprisant qui ne reflète pas le respect qu’il a pour son fidèle collaborateur. Mais l’inquiétude transparaît dans sa voix soudain cassante.
— En effet, rétorque l’autre sans se départir de son calme, mais il se trouve que je protège mes intérêts, figure-toi, et les comptes rendus de l’AFFSAPS m’ont inquiété.
Costay se rassoit et se prend la tête à deux mains. Il inspire profondément avant de s’adresser à Paul, resté debout :
— Écoute, Paul, je comprends tes réticences, mais tu sais aussi bien que moi que lorsqu’on lance un nouveau produit, on trouve toujours sur la route une armée de spécialistes pour appeler bruyamment à la prudence. Et puis, ajoute-t-il avec un froncement de sourcils, on ne peut pas se permettre actuellement de faire la fine bouche !
— « La fine bouche ! » manque s’étrangler son collaborateur, mais c’est d’êtres humains que l’on parle là !
— Oui, oui, fait Costay en levant une main apaisante, je sais que nous avons des responsabilités, mais, fait-il, en se redressant, n’oublie pas que la situation économique est difficile, la crise nous guette tous !
— Il n’empêche, martèle Paul, en venant plaquer ses deux paumes sur le bureau de Costay, tant que l’on n’aura pas eu tous les résultats sur les effets secondaires potentiels, on doit arrêter la production !
Costay repose son dos contre son dossier et croise les mains sur son abdomen qui écarte légèrement les pans de son blazer.
Avec une apparence de calme retrouvé, il articule :
— Écoute, je ne peux pas te forcer à distribuer un produit que tu ne sens pas.
Mais alors que son interlocuteur croit qu’il est en train de faire machine arrière, il ajoute, frappant à son tour des deux mains sur le bureau :
— Mais sache que si tu te retires, tu peux dire adieu à toute collaboration future !
— M… mais, enfin, Jacques, fait Paul en venant s’asseoir lourdement en face de Costay, tu ne peux pas mettre fin à dix ans de travail basé sur la confiance réciproque parce que j’émets un doute sur la fiabilité d’un produit !
Costay reprend sur un ton dangereusement calme :
— Tu sais pertinemment, Paul, que si tu me lâches sur ce coup, c’est la crédibilité de la boîte tout entière qui est remise en cause ! Et je ne t’apprends rien si je te dis que perte de crédibilité rime avec perte de débouchés !
— Tu accordes beaucoup d’importance à mon opinion, ironise alors Paul, j’en suis très flatté, mais ne me fais pas croire que ma décision seule aura de telles conséquences !
— Ne te fais pas plus naïf que tu ne l’es ! se met à aboyer Costay, si tu abandonnes la commercialisation du produit, les revues médicales vont aussitôt te tomber dessus. Et tu devras expliquer que (là, Costay adopte une voix mielleuse) Distripharm cesse sa collaboration avec Coslab pour des raisons personnelles. Et moi, fait-il en reprenant son timbre normal, je me retrouverai à devoir dire : « Non, non, détrompez-vous, notre plus fidèle collaborateur ne nous tourne pas le dos, c’est juste une impression ! » Lentement, Paul s’est relevé. Dans un geste machinal, il regarde sa montre : 20 heures 22. Le flot des véhicules s’est un peu tari sur le périphérique. L’heure de pointe est passée. Il presse ses doigts les uns contre les autres à hauteur de sa poitrine comme en une prière muette. D’une voix blanche, il sollicite :
— Laisse-moi quelques jours, Jacques, le temps que je relise les comptes rendus et que je me renseigne davantage.
Le directeur regarde son interlocuteur dans les yeux et réplique :
— Quinze jours, pas un de plus. Le quinze décembre, tu donnes ta décision.
Le ton est sans appel. Paul laisse retomber ses bras le long de ses cuisses et tourne les talons en esquissant un timide geste d’au revoir. Costay ne répond pas au salut. Il sait que leur association a fait long feu.
*
— Bonsoir ! Tout va bien ?
— Oui, répond Maxime de l’étage.
Sylvie Lebon ôte son manteau en soupirant d’aise. La petite maison bien chauffée lui semble un havre de paix après la tempête qu’elle vient d’essuyer. Pendant tout le trajet, la pluie cinglait le pare-brise de sa petite voiture tandis que le vent semblait vouloir l’arracher à la chaussée. Sur le bas-côté, les platanes agitaient furieusement leurs branches sous le déluge. Elle met généralement vingt minutes pour rentrer de la galerie commerciale où elle est vendeuse, mais ce soir, il lui en a fallu presque le double avec cette visibilité réduite. Elle secoue ses cheveux châtains que la capuche emprisonnait. Elle les porte à hauteur d’épaules. De taille moyenne, elle a la silhouette élancée dans son jeans ajusté et son pull-over noir à col roulé. Mais sa silhouette juvénile ne peut faire oublier les rides précoces qui sillonnent son visage. Elle aperçoit les bottes de Camille abandonnées au bas de l’escalier ainsi que sa doudoune gris argent. Cette dernière n’a pas répondu au salut de sa mère. « Pourvu qu’elle aille mieux ce soir », s’inquiète la vendeuse en grimpant l’escalier. Le palier étroit dessert trois petites chambres et une salle de bains. Elle frappe à la première porte sur la gauche, celle sur laquelle s’étale un poster représentant les Grands Lacs canadiens. À l’invitation de son fils, elle entre. Il fait froid dans la chambre. La fenêtre est entrebâillée. Le jeune homme taillé comme un athlète est assis à son bureau. Maxime a dû fumer. Sylvie Lebon fronce les narines et avec un geste réprobateur, fait mine de vouloir chasser l’air vicié. Il sourit au manège. Il s’est brutalement mis à fumer. Sa mère s’interroge. Mais sans doute qu’en ce moment, avec les partiels qui se profilent, il a besoin d’un peu de nicotine.
— Ça avance, ces révisions ? s’enquiert Sylvie Lebon en allant refermer la fenêtre avant de s’asseoir sur la couette aux couleurs du drapeau américain.
La chambre est tapissée d’affiches de football américain. Les sportifs harnachés de leur veste à épaulettes et casque grillagé ressemblent à des cosmonautes. Contrairement à ses camarades, Maxime n’a jamais soutenu les champions hexagonaux du ballon rond. Il n’apprécie pas le football, lui préférant son pendant américain. Un club s’est monté il y a six ans à l’initiative de Maxime et de son professeur d’EPS. Depuis, le club ne cesse de faire des recrues. Le jeune homme aux cheveux châtains coupés court et aux yeux noisette se retourne :
— Ouais, j’avance bien, je devrais être au point pour la semaine prochaine.
— Bien, approuve sa mère en se levant à regret, je vais voir Camille. Tu l’as vue ce soir ?
— Non, elle est rentrée vers cinq heures. Je ne l’ai pas entendue depuis. Elle est vachement silencieuse ces temps-ci, fait remarquer son aîné.
— Oui, soupire Sylvie Lebon, elle a vraiment changé dernièrement, j’espère qu’elle ne fait pas une déprime…
— J’en sais rien, marmonne le frère en retournant à son cours d’informatique.
La mère frappe à la porte voisine. Un panneau jaunissant annonçant sous le dessin d’une tête de mort « Défense d’entrer sous peine de mort », se décolle à un angle. À force de le voir, plus personne ne fait attention au slogan punaisé quelques années auparavant. Pas de réponse. Doucement, Sylvie Lebon actionne la poignée. La chambre est plongée dans l’obscurité. Seule la lampe de chevet éclaire le visage endormi de Camille. Elle est très pâle malgré la douce lueur diffusée par la lampe à abat-jour rose. La jeune fille est pelotonnée en position fœtale. « Comme elle semble fragile », se dit la mère, « comme elle a minci, aussi. Pourvu qu’elle n’ait pas cédé aux sirènes trompeuses des magazines de mode qui érigent la maigreur en idéal de beauté ! C’est pourtant vrai qu’en ce moment, Camille chipote dans son assiette au dîner et je ne sais pas si elle mange correctement à la cantine. » Cependant, Sylvie Lebon ne croit pas à cette explication : sa fille a toujours été mince et n’a jamais entrepris de régime. Elle s’approche du lit et caresse la chevelure souple. La jeune fille ouvre un œil égaré et murmure :
— C’est toi, m’man ?
— Mais oui, ma chérie, tu dormais ?
— Je crois, il est quelle heure ?
— Sept heures et demie. Tu ne te sens pas bien ?
— J’ai encore mal à la tête et au ventre.
— Mais tu as les mains glacées !
— Oui, j’ai froid.
— Reste au lit, je vais chercher des médicaments. Sylvie Lebon va à la salle de bains et revient, armée de comprimés de paracétamol et d’antispasmodiques. Entre-temps, elle a appelé le médecin de famille qui, à la fin de ses consultations, passera voir Camille. La jeune fille avale les comprimés sans broncher. Sa mère remarque le téléphone portable qui dépasse de l’oreiller. Elle annonce qu’elle va préparer le dîner et redescend. Dans la cuisine dont la fenêtre ouvre sur le petit jardin, elle allume la radio branchée sur un programme de variétés. Elle réchauffe le potage de légumes préparé hier soir et fait griller des escalopes de dinde avec des pommes de terre. Elle et Camille pourraient se contenter d’une soupe et d’un yaourt, mais Maxime a le corps d’un homme à présent et l’appétit qui va avec. C’est lui l’homme de la maison, aujourd’hui que Patrick est parti. Sylvie Lebon se dit que la séparation de ses parents n’est peut-être pas étrangère au mal-être de Camille. Celle-ci a dix-neuf ans, mais elle a encore besoin de son père. Tandis qu’elle achève de mettre la table, la sonnette de l’entrée retentit. Sylvie Lebon éteint la radio et va ouvrir au médecin. Âgé de quarante-cinq ans, il est de taille moyenne, avec un léger embonpoint et le crâne qui ne demande qu’à se dégarnir. Il est d’un naturel affable et ses yeux sont volontiers rieurs.
— Entrez, Docteur, merci d’être venu.
— Je vous en prie, Madame Lebon.
— Donnez-moi votre blouson, je vais le mettre à sécher devant le radiateur.
Sylvie Lebon pose le vêtement sur le dossier d’une chaise qu’elle tire devant le radiateur. Prince attrape sa sacoche et emboîte le pas à la maîtresse de maison jusqu’à la chambre de Camille. Puis sur un signe du médecin, la mère s’éclipse discrètement. Le praticien frappe à la porte, entre et allume le plafonnier. La malade se redresse sur ses oreillers et sourit avec lassitude.
— Bonsoir, Docteur.
— Bonsoir, Camille, alors, que t’arrive-t-il ?
— J’ai des maux de tête et des spasmes au ventre.
— Tu es en période de règles ?
— Non, répond-elle après une seconde d’hésitation.
— Tu as mangé quelque chose de particulier ?
— Non, je ne vois pas.
— On va voir ça, tu peux soulever ton tee-shirt ?
La jeune fille s’exécute et se rallonge en fixant pudiquement le plafond. Prince palpe l’abdomen, arrachant un léger gémissement à la patiente. Puis il examine la gorge, écoute le cœur et les poumons. Il lit attentivement le carnet de santé.
Enfin, il commente :
— Tu as déjà été opérée de l’appendicite, on peut donc exclure cette maladie. Je vois que je t’ai soignée pour les mêmes symptômes le mois dernier. Les douleurs se sont calmées entre-temps ?
— Oui, au bout de quelques jours.
— Et ce sont les mêmes douleurs aujourd’hui ?
— Oui, mais plus fortes.
— Il faudrait peut-être revoir ton alimentation. Tu bois beaucoup de café ?
— Non.
— Tu manges épicé ?
— Non, je n’aime pas ça, réplique-t-elle en secouant la tête.
— Tu manges beaucoup de chocolat, de graisses ?
— Non, Maman cuisine équilibré et à la cantine, c’est plutôt pas mal.
— Et ces maux de tête, ils reviennent plusieurs fois au cours de la même journée ?
— Oui, c’est ça. Il y a des moments de répit et puis ça repart.
— Des deux côtés de la tête ?
— Non, un seul. On dirait que ça tape là, indique Camille en pointant sa tempe droite.
— Douleur pulsatile, note le médecin. Bon, des nausées, des vomissements ?
— Non, seulement des douleurs à l’estomac. Par vagues.
— Tu as combien de température ?
— 37.9
— Bon, on ne peut exclure un virus de gastro-entérite. Ceci dit, ajoute le médecin en fronçant les sourcils, ça paraît peu probable étant donné que tu as eu les mêmes symptômes il y a un mois. Je pencherais davantage pour un profil migraineux. Je vais te prescrire un antimigraineux. Mais si, d’ici quarante-huit heures, ton état ne s’était pas amélioré, tu viens au cabinet et je te prescrirai des analyses médicales.
— D’accord, merci Docteur.
Le médecin redescend au rez-de-chaussée et répète à Sylvie Lebon ce qu’il vient d’expliquer à la jeune fille. Puis après s’être fait régler la visite à domicile, le médecin enfile sa veste que le radiateur a agréablement chauffée. Lorsqu’il franchit le seuil, la femme a l’intuition que le médecin sera de retour avant longtemps.
*
Ses doigts volettent sur le clavier. Elle répond à toute vitesse. Elle aime l’immédiateté du rapport. Elle dit, l’autre réagit. Aussitôt. Elle a l’impression d’exister pleinement. Être au centre de l’attention, c’est être au centre de la vie. Elle est soudain l’actrice d’un film qu’elle rêverait écrit pour elle. Mais la satisfaction immédiate est trop vite oubliée. C’est comme une drogue qui ne ferait plus d’effet. Il lui en faudrait plus, alors elle décide d’aller plus loin. Elle a pris goût à cette poussée d’adrénaline que lui procure l’alerte de la boîte mail. Elle a tellement d’importance soudain. Son opinion, ses états d’âme comptent tellement. Alors, elle se lâche complètement et laisse son imagination guider ses doigts.
*
Marie Bacconière a dressé le couvert et disposé le plateau de sushis sur l’îlot central en béton ciré. Le riz finit de cuire dans l’autocuiseur. Les enfants sont invisibles. Marie Bacconière chantonne doucement. À l’approche du week-end, elle se sent détendue. Robert a promis de rentrer tôt. Elle a troqué son pantalon noir et ses escarpins pour une tenue d’intérieur et relevé ses cheveux à l’aide d’une grosse pince. Grande, elle a les jambes minces, les hanches un peu larges et la poitrine rebondie. Sa grande taille s’accommode parfaitement de ses rondeurs. Pourtant, Marie Bacconière veille à ne pas trop céder à la gourmandise. Au moment où elle termine ses préparatifs, elle entend le cliquetis de la porte d’entrée. Robert Bacconière entre directement dans la vaste cuisine et embrasse son épouse. Elle a à peine senti ses lèvres sur sa joue. En revanche, le contact froid du pardessus mouillé lui arrache un frisson. Il est plus petit qu’elle. Carré d’épaules, il est mince et porte ses cheveux bruns coupés court. Ses yeux sombres sont brillants.
— Brrr, tu es trempé !
— Oui, ma place était prise en bas, du coup, je me suis garé rue Franklin et comme il pleut à verse…
— Oui, ça n’a pas arrêté de la journée. Idéal pour les visites ! ironise-t-elle.
Elle tient une agence immobilière place du Commerce et redoute les jours pluvieux où elle doit accompagner acheteurs ou locataires potentiels à la recherche du logement de leurs rêves.
— Moi, au moins, reconnaît son mari en se débarrassant de· son vêtement trempé, je suis au sec dans mon cabinet. Mais je n’ai pas arrêté de la journée. J’ai eu trois urgences si bien que je n’ai pas eu le temps de déjeuner.
— J’ai fait des sushis, indique Marie Bacconière en désignant le plateau.
— Super ! Les enfants vont bien ?
— Oui, ils sont dans leur chambre, j’imagine qu’ils sont devant un écran quelconque…
— Sans doute ! Je les appelle pour dîner ?
— Vas-y, j’égoutte le riz et c’est prêt.
Les enfants arrivent bruyamment. Les cadets se disputent au sujet de quelque jeu vidéo tandis que l’aînée envoie un dernier SMS tout en marchant. Pendant le repas, Bacconière parle à peine. Son épouse s’en rend compte mais choisit de mettre ce mutisme sur le compte de la légitime fatigue de fin de semaine. De toute manière, le silence n’a rien de gênant car les deux plus jeunes, Pablo et Pedro, parlent pour cinq. Éva est plongée dans ses pensées mais fait malgré tout honneur au repas japonais. Bacconière entend le babillage de ses fils mais de très loin, comme s’il était dans une bulle. Il se sent préoccupé. Il reçoit sans arrêt des SMS et comme il n’y répond pas, elle appelle maintenant au cabinet. Elle se fait passer pour une patiente qui souhaite parler au docteur en urgence. Ce matin, elle était une jeune femme qui soupçonnait une grossesse extra-utérine. Cet après-midi, elle était une future maman dont le terme approchait et dont le bébé ne bougeait plus. À chaque fois, bien sûr, la secrétaire lui passe la communication sans soupçonner qu’il puisse s’agir d’une supercherie. Étant au beau milieu d’une consultation, le gynécologue a dû à chaque fois faire appel à tout son sang-froid pour ne pas l’envoyer promener. Il a fait mine de donner des conseils à cette patiente invisible. Mais à l’autre bout du fil, elle s’est énervée, a exigé qu’ils se voient. Heureusement, la voix était inaudible pour la patiente allongée sur la table. Bacconière a mis un terme à la conversation avec un « Il n’y a pas d’inquiétude à avoir, soyez sans crainte ! » et a adressé un sourire contrit à sa patiente. Il se dit qu’il va devoir la revoir une dernière fois et lui expliquer que tout doit s’arrêter au plus vite. Qu’il a le double de son âge et qu’il ne sait pas ce qui lui a pris. Ou plutôt si, il le sait. Il a une femme parfaite. Agréable, intelligente, jolie. Mais prévisible. Tellement prévisible. Bien sûr, cela a quelque chose de rassurant. Mais il est sans doute à l’âge des bilans. Il se demande s’il n’est pas passé à côté de quelque chose…
*
« Chers amis,
Aujourd’hui, nouvelle séance de chimio. Je me sens mal, si mal. Je n’ai plus de cheveux. J’hésite à poster une photo récente de moi, j’aurais peur de vous effrayer. Je suis si maigre. Et puis j’ai des bleus sur les avant-bras, là où on me plante les seringues. Je ne suis pas encore prête à me mettre totalement à nu devant vous. Un reste d’orgueil déplacé sans doute… J’ai fait le trajet jusqu’à l’hôpital en taxi. J’aurais aimé qu’un parent ou un ami m’accompagne, mais je n’ai pas cette chance. Ce soir, à nouveau, je ne vais pas dîner. Mais, je ne veux pas vous ennuyer avec mes soucis. Vous avez les vôtres, j’en suis sûre. Je vous laisse.
Pensez à votre petite sœur de la Toile (enfin ce qu’il en reste !). »
*
Costay contemple ses mains posées devant lui. Il ne les voit pas. Il est comme tétanisé. Comment Paul a-t-il pu lui faire un tel coup ? Qu’est-ce qu’il lui prend de jouer les redresseurs de tort, les empêcheurs de tourner en rond ? Ses scrupules ont quelque chose de risible. Comme si on attendait toujours le feu vert de tous les spécialistes avant de lancer un produit sur le marché ! Bien sûr qu’un effet secondaire est toujours possible. Bien sûr qu’on n’est jamais à l’abri d’une réaction imprévue à une nouvelle molécule. Mais le risque zéro est une utopie, n’est-ce pas ? Si l’Agence du Médicament donne son feu vert, pourquoi tergiverser ? Costay regarde au dehors. Les gouttes de pluie dégoulinent sur la vitre. Il se dit qu’il est comme cette goutte, là, au milieu du carreau, qui se fait entraîner dans sa chute par celles qui arrivent du dessus. « C’est curieux, observe-t-il, c’est comme si toutes ces gouttes d’eau étaient incapables de faire face seules à leur mort imminente. » Elles descendent, groupées, aspirant dans leur sillage celles qui s’attardent. Cette étrange correspondance avec la nature humaine lui étire un rictus amer. « Si Paul me lâche, je coule. Mais lui avec ! Je me ferai un plaisir de faire connaître son absence de scrupules passée ! » Costay regarde sa montre en or. Cadeau de ses quarante ans. Il peut se faire plaisir à lui et à sa famille et il n’est pas prêt à renoncer à ce privilège durement acquis.
*
Camille Lebon essaie de se lever, mais elle est aussitôt prise de vertiges. Que lui arrive-t-il ? Ça ne peut être une simple gastro-entérite, comme l’a suggéré le médecin. Il a aussi parlé de migraines. Soit, mais alors ces maux d’estomac, ces nausées ? Elle tente de se lever à nouveau. Elle garde les yeux fermés pour ne pas voir le mur tanguer. Avec précaution, elle se glisse au bord du lit et, prenant appui sur ses deux mains, elle se met debout. Elle va à sa table de travail et allume l’ordinateur. Sur le moteur de recherche, elle tape les mots « migraine » et « maux de ventre ». Des dizaines de liens apparaissent aussitôt, alors elle se met à cliquer au hasard. Mais elle ne retrouve pas ses symptômes dans les descriptions faites par les témoins migraineux. Si elle vomissait ou si elle était sensible à la lumière, cela cadrerait. Mais elle souffre d’un mal-être plus général, indéfinissable et invalidant. Elle regarde son téléphone portable qui reste obstinément muet. Et si elle souffrait d’une dépression qui ne veut pas dire son nom ? Après tout, elle n’a plus de goût à rien depuis qu’il l’ignore. Et elle n’a plus d’appétit non plus. Elle n’écoute plus rien en cours. Elle ne pense qu’à lui. Tout le temps.
*
Paul Aundrin actionne les essuie-glaces. L’un des balais crisse désagréablement sur le pare-brise. Cela fait des semaines qu’il doit en changer, mais ça lui était sorti de la tête. Depuis quelques jours, il est uniquement préoccupé par ce qu’il devait annoncer à Costay, à savoir son probable renoncement à la distribution du nouveau produit. Une grande quantité en a déjà été écoulée mais, maintenant que certains effets secondaires ont été exposés au grand jour, on ne peut feindre de ne rien savoir. Et la réaction de Costay l’a surpris. Il pensait qu’il se rangerait à son avis. Qu’il ferait un communiqué prudent, annonçant le retrait provisoire du marché, le temps que les soupçons de toxicité soient levés. Mais il s’est montré inflexible. Il lui a posé un ultimatum. Paul a jusqu’au quinze décembre pour donner sa décision. Au-delà de cette date, c’en sera fini de leur collaboration. Paul plisse les yeux pour percer l’obscurité pluvieuse. Il a du mal à se concentrer sur sa route. Il vient de faire une embardée, suscitant le courroux d’un chauffeur de poids lourd. Il essaie de se recentrer sur sa conduite, mais son esprit s’évade à nouveau. La réaction de Costay est tellement disproportionnée ! Pourquoi mettre un terme à dix ans de collaboration fructueuse juste parce que Paul se retire d’un marché ? Après tout, Costay a d’autres distributeurs, Distripharm n’a pas de contrat d’exclusivité. Et puis Paul compte bien poursuivre la distribution des autres produits Coslab. Alors quoi ? Les choses seraient-elles plus graves qu’elles ne le paraissent ? Costay aurait-il commis des imprudences ? Voire des malhonnêtetés ? Paul refuse d’y croire. Pourtant, l’attitude de Costay ne laisse pas de le chiffonner.
*
Sylvie Lebon débarrasse la table du dîner. Son visage fatigué la fait paraître plus âgée que ses quarante-six ans. Maxime est remonté travailler dans sa chambre. « Qu’il est sérieux », pense-t-elle avec fierté, « il est soucieux de son avenir. » Tandis qu’elle lave la vaisselle, elle songe à Camille qui n’est pas descendue dîner. Assise dans son lit, elle a avalé du bout des lèvres le potage que sa mère lui a porté. Puis elle a mangé la moitié d’une compote. Elle a repoussé le plateau en se plaignant à nouveau du ventre. « Et si elle souffrait d’anorexie ? Cela expliquerait ses difficultés à s’alimenter et sa faiblesse grandissante. » Cependant, elle n’y croit pas. Jusqu’il y a peu, Camille s’alimentait normalement. Elle a toujours été mince et n’a jamais suivi ses amies dans leurs délires de régime. « Mais alors, que lui arrive-t-il ? se répète la vendeuse pour la centième fois. Un chagrin d’amour peut-être ? » Sylvie Lebon vide l’eau savonneuse et entreprend d’essuyer la vaisselle, l’esprit ailleurs. Si Camille a ou a eu un petit ami, elle l’ignore. « Ce qui est normal, se dit-elle, je suis sa mère, pas sa copine. Si elle en a parlé à quelqu’un, c’est probablement à une de ses meilleures amies. Oui, mais dans ce cas, réfléchit-elle en rejetant de son avant-bras nu une mèche qui lui barre le front, pourquoi n’a-t-elle pas le soutien de ses amies aujourd’hui ? » Frappée par cette pensée, elle suspend son geste. « C’est vrai, où sont-elles, les deux amies de toujours ? Cela fait bien longtemps qu’on ne les a pas vues à la maison. » Elle secoue la tête, perplexe, avant de reprendre son essuyage. Elle continue à réfléchir. L’hypothèse du chagrin amoureux ne la convainc pas vraiment. Depuis quand les peines d’amour rendent-elles aussi souffrants ? Les poètes et les chanteurs célèbrent « la maladie d’amour », mais ils ne la dépeignent pas sous un jour si terrible, n’est-ce pas ? Bien sûr, elle-même n’a jamais surmonté le départ de Patrick. Depuis qu’il est parti un beau matin, il y a six ans, elle n’a plus jamais été la même. Elle a fait une grave dépression à l’époque. Puis elle s’est relevée, mais elle avait définitivement perdu sa joie de vivre. Depuis, elle a du mal à faire confiance aux hommes. Mais elle a toujours essayé d’être là pour les enfants. Malgré les baisses de moral et l’envie, parfois, d’en finir. Elle secoue la tête à nouveau et laisse retomber le torchon le long de sa cuisse. Non, Camille n’est pas du genre à se laisser aller à la dérive par dépit amoureux. Il doit y avoir autre chose. En tout cas, se jure-t-elle, une chose est sûre, elle se battra pour sa fille !
*
Allongé auprès de sa femme, Robert Bacconière ne parvient pas à trouver le sommeil. L’insistance de la jeune femme le perturbe. Bien sûr, il suffirait de ne pas prendre ses communications, mais comment filtrer ses appels au cabinet ? Il ne sait plus que faire. Peut-être devrait-il lui proposer tout bonnement une dernière rencontre ? Il lui dira, avant le rendez-vous, qu’il veut faire le point avec elle, ainsi elle n’entretiendra pas de faux espoirs. Voilà, c’est ça, il va lui fixer rendez-vous pour mardi après-midi. Exceptionnellement, il n’a pas de consultation ce jour-là. Bacconière se sent enfin soulagé. Pourtant, deux heures plus tard, le sommeil lui résiste encore. Il se dit que tant qu’il n’aura pas concrétisé son projet, il ne trouvera pas le repos. Alors, il se lève avec précaution pour ne pas réveiller sa femme. Même s’il sait qu’elle a un sommeil de plomb. À tâtons, il va dans le bureau. Sa sacoche est posée dans le coin. Il l’ouvre et d’un étui censé abriter une paire de lunettes, il exhume un téléphone portable dont très peu d’élus ont le numéro. Prudemment, il va s’enfermer dans les toilettes. Il ne faudrait pas que sa femme ou un enfant le surprenne en train de pianoter comme un voleur sur son téléphone portable.
Il envoie un SMS bref : « Il faut qu’on fasse le point. Mardi 14h. Au Molière. Serai au fond. » Il évite l’éculé « Je t’embrasse. » Il n’en a plus envie à présent.
*
Caroline Costay sent son mari tendu. Il n’a pas desserré les dents au dîner. En ce moment, il fixe l’écran de télévision sans le voir.
Maintenant qu’Amandine est couchée avec un livre et Capucine occupée dans sa chambre, elle tente une manœuvre d’approche :
— Quelque chose ne va pas ?
Il sursaute comme s’il avait oublié sa présence. Puis il se reprend :
— Non, enfin, si, des petits soucis au labo.
— De quel ordre ?
— Disons, technique, répond vaguement Costay.
Il n’a pas envie de parler de ses soucis à Caroline. À quoi bon ? S’il lui dit les réticences de Paul, elle va forcément abonder dans son sens. Qui ne le ferait pas ? Oui, qui ? s’interroge le directeur du laboratoire. Quelqu’un qui place ses intérêts avant le bien public, voilà qui ! Pourtant, il refuse de s’accabler de la sorte. Il est sûr de son fait. Il sait bien que dès qu’on touche au domaine de la santé, on pénètre dans un domaine sacré, on outrepasse ses droits de simple mortel. Mais de tout temps, l’être humain a essayé de prendre la place de Dieu en tentant de sauver des vies…
— Technique ? C’est-à-dire, la mise au point d’un produit ou d’un protocole ? insiste Caroline Costay en penchant le buste vers lui.
Il secoue la tête avec l’envie farouche de ne rien répondre. Mais il connaît sa femme et son opiniâtreté, elle ne le laissera pas s’en tirer aussi facilement. Alors, il explique :
— Non, le produit est déjà sur le marché depuis six mois, mais il se trouve que certaines patientes se seraient plaintes d’effets secondaires…
— Importants ? interrompt Caroline.
Costay balaie la question d’un geste impatient.
— Importants, je ne sais pas, disons suffisamment pour avoir alerté l’Agence du Médicament.
— Ah, quand même !
— Quoi : « Ah, quand même ! », tu sais comment sont les gens aujourd’hui, prêts à traîner en procès n’importe qui pour n’importe quoi ! s’échauffe Costay en se jetant sur ses pieds.
Il va à la fenêtre et entrouvre les lourdes tentures. Quelques passants ont eu le courage d’affronter les intempéries, des jeunes pour la plupart. « J’étais pareil à vingt ans, toujours prêt à partir en goguette. » Costay les observe non sans un brin d’envie. Caroline est restée sur le canapé, les yeux rivés sur l’écran de télévision. Elle n’a pas le courage de poursuivre la conversation. De toute manière, elle sait que Jacques ne lui dira que ce qu’il veut bien lui dire. Il peut se montrer si têtu parfois ! D’un autre côté, se rassure-t-elle, ce défaut est sa force et a fait son succès en affaires. Pourtant, elle a beau essayer de se convaincre que son mari sait probablement ce qu’il est en train de faire, elle se sent étrangement inquiète. Et elle sait que ses intuitions la trompent rarement…
*
— Ça va, chéri ?
— Oui, un peu de fatigue, c’est tout.
Sonia Aundrin est allée au réfrigérateur comme si elle se satisfaisait de ce mensonge. Mais le soir même, au lit, elle est revenue à la charge. Pelotonnée contre lui, elle a susurré d’une voix mutine :
— Blonde ou brune ?
Il a ri.
— Gros seins ?
— Évidemment, quelle question !
Amusé, il l’a serrée contre lui. Sa chemise de nuit faussement ingénue laissait voir une poitrine rebondie. Depuis la naissance d’Anatole et son allaitement, Sonia avait, contrairement à toute attente, gagné une bonne taille de bonnet. Paul était ravi du changement. Sonia, pour sa part, avait eu du mal à se faire à cette nouvelle féminité. Elle avait décidé d’en faire un atout et depuis, elle portait volontiers des décolletés.
Elle s’est hissée sur les coudes et retrouvant un ton plus sérieux, a insisté :
— Dis-moi ce qui ne va pas. Ça n’a rien à voir avec nous deux, n’est-ce pas ?
— Non, qu’est-ce que tu vas imaginer ! a-t-il répondu en caressant ses cheveux blonds.
— Alors, c’est quoi ?
Il a gardé le silence quelques secondes avant de se lancer :
— C’est Jacques…
— Quoi, « Jacques » ? s’est-elle écriée en se mettant sur son séant.
— Eh bien, je lui ai dit que je me retirais d’un marché…
— Ah bon et pourquoi ça ? l’interrompt Sonia en glissant ses cheveux derrière ses oreilles.
— Des médecins ont parlé d’effets secondaires importants à propos d’un médicament que Coslab commercialise depuis plus de six mois.
— Et ?
— Et j’ai dit à Jacques que dans l’attente de nouvelles vérifications, je préférais appliquer le principe de précaution.
— Ce qui est tout à fait légitime !
— Oui, sauf que lui ne l’a pas entendu de cette oreille et m’a donné quinze jours pour prendre ma décision.
— Ça te laisse peut-être le temps de faire les vérifications qui s’imposent ? avance Sonia sans conviction.
Gravement, le jeune homme secoue la tête.
— À mon avis, je n’aurai pas connaissance de nouveaux cas en un si petit laps de temps.
— Ce qui ne signifie pas qu’il n’y en a pas ou qu’il n’y en aura pas d’autres.
— Évidemment. Mais Jacques veut du concret, lui. Et même si je suis convaincu que les prochains résultats corroboreront les précédents, je n’aurai sans doute aucun nouveau chiffre à lui communiquer d’ici au quinze décembre.
— Probablement, acquiesce Sonia gravement. Ce délai de quinze jours ne rime à rien et Jacques le sait pertinemment. Il te laisse un sursis qui n’en est pas un.
Paul hoche silencieusement la tête. Cela lui fait du bien de s’ouvrir de ses soucis. Mais, du même coup, l’analyse de Sonia a transformé ses doutes en certitude : non, Jacques ne lui laisse pas vraiment le choix. En exigeant une réponse si rapide, il pousse Paul à prendre une décision guidée par des impératifs non plus moraux mais financiers. Le jeune homme se sent acculé, tiraillé entre des exigences de père de famille censé subvenir aux besoins des siens et des scrupules qui lui commandent de ne rien faire dont il pourrait avoir honte. Il sent les muscles de son dos tendus, douloureux. Il essaie de se cambrer mais esquisse une grimace. Alors, Sonia vient se placer derrière lui et entreprend de masser sa nuque nouée. Il soupire d’aise tandis que les petites mains pétrissent ses cervicales tendues à se rompre. Il ferme les yeux en sentant les tensions s’alléger. Quel bonheur de pouvoir partager avec Sonia ! Elle sait écouter et ne porte jamais de jugement à l’emporte-pièce. À l’abri du bouclier de son corps accueillant, il se demande ce qu’il ferait sans elle. « D’un autre côté », songe-t-il en se raidissant à nouveau, « c’est en partie parce que Sonia ne travaille pas que je vais peut-être devoir choisir l’option la moins reluisante ! Si elle gagnait un salaire, je pourrais me permettre de cesser ma collaboration avec Jacques ! » Au même moment, comme si elles étaient douées d’un sixième sens, les mains de Sonia se font plus caressantes, enjôleuses. Puis comme pour bien marquer leur autorité, elles affermissent de nouveau leur prise et arrachent un petit gémissement à Paul. Mais la torture cesse et les doigts se mettent à alterner douceur et fermeté. Obéissant au rappel à l’ordre des mains aimées, Paul a ravalé la pensée mesquine qui lui a fugacement traversé l’esprit. Et décidant de céder à l’instinct de plaisir, il attrape le bras menu et attire Sonia face à lui. D’une poigne qui ne souffre aucun refus, il l’allonge sur le lit. Elle se laisse faire, les yeux plantés dans les siens. Elle ne feint pas la pudeur mais dit clairement son désir dans ses yeux qui brûlent. Il décide de la faire languir, comme si en prenant les rênes de l’étreinte à venir, il réaffirmait son pouvoir sur sa propre vie. Paul se met à regarder Sonia, très lentement, s’attardant sur les courbes de ses seins qui se devinent sous le coton de la chemise de nuit. Elle gémit doucement, les yeux étrécis. Mais il continue son examen cruel, descend le long de ses cuisses, effleure du regard le vallon caché. Elle entrouvre imperceptiblement les jambes mais déjà, son regard est plus haut. Il avance une main qu’il pose à l’échancrure de sa gorge. Du bout du doigt, il dessine la lourdeur du sein. L’un puis l’autre, toujours lentement. Sonia a fermé les yeux, le front légèrement plissé par l’attente. Puis il plaque sa main sur son ventre ferme et s’y arrête, sans bouger. La chaleur de sa paume traverse le tissu et irradie la peau tendre. N’y tenant plus, Sonia attrape la main de Paul, le repousse sur le lit et s’installe à califourchon sur lui. Elle arrache sa chemise de nuit, se tortille en riant pour ôter sa culotte et ainsi nue, le met à son tour au supplice. Doucement, elle va et vient sur lui, toujours vêtu. Alors, vivement, tout en maintenant la jeune femme sur lui, il se débarrasse à son tour de son pyjama et accueille Sonia. Submergés par un désir que l’inquiétude a nourri, les deux amants gémissent à l’unisson lorsque le plaisir s’empare d’eux.
*
Camille Lebon a passé la soirée au lit. Elle n’a plus de température ce matin, mais elle se sent percluse de douleurs. Elle a toujours mal au ventre et à la tête. Elle a senti son téléphone vibrer au milieu de la nuit. Instinctivement, du fond de son rêve, elle a tâtonné à la recherche du combiné. Une sourde angoisse l’a saisie, la certitude qu’un message dans la nuit ne peut être porteur de bonne nouvelle. Elle s’est pourtant forcée à faire glisser le clapet du téléphone. Puis, comme si elle s’élançait pour une course de fond, elle s’est mise à lire le message. Après coup, elle s’est dit qu’elle aurait dû attendre, pour faire durer l’espoir, pour s’offrir une fugace illusion du bonheur. Mais elle a lu. Laconique, Robert lui proposait un rendez-vous. Pour faire le point. La formule vide de sens lui a arraché un gémissement de désespoir. Ainsi donc, leur histoire allait se terminer, aussi banalement que toutes les autres ! Pour ne pas qu’on l’entende, elle a étouffé ses sanglots dans l’oreiller, hoquetant à perdre haleine. Elle a cru, elle a même espéré un instant qu’elle ne résisterait pas à cette douleur. Plutôt mourir que de le perdre ! Et puis soudain, venu d’elle ne sait où, une petite voix s’est fait entendre, l’écho de quelque volonté enfouie, et elle s’est dit qu’elle ne devait pas sombrer. Elle irait à ce rendez-vous. Et regagnerait son amour.
*
« Chers amis de la Toile,
J’ai une trêve ce week-end. Enfin, façon de parler ! Je suis si fatiguée que les médecins ont jugé préférable de ne pas me faire de séance pendant les trois prochains jours. C’est un soulagement, bien sûr, mais d’un autre côté, j’appréhende ces trois jours de solitude. Au moins, quand je vais à l’hôpital, je vois du monde : le chauffeur de taxi, le personnel soignant, les malades même ! Allons, il ne faut pas se laisser aller au découragement ! Certaines personnes sont plus à plaindre que moi ! J’arrive encore à me lever, c’est déjà ça. Heureusement, d’ailleurs, car je vis seule. Je redoute le jour où je serai clouée au lit. Que m’arrivera-t-il alors ? Ce sera sans doute la fin… Mais, je n’en suis pas encore là, Dieu merci ! Même si je perds du poids à vue d’œil, je suis toujours de ce monde.
Chers amis, essayez d’avoir une petite pensée pour moi. J’en demande beaucoup, c’est vrai, mais vos paroles de réconfort m’empêchent de sombrer définitivement…
Votre petite sœur de la Toile qui s’accroche tant qu’elle peut… »
*
Samedi matin. Costay se lève tôt. Il a si mal dormi qu’il a été soulagé de voir s’inscrire 6 heures 38 sur le radio-réveil. Il se glisse silencieusement hors du lit et va à la cuisine. Pieds nus sur le carrelage, il frissonne, debout devant la haute fenêtre. Un verre de jus de raisin à la main, il regarde le ciel encore sombre. Les lampadaires éclairent la rue déserte. Dans le faisceau de lumière danse une bruine lente. Il sent son corps courbaturé et son cerveau embrumé. Pourtant, il décide que seule la course à pied pourra lui vider l’esprit et lui redonner un semblant d’énergie. Il ne déroge jamais à ce rituel de fin de semaine. Il court le samedi matin et joue au golf le dimanche matin. D’un pas lourd, Costay gagne le dressing. Il enfile un survêtement et ses chaussures de sport. Par précaution, il glisse son portefeuille dans sa poche intérieure, puis sans bruit, il quitte l’appartement. Les trois étages sont complètement silencieux. Lorsqu’il débouche dans la rue piétonne, sept heures sonnent au clocher de l’église. L’air embaume les viennoiseries et le pain frais de la boulangerie toute proche. Les devantures des boutiques sont allumées, donnant une impression de vie à la ville endormie. Costay s’élance, le froid lui pique les narines et lui embue le regard. Les premières secondes lui pèsent, puis sa foulée s’affermit. Il prend son rythme, sa respiration se fait régulière. Il sent que la tension s’allège. Il croit entrevoir une issue favorable à ses problèmes du moment.
*
Elle verrouille l’ordinateur et se frotte les paupières. Les yeux brûlants d’avoir trop fixé l’écran. Sa nuque est raide, douloureuse. Elle se lève et se glisse sous la couette. Elle entend déjà du bruit dans l’appartement. Il faudrait qu’elle dorme, sinon elle va être d’une humeur exécrable toute la journée. Elle sait tout ça, mais elle n’arrive pas à se raisonner. C’est plus fort qu’elle, elle a besoin de se donner de l’importance. Elle veut mettre du piment dans son existence bien rangée, dans son avenir programmé. Elle ne fait de mal à personne, si ? Elle ne fait qu’éveiller le désir d’identification qui sommeille en chacun. Tout le monde veut jouer un rôle, n’est-ce pas ? C’est naturel. Elle se souvient de ces années pas si lointaines où elle se déguisait en fée ou en mariée. C’était son jeu favori. Elle élaborait des scénarii improbables qui faisaient dire à ses parents qu’elle avait vraiment un talent pour l’improvisation ou l’écriture. Elle se retourne dans son lit, elle devrait dormir. Elle regonfle son oreiller en tapotant dessus. Elle repose la tête, soupire. La dernière fois qu’elle regarde son réveil, il indique 7 heures 02.
*
À petites foulées, Costay atteint les bords de l’Erdre qu’il se met à longer. Il court en direction du nord. Sur sa droite se dresse l’île de Versailles, lieu de promenade très prisé avec son jardin japonais et ses temples d’inspiration bouddhiste. Il commence à transpirer malgré le froid. Il aime cette heure où tout est calme. Il traverse le pont Général de la Motte Rouge avec ses arches métalliques qui rappellent un peu la Tour Eiffel. Arrivé sur l’autre rive, il voit le commissariat Waldeck-Rousseau qui dresse son immense façade. Il passe devant le bureau des Bateaux Nantais qui propose des croisières sur l’Erdre à bord de petits ferries. Puis il ralentit le pas pour descendre l’escalier menant au bord de l’eau. L’été, les pelouses au bord de la rivière sont envahies de pique-niqueurs ou de joueurs de badminton. Mais en ce petit matin du mois de décembre, les joggeurs et cyclistes se comptent sur les doigts de la main. Ça ne le gêne pas, au contraire. Il aime courir sans devoir slalomer entre les groupes de coureurs plus soucieux de muscler leur langue que leurs mollets. Le grand air lui éclaircit un peu les idées, mais la colère demeure. Il en veut à Paul qui s’apprête à le lâcher en pleine tourmente, comme un mauvais capitaine qui quitterait le navire. « Il a l’air d’oublier que c’est grâce à moi si les affaires vont si bien pour lui aujourd’hui ! Il n’est pas simple distributeur, il a un intéressement sur les ventes, alors de quel droit cracher dans la soupe ? » Costay se met soudain à accélérer comme pour chasser ces idées noires. Il sent son tee-shirt qui commence à lui coller au dos, malgré le froid ambiant. Le vent glacial fige la sueur sur sa peau et lui arrache des larmes. L’effort lui fait du bien mais ne parvient pas à émousser sa hargne. Et malgré les arguments qu’il se répète, il sait qu’il fait preuve de mauvaise foi. Non, Paul ne l’a pas vraiment pris en traître. Un mois après le lancement du produit déjà, il avait émis des réticences quant à son innocuité. Des médecins avaient fait part de témoignages inquiétants de patientes. Costay s’en était même ouvert à son ami gynécologue, Bacconière. La discussion est encore très vive dans sa mémoire. Ils avaient discuté pendant une partie de golf dominicale :
— Paul m’a fait un peu peur, avait commencé Costay en tirant son caddie. Des médecins américains parlent d’effets secondaires très inquiétants. Je me demande si…
— Attends, l’avait interrompu Bacconière, qui marchait à ses côtés, vêtu de blanc et vert, si on se met à écouter tous les oiseaux de mauvais augure, on ne fait plus rien ! Et jusqu’à preuve du contraire, tout médicament est potentiellement dangereux si un patient se révèle allergique à un constituant ! Pour autant, il faut évaluer les choses en termes de bénéfice, comme on l’a toujours fait. Par exemple, on sait très bien que la chimio est très pénible et pourtant, dans la balance, le bénéfice l’emporte !
Vaincu par l’argumentaire, Costay s’était tu. Son collègue avait raison et il ne demandait qu’à se ranger à son avis. Et en ce moment, il est toujours convaincu qu’il a raison de produire ce médicament. Les femmes le remercieront un jour ! Il s’engage sur la passerelle de bois enjambant la rivière et admire les manoirs en surplomb dont les pelouses descendent en pente douce vers la rive. Ces bâtisses qu’on appelait «folies» au siècle passé rappellent au promeneur une page d’histoire que les Nantais aimeraient oublier. En effet, nombre de leurs propriétaires avaient fait fortune dans la traite négrière. Les canards et les cygnes habituellement maîtres des lieux sont encore invisibles à cette heure matinale. Tandis qu’il commence à peiner, Costay reconnaît en lui-même que les choses ont évolué en six mois de temps. Il semblerait – selon certains médecins dont il ne sait s’il doit prendre le témoignage pour argent comptant – que les cas d’intolérance se soient multipliés. Dans le doute, il va réfléchir avant d’administrer le produit à sa fille aînée. Et demain, il en parlera avec Bacconière. Il verra s’il partage ses inquiétudes.