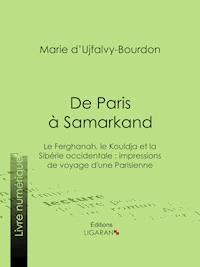
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "C'en est fait ! mon mari, M. de Ujfalvy, chargé par le ministre de l'instruction publique d'une mission en Russie et dans l'Asie centrale, quittera Paris le 10 août 1876. Je suis résolue à le suivre. Nous avons deux mois pour nous rendre à Saint-Pétersbourg ; il nous est permis de passer par Gratz, en Autriche, et d'y prendre congé de la famille de M. de Ujfalvy."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À SON EXCELLENCE
MONSIEUR LE GÉNÉRAL DE KAUFFMANN
GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU TURKESTAN
EXCELLENCE,
Permettez-moi de vous dédier un récit de voyage écrit au jour le jour, sous l’influence des impressions du moment. Vous avez été si aimable pour mon mari et pour moi, que j’ai voulu acquitter une dette de reconnaissance en plaçant votre nom en tête de mon livre.
Je viens demander votre indulgence pour les imperfections de mon œuvre, mais la contrée que vous administrez est si intéressante que je voudrais donner aux Françaises, que l’on dit ennemies des voyages, l’envie de visiter l’Asie centrale et ses merveilles. Mes compatriotes seront sûres d’y être bien accueillies.
Que mon désir de voir imiter mon exemple me serve d’excuse !
MARIE DE UJFALVY-BOURDON.
PARIS, le 4 Novembre 1878.
Le départ. – De Paris à Munich. – Le Semering. – Le tunnel. – La verte Styrie. – Maria-Trost. – Sanct-Martin. – Moravie. – Galicie. – L’officieux israélite. – À la douane. – Les tumuli polonais. – Le conseiller russe. – Varsovie. – Le quartier juif. – Les jeunes Kellner. – Nous retrouvons Saint-Cloud. – L’hydromel. – Les cimetières. Saint-Pétersbourg.
C’en est fait ! mon mari, M. de Ujfalvy chargé par le ministre de l’instruction publique d’une mission en Russie et dans l’Asie centrale, quittera Paris le 10 août 1876. Je suis résolue à le suivre.
Nous avons deux mois pour nous rendre à Saint-Pétersbourg ; il nous est permis de passer par Gratz, en Autriche, et d’y prendre congé de la famille de M. de Ujfalvy. C’est un aurevoir que nous allons prononcer tout haut ; c’est presque un adieu que nous murmurerons tout bas.
Mes malles sont bientôt faites : qu’emporter dans de si lointaines pérégrinations ? Tout ou rien. J’ai pris le dernier parti. On nous a conseillé, d’ailleurs, de faire nos achats, suivant les temps et les circonstances, au fur et à mesure de nos besoins. On a emballé ce qui nous semblait indispensable, et cet indispensable constitue encore un bagage deux fois trop gênant et comme volume et comme poids : les colis sont des boulets rivés aux pieds du voyageur.
Le trajet de Paris à Vienne est devenu une promenade : deux jours et une nuit, ou deux nuits et un jour, suivant l’heure choisie pour le départ ; tout au plus une étape dans un voyage comme le nôtre. La conversation laisse peu de loisir au sommeil et à la méditation. Si les réflexions ont une couleur, je puis dire que les miennes sont bariolées et que le rose n’y prédomine pas : on comprend aisément qu’elles prennent la teinte grise des profondeurs lointaines vers lesquelles nous nous engageons. Nos compagnons de voyage eux-mêmes sont mélancoliques : ce sont un prince roumain. – la Roumanie est féconde en princes. – sa mère et sa sœur. Cette famille ne paraît pas ravie de retourner au pays.
Voici déjà l’Alsace !… Combien la frontière allemande est proche de Paris ! Je l’avais déjà franchie en 1869, mais alors elle était plus reculée. Je n’en étais pas moins triste, car je venais de perdre ma mère. Au souvenir ravivé d’un deuil de famille se joint aujourd’hui l’amertume d’un deuil patriotique. Cette terre était libre naguère, et j’en respirais l’air à pleins poumons. Que les temps sont changés ! À chaque station, des uniformes allemands, des inscriptions allemandes… L’Allemagne a voulu estampiller sa conquête et afficher sa domination sous tous les insignes et sur toutes les enseignes. « Station de Zabern ! » crie le conducteur. Zabern pour Saverne ! En dépit de mon serrement de cœur, cette traduction me fait sourire ; je pense qu’un grand poète allemand. Schiller, a eu le bon esprit d’appeler Saverne Saverne, et de lui donner ainsi le droit de cité dans une de ses remarquables ballades.
Nous franchissons le Rhin ; bientôt s’enfuient derrière nous Carlsruhe la bien alignée ; l’honnête Stuttgart, qui a vu grandir le libraire Cotta ; Munich l’Athènes bavaroise ; voici les superbes versants du Wiener-Wald, voici le Danube, le beau Danube bleu.
Les rives du Danube m’ont toujours paru bien autrement originales que les rives du Rhin ; est-ce parce que celles-ci ont fourni trop de modèles aux enluminures ou trop de décors aux théâtres ? Le Danube, s’il n’est pas absolument neuf, n’est pas encore défraîchi. La nature y est simple et grande ; elle n’y affecte pas de ces allures agaçantes ou étudiées qui semblent faire appel à l’admiration et peut-être à la générosité du touriste.
Nous sommes à Vienne, et nous ferions volontiers notre Capoue de cette séduisante capitale si l’index du dieu qui préside aux missions scientifiques ne flamboyait pas devant M. de Ujfalvy et si une voix intérieure ne lui criait pas : Marche !… marche !… Et M. de Ujfalvy marche, et il faut bien que je marche avec lui, puisque la femme doit suivre son mari, et nous marchons avec les jambes du Juif errant, qui se sont incarnées aujourd’hui dans des bielles de locomotive.
De Vienne à Gratz, tout est nouveau pour moi. Le chemin de fer gravit le Semering sur une pente si douce, que l’on parvient à la crête sans s’en apercevoir. Le panorama est vraiment grandiose : mamelons entrecoupés de champs fertiles, véritables tapis de verdure, maisonnettes disséminées sous nos pieds et d’où s’échappe une légère fumée, troupeaux qui paissent, vieilles ruines sur le haut de montagnes rocheuses et couvertes de sapins. Et le chemin de fer monte encore, monte toujours, enjambant les gouffres sur des empilements de viaducs, trouant les monts sous des tunnels où l’on a su faire pénétrer le jour. Le dernier souterrain qu’il traverse est d’une longueur désespérante ; on sent peser sur ses épaules des blocs plus monstrueux que ceux qui ont écrasé les Titans ; aussi un soupir de soulagement s’échappe-t-il de la poitrine du voyageur quand il voit reparaître le ciel.
Au sommet du Semering s’élève le buste de l’ingénieur qui a construit cet audacieux railway ; il semble placé là pour recevoir le tribut des émotions diverses qu’il nous a fait éprouver. Le train s’arrête comme essoufflé ; des jeunes filles accourent pour offrir de charmants bouquets de fleurs des Alpes. En Autriche, les jeunes filles présentent des fleurs ; en France, elles apportaient des journaux ; en Allemagne, elles tendaient des bocks.
Le train repart après quelques minutes d’arrêt, et nous redescendons avec une douce quiétude l’autre versant de la montagne, dans un océan de fraîche verdure qui a valu au pays le nom de verte Styrie (die grüne Steiermark). Le paysage est toujours varié, mais la végétation alpestre a disparu.
Nous arrivons à Gratz où, si agréable qu’ait été le voyage, nous serons heureux de prendre baleine et de goûter quelque repos. C’est « la ville des grâces sur le fleuve de l’amour, » a dit Napoléon III. On l’aperçoit de loin, car le château couronne la montagne autour de laquelle la ville s’est bâtie, ville charmante qu’arrose la rivière Mur et que son parc et ses jardins transforment en oasis. Le parc surtout est magnifique, ses grandes et belles allées convergent sur un rond-point que décore une fontaine monumentale, semblable à celles de la place de la Concorde à Paris. Les maisons sont spacieuses et propres. La propreté est la qualité caractéristique de la Styrie ; on l’apprécie à chaque pas, elle apporte son rayonnement dans l’intérieur, sa limpidité dans les promenades. Les environs de Gratz, sont au nombre des principaux agréments de cette résidence ; les plus renommés sont Maria-Trost (Marie Consolatrice) et Sanct-Martin.
Maria-Trost doit son nom à une église bâtie au sommet d’une montagne d’où l’on contemple un magnifique panorama. Les pèlerins gravissent à genoux les marches qui conduisent au monument ; l’exercice est pénible, car les gradins sont escarpés et la montée est rude. Si, en Styrie, les processions se font sur les genoux, dans la Prusse rhénane elles se font à quatre pattes. Sanct-Martin, un silo charmant qu’on va chercher au fond des bois, est renomme pour le joli ruisseau qui serpente à travers ses prés, ses taillis et ses futaies.
Après quelque temps passé au milieu de notre famille, nous parlons vers la fin de septembre pour notre long voyage. Nous nous arrêtons quelques jours à Vienne, ville charmante que je ne décrirai pas, car ce serait une redite, et nous y achetons à la hâte les objets nécessaires pour traverser la Sibérie, ayant été prévenus que les florins d’ici se changent en roubles à Saint-Pétersbourg. Enfin, le 1er octobre, le chemin de fer nous emporte de Vienne à Varsovie, munis de toutes nos fourrures : celle de mon mari excite mon hilarité, je ne puis m’imaginer qu’il en aura jamais besoin, il fait si beau et le soleil est si rayonnant !
Nous traversons la basse Autriche, la Moravie, la Silésie autrichienne et un tout petit coin de la Galicie. La basse Autriche est un pays plat, mais où la culture ne laisse rien à désirer ; le pays me paraît plus accidenté en Moravie, les collines sont riantes, de charmants petits villages bordent la route, tout respire l’aisance.
En Silésie, nous voyons de grandes houillères ; en Galicie, de vastes forêts de pins. Voilà tout ce qu’il m’est permis d’admirer, bien que nous ne marchions pas à grande vitesse. Nous prenons nos repas dans des stations assez malpropres, entourés de force juifs polonais qu’il est facile de reconnaître à leurs costumes et à leur mépris de la toilette. Un vieil israélite à barbe blanche, plus soigné que ses coreligionnaires, et qui me rappelle vaguement l’image que je me suis faite d’Abraham, se distingue par un empressement servile envers les étrangers. Mais ce n’est certes pas pour leurs beaux yeux : il tient à la main une liasse de billets de banque russes et fait un petit commerce de change très avantageux… pour lui, s’entend. Il nous offre gratis 14 fr. 50 (monnaie russe) contre 20 francs (monnaie française). Le commerce, c’est l’argent des autres. Nous l’envoyons à tous les… patriarches.
Enfin nous arrivons à la frontière russe. C’est la première fois que nous voyageons dans un pays dont nous ne savons ni l’un ni l’autre la langue ; l’embarras est extrême. M. de Ujfalvy exhibe son passeport diplomatique à un employé supérieur qui parle l’allemand mieux que le français. Pour mon compte, j’essaie d’attendrir les douaniers ; je ne puis me faire entendre que par une pantomime plus ou moins éloquente que je parviens à rendre persuasive, et on n’ouvre pas mes malles. Cependant mon mari, moins bien inspiré, se déclare porteur d’un fusil de chasse dont il compte se servir en Asie centrale. Comme toute bonne action a son prix, celle-ci est évaluée à 8 roubles 12 kopeks, qui sont incontinent encaissés par la douane. Le beau mérite d’être honnête, si l’honnêteté ne coûtait rien ! Nous pouvons donc partir honnêtement, ce qui nous permet de dormir jusqu’à peu de distance de Varsovie.
Aux approches de la ville, le jour blanchit sur de vastes plaines parsemées, ainsi que le bord de la route, de petits tumuli qui n’ont rien, hélas ! de préhistorique. Ils datent de la dernière insurrection polonaise. « On voyait à des plis qui soulevaient la terre qu’hier des régiments s’étaient endormis là… » Notre compagnon de route, un excellent Courlandais à face rubiconde, saisit un prétexte pour défrayer la conversation. Comme Sganarelle, il estime que les morts sont gens de discrétion et n’ont pas le mauvais goût de se plaindre. Il jouit d’une bonne santé, d’une belle humeur et d’un ineffable contentement de lui-même. Pourquoi s’attristerait-il au souvenir de ceux qui ne sont plus ? Une carte qu’il met sous nos yeux nous apprend qu’il est conseiller d’État au service de S.M. l’empereur de toutes les Russies : c’est un titre purement honorifique qui donne droit à la noblesse. En Russie de même qu’en Chine, il y a des conseillers de tous les degrés ; par exemple, un conseiller de collège peut être en même temps attaché à la maison de l’empereur, faire partie d’une ambassade, du ministère des finances ou de n’importe quelle administration publique.
Le chemin de fer passe rapidement entre des bois des bouleaux et de pins. Devant nous surgit une magnifique forêt de chênes : mon imagination me la représente peuplée d’aurochs. Notre conseiller, qui chasse l’élan dans ses moments perdus (et il n’en doit pas manquer), nous dit que l’aurochs n’existe plus que dans une seule forêt de la Russie centrale, où l’empereur a seul le droit de chasse.
De grandes terres maraîchères nous annoncent l’approche de Varsovie. Nous descendons, décidés à ne point laisser cette ville derrière nous sans y avoir passé au moins une journée. Cette capitale ; qui compte environ 300 000 âmes, est située sur les véritables frontières du monde occidental et du monde oriental. À côté de monuments publics et de palais d’une magnificence asiatique, nous rencontrons des maisons malpropres et des rues où la boue semble persister à l’état permanent. À l’exception d’une rue bitumée et de quelques autres voies dont le pavage est en fer et où le bruit des voitures retentit péniblement aux oreilles, toutes les autres voies, y compris les trottoirs, sont pavées sans doute par une confrérie de cordonniers. À défaut de notre mémoire, nos bottines garderaient plus d’une empreinte de la promenade que nous avons faite à travers la ville.
Varsovie a été assez souvent décrite pour que je sois dispensée d’en signaler les splendeurs. Je ne parlerai que du quartier des juifs, unique en son genre et dont l’animation m’a frappée. Les hommes y portent une redingote en forme de robe, sorte d’ulster, dont les plis, serrés autour de la taille, descendent jusqu’à la cheville : ils portent la barbe longue et les cheveux bouclés aux oreilles. Les femmes s’y sont avisées d’une étrange coquetterie : comme il leur est interdit de laisser voir leurs cheveux une fois qu’elles sont mariées, elles couvrent leur tête d’une énorme perruque ; plus ce couvre-chef est volumineux, plus il laisse supposer que la chevelure est abondante ; il est tel de ces édifices capillaires qui équivaut à dix chignons de Parisiennes. Vous pouvez imaginer l’effet de ces monuments.
Les juifs sont ici divisés en trois catégories : les fanatiques, les tièdes, les indifférents. Ce premier aperçu nous a suffi, et je serais bien embarrassée d’en dire plus long sur ces trois classes qui paraissent qualifiées d’une manière satisfaisante. Il est bien entendu que chaque classe regarde les autres soit avec horreur, soit avec dédain, soit avec pitié.
Nous avons assurément acquis des droits à notre dîner. Il nous attend à l’hôtel de l’Europe, où le restaurant est tenu par une Française, Mme Rouquerel. Je puis dire sans vanité que l’établissement tire profit de l’intervention de ma compatriote. Il est doublé d’un café servi par des petits garçons de dix à douze ans qui promènent des tabliers blancs fort propres avec une gravité comique.
Reposés et refaits, nous reprenons le cours de nos promenades, d’abord au faubourg de Cracovie, puis au musée, où notre guide affirme qu’il n’y a de place que pour les chefs-d’œuvre. Les tableaux qui se déroulent sous nos yeux présentent tous une affinité avec cette grande toile de Matejko, que nous avons eu l’occasion d’admirer à Paris il y a deux ans. Dans toutes ces peintures il y a une richesse et une profusion de couleurs qui papillonnent à l’œil. Je note en passant le buste de Chopin.
Dans l’après-midi, nous suivons la grande rue du Nouveau-Monde, dont la continuation s’appelle avenue du Belvédère, le Corso de Varsovie, qui conduit aux Champs-Élysées de la ville : c’est le jardin de Lazienki où se dresse devant nous un petit bijou de palais, un Saint-Cloud en miniature (un Saint-Cloud avant le siège).
L’empereur y habite lorsqu’il vient à Varsovie, mais il n’y courbe pas ; quand il veut se livrer aux douceurs du sommeil, il doit se rendre au Belvédère, qui a été disposé à cet effet. Le palais respire encore les souvenirs de la magnificence des rois de Pologne. Nous remarquons un buste de Diane signé Houdou, 1780. Le jardin ressemble à celui de Saint-Cloud ; une ancienne arène convertie en théâtre d’été y produit un effet assez original, car les spectateurs sont séparés de la scène par un petit cours d’eau. Un peu plus loin, sur un pont, s’élève la statue équestre de Jean Sobieski, le vainqueur des Turcs. Après avoir admiré le jardin, nous prenons le parti de rentrer, car le froid est trop vif, et nous avons eu le tort d’expédier nos fourrures, qui nous attendent à Saint-Pétersbourg : toutes les dames ont leur manchon, et je les envie.
En rentrant à notre hôtel, nous rencontrons des équipages attelés à la russe, des huit-ressorts français, des omnibus remplis de juifs, des tramways et des petites voitures, des paysans dans leur costume national.
À dîner, notre compagnon de voyage, le Courlandais, nous fait déguster une bouteille d’hydromel qui lui coûte 30 roubles : c’est, dit-il, de la bière qu’on laisse en bouteille dans la cave pendant une centaine d’années et qui devient avec le temps sucrée et liquoreuse.
Le lendemain nous partons pour Saint-Pétersbourg dans des wagons meilleurs encore que ceux de Vienne ; ils offrent les mêmes avantages que les sleepingcar, puisqu’on est deux dans le compartiment ; la nuit les deux sièges se rejoignent, et l’on s’y couche comme sur un lit. Un corridor permet à ces messieurs d’aller et de venir et même de fumer, ingénieuse diversion à la désespérante uniformité de la route, qui les rendrait maussades. Les wagons étaient chauffes ; je ne m’en plaignis pas, car on sentait, à mesure que l’on avançait, la température se refroidir.
Nous voyions se dérouler une succession toujours renouvelée de plaines immenses, de forêts de sapins et de bouleaux. De temps à autre quelques troupeaux de bœufs, de moutons, de porcs et d’oies semblaient vouloir rompre cette monotonie que de chétifs petits villages en bois semés de loin en loin n’étaient pas faits pour égayer. En Pologne, les cimetières, avec leurs croix en bois de 8 à 10 mètres de hauteur, présentent un aspect étrange dont l’impression est indéfinissable. Toutes les maisons, même celles des personnes aisées, sont construites en bois et d’après un modèle uniforme. D’une station à une autre, l’intervalle est de une heure à une heure et demie ; à chacune d’elles, il semble qu’on recommence le même trajet ; c’est à croire que le train siffle, souffle et s’essouffle sur une piste circulaire sans issue.
Enfin, après trente-six heures de ce manège, nous secouons notre torpeur ; le train fait son entrée en gare. Nous sommes à Saint-Pétersbourg, et l’hospitalité la plus gracieuse s’y manifeste, à la portière même du wagon, sous les traits d’un ami qui vent nous souhaiter la bienvenue.
Saint Pétersbourg. – Helsingfors. – Notre premier mot finnois. – Le Kalévala. – L’hiver en Finlande. – Le Théâtre national. – Le dévouement des dilettantes. – Muista-Domino. – Les journaux français en Finlande. – À Moscou.
Nous sommes arrivés justement dans la plus mauvaise saison à Saint-Pétersbourg, c’est son négligé du matin ; aussi attendons-nous avec impatience le moment où sa toilette sera faite, couverte de son manteau d’hermine. Les traîneaux remplaceront ces périlleuses voitures où le moindre choc peut vous faire sentir que le pavé n’est pas un moelleux canapé. Pourtant il faut bien se résigner, car les autres voitures sont d’un prix fou : 4 roubles pour aller aux Îles pendant deux heures et un autre rouble de pourboire ont dû sortir de notre bourse ; encore notre automédon ne paraissait-il pas absolument satisfait : ce plaisir est coûteux. Il est vrai que le coup d’œil de la Néva se jetant, à la fin des Îles, dans la mer qu’on entrevoit au loin, bien loin, si loin, que son chant n’arrive pas jusqu’à vous, vaut peut-être bien cette somme ; mais on se demande ce que coûteront les autres plaisirs ; il est heureux que Saint-Pétersbourg ne contienne pas plus de monuments remarquables. Aussi le mot après revenait toujours à ma pensée…
Depuis le paradis terrestre, nous sommes tourmentes, nous autres femmes surtout, par cette éternelle question : et après ? car le maintenant s’évanouit toujours en présence du tout à l’heure. Il me semblait que nous restions trop longtemps à Saint-Pétersbourg : n’est-ce pas une ville trop connue, trop rapprochée de Paris, partant trop banale ?
Quand j’eus admiré les grandes rues toutes blanches, le Palais d’Hiver, les monuments, la promenade des Îles, constaté que le Champ de Mars y était plus petit que celui de Paris, genre de satisfaction très relatif, constaté encore que le thé est délicieux, hygiénique par excellence, qu’il réchauffe les soldats russes sans les enivrer, que je le trouve meilleur à mesure que nous avançons vers la Chine où j’espère le savourer à l’état de perfection… ; quand je me lus convaincue que les drochki sont les plus insupportables voitures que je connaisse ; il faut être dame russe pour pouvoir s’y maintenir en équilibre : hommes et femmes s’enlacent par la taille et rappellent vaguement le Printemps peint par Cot ; la frêle et légère balançoire est remplacée très désavantageusement par la voiture, et le printemps par l’automne et après ! me dis-je.
Il suffit de jeter les yeux sur une carte du pays pour être tenté de parcourir le golfe qui nous attire sur sa rive septentrionale : voilà la réponse à ma question. En route donc pour Helsingfors et la Finlande.
Nous voilà promus de – 4° à – 8° (style thermométrique) ; c’est un commencement de considération de la part du climat, et par-dessus le marché investis d’un numéro d’ordre, le n° 29, que mon mari est forcé de traduire par le mot yhdeksänkolmatta, faute duquel nous n’aurions pas en de traîneau à notre disposition. J’avais souvent demandé à M. de Ujfalvy à quoi lui serviraient ses études sur la langue finnoise, la réponse était triomphale. Les gens du pays ne peuvent entendre d’autre idiome, que le leur.
Helsingfors est une ville agréable ; elle a un musée, une université, une église grecque, une église catholique et tout ce qui doit figurer dans les cités qui se respectent. Il y manque des passants, aussi nous félicitons-nous d’être venus pour faire nombre. Population d’ailleurs fort douce et très propre. Nous étions munis de recommandations qui nous valent le plus cordial accueil. En témoignage de gratitude nous professons un vif intérêt pour le Kalévala. Qu’est-ce que le Kaléva ? j’aurais été mal venue en avouant mon ignorance : c’est le poème épique que la Finlande oppose à ceux d’Homère. En voulez-vous un échantillon ?
Tout le monde ici regrette que nous ne soyons pas venus plus tôt (ou plus tard) pour admirer l’été, mais nous voulions précisément voir l’hiver, voir la Finlande dans son élément.
La Finlande avec ses sapins ployant déjà sous la neige, ses rochers de granit sur le flanc desquels une sorte de grésil doré par le soleil forme des blocs d’ambre superposés, produit une impression austère, dénudée, glaciale, mais c’est beau, d’une beauté rigide qui s’impose. Cette neige, qu’à Paris je voyais tomber avec joie, me rendait ici muette et triste. Là-bas ce n’était qu’une discrète visiteuse, lente à venir, prompte à partir ; ici c’est une souveraine qui prend possession de son immense empire, hautaine, froide, silencieuse, comblant ravines et fondrières, dissimulant les gouffres, effaçant les chemins, étendant sur le sot glace les molles ondulations d’un formidable linceul. Ici la nature n’est plus la tendre nourricière qui se prête complaisamment à la faiblesse des enfants des hommes ; elle reprend son implacable majesté ; elle veut qu’on lui cède ; il faut qu’on la subisse.
La mer elle-même, si imposante sur les côtes de Normandie et surtout de Bretagne, semblait ici s’avouer vaincue ; sa grande voix était timide, seul le clapotement des petites vagues rappelait sa présence et nous murmurait à sa manière : « C’est moi, je suis là, si tu veux profiter de mes ondes pour aller à Stokholm, vite, vite, dépêche-toi, car bientôt mon ennemie me saisira et me fera prisonnière dans un palais de cristal. » Ces idées flottaient dans l’air avec les flocons de neige, tandis que debout sur l’énorme rocher de granit j’avais à mes pieds les flots et l’immense horizon.
Après le spectacle de la nature, celui de l’art. Helsingfors possède un théâtre, et j’étais curieuse d’entendre un opéra finnois. M. Ahlqvist, qui figure au premier rang des poètes nationaux, nous vanta le talent d’une jeune Finnoise, ancienne élève du Conservatoire de Paris. M. Aspelin, le premier archéologue de la Finlande, voulut bien nous accompagner au théâtre et réclama notre indulgence pour les autres artistes, les premiers sujets étaient en voyage et le ténor malade. Mais les rôles sont toujours tenus par des dilettantes de bonne volonté. Confraternité charmante. Les actrices elles-mêmes sont souvent des femmes de la meilleure société. La ville n’est pas opulente, les chanteurs de profession sont rares et exigeants ; il ne faut pas que le théâtre soit fermé et la scène vide. Honneur à ces courageuses dames qui chantent par patriotisme, et quelle conscience elles apportent dans leur jeu ! Or ce soir-là elles jouaient – devinez, chère lectrice, – le Domino noir, Muista-Domino.
En sortant du théâtre, nous allons souper au restaurant, dans le premier hôtel de la ville. M. de Ujfalvy demande au garçon s’il a des journaux français. Oui ! répond-il avec assurance, et, pour prouver son affirmation, il en apporte trois, le Courrier de Meurthe et Moselle, le Courrier de Rodez et un autre Courrier du même genre : malheureusement ces courriers se sont un peu attardés chemin faisant, ils datent du 23 juin 1876 ! Les Finnois sont assurément trop aimables, et nous leur savons gré d’avoir transformé en archives ces paperasses sur lesquelles ils se figurent que la France a laissé son empreinte.
Quand nous revînmes à Saint-Pétersbourg, le traînage était complet, ô la belle ville dans ses fourrures d’hiver ! Les arbres plient sous la neige, les monuments se dressent tiers et isolés dans leur granit, et font contraste avec les vilaines maisons jaunes et roses, qui veulent rappeler l’Orient. Ô Palais d’Hiver, comme tu es laid dans ton immensité ! On dit le dedans superbe. Tant mieux, mais je ne puis en juger, car il est habité par ses hôtes impériaux, et la porte aux mortels en est rigoureusement interdite. Du reste, pourquoi seraient-ils dérangés dans leur somptueuse demeure plus que de simples bourgeois chez eux ? Pourtant ce Palais d’Hiver tel qu’il est, avec ses grands murs d’un jaune tirant sur le rouge, est un prodige vivant de la volonté d’un homme. Brûlé intérieurement par un incendie en 1837, il fut, sous les ordres de Nicolas, relevé de ses cendres en une année. Les plus belles salles, dit-on, sont la salle de Pierre 1er, la salle Blanche, la salle Saint-Georges. La galerie des Feld-Maréchaux contient les portraits de tous ceux qui ont combattu contre nous, et la galerie Alexandre renferme ceux des généraux qui ont résisté à l’invasion française de 1812. Le salon de l’impératrice, plafond et murs, couverts de dorure, est l’appartement le plus élégant et on peut ajouter le plus brillant. Du reste, il paraîtrait qu’aucune cour n’offre un plus beau coup d’œil que celle de Russie. Notre vieil éclairage aux bougies, qu’ils ont préféré au gaz, est et restera toujours le plus beau et le plus scintillant éclairage du monde. C’est ici qu’il faut parler du grand diamant Orloff qui orne le sceptre impérial russe. C’est le plus grand diamant connu, mais il est moins beau que le régent de France. La légende raconte qu’il était enchâssé autrefois dans l’œil d’une idole du temple de Séringham, près de Trichinopoly, dans les Indes orientales. Un soldat français, renégat d’alors comme il y en a encore aujourd’hui du reste, s’introduisit comme domestique dans le temple, arracha l’œil à l’idole, non pour le manger, fi donc ! comme les sauvages, mais pour le vendre 2 000 guinées à un capitaine de vaisseau en station à Malabar, que cet habile opérateur avait réussi à gagner. Ce capitaine le vendit à son tour à un juif : mais, comme boule de neige fait avalanche, le capitaine trouva que 12 000 guinées (300 000 fr.) n’étaient pas trop pour s’en être embarrassé quelque temps. Puis ce juif, flairant une bonne aubaine, le vendit à un marchand arménien, l’histoire ne dit pas le prix, mais je suis sûre qu’il y gagna en dépit du proverbe qui dit qu’il faut trois juifs pour tromper un Arménien. Celui-ci, ne voulant pas faire tort à sa réputation, l’offrit à l’impératrice Catherine, mais à un prix si exorbitant, que l’impératrice refusa. L’Arménien remporta le diamant à Amsterdam, jugeant bien dans sa finesse qu’il n’y resterait pas longtemps. En effet, le comte Orloff l’acheta moyennant 450 000 roubles (1 800 000 fr.), une rente viagère de 2 000 roubles avec promesse de lettres de noblesse. La légende n’assure pas que les lettres de noblesse furent octroyées, mais le diamant fut offert à l’impératrice et déposé à ses pieds par son fidèle sujet, heureux temps et heureux pays où les sujets peuvent faire de tels présents à leur souveraine.
Si nous n’avons pu visiter intérieurement le Palais d’Hiver, j’ai vu et revu le palais de l’Hermitage transformé en musée ; c’est bien le premier de Saint-Pétersbourg et un des plus riches que je connaisse. Son nom d’Hermitage lui vient de Catherine Il qui en 1768 l’avait fait construire par de la Motte à proximité du Palais d’Hiver pour se retirer des bruits de la cour ; c’est un des bijoux de Saint-Pétersbourg, quoique son style grec à côté du Palais d’Hiver fasse mieux ressortir encore le style baroque et manière de cette masse imposante. Les richesses de ce musée sont très grandes, la peinture, la sculpture antique, les antiquités du bosphore Cimmérien, de la Sibérie, se confondent avec un ordre admirable, et, comme il n’est pas trop grand, on se retrouve toujours dans ces délicieuses salles qu’on finit par connaître et qu’on admire d’autant plus qu’on trouve toujours quelque chose qu’on n’a pas admiré la veille. En sortant de l’Hermitage, on rencontre, vis-à-vis le Palais d’Hiver, un arc de triomphe ; sa couleur jaune est la seule chose qui le recommande à l’attention publique. Quelle différence avec la statue de Pierre 1er dont le piédestal en granit ne porte que ces mots : « Petro primo Catharina secunda. » Cette statue équestre est une des plus belles, pour ne pas dire la plus belle, de la capitale. Pierre 1er contenant son cheval sur le bord d’un rocher regarde la Néva, sa main est étendue vers l’Académie, vers la forteresse, vers ce côté de cette ville qu’il a fait surgir de terre par la seule force de sa volonté. Car Saint-Pétersbourg est bâtie sur des marais, toutes les maisons sont construites sur pilotis, et pourtant elles sortent de terre avec une rapidité qui ne nuit en rien à leur solidité, il y en a qui datent de Pierre 1er et n’ont pas l’air de s’apercevoir qu’elles sont déjà si âgées. Le rez-de-chaussée est toujours voûté, les planchers sont doubles, et, grâce à leur double châssis, les fenêtres ferment hermétiquement ; les poêles, bien construits, gardent leur chaleur souvent pendant un ou deux jours. Cependant les briques dont sont formées les maisons paraissent être légères, mais l’ouvrier russe est extrêmement habile et pousse la hardiesse jusqu’à la témérité. Il n’a généralement qu’un outil, la hache ; avec ce seul instrument, il coupe une planche, la dégrossit, la façonne, la polit, puis enfin la pose. Aussi ne marche-t-il jamais sans cet instrument, qu’il porte suspendu par derrière à sa ceinture. Cette ville, sortie comme par miracle des bords de la Néva, est toute grande, toute spacieuse ; pas de petites rues, indiquant son ancienneté. La Newski, longue et grande rue, est, on peut le dire, le rendez-vous de la ville ; on y admire l’église de Kasan dont la colonnade rappelle celle de Saint-Pierre de Home ; les magasins, qui bordent la rue des deux côtés, sont beaux et variés, mais les escaliers conduisant aux magasins en sous-sol nuisent à la régularité des trottoirs. En général bon nombre de ces magasins sont occupés par des marchands de comestibles et par de petits traktir ou marchands de boissons : car le Russe aime assez à boire, et l’ivrogne de Saint-Pétersbourg ne ressemble pas aux autres ; même dans son ivresse, il conserve une bonhomie et un respect dû en partie à son bon naturel, en partie à son éducation. Combien de fois nous en avons rencontré qui, ayant si bien fêté le dimanche, qu’ils avaient de la peine à se tenir sur les jambes, s’écartaient pourtant respectueusement sur notre passage. Grâce au thé, cependant, l’ivrognerie tend à disparaître peu à peu.
Vers la fin de notre séjour à Saint-Pétersbourg nous nous étions logés à l’hôtel d’Angleterre, car notre petit appartement meublé n’était plus tenable et la nourriture était trop mauvaise, les traktir ou restaurants qui remplacent ici ceux du Palais-Royal, tels que Milbret, ne les valent certainement pas, soit dit sans orgueil de patriotisme. La nourriture russe n’est pas mauvaise, mais il faut y être habitué, et elle doit être bien faite ; dans de bons restaurants et chez les particuliers, elle est très bonne : certains plats tels que le borche, le chtchi (soupe), le cochon de lait, ont une saveur étrange à laquelle on s’habitue très volontiers. C’est des fenêtres de l’hôtel que nous pouvions admirer l’église Isaac-Dalmate, la cathédrale russe par excellence. Cet édifice rappelle le Panthéon de Paris, mais il a les quatre faces pareilles. Cette église fut bâtie par un Français appelé Montferrand, en 1819. L’architecture en est simple, malgré ses proportions gigantesques ; mais ses richesses en font, je crois, la plus riche cathédrale du monde ; ses degrés de granit reposent sur une forêt de pilotis, les colonnes des quatre péristyles, également en granit, sont ornées de chapiteaux corinthiens en bronze. La coupole est toute dorée et surmontée d’une immense croix. Les colonnes revêtues de malachite et de lapis-lazuli, les peintures, les images, les objets en or couverts de pierres précieuses qui décorent l’intérieur, sont impossibles à décrire.
La première visite cause un éblouissement complet : ce n’est qu’à la seconde qu’on peut se rendre compte de toutes les richesses enfouies dans ce monument. Après cet édifice, je trouve celui de l’Amirauté un peu disproportionné, trop long pour sa hauteur ; la petite flèche qui se trouve au milieu ne laisse pas que de faire un singulier effet.
Le palais Michel, le palais de Marbre sont remarquables, mais ce qu’il y a certainement de plus beau à Saint-Pétersbourg, c’est la Néva enfermée dans ses quais de granit ; et, malgré ses solides fermetures, elle s’échappe pourtant bien des fois, et dans sa course folle dévaste tout sur son passage. Sa plus terrible équipée fut celle du 7 novembre 1824. Furieuse sans doute d’avoir été depuis 1777 comprimée dans ses débordements, elle dépassa cette fois toutes les limites du possible, entrant dans les rues, entraînant tout sur son passage ; des villages entiers furent emportés, et aucune habitation ne put résister à sa fureur. Plus de cinq cents personnes en furent victimes. Pourtant en ce moment elle est bien calme, métamorphosée en miroir glacé dans lequel le soleil pâli se mire discrètement. Qui soupçonnerait ses ravages en voyant ces eaux vagabondes changées en blocs de glace, qu’on transporte dans des traîneaux. Les conducteurs paraissent ne pas s’apercevoir de la froidure des sièges sur lesquels ils sont hissés.
Cet élément terrible peut à grand-peine être comprimé ; il n’en est pas de même du feu, dont on peut toujours faire la part, et, à Saint-Pétersbourg, le service des pompes à incendie est fort bien organisé. Des signaux sont placés au haut des tours ; l’hiver les pompes sont portées sur des patins et elles glissent avec rapidité. Lorsqu’un incendie se déclare, les personnes accourues pour le voir ne s’occupent nullement de faire la chaîne, comme chez nous ; tout se passe avec un calme parfait, et ceux qui sont chargés de l’éteindre ont seuls le droit de prêter leur concours. Singulier peuple, soumis, complaisant, mais façonné à une étrange discipline, regardant, quand il le faut, sans voir.
Après un séjour de quatre mois à Saint-Pétersbourg, après une interminable succession de pas et de démarches. M. de Ujfalvy obtint enfin la permission d’aborder l’Asie centrale, grâce à l’intervention de M. de Séménoff et du baron Osten-Saken, grâce surtout au bon vouloir du général de Kauffmann, qui s’était empressé d’envoyer son acquiescement. Le 2 janvier, dans la soirée, nous partions pour Moscou.
Les dames ne comprenaient pas que je fusse décidée à suivre mon mari. C’était folie qu’une femme s’avisât d’une telle aventure ; courir les grands chemins ! passe encore s’ils avaient été suffisamment frayés. Assurément vous n’en reviendrez pas ! – et de fait, quand j’en revins, on s’extasia de ma réapparition, comme d’une résurrection.
Remercions ici la compagnie des chemins de fer de Saint-Pétersbourg à Moscou. On voyage à l’aise dans ses vastes wagons garnis de fauteuils qui se transforment à votre gré en lits, en canapés, en chaises-longues. Un seul défaut, rien n’est parfait en ce monde, c’est d’être trop chauffé, critique qui peut s’adresser à tous les appartements en Russie, surtout en dehors de Saint-Pétersbourg, car leurs doubles fenêtres sont si soigneusement mastiquées, qu’il n’y pénètre pas un filet d’air extérieur ; elles sont dénuées même du petit carreau mobile usité dans la capitale.
En somme, le voyage fut agréable, et à onze heures du matin nous étions à Moscou.
L’ancienne capitale de la Russie, celle que les Russes, les vrais Russes considèrent toujours comme telle, fit sur moi, je l’avoue, une beaucoup plus grande impression que Saint-Pétersbourg. Plus asiatique que sa jeune rivale, elle conserve, avec toutes ses églises aux tourelles élégantes et massives, un cachet que l’autre n’aura jamais. Son Kremlin est d’une ampleur et d’une originalité auxquelles le Palais d’Hiver, malgré son air de grandeur, ne saurait être comparé.
Le Kremlin ressemble à un polygone irrégulier flanqué de dix-huit tours. Il communique avec la ville au moyen de cinq portes appelées Tikolskya, Spasskya, Troïtskya, Taïnitskya et Borvoïtskya vorota. En passant sous la porte Sacrée (Spasskya vorota), on est obligé de se découvrir devant l’image miraculeuse du saint Sauveur placée au-dessus de cette porte. Par un froid de 20 degrés Réaumur, comme il arrive souvent dans cette ancienne capitale, ce n’est pas très agréable : on a le temps, comme elle est assez large, d’y attraper un bon rhume de cerveau : c’est en passant sous cette porte que l’on sent les avantages d’être du sexe féminin : le moyen d’ôter son chapeau ou son bonnet, puisque se rendre à l’église sans ce gracieux couvre-chef est un manque de respect ! Cette porte a été bâtie en 1491 par Pierre-Antoine Solarius, célèbre architecte. On compte trente-trois cloches dans cet immense et original monument qui porte le nom de Kremlin, et elles sont toutes d’une assez belle dimension, mais la plus grande, la reine de toutes les cloches présentes, passées et à venir, gît triste et isolée dans son immensité, près du clocher d’Ivan Vélikoï. Elle avait été fondue en 1733, sous le règne de l’impératrice Anne, par un ouvrier russe appelé Ivan khotorine. La poutre qui la portait devait être énorme. Un incendie arrivé en 1737 la dévora. La reine des cloches n’ayant plus rien pour la soutenir dans son élévation tomba majestueusement sur le sol, mais si heureusement, que, sans l’énorme trou qui a entamé son bronze royal, on pourrait croire que c’est une originalité de plus au milieu de toutes les autres qui composent ce palais.
Au milieu de toutes les églises qui sont dans le Kremlin, la plus antique est celle de Spass na Boron (l’église du Sauveur dans la forêt) ; c’est aussi autour d’elle que le grand palais du Kremlin a été bâti, et elle se trouve au milieu de la cour. Ivan Kalita y distribuait autrefois ses aumônes, et le peuple accourait vers lui comme autrefois vers saint Louis rendant la justice sous les grands arbres du bois de Vincennes. Bonté, justice, rares qualités surtout pour un souverain ! Jusqu’au quinzième siècle, les grandes-duchesses y furent enterrées. Le grand palais du Kremlin a été bâti de 1838 à 1848 par l’empereur Nicolas ; sa façade principale regarde la Moscova, et, des fenêtres de l’hôtel Kokoref, où nous habitions, je pouvais contempler à mon aise cette façade percée de trois rangées de fenêtres qui font croire à trois étages, quand il n’y en a réellement que deux. Ô fausseté, tu te glisses jusque dans les bâtiments ! Aussi les salles du bel étage, comme on appelle le premier en Russie (qui est quelquefois le troisième, le rez-de-chaussée comptant pour un), s’en ressentent-elles, gagnant en élévation ce qu’elles perdent en vérité.
La plus belle salle, à mon goût, est la salle Saint-Georges, consacrée à l’ordre de chevalerie qui porte ce nom ; ses dimensions colossales et la sévérité de l’ornementation vous frappent, et les détails vous font une impression ineffaçable. Tous ceux qui ont contribué à fonder la grandeur russe et ceux qui, maintenant encore, la conservent, y ont droit de cité ; les noms les plus modestes se confondent avec les plus orgueilleux. Les murs de la salle sont tapissés de marbre blanc sur lequel est gravé le nom de chaque régiment ayant pris part aux conquêtes, puis en marge de ce singulier livre le nom de tous les chevaliers de l’ordre. Une statue colossale représentant un Saint Georges à cheval perçant le dragon de sa lance orne l’une des belles cheminées de ce vaste salon. Puis vient la salle Suint-Alexandre, fondée par Catherine. La salle Saint-André, affectée à l’ordre de chevalerie qui porte ce nom, est en même temps la salle du trône. Il faut encore signaler la salle des chevaliers-gardes, celle de Sainte-Catherine, en l’honneur de l’ordre de ce nom, qui fut fondé en 1714 (il n’est composé que de dames dont l’impératrice est la grande maiîtresse), et enfin celle de Saint-Vladimir, de forme octogone ; ces salles forment les salons de réception. À l’occasion de son couronnement, l’empereur admet au Kremlin toutes les classes de la société, depuis le paysan jusqu’aux princes, et cette réunion porte le nom de mascarade.
À la suite de ces salles se trouvent les appartements de l’empereur et de l’impératrice. Le Krasnoé Krilzo (Perron rouge) était réservé à l’entrée et à la sortie solennelle des tzars et des ambassadeurs. L’église du Spass za Zolotoïou réchotkoï (le Sauveur à la grille dorée), bâtie en 1635, est l’église où la famille du tzar faisait ses prières et ses dévotions. L’Oroujeynaya patata (la salle d’armes), plus communément connue sous le nom de trésor, est le musée des souverains ; ces derniers ainsi que les princes russes y ont entassé pendant des siècles les objets les plus remarquables, qui constituent en effet un véritable trésor.
Outre les souvenirs historiques, les richesses qui y sont enfermées, les pierres précieuses qui ornent les trônes, les sceptres, les couronnes, les vêtements de cour, la vaisselle d’or et d’argent, font de ce musée le plus riche de l’Europe ; l’œil est réellement ébloui, les merveilles des contes orientaux défilent devant vos yeux, et l’on se croit transporté dans les jardins féeriques du palais d’Aladin. Un superbe vase de Sèvres, une horloge en bronze des plus originales, le portrait de Catherine la Graude, le brancard de Charles XII, le lit de campagne de Napoléon 1er, pris au passage de la Bérésina, les bottes fortes de Pierre le Grand, son habit de matelot porté par lui à Saardam, lorsqu’il y étudiait l’art de construire des navires, et surtout le gros bâton appelé doubinnka, avec lequel Pierre 1er punissait de ses propres mains ses sujets qu’il voulait traiter d’une manière paternelle, vous rappellent à la réalité. Cette correction paternelle ne devait pas être une illusion, administrée par un homme qui, à en juger par ses œuvres, ne faisait rien à demi ; on voit passer devant ses yeux tous ses vassaux courbés sous le despotisme impérial et s’estimant heureux d’être frappés par leur maître. Ce souvenir, évoqué au milieu de ces richesses enfouies dans quatre salles immenses, dont la dernière est décorée par une statue en marbre de l’empereur Napoléon 1er prise par les Russes à Hambourg, me fit éprouver un sentiment de soulagement, et, comparant notre siècle à l’autre, je m’estimais heureuse d’être du dernier.
Le monastère de Vosnessenskoï (des femmes) est vraiment remarquable ; son aspect répond bien à son nom, toutes les grandes-duchesses, les princesses et les tzarines qui y ont été ensevelies, depuis le quinzième siècle jusqu’au dix-huitième, doivent y dormir en paix. Ce monastère abrita Maria Mnichek, lorsqu’elle était fiancée du faux Dimitri, et enfin Marthe, mère du tzar Michel, et Eudoxie, la première femme de Pierre 1er, y prirent le voile. Notre cicerone n’ajouta pas qu’elles le prirent forcément, mais il est aisé de le deviner.
Les casernes n’ont rien d’extraordinaire ; devant elles sont rangés, en ordre bien entendu, les anciens canons : comme il y a la reine des cloches, il y a aussi le roi des canons, appelé Tzar-pouchka ; il me semble que l’allégorie est bien trouvée. Le nom de son fondeur est connu tout comme celui de la reine des cloches : c’est Tchokhoff (en 1585). Ce canon a cent cinquante-deux ans de plus que sa compagne ! Il me semble que c’est un peu beaucoup, mais entre cloche et canon !
Après le Kremlin, le monument le plus remarquable est certainement le Vassili Blajennoï, ou la cathédrale de Pokrovski sur le Fossé. Cet édifice original, avec ses nombreuses tours grandes et petites, est sorti de terre sur un désir de Jean le Terrible, pour consacrer la mémoire de la double prise de Kasan et d’Astrakhan, et la première de ces deux villes en paya les frais. Si le nom du tzar est resté, celui de l’architecte est demeuré inconnu. Vassili Blajennoï n’est pas, comme on aurait pu le croire, le nom de l’obscur artiste, c’est celui d’un contemporain, enterré dans cette basilique et reconnu pour saint. Qu’avait-il fait ? Je crois bien qu’on n’a jamais pu le savoir, mais bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée : en vertu de cet axiome, qui était déjà vrai en Russie à cette époque, la basilique porte fièrement le nom de ce sujet du terrible Jean, qui, pour récompenser sans doute l’architecte, lui fit crever les yeux. La légende dit que c’était pour l’empêcher de construire autre part un tel chef-d’œuvre, car ces onze chapelles indépendantes, et cependant reliées entre elles par des corridors quelquefois si étroits qu’une personne seule peut à peine y passer, sont tout à fait extraordinaires et étonnent autant par leur nouveauté que par leur beauté.
Un souvenir historique bien intéressant, c’est la maison des boyards Romanoff, ancêtres du tzar actuel. Malheureusement elle a dû être reconstruite en entier en 1856, mais l’imitation exacte de l’original nous montre ce qu’était au seizième siècle la demeure des anciens boyards russes. On a peine à comprendre comment ces grands seigneurs pouvaient se trouver à l’aise dans ces petites pièces aux fenêtres étroites, aux escaliers plus étroits encore et aux portes si basses, qu’il faut incliner gravement la tête pour y pénétrer. On y voit tous les objets qui ont appartenu à cette royale famille : la crosse du patriarche Philarète Romanoff, l’armure du prince Michel Féodorovitch, les petites poupées revêtues du costume de l’époque ayant servi aux amusements des princesses de cette noble famille. Tout y est resté tel que cette maison était à cette époque ; on croit voir ces robustes seigneurs prêts à vous faire les honneurs de leur royale habitation ; les chambres sont aussi froides et aussi rigides que leurs habitants.
Plusieurs hôtels ont aussi conservé quelques traces de la vie commerciale de cette époque, mais quelle différence entre notre temps, qui est essentiellement porté de ce côté pratique de la vie, et celui où les coups d’estoc étaient pourtant beaucoup plus en honneur !
Après cette visite, nous retournâmes à l’hôtel Kokoref, hôtel russe qui, hâtons-nous de le dire, n’est pas l’idéal des hôtels. La vue du Kremlin nous dédommageait bien un peu, mais pas assez pourtant pour ne pas nous faire regretter le confort dont nous étions privés.
Cependant l’hôtel est superbe avec ses grandes pièces, ses corridors immenses, mais l’intérieur laisse beaucoup à désirer. Heureusement notre séjour ne devait pas être de longue durée et nos journées se passaient en visites et en achats : la rue Loubianka, une des plus fréquentées de la ville, fut bien des fois parcourue par moi dans toute sa longueur. Il nous fallait acheter des provisions de bouche et des fourrures en peau de mouton pour notre voyage en Sibérie ; toutes ces choses se trouvent plus facilement ici qu’à Orenbourg. La propriétaire d’un magasin de confiserie, Française de naissance, me fut, je dois le dire, d’un grand secours ; elle m’indiqua l’adresse d’un marchand de comestibles chez lequel je trouvai tout ce dont j’avais besoin. Je traversai ainsi l’Ohotniiriad (marché Ohotnii), le premier marché de la ville pour les approvisionnements, tenu sur l’emplacement occupé autrefois par la cour des Monnaies. Près de ce marché, est située la maison de l’Assemblée de la noblesse. La grande salle peut contenir 4 000 personnes. On voit bien qu’on ne regarde pas au terrain ; ici tout est grand, vaste, on sent qu’on a l’espace immense des steppes devant soi. Un peu plus loin, se trouve la place du Théâtre, sur laquelle s’élève majestueusement le grand théâtre bâti en 1824 par l’architecte Bauvais. Après avoir été endommagé par un incendie, il fut restauré en 1856 par Kavoss. C’est l’une des plus belles et des plus vastes salles du monde, sa construction est à l’italienne, ses rangs de loges y sont disposés au-dessus les uns des autres et chacune d’elles est pourvue d’un salon. Quoique je goûte peu ce genre de construction, je m’y trouvai très bien et j’admirai un ballet où, grâce à l’immensité de la scène, on avait pu déployer un luxe de décors inimaginable. Outre les ballets, dont les Russes paraissent être très friands, on y joue l’opéra russe et italien ; la façade du grand théâtre ressemble à celle de l’Odéon de Paris, le degré en moins.
Tout à côté, et sur la même place, s’élève modestement le petit théâtre : drames, vaudevilles, opérettes russes, s’en donnent à cœur joie ; point de langues barbares, la langue nationale y a seule droit de cité, et c’est de toute justice, car enfin la langue russe n’est pas plus laide qu’une autre langue, au contraire ; d’ailleurs où trouverait-elle l’occasion de se développer et de se perfectionner si ce n’est chez elle, d’autant plus que les artistes qui y jouent sont les meilleurs de toute la Russie.
Je me rappelle que c’est dans un des deux plus beaux passages de la ville que je fis provision de laine à tapisser ; le passage Galitzine et le passage de la maison Solodovnikoff ont des magasins tellement variés, qu’ils constituent un des ornements de cette ancienne capitale. Dans la maison Solodovnikoff se trouve le théâtre, français. Le Pont-des-Maréchaux (nom d’une rue), sur la Neglinnaya, possède les plus beaux magasins de Moscou ; ceux de Khlebnikoff et de Oftchininkoff sont renommés pour leur orfèvrerie, cette orfèvrerie émaillée, si bien en rapport avec les monuments multicolores de cette ville. Le quartier est presque tout français, la colonie française s’y est groupée à cause sans doute du voisinage de l’église catholique. La tour Souhareff, bâtiment massif et solide, est surmontée d’une autre tour octogone terminée en forme de cône ; comme elle est construite sur un terrain très élevé, on l’aperçoit de fort loin. Bâtie de 1692 à 1695 en mémoire de la fidélité au tzar du régiment des Streltzys du Stolnik Souhareff, elle servit successivement de logement pour l’administration de ce régiment, puis Pierre 1er la transforma en école de mathématiques et de navigation. Ensuite on y plaça le premier observatoire de la Russie ; le bureau de l’amirauté y prit place à son tour, et, en 1832, le réservoir d’eau qui alimente les fontaines de Moscou le remplaça. Espérons que ces transformations ont pris fin et que, nouveau Protée, elle se fixera dans son élément humide. La porte Rouge (Krasnié vorota) est une des plus belles portes de Moscou ; elle fut bâtie en 1742 par les marchands de la ville à l’occasion du couronnement d’Élisabeth 1er.
Le plus vaste édifice de Moscou est bien certainement la maison des Enfants Trouvés ; les cinq étages qui le composent sont percés de 2 228 fenêtres. Le deuxième, le troisième et le quatrième étage sont consacrés à l’éducation de huit cents jeunes filles qui y reçoivent gratis une éducation complète ; en échange, elles doivent pendant six ans se consacrer à l’éducation publique et même privée : l’État les envoie dans tous les coins et recoins de l’empire pour y répandre les lumières qu’elles ont acquises ; la maison leur donne un trousseau, et, lorsque, après les six années accomplies, elles se retrouvent sans emploi, elles peuvent toujours retourner au doux gîte de leur enfance. Le cinquième étage est consacré aux enfants trouvés. Ces enfants, dont le nombre s’élève à plus de 30 000, sont transportés à la campagne où ils sont parfois adoptés par les paysans qui en ont pris soin. Tous les enfants sont reçus sans distinction. Cet établissement philanthropique fut fondé en 1764 par Catherine II. Il ne faut pas non plus que j’oublie de parler du Zamoskvorétchié, cette partie de la ville qui ne fut fondée qu’au commencement du dix-septième siècle, tant cette surface favorisait les invasions de l’ennemi, mais, à partir de cette époque, elle se peupla rapidement et rattrapa bientôt le temps perdu. On y trouve beaucoup de vieux édifices, l’esprit moscovite y est plus tenace que dans les autres quartiers, le mouvement des rues y est nul, et pourtant les maisons sont grandes et neuves, mais les portes y sont souvent fermées ; on dirait le faubourg Saint-Germain de Paris. La maison Pachkoff, qui se trouve dans ce quartier, a été convertie en musée public de Roumiantzeff et en musée ethnographique de Dachkoff. Ce musée possède une bibliothèque riche de 300 000 volumes, de 3 900 manuscrits anciens, de tableaux de différentes écoles étrangères et de l’école russe, de 50 000 objets antiques, etc.
Le monastère Donskoï, qui a été fondé en 1592, renferme l’un des plus beaux cimetières de la ville : c’est le Père-Lachaise de Moscou : une quantité de célèbres familles russes y ont leur sépulture. Citons aussi le musée du prince Galitzine et le temple du Sauveur, grandiose et solide édifice dont la base repose sur l’une des plus hautes élévations de terrain de Moscou. Tout en pierre de taille dure, je crois qu’il pourra braver les injures du temps. Les blocs de granit rouge sur lesquels il est porté font un bel effet ainsi que les figures en haut-relief qui décorent les murailles. Son aspect est magistral, et sa coupole, flanquée de ces petites tours inévitables à une église russe, est si haute, qu’on a dû donner aux figures des proportions colossales : celle de Dieu le père mesure 12 mètres et demi. Les salles, les murs, les escaliers, sont en marbres de différentes couleurs.
La maison des archives est aussi très remarquable ; l’église de Rojdestvo Bogoroditzi Poutinnkah est la plus ancienne des églises de Moscou ; elle date du seizième siècle, et son nom, Poutinnkah, vient probablement de ce que l’on s’y disait adieu lorsqu’on se mettait en route. Enfin l’arc de triomphe, érigé en souvenir des campagnes de 1812 à 1815, est beaucoup mieux réussi que son frère de Saint-Pétersbourg.
Je m’arrête, car je suis fatiguée, et vous aussi, cher lecteur ; cependant je n’ai pas énuméré tous les monuments remarquables de cette antique ville, bien supérieur, à mon avis, à la nouvelle capitale. Quel merveilleux coup d’œil, vue du kremlin, cette étrange cité n’offre-t-elle pas, avec ses 7 cathédrales, ses 284 églises, ses 30 chapelles, ses 10 églises de différentes croyances, ses couvents, ses palais, ses théâtres, avec tous ses clochetons, toutes ses tourelles, au milieu de ces bâtiments sévères ! Tout cet ensemble est d’un effet fantastique, on sent l’Orient dans l’Occident, et ce pêle-mêle vous fait rêver à toutes les douceurs d’une fusion impossible entre tous les peuples.
En route. – Les deux Tatars. – Orenbourg. – Le Sakmara. – Le quartier pauvre des Cosaques. – Un souvenir de Pougatcheff. – Le Ménavoïdvor. – Le Caravansérail. – Les Bachkirs et leur honnêteté. – Mes réflexions politiques tournent au triste. – La mosquée. Visite chez le mollah. – Bonheur des femmes dans le harem. – L’aveugle musicien. – Je m’apitoie encore sur les femmes. – L’ex-khan de Khokand. – Ma commisération s’étend sur les chameaux.
Nous ne restons pas longtemps dans cette ville, en dépit de ses attraits ; nous avions hâte de commencer notre véritable voyage. Aussi, après quatre jours employés par mon mari en achats pour le gouvernement et en visites de toutes sortes, nous sommes vite partis pour Orenbourg par le chemin de fer qui venait d’être ouvert jusqu’à cette ville depuis cinq ou six jours. Avec un peu de fatuité nous aurions pu croire qu’on l’avait construit pour nous. Mais en Russie comme ailleurs le chemin de fer n’attend personne. Après deux jours et deux nuits, nous sommes descendus à Sizrane, où nous vîmes, enfouis dans sa fourrure et portant (comme les arbres de la Bourse à Paris) une vaste collerette-cuvette, notre premier Tatar. Sans le flatter, il était très laid. En revanche, son domestique (deuxième Tatar) était d’un assez beau type et semblait le faire valoir. Où la coquetterie va-t-elle se nicher ?





























