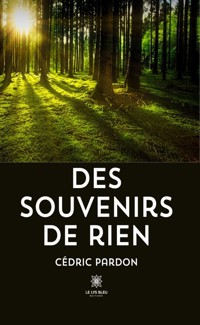
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Enfant non désiré, Martin naît au sein d’une famille bourgeoise de Bordeaux où il tente de trouver sa place. Puis, au fil de ses études et de ses aventures, il évolue vers une vie en dehors des cadres habituels, devenant à la fois un bryologue réputé et un homme sulfureux. Finalement, son corps est retrouvé sans vie dans la forêt de sa propriété du sud de la Gironde. Alternant entre le récit de la progression de l’enquête sur sa propre mort, menée par les gendarmes Le Brio et Leborgne, et les méandres de sa vie, Martin nous dévoile son histoire.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Après des études littéraires et l’obtention d’une licence en histoire de l’Art,
Cédric Pardon est revenu à ses premières passions : le jardinage et la nature. "Des souvenirs de rien" est son premier roman publié.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cédric Pardon
Des souvenirs de rien
Roman
© Lys Bleu Éditions – Cédric Pardon
ISBN : 979-10-422-1356-5
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L. 122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivante du Code de la propriété intellectuelle.
Dimanche 22 octobre 2017
Une pluie d’automne tombait sur la clairière. Les lourdes gouttes s’écrasaient sur le sol recouvert de mousse verte, les perles éclataient leur contour au contact des feuilles grillées abandonnées là sur le matelas onctueux où je reposais inerte.
Mon corps raide était allongé au-dessus d’un entrelacs de lierres qui serpentaient sur le sol moussu. L’eau du ciel pénétrait dans les trous de mes yeux, de mes oreilles, recouvrait mon visage, mes habits, les gouttes explosaient sur ma rétine, sur mes narines.
Ce flot ne me dérangeait pas, il ne me dérangeait plus. J’étais mort.
Mon nez et ma bouche étaient remplis de mousse qui débordait. Les amas verts semblaient être enfoncés profondément dans les orifices obstrués au point de déformer mon visage aux naseaux agrandis, à la bouche et aux joues dilatées pour le métamorphoser en un masque terrifiant figé dans la laideur.
Je m’appelais Martin D. J’avais quarante-deux ans et j’étais un bryologue, spécialiste de la mousse, mondialement reconnu. J’arpentais la planète pour faire des conférences sur ce végétal que j’étudiais pour le défendre, en décrire les bienfaits et son utilité.
J’habitais sur la côte atlantique dans la forêt de pins qui abritait la bergerie restaurée qui me servait de demeure. J’y vivais seul au milieu d’une nature rugueuse, relativement inhospitalière, mais très attachante. L’océan si proche me procurait un air frais vivifiant, il ouvrait mes horizons, les cieux, l’immensité des flots. Son vacarme me réveillait, me sonnait parfois, la lumière pure et forte m’irradiait et chassait la pénombre froide de mon coin de forêt, le soleil réchauffait parfois un cœur glacé par la vie pas toujours bienveillante.
Ainsi, je parcourais régulièrement les quelques centaines de mètres qui séparaient mon airial de l’océan Atlantique pour recharger des batteries fragiles.
Que m’était-il arrivé dans ce bois ? Quel destin tragique ? Quel scénario machiavélique avait décidé de me donner, m’offrir peut-être, m’imposer sûrement la mort par le biais d’une mousse tant aimée ? Mousse qui était ma vie, qui était la vie, vie qui me donna la mort !
Combien de temps allais-je rester là allongé sur le sol humide, sous la pluie, dans le froid de la nuit ? Quand allait-on découvrir ce corps ? Dans quel état ? Je vivais seul et peu de personnes venaient me rendre visite dans ma bergerie isolée dans la forêt.
Des animaux sauvages risquaient-ils de s’attaquer à mon corps devenu charogne ? La mousse allait-elle envahir peu à peu ce corps décharné ? Le recouvrir entièrement jusqu’à participer à son pourrissement total ?
Quelques chasseurs à l’affût de gibiers innocents passeraient probablement à côté de ma carcasse émoussée et préviendraient la gendarmerie. Quelle affaire !
La fin de journée était passée sur cette mort, lente, mouillée. Les ombres avaient envahi le bois, la nuit recouvert la vie. Des chevreuils passaient là tout près de moi, une chouette survolait ma dépouille à plusieurs reprises en hurlant pendant que des escargots ne contournaient pas mon corps afin de poursuivre leur but et laissaient derrière eux la trace gluante de leur passage en biais sur ma joue pâlie. Un bataillon de fourmis fonçait droit vers mon cou, ma tête, la colonne escaladait mon nez, traversait non sans mal les cils de mon œil droit, avant de franchir le front et de coloniser mes cheveux. Les soldats minuscules ressortaient ensuite de ma chevelure et continuaient leur chemin dans la mousse tout entier à leur quête.
La nature prenait le contrôle de mon corps, le submergeait, la forêt s’abattait sur moi, les forces de la nuit gagnaient peu à peu.
Vendredi 3 octobre 1975
Ma mère me mit au monde ce jour d’octobre dans une chaleur inappropriée pour l’évènement. Alors que ma vie commençait dans un flot de hurlements post-natal, l’Espagne voyait le général Franco être terrassé par une attaque avant de mourir quelques jours plus tard.
Ainsi va le cycle de la vie, naissance et mort, bonheur et souffrance. Ce jour-là, le monde se préparait à perdre un dictateur et à gagner un beau bébé joufflu, bientôt éminent bryologue réputé dans le monde entier.
Avant d’entamer cette belle carrière, je faisais mon apparition dans une famille bordelaise qui attendait ma venue sans grand enthousiasme. Mon arrivée tardive dans la sphère familiale sonnait comme un arrêt brutal au train-train quotidien installé depuis des années.
Mon père était un brillant petit bon médecin installé dans son quartier de toujours et maman s’occupait comme toute bonne bourgeoise bordelaise de ses deux garçons.
Mes deux frères étaient de douze et dix ans mes aînés. Petit dernier, je dus trouver ma place entre une mère étouffante d’amour, un père absent et deux frères désintéressés par ma personne, voire étrangers à tout ce qui pouvait me concerner de près comme de loin.
Depuis tout petit, je fuyais l’amour dégoulinant de ma mère qui s’accrochait à moi comme pour oublier qu’elle n’avait rien d’autre. Mon apparition dans sa vie l’avait sauvée d’un naufrage psychologique certain, d’une routine inexorable et funeste probablement dus à ce mari qui s’était réfugié dans une médecine-béquille pour tenter de masquer sa vie médiocre et à ses fils qui boudaient cette mère qui les avait abandonnés à leur vie toute tracée.
Parallèlement, je recherchais vainement l’intérêt de mon père pour ce troisième fils, son regard sur moi me manquait, il semblait avoir abandonné à ma mère la tâche de m’éduquer, de me parler, de s’occuper de moi, de m’inscrire dans l’histoire de cette famille.
En réalité, cette personne n’a jamais été mon père. Il se contentait d’être un médecin qui vivait là, chez nous, stéthoscope dans la poche de sa veste et serviette à portée de main, comme en transit permanent, entre deux patients, deux maladies, deux diagnostics. Il m’avait toujours paru déjà vieux, usé de rien, triste de naissance.
Malgré cela, mon enfance fut heureuse, la nature craignant le vide, je m’inventais une vie de gamin, un univers composé de personnages fictifs glanés là à la télévision, là dans mes bandes dessinées, là dans mon imagination. Je fabriquais des armées de monstres gentils, des familles idéales, des amis aventuriers qui envahissaient les steppes de mon esprit.
Mes frères me détestaient, et je leur rendais bien, ils ne m’avaient jamais fait entrer dans leur vie, ils me considéraient comme une pièce rapportée, une erreur, un dérèglement familial, une incongruité inacceptable. Nous n’avions aucune communication réelle, nous nous contentions de brefs échanges stériles et superficiels quand nous n’en avions pas le choix. Mes frères et moi avions des vies parallèles qui glissaient les unes sur les autres sans jamais se croiser, interagir, se mélanger comme l’eau fuit les plumes de l’oiseau.
Lundi 23 octobre 2017
Le petit jour se levait sur mon cadavre et chassait la sombre nuit pour quelques heures. La brume enveloppait le sous-bois afin de laisser aux animaux nocturnes retardataires le temps de regagner leur cache pour la journée.
Le silence régnait sur les lieux, des feuilles se détachaient et tombaient sans bruit sur le sol et les buissons. Le monde dormait toujours, anesthésié, paralysé par la nuit. Les arbres semblaient figés, les branches tétanisées, la mousse était couverte de rosée. Les gouttelettes de la brume flottaient dans l’air chargé, pas encore décidées à tomber. Le temps paraissait ralenti par une force invisible mais pesante, qui écrasait toute tentative de mouvement ou de respiration de la forêt.
Le silence m’avait toujours semblé être un trésor rare de la vie. Je le considérais comme un répit, une pause revigorante, un allié du vent léger, de la lumière fine du petit jour. L’absence de bruit était propice à ma réflexion sur la vie, les Hommes, le monde et son fracas.
Le silence signifiait également la mort, ma mort, effective, flagrante depuis quelques heures. Le néant qui s’ouvrait à moi était évidemment imprévu et nouveau.
Mon corps sans vie s’ajoutait au paysage tant aimé de ma forêt. À présent, je faisais corps avec les autres éléments constitutifs des lieux, bientôt ma carcasse allait se fondre dans le décor vert bouteille du sous-bois frais, je pourrais disparaître, avalé par la mousse, évanoui dans la forêt, perdu dans le paysage, ma matière redeviendrait matière.
J’ai toujours aimé m’allonger par terre, sur le sable au bord de l’océan pour admirer le coucher du soleil, sur l’herbe du jardin fraîchement tondue pour compter les étoiles la nuit venue, sur les rochers brûlants dans le désert pour écouter le silence assourdissant des immensités arides, près des rails de chemins de fer afin de ressentir les vibrations des trains qui filaient droit vers moi, sur la mousse tendre bien sûr pour m’oublier, penser au néant, à l’éternité et à la constance du monde végétal qui me fascinait.
Allongé j’étais, allongé je resterai…
Un groupe de randonneurs chevronnés et habitués de ce bois avait découvert mon corps et les autorités ainsi prévenues avaient fait transporter ma dépouille jusqu’au centre médico-légal de Bordeaux.
Jeudi 30 juillet 1981
Quelques mois plus tôt, mon père vivait son pire cauchemar en voyant arriver, ce qui s’imposait à lui comme un cataclysme, une catastrophe incroyable, une stupeur printanière, l’élection à la présidence de la République du socialo-communiste François Mitterrand.
Pour mon gaulliste de père, cette épreuve était vécue comme une aberration, un ersatz de l’Histoire, une impossibilité, une meurtrissure. Les repas de cette époque ainsi que les longs dimanches après-midi, étaient empoisonnés par les débats, les inquiétudes, la colère de mon père.
Les vacances d’été battaient leur plein et la famille se préparait à prendre la route vers Fréjus où nous passions un mois des grandes vacances dans la maison secondaire de mon oncle, le frère aîné de mon père. Maman avait préparé les valises pendant que mon père continuait jusqu’au bout ses consultations. Comme chaque année, j’étais partagé entre l’enthousiasme de retrouver mes cousins, les plaisirs de la mer et l’excitation des départs. Je passais tout le trajet interminable coincé à l’arrière de la voiture entre mes deux frères et la portière droite, derrière ma mère qui tenait à merveille le rôle de copilote.
Il faisait chaud, nous roulions les vitres ouvertes d’où s’échappaient les fumées du cigare paternel. Je rêvais aux possibles, les cheveux aux vents, mon regard plongé dans les paysages qui défilaient se perdait dans mon imagination, je fuyais cette voiture, ce carcan, cette prison de tôles, je m’envolais au plus profond de moi.
Maman réussissait parfois à nous faire écouter en boucle une cassette de Julio Iglesias qui nous accompagnait alors le long des campagnes qui évoluaient au fil des heures. Tout ce temps passé à écouter l’hidalgo tombeur était à chaque fois une petite victoire pour ma mère.
Comment était-il possible que mes frères et moi soyons si étrangers au sein d’une même fratrie ? Comment des êtres si proches du point de vue des chromosomes pouvaient-ils être si différents, si opposés ? Comment la nature profonde des êtres pouvait-elle être modelée, modifiée, reconfigurée par une éducation, une culture ?
Je faisais abstraction de mes deux frères à l’arrière de la Peugeot 504 de mon père. Je me concentrais sur le bruit du moteur diesel, sur la conduite pépère du paternel, sur la couleur et les motifs du tissu des fauteuils pour en faire une aire de jeux, de découvertes, de courses-poursuites, pour y inventer un dédale de chemins où se perdaient mes héros qui poursuivaient de terribles méchants pas contents.
Un des meilleurs moments de ces départs en vacances demeurait les rares espaces-temps durant lesquels mes frères et ma mère dormaient. Mon père luttait contre le sommeil, agrippé à son volant en écarquillant les yeux qui fixaient la ligne blanche au centre de la chaussée, il espérait secrètement enfin apercevoir le panneau qui allait indiquer le nom de la ville tant attendue et ainsi achever ce long périple vers la chaleur, la plage, les parasols, le pastis, la détente, les vacances.
J’étais bien dans ce dortoir mobile qui fendait l’air chaud en direction de la mer Méditerranée. J’étais seul au monde, la tête penchée à l’extérieur de la voiture, les yeux fermés, le vent fouettait mon visage et balayait mes cheveux pour former une raie au milieu digne des héros de Pagnol. Devenu empereur des terres ensommeillées, je régnais sur mes sujets endormis, je maîtrisais un silence d’or, je jouissais d’un pouvoir fugace, mais si puissant. Je regardais mon frère dormir sur l’épaule de notre aîné, libérant ainsi de l’espace que je m’empressais d’occuper. Je contemplais ces frères inconnus à qui je ressemblais pourtant beaucoup, je tentais de percer les mystères de notre incompréhension au travers de leurs yeux clos pendant que maman ronflait la tête en arrière et la bouche entre-ouverte. Ces moments de quiétude m’apportaient une sérénité, un bien-être, je devenais le commandant en second de la voiture familiale qui se rapprochait inéluctablement de la mer azur.
Mardi 24 octobre 2017
J’étais toujours étendu dans une sorte de long tiroir froid et noir, dans le silence de la mort, le nez et la bouche enfin débarrassés de la mousse enfoncée là deux jours plus tôt. Les lieux semblaient comme ensevelis sous le poids du silence, du vide, de l’absence de tout. Par moment, cet abysse insonore était troublé par les bruits métalliques de portes qui claquaient, des parois lisses étaient choquées, des glissements sinistres provoquaient des ondes d’un autre monde venues déranger le calme synthétique de ces locaux secs de vie.
Dans la matinée, trois personnes entrèrent dans la pièce. Il s’agissait d’un médecin légiste accompagné de deux gendarmes : le capitaine Le Brio et son adjointe Leborgne.
Le médecin tirait doucement le tiroir où mon corps gisait afin que le capitaine et son acolyte m’examinassent. Il déclama le topo qu’il avait préparé à la suite de mon examen préalable en énumérant de façon froide et mécanique les différentes constatations visibles et supposées.
Le Brio présentait au médecin une ordonnance d’autopsie délivrée par le procureur de la République pendant que Leborgne finissait de prendre des notes d’une manière scolaire, mais semblait-il efficace.
Le capitaine Le Brio était un homme assez grand, fin et longiligne, avec de grands pieds camouflés dans de vieux mocassins usés. Ses longues mains sèches fortement veinées trahissaient une nature nerveuse et anxieuse du militaire. Il portait fièrement un képi bleu qui cachait une chevelure courte mais dense et grisonnante. Son visage anguleux, fin, annonçait un caractère sérieux, un peu austère et surtout rempli d’un désir de justice, de bien faire.
Mademoiselle Leborgne avait un physique de jeune femme jolie et dynamique. Elle avait toujours un sourire aux lèvres et aux yeux, qui contrastait avec l’austérité de son binôme. De grands yeux bleus illuminaient un visage rond aux pommettes saillantes et au nez fin, court et droit. Ses cheveux blonds étaient canalisés dans un chignon serré haut perché sous le képi. Sa taille modeste s’harmonisait à merveille avec sa petite corpulence pour offrir une silhouette gracieuse.
Le chef et sa subordonnée s’en allèrent par les couloirs glacés du centre médico-légal.
— Que penses-tu de cette affaire Leborgne ?
— Je ne sais pas, ça ressemble à un meurtre, chef.
— Oui, un meurtre original.
— Mais pourquoi avoir mis de la mousse dans son nez et dans sa bouche ? se demandait l’adjointe.
Le Brio restait silencieux, s’interrogeant sur les causes de ma mort surprenante et inédite dans ses annales.
— Les résultats de l’autopsie de son corps nous éclaireront sans aucun doute, ajouta le capitaine pensif.
Le Brio paraissait tendu, soucieux, il n’était pas très souvent soumis à ce genre d’affaires, de meurtres, semblait-il, plus habitué aux cambriolages, aux problèmes de voisinage, de disputes entre piliers de bar en fin de soirée, de dégradations de biens publics, de tapages nocturnes…
Avec cette affaire, Le Brio devait faire face à un tout autre défi, à une enquête bien plus complexe.
Dimanche 4 décembre 1983
Généralement, maman organisait la mise en place du sapin de Noël le premier dimanche de décembre. C’était un de ses rôles, une de ses fonctions officielles au sein de notre famille. Elle y accordait, cela va de soi, une grande importance. Rien n’était fait au hasard.
Alors que Joan Miro allait disparaître quelques semaines plus tard le jour de Noël, mon artiste de maman s’investissait totalement dans la mise en place du sapin et de toutes les décorations annexes. L’arbre qui célébrait la naissance du Christ jouait évidemment un rôle central. Maman l’avait fait livrer et installer la veille, le sapin nu qui avait trouvé sa place dans un coin du salon attendait ses décorations. Mes frères désertaient ce moment depuis quelques années, c’était donc maman et moi qui œuvrions pour donner un air de fête au conifère sacrifié. Nous le couvrions de boules dorées, nous installions des guirlandes électriques qui donnaient ses lumières au sapin, j’accrochais des cloches argentées, des personnages bedonnants, des animaux tels des cerfs, des ours, des lapins, l’arbre de Noël croulait sous les ornements. Maman finissait par positionner l’étoile au somment du sapin et nous disposions enfin une crèche au centre d’un petit village reconstitué avec de multiples animaux de la ferme en plastique, de faux arbres, de haies et autres cabanons. Nous ajoutions également beaucoup de santons dont mon père appréciait énormément la présence. Afin de lier le tout, nous plaquions sur toute la surface du sol de la mousse des bois, quelques brindilles et morceaux de branches. Ma passion pour les bryophytes datait certainement de ces doux moments de récolte. En effet, nous prenions la voiture, maman et moi, en direction d’un bois à quelques kilomètres de Bordeaux où nous étions certains de trouver cette précieuse mousse. Il s’agissait d’un bout de forêt où chênes, pins et bouleaux se mêlaient. Le sol était presque entièrement recouvert d’une mousse verte, onctueuse, pure. Rien ne venait pervertir cette pureté, seules quelques feuilles mortes ou des paquets d’aiguilles de pin sèches la recouvraient par endroits. Je marchais sur ce tapis où mes pieds s’enfonçaient et où une fois accroupi, mes mains caressaient le matelas vert avant que mes doigts ne pénétrassent dans cette ouate chlorophyllée. J’éprouvais un réel plaisir à les enfoncer dans ce décor naturel propice aux rêveries champêtres, à la sensibilisation à l’écologie naissante, à la fragilité du monde, à l’émoi sensuel…
Mon corps tout entier plongeait au cœur de cette nature jusqu’à m’évanouir dans ce monde merveilleux, royaume de la poésie, je flottais sur les méandres de mon imagination en plein développement où de multiples personnages fantastiques envahissaient les campagnes de ma pensée. Je m’échappais du réel, des carcans de ma vie d’enfant, des murs de ma chambre trop rapprochés. Mon esprit profitait de cette porte de sortie pour s’évader vers l’inconnu, l’espoir, l’aventure, pour oublier un monde qui ne me plaisait pas, me paraissait trop étriqué et fade. Ce rêve éveillé était parfois interrompu par le cri strident d’une pie probablement mécontente de notre présence dans le bois, il me ramenait brutalement à la réalité ! Nous ramassions la quantité de mousse nécessaire pour la décoration du pied du sapin.





























