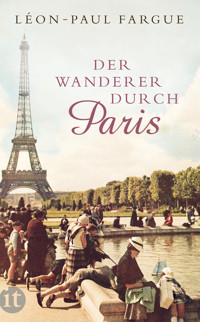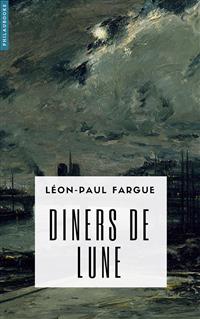
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
En dépit de ce qui se passe, comme disent, sans le dire, tout en le disant, les flâneurs des deux rives, les gens du voyage et les compagnons de la solitude, en dépit du malaise menaçant, qui, de la distance d’un oiseau planant, se rapproche jusqu’à celle d’une brosse dure ; en dépit de l’écœurement où nous ont jetés tous tant que nous sommes l’intellectualité pure, l’idéologie à tous les étages, la sociologie obligatoire, eh bien, en dépit et au delà de tout cela qui n’est qu’un prurit, un coup de cerveau, mais qui passera, qui nous rendra les cerises et leur temps, j’aime mon pays. Léon-Paul Fargue Diner de lune, publié en 1952, s'inscrit dans la continuité d'Un déjeuner de soleil.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Dîners de Lune
Léon-Paul Fargue
Table des matières
1. Tout simplement
2. Légendes
3. Gourmets et gourmands
4. Du préfabriqué
5. Le drame de l’argent
6. Cactées
7. Cirques et clowns
8. Le stylographe
9. Féminité occidentale
10. Fantaisistes et fantaisies…
11. Le timbre-poste
12. Le musée Grévin
13. Ce que lisent les femmes
14. Voyages, déplacements et villégiatures
15. Les caractéristiques français
16. Haute couture
17. Le petit doigt qui parle
18. Un nouveau mal du siècle
19. Optimisme
20. Camping 38
21. La vieille fille
22. Des rapports du sexe fort au sexe faible
23. Le gîte et la pitance
24. Maisons Tellier
25. La plume reparaît (1946)
26. Un flâneur à l’exposition de 1937
27. Taxes
28. Charmes du recul
29. Le feu
30. L’exposition de New-York (1939)
31. Le théâtre de l’année 1946
32. Bal des petits lits blancs
33. Souhaits de nouvel an
34. Couverture
1
Tout simplement
En dépit de ce qui se passe, comme disent, sans le dire, tout en le disant, les flâneurs des deux rives, les gens du voyage et les compagnons de la solitude, en dépit du malaise menaçant, qui, de la distance d’un oiseau planant, se rapproche jusqu’à celle d’une brosse dure ; en dépit de l’écœurement où nous ont jetés tous tant que nous sommes l’intellectualité pure, l’idéologie à tous les étages, la sociologie obligatoire, eh bien, en dépit et au delà de tout cela qui n’est qu’un prurit, un coup de cerveau, mais qui passera, qui nous rendra les cerises et leur temps, j’aime mon pays.
Je l’aime comme on aime une femme, physiquement et pensivement, je l’aime comme on aime une compagne. Il m’épaule et me console, et je me retourne dans notre confusion actuelle avec les souvenirs dont il m’emplit, je me débats dans nos convulsions avec les armes de ses images, avec toutes les images qu’il m’a données le long de ma vie, comme des cadeaux. Quelles images ? Mais, celles de la terre de France.
J’aime songer aux villages de la Savoie, renversés au fond des vallées comme des jeux de dominos, survolés dans l’aigue-marine du ciel par de grands oiseaux à lunettes. Je revois ces portes, ces jardins bien meublés, je crois entendre ces bruits de sabots par quoi se signale le train-train de la population de ces villages tricotés comme des gilets de chasse, bien au chaud dans leurs traditions. J’aime les chemins creux de mon Berry, ses clochers dorés comme une flèche de gypse, ses étangs bigles, ses légendes, ses chasses fantastiques, ses lavandières de nuit, les haies et les tournants de ses routes, pleines du nasillement des moyeux, des jantes, des ressorts d’une bande de vieilles voitures qui s’en vont à la foire et à la noce. Il me semble que je revois les images et que je sens encore les odeurs qui montent de ces spectacles charmants et dans lesquelles se marient les tableaux parfumés de la nature et du cœur. Collerettes des filles à marier, touffeurs des beaux soirs de juin coiffés de foin ; peinture des soldats répandus dans les bourgs et colorations des boutiques, fines comme de vieilles soieries ; charme des amours et des forêts… J’aime les hautes toitures du Jura et l’ocre profonde de ses fermes, l’hospitalité de ses aubergistes, le silex de ses vins, l’âpreté suave de ses champignons. Je regrette la sieste appliquée et créatrice du Midi méditerranéen, les pêcheurs étendus sur les dalles chaudes, les belles jambes nues et bien roulées des mareyeuses, et leur cri de liberté vraie. Si je me tourne du côté de l’Yonne, j’aime ses pentes douces où l’on aperçoit toujours, tantôt à gauche et tantôt à droite, des lointains à la Poussin, des premiers plans à la Chardin. J’aime la gaité grave, mais sans arrière-pensée, des Charentes, aux verts délicats, presque saupoudrés de poudre d’oiseaux… J’aime les bras rêveurs de nos rivières, les yeux pers de nos canaux, le beau front de nos forêts, la clarté de vue de nos horizons. Mais je me souviens aussi des menhirs et des dolmens perdus de Bretagne, qui s’en retournent vers les maisons du passé comme de vieux professeurs, les mains derrière le dos… Et j’aime les vaches et les dindons, les portes cochères et les peupliers élégants de ces beaux chemins qui vont de Roanne à Montluçon, de Chaumont à Langres, d’Orléans à Tours, et les mélodies qui naissent peu à peu de ce concert. Je n’en finirais pas sans doute d’énumérer les enchantements de cette belle fresque heureuse et tourmentée. Mais je dirai tout d’un mot : la France c’est pour moi la poésie. La vraie poésie, nourrie par en-dessous, tenue par la mesure. La France émerge douce et triomphante, de cette poésie infiniment réussie, toujours renouvelée, qui est à la fois sa complexion et son secret.
Je songe aux métiers, aux familles, aux routes sans goudron, aux vieux ponts des provinces, aux chasubles des fenêtres, aux cachotteries des armoires, à l’étoffe même de la réalité française dans laquelle s’enveloppent les destinées particulières, les espérances et les gentillesses de notre vie à tous. Je songe à nos animaux familiers, aux patois, aux veillées des chaumières, aux réunions à la Flaubert, aux méditations à la Balzac, aux effusions à la Francis Jammes, à tout cela qui compose le merveilleux tableau de maître que nous ne savons plus voir, et qui, cependant, est là, face à notre sensibilité. La France est une salle de spectacle heureuse et soignée. C’est une des sommes poétiques les plus éloquentes que la nature ait mises à la disposition des hommes de bonne volonté. Je voyage dans mes souvenirs, je cours après ma jeunesse à travers ces dons inestimables et réconfortants. Et je retrouve toujours des enseignements riches et frappants au bout de mes courses dans moi-même — dans moi-même intimement mêlé aux caprices du pays. Et ceux-ci me rendent l’espérance, me la posent sur le bord des rêves.
Oui, en dépit de ce qui se passe, et qui ne provient que de la fureur intellectuelle, de cette manie sans analogue de vouloir placer le cerveau aveugle avant les mains et les intuitions, le raisonnement avant la méditation, le sujet avant l’objet, en dépit de tout cela, la France demeure, avec ses paysages, ses traditions, son labeur, et surtout sa poésie naturelle, semblable à une statue confiante et dorée au fond de nos consciences bourrelées, qui voudraient bien revenir « à la page où l’on aime »…
2
Légendes
La plus grande part de notre vie, et bien souvent la plus sérieuse, repose sur les bruits qui courent. Nous croyons tous à ces romans qu’on accroche à quelque cause insignifiante ou fortuite, et nous les alimentons à notre insu. Nous les prenons pour de la monnaie sonnante, car il n’y en a pas d’autre. Nul n’est censé ignorer cette loi non écrite d’après laquelle ce ne serait pas le bon sens qui est la chose du monde la mieux partagée, mais la petite imagination.
Votre ami Léandre a été vu une fois dans un café passé minuit, on ne sait par qui, mais, au bout d’une semaine, c’est un pilier d’estaminet, c’est un désespéré, un personnage dostoïevskien qui passe ses jours et ses petits jours au bistrot. Vous avez oublié de régler votre teinturière, cela vous est sorti de l’esprit. Quelques jours plus tard, vous êtes un homme couvert de dettes qui ne songe pas à faire face à ses engagements ! Un mur de coton et de gaze se dresse devant vous et vous vous cognerez dedans à partir de cette sentence obscure : Vous avez des dettes ! Essayez d’en sortir et vous m’en direz des nouvelles. Autre exemple : Votre conjointe, votre sœur ou votre secrétaire a pris un jour un taxi en lieu et place du métro et ceci pour arriver à temps au rendez-vous que vous lui aviez fixé. Eh bien, c’est dorénavant une femme perdue qui se ruine en voitures et à laquelle aucune mission, même anodine, ne peut plus être confiée car elle sabote la besogne et la dissout en aventures. Le mal est fait et la pente à remonter est trop longue. Il faut accepter les gens selon la légende. Personne ne coupe à ces coutumes inexplicables et comme naturelles. On vous apprend bien, quand vous êtes jeune, à croire le contraire de ce que l’on vous dit, mais il ne s’agit plus du contraire ; il s’agit d’une vérité de moment, dont on se sert pour faire une vérité de durée. Il s’agit d’un épisode dont on se sert pour fabriquer une destinée…
Ces inventions de l’observation quotidienne et de la rêverie mêlées constituent l’écran même sur lequel se projettent nos vies, et les trois quarts du temps sans que nous y prenions garde. Il y a plus : nous collaborons de toute notre puissance fantaisiste à ces contes de bonne femme. C’est sans doute qu’il y a là une loi de nature, et que nous ne pouvons exister qu’au milieu de personnages mi-réels et mi-conçus. De là tant d’amants imaginaires, de maîtresses controuvées, de véhicules fabuleux, d’animaux domestiques invisibles, de vices impalpables et de douces manies que personne ne vérifie. « Méfiez-vous d’un tel, vous dit-on à l’oreille, il mange du savon, boit de l’eau de Cologne, pique avec des épingles les maîtres d’hôtel au passage, hypnotise les bibelots et hurle à la lune quand il voit des haricots blancs sur une table… N’invitez jamais le docteur Muchetruc, il a constamment besoin d’un million pour faire une banque, un journal, acheter une colonie… Quant à la petite Léontine Mystère, elle dit qu’elle rêve de brûler ses amants dans un séchoir électrique… » Ainsi s’établissent les réputations, non seulement dans ce Paris où les oreilles sont toujours affamées, où les curiosités particulières se tournent les pouces, mais au delà des mers et dans tous les empires. Cela commence chez la concierge et finit au cinéma. Vous ne faites pas un pas qui ne vous conduise dans les vues de l’esprit. Tout se passe comme si les hommes ne se consolaient pas d’avoir rompu avec la mythologie, les sorcières et le marc de café. Ajoutez à cela qu’on ne vous laisse jamais en paix si vous êtes blanc comme lys et immobile comme une mare au fond de votre confort intime. Essayez de ne pas sortir de chez vous, et, quand vous sortez, ayez soin de ne point sortir votre langue. On dira aussitôt de vous que vous fabriquez de la fausse monnaie ou que vous pataugez dans les vices impunis.
Or, cette ambiguïté est notre lot. Malade, enfermé dans une cellule, loin de votre patrie, on vous prêtera encore un autre train que celui que vous avez pris. Il me souvient d’avoir regardé une rue « prise à part » dans la fourmilière parisienne, des heures durant. D’avoir regardé cette rue comme un visage pourvu de front et d’oreilles. Ce n’était bientôt plus une rue, mais une ruche, une boîte à musique, une fosse d’orchestre. Les persiennes bourdonnaient d’imagination frénétique ; les voûtes écoutaient, bouche ouverte ; il n’était pas une porte qui ne babillât. Rien, pas même la matière, ne voulait vivre dans l’ordre, avec passions contrôlées, sagesse ancienne et bien huilée, routines de grande classe. Il fallait contrefaire le réel, falsifier ce qui se voit et se palpe, imprimer des courbures. La sainte hypocrisie se dresse au milieu de ce ravage de paroles. Et l’on serre fortement la main de celui qui se couvre de dettes, qui se ruine en limousines, entretient douze maîtresses et signe des chèques sans provision. Qui sait ? nous préférons peut-être ce personnage faux au vrai, même si nous nous efforçons de lire à travers le masque… Cela flatte nos accommodements avec cet univers occulte dans lequel nous cheminons mi-souriants, mi-tremblants…
Je sais comme tout le monde que Dieu, en fin de compte, reconnaît les siens, et vous-même, parfois, il vous arrive de songer qu’un tel ne passe pas tous les mois de l’année au café. Il vous arrive de trouer la légende ambiante, d’user de vos dons de double vue dans la vie opaque. Mais des fêlures demeurent sur ce cristal, et vous n’aurez pas fait dix pas que des doutes viendront assaillir vos tempes : « Et si, par hasard… ? » Nous sommes tous atteints de ce mal nommé l’imagination des jaloux et d’après lequel nous établissons le pour et le contre. Nous en arrivons vite à nous croire nous-même sur la base du murmure général. Il faudrait une nouvelle guerre mondiale pour sortir de ce guêpier, et encore ! Il circule tant de bruits par la ville et par le monde que les distances deviennent folles qui nous séparent de l’exactitude rétablie… Ce ne sont que traites protestées, maladies honteuses, taxis abandonnés avec des ardoises importantes, propos qui n’ont jamais été tenus, bonnes intentions transformées en machiavélisme… et autres fariboles empoisonnées comme langues de vipère. Ces opinions fausses sur les gens, les familles et les camarades sont difficiles à redresser. Mais c’est la petite histoire, et il faut en prendre son parti. Si encore les rumeurs étaient poétiques, nous serions tous heureux, enchantés, mais elles sont presque toujours malveillantes. Un tel est comme ça, et voilà tout ! C’est le mensonge (en temps de guerre bourrage de crâne), qui mène ce pauvre monde par le bout du nez.
3
Gourmets et gourmands
Un monde les sépare. Le gourmand, c’est celui qui mange sans compter, sans choisir, qui manque de discernement, qui perd le nord devant un beau morceau. Il ne se déplace pas, commande ce qu’il désire par téléphone et descend à la gloutonnerie sans se retourner. Autrefois le gourmand signifiait le gastronome, et on le trouve ainsi désigné dans des Brosses, dans Marivaux, dans les anciennes gazettes. Mais cet honneur lui fut retiré quand on s’aperçut qu’il creusait, comme on dit, sa fosse avec ses dents et que la mort entrait en lui par le palais. Ainsi le maréchal de Villars fut un gourmand, pour ne pas dire un glouton.
Tout autre est le gourmet, qui fut d’abord un fin gourmet, mais qui se situe fort noblement aujourd’hui dans le langage, où il a rang d’artiste. Le gourmet est avant tout le dîneur ou le soupeur qui sait choisir, qui ne mélange ni les goûts, ni les fumets, ni les vins, ni les épices. Experts gourmets, piqueurs de vins, disait-on jadis, quand le mot gourmet ne désignait encore que les connaisseurs de crus. Mais c’était déjà le préparer aux finesses, aux modérations. Le gourmand est un égaré, le gourmet est un pondéré, c’est pourquoi les innovations culinaires épouvantent moins le second que le premier, car le gourmet s’intéresse aux produits, à la fabrication, aux audaces, et quand elles lui semblent plausibles, quand elles se rattachent pour lui à d’autres manifestations du goût, il les adopte.
Le gourmet est celui qui pressent au premier choc l’excellence de cette recette de mon vieil ami Pierre Lestringuez : ouvrez par le milieu longitudinalement un beau rôti de veau, insérez dans cette fente un morceau de boudin dépouillé de sa peau et enveloppé dans une mince tranche de jambon de Parme, ficelez serré et cuisez au four comme un rôti ordinaire… J’ai goûté de la chose, et j’ai connu que je n’étais point gourmand, ou plutôt que j’étais un gourmet qui eût bien voulu devenir gourmand. Mais je connais aussi, qui chantent dans les cuisines de ma mémoire, des pâtés de truites, comme on n’en mangeait pas dans les Mousquetaires au Couvent, des civets de saumon frais au Vosne Romanée, des soupes de rognons de veau à la russe, des langoustes farcies, frottées d’ail, doucement rôties au four sous une neige de Parmesan, arrosées de cognac, finement flambées, et servies dans le soleil du champagne. Je connais des menus à réveiller des morts, à faire danser dans les cabinets particuliers tous les spectres de la gastronomie gréco-romaine, artistique et littéraire, et qui eussent fait pâlir Brillat-Savarin, les membres du Grand Perdreau, les chefs de la cour d’Angleterre, le cuisinier de Rossini et autres princes de la sauteuse. Tenez bon la rampe :
Broutilles, miévretés et pastiqueries,
Calotines d’agneau en musette,
Ris de veau sous cloche à la mode du couvent,
Désirs de Roi,
Étoiles filantes,
Etc…
Le gourmet est aussi un homme qui va lui-même aux fromages, qui aime qu’on lui adresse ainsi la parole : « Votre camembert, monsieur, c’est pour le déjeuner ou pour le dîner ? » Car ce n’est pas le même. Le gourmet se charge des vins, des liqueurs, des fruits qu’il palpe et renifle avec beaucoup de dignité, de flegme, sans vouloir étonner le marchand, mais plutôt l’amener à des conceptions nuancées. Il ne s’enivre pas. Il ne s’empiffre jamais. Il ne mange pas comme le frère Ange de la Rôtisserie de la Reine Pédauque, qui attrapait des morceaux de dinde à la volée. Il est plaisant à voir à table, car il ne produit aucun effet, comme le véritable élégant. Il sait parfaitement ce que c’est que le gigot Pravaz, la côte de porc à la bière, le lapin aux herbes, le poulet chargé au croupion d’un obus de fromage blanc, le steak tartare, splendide comme une confiture de viande, le lièvre à la Royale, les gélinottes à la crème fraîche, pareilles à des chapeaux sur des visages de princesses un peu passées, les crêpes à l’angélique, le bœuf à la ficelle, si cher à mon vieil ami trop tôt disparu, le gouverneur général Marcel Olivier, la sarcelle rôtie, l’omelette au saucisson sec, à peine teintée d’ail et relevée d’une pointe d’aneth au dernier moment, le jambon chaud au whisky, et bien d’autres choses encore, mais il n’en fait pas étalage.
Sa grande formule est célèbre et connue, si j’ose dire, de tous les lettrés : deux plats, deux vins. C’est la plus pure tradition française, et c’est dans la préparation de ces deux plats que se distinguèrent, que luttèrent âprement, des années durant, les membres charmants d’un dîner parisien « dont j’ai oublié le nom ». Un dîner de gourmets, bien entendu. Douze membres, douze dîners, douze réunions annuelles chez l’un des adhérents. Le fin du fin était de servir aux amis les choses les plus simples. Toute l’attention allait au style, au faire, à la coupe, au je ne sais quoi qui vous met un bœuf gros sel ou une soupe aux choux sur le plan divin. Jamais d’invitation en excédent. Rien que les douze initiés. Interdiction formelle d’inscrire sur son menu les plats choisis par le collègue. Toute l’année était prévue d’avance, comme une saison théâtrale. Celui-ci offrait des quenelles de brochet et le gigot d’agneau purée de châtaignes. Celui-là promettait le turbot poché et le râble de lièvre. Le premier annonçait : Montrachet, Hermitage. Le second murmurait Grenache authentique, pris sur place, Grand Échezeaux. Et les réjouissances de se répartir sur l’année. Quelles années, ventrebleu !