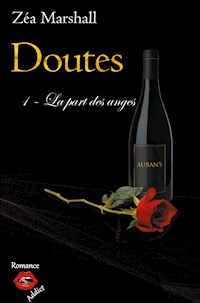
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le monde peut bien tourner autour d'elle, Yaëlle s'en moque. Pourtant, à vingt ans, une jeune fille en fleur devrait s'étourdir dans la ronde des sentiments. Elle devrait vivre et se perdre dans ces tumultes intimes que seules les femmes connaissent. Elle devrait donner corps à ses amours rêvés. Landry est un play-boy, collectionneur d'histoires, taxidermiste des coeurs. Un esprit frappeur. Ils se rencontrent. La douce lumière du printemps angevin inonde les vignes, le renouveau de la vie écrase la morte-saison. Cette année, le vin sera bon. Tout comme lui, Yaëlle aura besoin de vieillir. De prendre de la maturité. D'associer saveurs et épices, parfums et force, de donner une nouvelle couleur à sa robe, et d'enivrer, d'étourdir Landry... Landry devra boire au calice de sa beauté, de son amour démesuré et il devra contrôler l'incendie qu'il a provoqué dans le corps et l'âme de Yaëlle. Pourtant, tout les séparent. Alors, ils se feront mal, ils s'écorcheront vifs aux barbelés de leurs tourments, se perdront coeurs et âmes dans la lie écarlate de leurs amours incandescents et nieront l'essentiel. Souhaitons qu'il leur restera à consommer la part des anges flottant quelque part entre ciel et terre... Il est des histoires qui nécessitent plusieurs tomes. Celle-ci en est une. Parfois crue, parfois poétique, parfois déroutante, Zéa Marshall offre à ses lecteurs, une fresque angevine, digne de ces histoires qui ont marqué plusieurs générations de spectateurs. Pionnière de la collection Romance Addict, femme d'expérience et de talent, notre auteure avec sa saga " Doutes ", vous emportera dans une douce ivresse des sens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
Chapitre 29
Chapitre 30
Chapitre 31
Chapitre 32
Chapitre 33
Chapitre 34
1
Admise. Les lettres de mon nom se mêlent sur cette liste interminable de résultats. Au milieu des hourras, des cris, des pleurs, je suis seule, stoïque et admire bêtement le mien. Droite comme un I, les poings serrés, mon cœur bat la chamade. Aucune émotion sur mon visage, j’intériorise. Du soulagement, voilà mon ressenti : c’est enfin fini. Admise, est-ce que je dois me réjouir ? Non. Un petit rayon de soleil dans ma vie de merde. La fin d’une scolarité interminable. Je suis silencieuse au milieu du brouhaha. Pas comme les filles de ma classe. Adulées, hystériques, leurs parents proches, heureux et fiers, ils s’embrassent, se serrent fort dans leurs bras. Je les mate mine de rien. Cette effusion m’écœure, parce que moi, je suis seule, comme toujours.
Je sors de mon lycée, reprends mon vélo pour rentrer. Je n’aurai pas de fiesta « fin d’examen, casse-boîte et fête foraine ». Je ne suis pas la fille que l’on invite. Transparente. On m’évite. On m’ignore. Même si je criais, je ne suis pas sûre de déclencher une quelconque réaction.
Je parcours les cinq kilomètres de plats alternés de coteaux en ronchonnant pour une soirée ordinaire en perspective dans cette maison minable où j’habite. Je descends à toute vitesse le grand chemin de terre et de trous qui mène au « Bas Bel Air » : un corps de ferme vieillissant que personne n’a pris le soin de restaurer. J’y vis avec ma mère.
La vue de cette masure ne me remonte pas le moral.
Je pose mon vélo contre la grange. Un petit regard vers le ciel, il est bleu azur, aujourd’hui. Je souffle. Le lui annoncer ? Dans quel état va-t-elle être à cette heure ? Je ferme les yeux, prends mon courage à deux mains et j’entre. Ma mère est collée dans son canapé, hébétée devant une émission de télé pourrie, un verre à la main, comme d’habitude. Elle ne me remarque pas. Ses yeux sont vitreux, injectés. Elle doit avoir sa dose et planer loin, très loin… D’habitude, je l’ignore ; elle aussi, d’ailleurs. Aujourd’hui, c’est un peu jour de fête :
— J’ai mon bac, tenté-je en le lui murmurant.
Aucune réaction. Elle mate son écran, la bouche mollement entrouverte. Pitoyable. Une petite tape sur son épaule.
— Eh, j’ai mon bac.
Péniblement, elle se tourne et me dévisage comme si j’étais une inconnue, digérant la modeste information que je viens de lui communiquer. Une lueur apparaît dans ses yeux, me donnant un léger espoir.
— AH, ton bac… Il faut que tu bosses, maintenant.
Elle se retourne vers le poste.
Voilà, les félicitations de ma seule famille. Quand je dis « vie de merde ».
Mon père est décédé, il y a cinq ans. Crise cardiaque, tic, tac, boum, clap de fin. Le résumé de cette tragédie. Les obsèques sous la pluie, une dizaine de personnes que je ne connais pas autour du cercueil. Rigide, figée, je n’ai pas prononcé un mot, pas versé une larme. J’étais ailleurs. Ce sont les seuls souvenirs que j’en garde. Douloureux. Depuis, le temps s’est arrêté. Ma mère est murée dans un silence, dans son monde dont je ne fais pas partie.
Il était mon roc. Enfin, je crois. Il faisait que ma vie avait à peu près un sens. Aimant avec maladresse, j’étais sa princesse, comme il adorait me le dire. Son histoire avait été compliquée pour peu que j’en connaisse les contours : famille d’accueil, atterri en Anjou par hasard, après avoir vécu à Paris, rencontré ma mère et lui avoir fait un gamin. Une vie de patachon faite de combines et de bons plans, tous plus foireux les uns que les autres.
N’empêche que même s’il me laissait souvent seule avec elle, même s’il était loin d’être le père idéal, il essayait de combler le manque maternel, maladroitement. Imaginez ce que cela a pu donner quand je suis devenue… enfin, vous savez, une petite femme, pour le dire simplement. Un grand moment de solitude.
Je l’aimais.
Ma mère et moi ? Une relation compliquée entre deux étrangères. Parfois, je me demande si elle m’a enfantée. Rester toutes les deux ? Notre punition. J’envie souvent les filles de mon lycée, celles qui s’engouffrent dans la dernière « Mini » de leurs mères, qui leur ressemblent comme deux gouttes d’eau et qui se vantent du précédent week-end shopping. Pas nous. Nous crevons la dalle, nous vivons dans un taudis, et chaque mois, chaque semaine, chaque jour, c’est la même rengaine : survivre. Aucune complicité. Nous sommes deux colocataires, piégées dans une vie que nous ne désirons pas.
Je sors de la maison et file vers mon coin préféré : un petit talus à l’abri des regards, sous des arbres centenaires, en pleine nature, le seul bruit des oiseaux pour me tenir compagnie, où je me cache, où je me ressource et où je viens dévorer des livres. Un endroit hors du temps qui me protège et me permet de m’évader pour oublier qui je suis et où je vis.
À l’ombre de mes arbres, je réfléchis à mon avenir. Trouver un job ? Ma priorité numéro un, pour une longue liste de bonnes raisons : passer mon permis, m’acheter une voiture, manger et me tirer de ce bled pourri pour vivre Ma Vie. Au plus profond de mon être, j’ai ce sentiment qu’elle ne peut pas se résumer aux années qui viennent de s’écouler ; qu’un jour, j’aurai accompli mon destin. Je serai quelqu’un. Une certitude, elle m’a permis d’accepter toute cette noirceur, m’a fait tout supporter : les railleries, les moqueries, le regard des autres. Comme me l’a dit un jour Allan, assis à côté de moi en cours : « Tu es notre Cosette des temps modernes. »
Physiquement, je ne peux pas faire plus désuet. Soyons franches, mon allure est démodée. Vêtements de récup, fripes, l’ensemble ne fait pas vintage ou bobo, plutôt un joli capharnaüm de couleurs passées : la mode, ce n’est pas mon truc. Les habits sont un moyen de me protéger comme s’ils avaient ce pouvoir de me créer une armure. J’ai le visage triste avec un regard noir. Je tire mes cheveux, les attachent sans réellement en prendre soin. Je ne me maquille pas, prends des tenues plus amples pour ne montrer aucune forme de moi. Je n’attire pas les foules. Personne ne vient spontanément à ma rencontre et cette situation me convient.
Ma vie sera celle que j’ai décidée. Personne ne me l’imposera. Je ne peux compter que sur moi. Et pour ce faire, je me formalise un plan d’attaque, maintenant que j’ai mon sésame. Première étape : permis de conduire… Onéreux, même en le préparant dans une auto-école low cost. J’ai besoin d’argent, et sans voiture, je n’irai pas loin. Je ne me vois pas passer ma vie en Blablacar ou Blablabus. L’an dernier, pendant les vacances scolaires, j’ai travaillé chez un maraicher. C’était dur, physique, mais j’ai gagné quelques euros que j’ai mis au chaud dans ma cagnotte « je me tire d’ici ». Demain, je file à l’agence d’intérim et je ne les lâcherai pas tant qu’ils ne m’auront pas trouvé un job. Je me motive mentalement, allongée sous mes arbres, les yeux perdus dans le vide : courage, courage, bientôt, ma vie sera douce.
Je vais vivre une destinée extraordinaire, j’en fais le serment.
Depuis un mois, je me lève à cinq heures trente du mat’ en grimpant sur mon vélo pour aller travailler. L’agence d’intérim m’a reproposé un contrat chez un maraicher pour l’été : cueillir des légumes en plein champ avec des collègues sympas et jeunes qui ne me connaissent pas et n’ont pas d’aprioris. Parfait.
Ce soir, je termine, avant deux semaines de vacances (forcées) et enchaîne avec les vendanges. En plus, j’ai trouvé une place à proximité de ma maison, au domaine de Bel Air. Une propriété grandiose, un vignoble de renom et trois mois de boulot assurés. J’ai fait mes comptes : en novembre, je me taille.
Je me lève, en ce début d’août, guillerette et de bonne humeur. Rare. La température est caniculaire. La journée s’annonce lourde. Je profite de mes congés pour nettoyer notre terrain. Des chardons ont poussé ; si je ne fais rien, les voisins vont me tomber dessus. Après le fauchage, il fait chaud, très chaud. Je ne rêve que d’un truc : me baigner. Je connais par cœur la campagne qui entoure ma maison, chaque recoin pour avoir passé beaucoup de temps dehors, seule, à me cacher quelquefois. Et l’endroit idéal pour nager… un petit ruisseau qui s’agrandit et forme une retenue d’eau. Ce havre est secret, peu connu. J’ai longtemps observé le passage avant de me décider à me baigner. Il est devenu ma piscine privative, à moi, rien qu’à moi.
Je m’y dirige tranquillement, joyeuse. À cette époque de l’année, le niveau de l’eau a bien baissé, mais reste suffisamment important. J’adore m’immerger, seule au monde. Je me déshabille et cours vers l’eau. Elle est fraîche. Une caresse sur ma peau, un sentiment de plénitude m’envahit. Je nage, plonge et finis par me laisser flotter sur le dos. Les yeux dans le vague, je regarde les feuilles des arbres qui demeurent immobiles : je suis bien. Mon esprit vagabonde. Je rêve à mon avenir, pense au dernier livre que j’ai lu.
— Elle est bonne ?
Je me redresse d’un coup, surprise. Mon cœur se met à battre la chamade. Je replonge aussi vite que possible pour cacher ma nudité. Je me retourne. Deux hommes me regardent, amusés par cette situation. Ne pas paniquer, ne pas paniquer, je suis seule, dans l’eau, nue, en culotte. Et s’ils leur prenaient l’idée de me rejoindre ?
Je les reconnais assez facilement, Clovis et Landry De La Motte, les propriétaires du domaine de Bel Air. Ils sourient comme des gamins, scrutent mes vêtements déposés sur la berge et se doutent que je ne suis pas dans ma meilleure posture. Dans ma tête, cela défile très vite : soit je reste dans l’eau et attends patiemment qu’ils se lassent et partent, soit je sors, naturelle, sans complexes, genre « un problème, les mecs ? ».
Je ne sais pas ce qui me prend : est-ce la façon dont ils me matent, me narguent, est-ce mes nouvelles résolutions de ne plus me laisser marcher sur les pieds ? Je décide de sortir et de les affronter. Je nage vers la rive, émerge lentement, regard noir à l’appui, visage sans expression. Je me dirige vers mes vêtements, déterminée : j’assume.
Leurs yeux sont écarquillés. Clovis se met à rire, pas Landry. Il me fixe. Son regard descend doucement le long de mon corps. Il me détaille centimètre par centimètre. Ses iris bleu clair me transpercent et me troublent. Ils se posent sur ma poitrine.
« Reste naturelle, sois forte. »
J’arrive près de mes habits et enfile mon T-shirt. Enfin, j’essaie. Je m’y reprends à deux fois, incapable de passer les manches. Landry promène une main dans ses cheveux en inclinant légèrement la tête. Perturbant, je prends une mini décharge et le regarde bouche bée. Nos yeux restent accrochés. Cet instant me semble une éternité. Le rire sonore de son frère me ramène sur terre. La situation l’amuse beaucoup. Pas moi. Une répartie, je dois trouver, une répartie. Je bredouille un « excellente » inaudible, comme si j’avais du yaourt dans la bouche. Je me reprends :
— Elle est excellente ! leur lancé-je d’une voix qui se veut naturelle.
Je prends le reste de mes affaires, me retourne et file à toute vitesse. Ridicule et honteuse, je rentre me cacher dans ma chambre, enfin, la minuscule mansarde qui me sert d’abri.
La lose. La grosse lose… la lose internationale, voilà ce que je me répète en boucle. À poil devant mes futurs patrons. J’ai le don pour me mettre dans des situations impossibles. Et quelle nulle, incapable de prononcer une phrase cohérente. Je ne suis pas sortie de l’auberge si je veux devenir quelqu’un. Pourquoi n’ai-je pas confiance en moi comme tous les autres ? Je frissonne de la tête aux pieds en pensant aux yeux bleu intense de mon boss, me fixant bizarrement. Le rouge me monte aux joues. Désireuse d’oublier ce mauvais moment, je me précipite sous mes draps, ferme mes paupières en espérant trouver le sommeil.
2
Cinq heures, mon réveil n’a pas encore sonné. Premier jour des vendanges et premier jour de travail au domaine de Bel Air. J’ai un nœud dans le ventre. Je ne veux pas m’y rendre. Les dirigeants de ce domaine sont les deux mecs qui m’ont reluquée à la rivière. En plus, je me souviens très bien qu’au collège, le plus jeune, Clovis, se foutait de moi à chaque occasion. J’ai supporté ces railleries, et même des jetés de pommes pourries :
— J’ai vraiment besoin de ce travail, j’ai vraiment besoin de ce travail, me répété-je à haute voix pour me motiver.
Je vais me faire discrète. Quinze jours ont passé. J’imagine qu’ils ont oublié. Ils ont sûrement oublié. Je ne crains rien. Ils ne peuvent pas se souvenir d’une nénette insignifiante comme moi.
À sept heures trente, je prends mon vélo et parcours les quatre kilomètres qui me séparent du domaine. L’arrivée se fait par un chemin annexe. Un bel endroit, typique des coteaux de la Loire. Le château domine la propriété : une immense bâtisse en pierre d’ardoises apparentes avec de grandes fenêtres à la française entourées de tuffeaux, deux tourelles et des portes en bois monumentales. L’ensemble est entretenu. Un jardin de buis complète cette demeure en lui donnant un charme fou. Impressionnant. Je me sens petite et dépareille dans un tel lieu. Les vignes l’entourent et descendent en pente douce le long du coteau. À l’horizon, la vallée de la Loire se dessine, faite de cultures, de parcelles de peupliers et du fleuve majestueux.
Je m’approche des bâtiments et rejoins les autres saisonniers. Les habitués discutent bruyamment. Les nouveaux essaient de se trouver une convenance. J’en fais partie. C’est animé. Une atmosphère particulière flotte dans l’air. Une ambiance des grands jours, l’aboutissement d’une année de labeurs pour célébrer le fruit du travail de l’homme et de la nature, généreuse dans la vallée.
Pour passer inaperçue, j’ai vissé ma casquette sur ma tête, rentré mes épaules et baissé mes yeux, cachés par ma visière, mode incognito. Je signe la fiche de présence et me faufile dans le groupe en prenant bien soin de ne pas être dans le collimateur des fameux propriétaires.
Landry De La Motte prend la parole, entouré de son frère et de leur intendant. La photo de famille est déstabilisante. Ce sont deux beautés à couper le souffle, de très beaux hommes, mais Landry est le plus canon. Il se dégage quelque chose de lui que j’ai du mal à identifier. Magnétisme ? Charisme ? J’hésite. Il nous balaye du regard et enchaîne en nous souhaitant la bienvenue et en rappelant les enjeux de cette vendange. Il nous mobilise sur notre participation à cette aventure : nous allons en être les acteurs, les maillons œuvrant à la réussite de ce millésime, au renom et au prestige de son domaine. Joseph, l’intendant, une marmulle d’une cinquantaine d’années, rustre, le visage buriné par le soleil, sera notre référent. D’un ton autoritaire, le géant nous précise qu’il travaille ici depuis vingt ans et connaît tous les rouages d’un bon millésime. Il va nous indiquer notre rang et nous distribuer le matériel. Et vu le ton, on ne perd pas de temps. Je suis le groupe docilement en essayant d’être discrète :
— Tu es habillée ?
Je me fige et rougis de tout mon être. Clovis a un sourire jusqu’aux oreilles. Sa boutade me paralyse de honte.
— Mon frère t’aurait préférée nue.
De rouge, je passe au cramoisi. Ses mots me tétanisent. Je reste interdite sans bouger, les yeux exorbités. Le sourire moqueur de Clovis est immense. Si j’avais le choix d’un autre job et de l’assurance, je lui dirais direct que son humour est au ras des pâquerettes. Sauf que je n’ai pas le choix, que je n’arrive pas à bredouiller quoi que ce soit et qu’aucune bonne idée de répartie cinglante ne me vient.
— Eh, c’est une blague ! Détends-toi. Tu fais ce que tu veux dans la rivière. Allez, avance, j’ai l’impression que tes pieds sont cimentés.
Comment ferait une fille cool en pareilles circonstances ? Elle rigolerait de son humour ? Je ne sais pas faire. Sans répondre, je suis bien vite Joseph et croise rapidement le regard de Landry, qui n’a pas loupé une miette de la bonne blague de son frère. Ses yeux bleus me dévisagent, étonnés. Comme la première fois, centimètre par centimètre, ils sont brûlures. Pendant quelques infimes secondes, le temps se suspend. Mes yeux s’accrochent aux siens, je suis scotchée… carrément godiche, en fait. Je baisse les miens et fonce vers les vignes. Qu’est-ce qui m’arrive ?
Joseph me donne un sécateur, un seau à vendange, et me conduit avec dix autres ouvriers vers la parcelle où nous allons débuter. J’écoute attentivement les consignes, en me mélangeant avec mon groupe, composé de retraités, de travailleurs étrangers et de deux autres étudiantes. Je suis à côté d’une fille de mon âge qui me regarde. Elle a envie d’entamer la conversation. Je le vois à ses yeux et ses mimiques de sourire. Je suis en mode concentration. D’habitude, les filles de mon âge ne me parlent pas. Aucune raison que cela change. Je m’éloigne vers mon rang et, pas de bol, je me retrouve en binôme avec elle :
— Salut, je m’appelle Anna. Alors, c’est ta première année ? Moi aussi, je vais reprendre mes études après. Je rentre en deuxième année de fac d’histoire, j’espère être prof au collège après mon master… Blablabla. Et toi ?
Ouah, une pipelette, pas de veine. Cette fille vient de faire un monologue de cinq minutes. Je sais plein de trucs de sa vie privée et elle me demande « moi ». Je vais la décourager. Je n’ai pas l’intention de me laisser déconcentrer par une nénette bavarde qui me raconte sa life.
— Rien.
Elle attend la suite, la tête légèrement penchée, un peu idiote. Je continue de couper les grappes en prenant soin des rameaux et de ne pas faire tomber les grains au sol. Joseph nous a dit de ne pas les abîmer.
— Rien, comme rien du tout ?
Pas de réponse, je n’ai pas besoin de me fatiguer.
— Tu n’as pas envie de parler ?
— Non.
— OK, comme tu veux.
Voilà, une chose réglée.
Cette première matinée passe vite. Je finis mon premier rang et attends le verdict de l’intendant. Je me suis appliquée, j’ai fait attention à toutes les consignes. Ce job est hyper important, mon passeport pour ma nouvelle vie :
— C’est quoi ce boulot ? Un rang ? Nous n’avons pas dû nous comprendre : c’est mal coupé. Les grappes sont abîmées. Tu as fait ce travail de merde ?
Je reste immobile, la bouche ouverte, et tente même un petit regard au-dessus de mon épaule pour être bien sûr que les remontrances me soient adressées. Landry, le patron du domaine, vient de débouler. Sa voix est hautaine, cassante, désagréable. Je bredouille un « je ne comprends pas » qui meurt au bout de mes lèvres.
— À côté, ce n’est pas mieux. Les filles, vous croyez quoi ? Que nous avons tout l’hiver pour vendanger et qu’un domaine comme le nôtre peut supporter du travail médiocre ? Aujourd’hui, vous avez commencé une parcelle facile, et franchement, je ne vois pas comment vous pourrez faire mieux.
Autour de nous, les autres vendangeurs regardent la scène, ébahis. Avec Anna, nous avons plongé notre regard vers nos chaussures en espérant qu’il cesse. Il appelle Joseph et lui parle sur un ton tout aussi cassant.
— Viens voir ce travail. Putain ! Joseph, tu les as laissées faire ?
Il va nous virer : adieu permis, voiture, nouvelle vie et retour à la case taudis où je n’aurai rien, mais rien à faire.
Le pas lourd de Joseph se rapproche. À son regard, je comprends que nous allons de nouveau passer un sale quart d’heure. Pas un mot, il entre dans mon rang, se penche, regarde.
— Ouais, la coupe pourrait être plus franche. Je vais leur filer des sécateurs plus affutés, et niveau vitesse, Landry, elles débutent. Nous verrons ce soir. Après, chaque année, c’est le bordel avec les étudiantes. Je ne sais pas pourquoi tu t’entêtes à en recruter.
— Arrange ça !
Landry fait demi-tour sans plus d’explication, nous laissant comme deux sottes ébahies : pas assez rapides, coupe pas assez franche, tout est à refaire. Quel sale type !
— Les filles, faites votre pause déjeuner et revenez un quart d’heure plus tôt. Je vais vous donner d’autres sécateurs. Cet après-midi, avancez plus vite et mieux, car, ce soir, je ne pourrai rien pour vous. Le Baron, il ne plaisante pas.
Nous nous dirigeons toutes les deux, dépitées, vers un hangar à côté du chai, où quelques tables ont été disposées pour le déjeuner des vendangeurs. Anna n’a rien compris, moi non plus, d’ailleurs : elle n’arrête pas de répéter que si nous avions été bavardes, encore, il aurait pu nous faire des reproches. C’est loin d’être le cas. Elle flippe, moi aussi : retrouver un autre job à cette période de l’année, c’est mort.
Les mots du « baron » l’ont blessée : elle ne doit pas avoir l’habitude qu’on lui hurle dessus. Pour ma part, je suis agacée et en colère : la façon dont il nous a parlé. Une attitude de mec qui se la claque. Anna me peine. Elle ne prononce plus un mot et reste les yeux dans le vide. Je la mate, mine de rien. Elle est différente des filles que je côtoie habituellement. Elle n’a pas cet air pimbêche. Elle est plutôt jolie, d’ailleurs : grande, blonde, des yeux verts, fine. Elle doit plaire aux mecs. Son visage est doux et, dans l’ensemble, elle fait sympa. Oui, la bonne copine, assez naturelle… et le regard triste. Elle est affectée et bien que, normalement, je ne parle pas avec une autre fille de mon âge, bien que je ne fasse pas dans l’empathie, je tente de la rassurer :
— Joseph va nous réexpliquer. Il ne semblait pas aussi catégorique. De toute façon, je suis comme toi, je ne retrouverai pas d’autre boulot.
Ce job ne peut pas finir au bout d’une pauvre matinée. Nous allons nous motiver et lui montrer de quoi nous sommes capables : ce n’est pas un « Landry De La Motte » qui va m’empêcher de mettre mon plan d’attaque à exécution pour quitter ma vie de merde. Je ne vais pas baisser les bras au premier obstacle.
— Écoute, je n’ai pas été très causante, ce matin. Je m’appelle Yaëlle. C’est la première fois que je fais les vendanges. En vrai, je n’ai pas de plans pour la suite, mais besoin de pognon et vite. OK ?
Un peu gauche, avouons-le. Elle retrouve un léger sourire. Je lui tape dans la main, pleine de motivation.
— Entre nous, ce n’est pas un bellâtre à la voix hautaine qui va me décourager. Nous avons travaillé de façon sérieuse. Ce mec, il a un problème. Il doit être gonflé à la testostérone. L’occasion était trop bonne pour passer ses nerfs sur deux étudiantes. Ce n’est pas parce que MONSIEUR LE BARON vit dans un grand château qu’il peut nous parler comme à des quiches. Tu sais quoi ? Nous allons lui montrer, et ce soir, il sera tout penaud, prêt à s’excuser.
Anna change de couleur. Mes mots lui font de l’effet. Elle me fait un signe de tête.
— Quoi ?
Sa main me montre de me retourner. À son air paniqué, la situation va se compliquer. Landry est derrière moi. Ses yeux lancent des éclairs.
— Mince, murmuré-je entre mes dents.
Il se rapproche à quelques centimètres. Son parfum, son odeur, sa chaleur me paralysent. Mes pieds sont scellés au sol, ma bouche, désespérément ouverte, comme si on m’avait coupé le son.
— J’attends de voir. Les excuses, jamais ! me rétorque-t-il.
Je crois qu’il a épelé chacune des lettres. Il me toise, froidement, se retourne et file vers le vignoble.
— Ouah ! Tu as eu un sacré courage, me lance Anna.
— Courage ? Je ne savais pas qu’il était là.
— Quand même, tu ne t’es pas excusée et ce que tu as dit, est vrai : il a un problème avec les femmes. Je préfère son frère. Je le trouve même très à mon goût.
Je vais me faire virer et cette fille trouve Clovis De La Motte à son goût. L’après-midi va être long, très long : demain, je suis bonne pour Pôle emploi.
Après le déjeuner, Joseph nous attend. Nouveau matériel, il nous donne les mêmes consignes que ce matin. Anna acquiesce et file vers son rang.
— Joseph, je ne suis pas d’accord.
Il se retourne surpris.
— Comment ça, pas d’accord ? souffle-t-il, agacé.
— Ce matin, j’ai bien compris. Je me suis appliquée, concentrée et a priori, j’ai tout fait de travers. Je ne comprends pas. Qu’est-ce que j’ai mal fait ?
— T’es peut-être nulle, me répond-il du tac au tac.
Sa remarque me blesse et résume bien ce que j’ai vécu toute ma vie : pas d’encouragements, et si je veux avancer, ne compter que sur moi.
— Laissez tomber, Joseph.
Je marche vers mon rang en secouant la tête, résignée. Je n’ai plus qu’à prier que l’autre sale type, baron de je ne sais quoi, m’oublie et que je passe à travers les gouttes.
— Attends, me lance Joseph. Les coupes, elles étaient correctes. Si tu prends ton sécateur plus penché, tu vas gagner en rendement. Après, le baron, c’est un exigeant. Il a repéré un truc dans ton rang et il va le généraliser. Il ne supporte pas le « à peu près ». Sois efficace et il sera moins sur ton dos.
Sacré conseil : je fais tout comme ce matin, avec de la vitesse en espérant qu’il ne me tombe pas dessus. Avec ce qu’il a entendu dans le hangar, la probabilité que je sois à l’embauche demain est quasi nulle. Tant pis, je vais leur montrer de quoi je suis capable et partir la tête haute.
J’ai mené un marathon tout au long de l’après-midi. Avec Anna, nous avons rattrapé les premiers coupeurs. Nous nous sommes appliquées, même fait un peu de zèle en repassant dans les rangs, en taillant des petits bouts de tiges, au cas où, et en vérifiant que nos seaux ne contenaient pas de feuilles. Je l’ai encouragée tout l’après-midi, avec mes mots, maladroite, pour suivre la cadence et gagner en dextérité dans le maniement des outils. Elle a retrouvé des couleurs, malgré les microcoupures et les ampoules sur nos mains. Elle m’a avoué que c’était son premier job, qu’elle l’avait trouvé seule et que se faire virer serait un aveu d’échec. Ses parents étaient contre, pas de besoin. Elle veut leur prouver qu’elle peut se gérer. J’ai aimé son besoin d’indépendance. Elle me parle et, au final, cette fille est sympa.
Nous sortons des rangs, épuisées. La chaleur est suffocante. L’été a décidé de jouer les prolongations. Nous sommes dans un sale état, en sueur, usées et moral bas. Le couperet va tomber et décider de notre avenir, enfin, du mien et de ma possibilité de partir au plus vite de cette région.
Joseph arrive, pas de Landry à l’horizon :
— C’est bon, à demain. Bonne soirée les gars.
Quoi ? C’est tout ? Pas de vérifications ? Je l’appelle. Il s’approche de moi, son air encore plus agacé.
— Si je te dis que c’est bon, c’est bon. Je ne vais quand même pas te filer une médaille ?
J’ai compris la leçon : me taire et me fondre dans le paysage.
Nous rejoignons le parking, un peu chamboulées, en mode « j’en ai déjà plein les bottes et je n’ai fait qu’une journée ». Je me demande bien comment je vais supporter de me faire aboyer dessus pendant trois mois :
— Le vendredi soir, ils organisent un repas des vendangeurs. Tu resteras ? me demande Anna, me sortant de ma réflexion.
— Pardon ?
— Le vendredi soir, ils font une fête.
Je suis étonnée de sa proposition. Peu de chance que nous soyons encore là en fin de semaine et fêter notre travail, j’ai comme un doute.
— Anna, je ne crois pas. Il fait super chaud, nous avons bossé dur. La seule chose dont j’ai envie ? Une douche et dormir.
Anna me donne un coup de coude.
— Danger, droit devant, me souffle-t-elle à l’oreille.
Landry est sur le chemin et descend dans notre direction.
— Tu vas te baigner ? me lance-t-il en me dévisageant de la tête aux pieds avec son regard.
Mais pour qui se prend ce type, mais pour qui se prend ce type ? Qu’est-ce qu’il vient de dire, j’ai compris ?
— Pardon ? Non, balbutié-je.
— OK.
Et il continue son chemin, mine de rien.
— Pourquoi te demande-t-il si tu vas te baigner ? Tu le connais ?
— Bien sûr que non, ne t’emballe pas, je ne me suis jamais baignée avec lui, ce mec a un grain. Anna, je te laisse, à demain.
En prenant mon vélo, je suis perdue. Il est complètement à la masse. Il me reluque avec ses yeux bleus transperçants, me hurle dessus, et maintenant, il me demande si je vais me baigner ? N’importe quoi ! Il m’exaspère. Je ne vais pas me laisser divertir par un kéké des plages, oui, c’est l’expression, un kéké des plages, un bellâtre, un, un… Ses yeux bleus, mon Dieu. Ils sont translucides, comme une mer chaude sous les tropiques, je pourrais m’y noyer. Non !
Le lendemain, je ne perds pas de temps pour retrouver mon poste de travail. Malgré les courbatures, avec Anna, nous avançons à bon train et avons même le temps de discuter. Elle est cool, pleine de joie et a une foi en l’avenir inébranlable :
— Yaëlle, oh là, là, ce mec est une bombe.
Je me retourne et aperçois Clovis.
— Il n’est pas mal, tu as raison.
Il avance vers nous.
— Alors les filles, on papote ?
Elle glousse, lui fait des yeux de biche. Pas croyable, elle en pince pour lui. Vu son sourire, je crois que le charme d’Anna ne lui est pas insensible.
— Je compte sur vous, vendredi soir : c’est le truc cool des vendanges.
— Oui, oui, nous venons, réplique aussitôt Anna.
— Comment ça, nous venons ? réponds-je en me retournant vers elle.
— Tais-toi ! Oui, oui, tu peux compter sur nous.
— OK, super, les filles. À vendredi.
Clovis continue son chemin. Je regarde Anna sans comprendre.
— Je t’ai dit que je n’avais pas envie.
— Non, tu n’as jamais dit « pas envie », tu as dit « si nous avions encore du travail », et comme nous n’avons pas perdu notre job, nous y allons.
— Je t’arrête, ce n’est pas mon truc.
— Yaëlle, tu as vingt ans. Faire la fête, t’amuser, ce n’est pas ton truc ? De toute façon, tu n’as pas le choix : tu ne peux pas me laisser tomber. Je ne connais pas les autres et j’ai besoin de toi pour m’empêcher de sauter sur ce mec canon.
— ANNA.
— Allez, s’il te plaît, s’il te plaît, s’il te plaît.
Je souris : comment résister à Anna qui a joint les mains pour prier et qui fait semblant de me supplier ?
— OK, OK, je viens.
— Nous allons nous éclater. Je pourrais apporter du maquillage. Dans les vestiaires, nous pouvons nous faire une beauté. Tu mettrais quoi, toi, un top décolleté ? Ou carrément une robe ?
Et blablabla.
En fin de matinée, Landry entame son inspection. Il arrive au bout de mon rang et vient à ma rencontre. Son visage est fermé. Je sens le mauvais quart d’heure arriver :
— Il ne faisait pas assez chaud ?
— Pardon ? Comment ça, pas assez chaud ?
— Pour te baigner.
— Je ne comprends pas.
— Laisse tomber.
Je le regarde, étonnée. Il passe sa main dans ses cheveux. Je n’aime pas quand il fait ce geste. Il est, comment dire : pas mal ? Non, un peu plus, soyons franches. Canon ? Oui, c’est ça, un très beau mec, sexy : le genre de spécimens masculins qui vous perturbe et qui vous empêche de réfléchir convenablement. Ses yeux sont pénétrants. Quand il vous parle, il vous mate. Déstabilisant. Le genre de types que je ne supporte pas. Haute opinion, sûr de lui. Un bellâtre, le terme le plus approprié.
— Montre ton travail, m’ordonne-t-il.
Je le laisse passer devant moi en secouant la tête : il ne parle pas, il exige. De dos, le spectacle est tout aussi saisissant. Landry doit bien mesurer vingt centimètres de plus que moi. Il est musclé et en joue en portant des chemises qui lui moulent le corps. Fit, l’attirail du BG. Brun, cheveux souples, yeux bleu clair, peau mate, il ne doit pas avoir de difficulté côté filles. Je secoue de nouveau la tête : je m’égare complètement.
Il s’agenouille auprès d’un cep.
— Tu prends ta tige trop haute. Au pressage, nous avons des déchets et nous perdons du temps. En prenant sous la grappe, tu peux améliorer le traitement du raisin. Regarde.
Je me penche vers lui et examine sa coupe précise.
— OK, j’ai compris. Et là, quand les grains de raisin ont du botrytis, tu fais quoi ?
En voulant joindre mon geste à ma parole, je lui frôle la main. Le contact est brûlant, électrique. Je la retire aussi vite. Je viens de prendre une décharge : des petits papillons au fond de mon ventre ont bondi. Ouh. Ma bouche reste entrouverte. J’ai l’air bien cruche. Landry me dévisage, amusé, se redresse et se rapproche de moi comme un félin. Il se penche doucement vers moi, le regard moqueur. Son visage est à quelques centimètres du mien. Il va m’embrasser. Mon rythme cardiaque s’accélère. Je ferme les yeux. Mes lèvres s’entrouvrent. Il s’approche encore plus près. Mon Dieu, ses lèvres sont charnues, sexy.
— Le botrytis, tu l’enlèves. Si la grappe est trop abîmée, tu la mets de côté, me murmure-t-il
Douche froide, même glacée, limite un seau nordique lancé en pleine face. Je me retourne, essaie de retrouver une contenance.
— D’accord, oui, oui, j’ai compris, réponds-je d’une voix qui ne ressemble pas à la mienne.
Quelle idiote ! Qu’est-ce qui m’a pris de croire qu’il allait m’embrasser ? Comment ai-je pu, ne serait-ce qu’une micro seconde, baisser mes paupières, entrouvrir ma bouche ? Ce mec, c’est le patron du domaine de Bel Air, Landry De La Motte, baron de je ne sais combien de générations, et moi, bête comme je suis, j’ai cru qu’il allait m’embrasser. Un bellâtre, un mec que je ne supporte pas, un…
— Yaëlle, c’est bien ton prénom ?
Il a un grand rictus sur le visage, visiblement diverti de la situation.
— Dommage pour la baignade, me dit-il en quittant le rang.
Et voilà, il me prend pour une fille facile. Ridicule, je suis ridicule. Landry De La Motte ne doit avoir aucun problème à embrasser des filles canons. Son charme a un effet sur la gent féminine tous âges confondus, et il perdrait son temps à m’embrasser ? Comment ai-je pu deux secondes avoir cette faiblesse ? J’ai une énorme boule au ventre, de honte. Anna me rejoint et voit ma tête, pas du tout naturelle :
— Ça va ? Tu as l’air chamboulé ?
— Non, ce n’est rien, un coup de chaud.
3
Les jours défilent à grande vitesse. Le travail est physique, fatiguant. Mais l’ambiance est bonne. Avec Anna, nous avons trouvé un rythme qui nous évite les ennuis : plus de remarques ni de hurlements du baron. Joseph gère. Je n’ai aperçu mon patron que rapidement à l’embauche et ai bien vite tourné les yeux. J’ai le sentiment qu’il se moque encore de moi. Il a son petit rictus qui m’énerve, greffé sur son visage.
Heureusement, j’ai Anna. Elle a des conversations sur tous les sujets qui la préoccupent : mode, Clovis, bottes, re Clovis…. Elle me divertit beaucoup. Une fille rafraîchissante. Ses monologues ressemblent à des romans bons à écouter :
— Yaëlle, tu ne parles pas beaucoup de toi, je t’ennuie ?
— Non, Anna, j’aime t’écouter. Je n’ai pas d’anecdotes, pas d’histoires de mode, pas d’histoires d’amoureux. En résumé, ma vie est plate, ennuyeuse, et pour tout te dire, c’est la première fois qu’une fille me parle autant. J’apprends plein de trucs.
Elle penche la tête. Ses yeux me regardent très étonnés, comme si je débarquais d’une autre planète.
— Quoi tu n’as pas d’amis ? Pas de petits amis ? Pourtant, les garçons doivent te remarquer.
— Me remarquer ? réponds-je très surprise, en riant. Non, jamais, et non, pas d’amis.
— Quand même, tu as bien eu des aventures ?
— Non, fais-je, gênée. Pas de petits amis, pas de bisous, enfin, si, une fois, et pas plus.
Je me vois bien lui raconter que le type n’a pas vraiment compris le non et que j’ai eu du mal à m’échapper. Si, en plus, je lui donne les détails de la situation où je m’étais fourrée, elle va me fuir.
— Et les fringues ? Quand même, les fringues, tu aimes ?
— Non, Anna, je n’aime pas. Écoute, je… Comment t’expliquer ? J’ai une vie merdique. Je n’ai pas envie de rentrer dans les détails. Est-ce que c’est grave si je n’ai pas d’amis, pas de mecs, pas envie de faire les magasins et encore je ne sais quelle autre chose apparentée aux filles ?
Surprise de ma réponse, elle a l’air d’hésiter, pas rassurée. Elle fait cette petite moue et tripote sa bouche avec ses doigts. Anna est la seule personne à ne pas savoir que je suis un paria. Les jeunes de mon âge me fuient ou m’insultent. Elle doit croire que les vêtements que je porte sont pour le travail. Non, ma vraie garde-robe.
— Je dois te gaver ?
Je ne m’attendais pas à ce retour. J’imaginais qu’elle se moquerait, qu’elle fuirait, même.
— Bah non ! J’ai découvert que toute fille qui se respecte porte des Stan Smith avec un jean, que les boots imprimées, c’est l’accessoire indispensable pour cet hiver, que si tu ne sais pas te maquiller, tu n’as plus d’excuses : avec les tutos sur YouTube, même la plus maladroite des nanas doit savoir utiliser un eye-liner.
Anna éclate de rire. Il est communicatif.
— Ouah ! Je t’ai bien bassinée. Yaëlle, je ne juge pas ta vie. J’aime bien ta compagnie, je trouve que nous formons un beau duo. Tu m’écoutes alors que je suis superficielle. En plus, tu m’as aidé à garder ce job, alors, amies ?
— Amies ?
— Oui, amies. Tu me défends, je te défends. Tu m’aides pour le travail, et moi, je t’apprends plein de trucs pour devenir une Fashion victime.
— Fashion victime ? Toute ta bonne volonté ne suffira pas.
Nous rigolons de nouveau. En même temps, une amie, cela ne m’est jamais arrivé. Anna est cool. J’aime être avec elle. Une amie.
— Ce soir, je te propose de commencer ton initiation pour la soirée des vendangeurs.
J’avais oublié ce détail : la fameuse soirée festive du vendredi soir. Anna a décidé de me maquiller. Elle a apporté des tops pour que nous soyons irrésistibles. Je ne vois pas qui nous allons séduire. Quelque part, je sais qu’Anna a des vues sur Clovis, mais moi ? Personne, non, personne du tout.
Une grande tente blanche est dressée à proximité du chai. À l’extérieur, Joseph s’occupe de la grillade géante pendant que Landry et Clovis servent du vin aux vendangeurs des différentes équipes. Surprenant. Je voyais le baron comme une personne hautaine, pas du genre à se mélanger avec la base. Je l’observe quelques minutes en attendant Anna qui parfait son maquillage. Il sourit, discute avec les différents groupes. Étonnant.
Anna arrive fin prête. Elle nous a changées, pomponnées. Elle m’a même convaincue d’enfiler un top noir à fine bretelle, un jean stretch très moulant, de relever mes cheveux et m’a maquillée légèrement. Je me sens différente. Plus sûre de moi. Joyeuse.
Ça, c’est nouveau !
Notre arrivée est remarquée. Anna se dirige naturellement vers le bar, rayonnante, pour rejoindre Clovis. Elle va lui sauter dessus. Ses bonnes résolutions ont tenu moins d’une minute. Il lui sourit, se penche vers elle et lui murmure quelques mots à l’oreille. Son visage s’éclaire, Clovis a visé juste. Je pouffe en secouant la tête devant le peu de volonté de mon amie et vais les rejoindre.
Mon regard s’égare quelques secondes. Je croise ses prunelles bleu azur, froides, me fixant sans expression. Ma bonne humeur s’envole comme un souffle. Déstabilisée. Pas à l’aise dans ces vêtements qui ne sont pas les miens et n’ont pas ce pouvoir de me cacher. Son regard ne me lâche pas. Je baisse les miens, laissant ma belle assurance toute neuve partir. Je me sens petite et ridicule, presque déguisée. Ma seule envie : fuir.
— Ça va ? me demande Clovis, un verre à la main, me sortant de ma torpeur.
— Oui, oui, très bien, lui mens-je.
— Viens trinquer, ma belle, ne reste pas plantée.
L’apéro se poursuit. J’ai bu quelques verres, un peu vite, certes. Je commence à rire pour rien. Anna est dans le même état. Il est grand temps de passer à table. Nous sommes hilares pour des trucs sans queue ni tête. L’ambiance est bonne. Je me détends de nouveau. Un des vendangeurs sort une guitare et un groupe entonne des chansons festives. À table, nous reprenons les couplets : je m’amuse comme jamais.
Plus de baron, il s’est assis à l’autre extrémité de la table. Je n’ai pas recroisé son regard implacable. Nous continuons à boire, à chanter, et ma tête tourne sérieusement :
— Arrête de boire, tu vas être malade, me murmure-t-on à l’oreille.
Landry. Je ne l’ai pas vu s’approcher. Il s’est retrouvé à côté de moi en deux mouvements.
— Non, je gère.
Il ricane et m’exaspère.
— Excusez-moi, MONSIEUR LE BARON, je ne pensais pas que j’avais des comptes à vous rendre après le travail, il y a une clause dans mon contrat ? lui rétorqué-je, l’alcool aidant.
Ma remarque acerbe ne lui plaît pas du tout. Son regard en dit long.
— Viens, suis-moi.
— Non.
— Je ne le répéterai pas. Je n’ai pas l’intention de te supplier.
Son ton autoritaire me laisse de nouveau sans voix. Pour qui se prend ce type ?
— Si je dois te traîner de force, je vais le faire.
Il ne plaisante pas. Je le regarde droit dans les yeux et ne cille pas.
— OK.
Je me lève, étourdie, et essaie de me stabiliser avec mes mains.
— L’alcool te joue des tours.
— Pas du tout, je me suis redressée trop vite.
À ses yeux, je comprends qu’il n’est pas dupe. Je le suis en direction du chai. Nous entrons dans le bâtiment à l’abri des regards. Il me plaque contre le mur, sans préambule. Mon souffle se coupe. Il prend mes mains, me les colle au-dessus de la tête. Sa bouche s’empare de la mienne assez brutalement. Il glisse sa jambe entre mes cuisses et, de son autre main, me caresse la poitrine. Violent. Perturbant. Sa langue puissante s’enroule autour de la mienne. Je me laisse faire. Des frissons me parcourent le corps, je gémis sans comprendre ce qui m’arrive. Il se fait plus pressant, colle son bassin contre le mien. Je sens son sexe durcir à travers son jean. Je me demande si je ne suis pas en train de perdre la tête. Sa main se faufile sous mon T-shirt. Chaude, immense et brûlante, elle me percute d’une sensation inconnue. Il soulève mon soutien-gorge et s’empare d’un de mes seins. Nouveau gémissement.
— Tu me fais beaucoup d’effet, j’ai envie de te baiser fort, maintenant.
Mon Dieu, qu’est-ce que je suis en train de faire ? Je suis collée contre un mur à me faire peloter par mon patron qui, au passage, a failli me virer au bout de quatre heures.
Il veut me baiser.
Non. Non, ce n’est pas moi. Les mecs ne me collent pas contre un mur et ne me touchent pas avec leurs sales pattes.
— Non.
J’essaie de libérer mes mains. Sa prise est ferme.
— Non, arrête, Landry, arrête !
— Quoi ? Attends, c’est quoi ton délire, tu ne veux plus ?
— Non. Laisse-moi tranquille. Non… Je…. Non, tu ne vas pas me baiser, comme tu me le dis. Non, tu es mon patron, je n’ai pas envie.
Il se recule, passe la main dans ses cheveux. Aïe, aïe, aïe, vu son regard, la réponse va être cinglante.
— Ça n’avait pas l’air de te déplaire, ma belle, tu gémissais.
— Non.
— Allez, encore deux minutes et tu me suppliais de te faire jouir. Les girouettes et allumeuses, ce n’est pas mon truc. Je n’ai pas l’habitude de demander et encore moins d’entendre non.
Je reste bouche bée : allumeuse. Quel culot ? Je n’ai rien demandé, je ne l’ai pas dragué et encore moins traîné dans le chai. Monsieur le baron est peut-être canon. Pour autant, je ne vais pas me pavaner devant lui. Il rêve.
— Je n’ai pas l’habitude qu’un mec m’impose quoi que ce soit. JE décide. Quand je veux, où je veux. Tu n’es pas mon genre. Le gémissement ? Un réflexe. Avant de me faire jouir ton prénom, il te reste du chemin à faire.
Je tourne les talons et retourne à la fête en zigzaguant, en me demandant comment j’ai réussi à lui sortir un mensonge aussi gros.
— Ça va ? m’interpelle Anna en voyant ma démarche.
— Parfait.
J’éclate de rire en pensant à ce que je viens de sortir à monsieur le baron.
Je viens de vivre un baiser à couper le souffle. J’ai gémi. Rien de forcé. En moins de cinq minutes, j’aurais pu le supplier et même crier son prénom tellement il a du sex appeal. Oui, je l’avoue. Sauf que Landry est un bellâtre, doublé d’un sale con prétentieux et en rien un mec pour moi.
Nous terminons la soirée, fortement alcoolisées. Anna ne peut pas conduire et me supplie de l’emmener chez moi. Clovis est parti se coucher, notre dose d’alcool lui faisant peur. Je lui explique que chez moi, c’est un taudis. Anna est hilare et me répond qu’elle s’en fout. Nous partons à califourchon sur mon vélo en direction de ma bicoque, très éméchées.
~
Le réveil est dur, ça pique. Les chiffres de ma radio clignotent devant mes yeux. Pourquoi un camion a roulé sur ma tête ? Dans le brouillard complet, une main se pose délicatement sur mon épaule. Landry ? Il me caresse, c’est doux, délicat, bon, continu…
— Yaëlle, Yaëlle, eh réveille-toi !
— Oui, je suis réveillée, Landry, embrasse-moi, bredouillé-je.
La main se fait plus insistante.
— Réveille-toi. Tu es dans le coma ou quoi ?
J’émerge doucement. Je sors de ma torpeur, pas de Landry, seulement Anna. Elle me regarde avec un drôle d’air. Dans ma tête, tout se mélange. Ce camion passe des marches avant et marches arrière incontrôlées. Je n’arrive pas à remettre mes idées en place. Je n’ai jamais autant bu d’alcool. J’ai des flashs : Anna hilare, moi en train de chanter et les lèvres de Landry. Qu’est-ce que j’ai fait ?
— J’ai mal à la tête.
— Première fois ? me répond-elle.
— Première fois, quoi ?
— Première cuite ? Est-ce que c’était la première fois que tu ingurgitais autant d’alcool ?
— Oui, non, ça faisait longtemps.
— Tu as bien fait. Nous avons abusé, mais qu’est-ce que nous nous sommes marrées. Après, vu la tête de Clovis quand il est parti, j’ai dû le saouler. Au fait, pourquoi m’as-tu appelée Landry ?
— Je t’ai appelée Landry ? Je devais délirer ou mélanger les événements de la semaine avec notre patron dévastateur.
— En tout cas, je suis contente pour toi. Tu t’es rapprochée de Steve. Ce mec a l’air bien.
— Steve ?
Anna éclate de rire. Je la regarde, désespérée. Qui est ce Steve et pourquoi parle-t-elle de rapprochement ? Elle me raconte que vers la fin de la soirée, alors que nous chantions à tue-tête, je me suis jetée dans ses bras. Je n’arrêtais pas de lui dire que je le trouvais trop beau. A priori, le Steve en question a trouvé cette déclaration très à son goût.
— Tu as son numéro de téléphone portable écrit sur ta main. Tu lui as donné le tien également.
— Je n’ai pas de téléphone portable, lui dis-je de plus en plus inquiète. Le seul que je connais par cœur, c’est celui du camion pizza.
Anna est hilare. Son fou rire contagieux me rattrape. Mon Dieu, comment vais-je gérer lundi ?
— Lundi. J’ai trop hâte d’être à lundi, me dit Anna entre deux crises de fou rire. J’ai hâte de voir la tête de Steve. Je suis sûre qu’il a appelé vu comment tu l’as chauffé.
— Je l’ai allumé ?
— Oh oui, même le patron te regardait bouche ouverte.
— J’ai trop honte, je ne pourrai plus y aller travailler.
— Si, si, va falloir assumer. Ne t’inquiète pas, je n’étais pas mieux. J’ai déclaré ma flamme à Clovis.
Elle n’a pas l’air gênée, plutôt droite dans ses baskets. Après, nous nous sommes bien lâchées, et c’est ce qui compte. Bon, tu m’offres à manger ? Faut que je retourne chercher ma voiture.
— Anna, je te l’ai dit hier soir, chez moi c’est… comment te dire…
— Je ne suis pas là pour te juger, pas de problème.
— OK, attends-moi là, je vais te chercher un truc.
Petit-déjeuner avalé, Anna a voulu retourner au domaine pour récupérer sa voiture. Pour ne pas marcher les quatre kilomètres, elle a appelé Clovis, qui n’était pas ravi. Au vu de sa petite voix, des excuses, si son comportement n’était pas digne, de sa promesse de ne jamais recommencer, il a cédé et va venir la chercher.
Devant mon air ahuri, Anna m’explique que quand on veut quelque chose, on fait tout pour l’avoir. Elle est sûre d’une chose : elle veut Clovis. Elle me dit aussi qu’il faut savoir faire profil bas. Elle n’a peur de rien. Jamais je n’appellerai Landry de la sorte.
Pourquoi, je pense à lui, qu’est-ce qui me prend ? Et je revois les images du baiser endiablé d’hier soir. Je me souviens aussi très bien de mes propos. S’il m’a vue en plus draguer Steve, entre la rivière et le plaquage contre le mur, il va me prendre pour une marie-couche-toi-là.
— Je suis trop contente de mon coup. Je vais enfin me retrouver seule avec lui.
— Espérons qu’il ne te saute pas dessus comme son frère.
— Quoi ?
— Non, rien.
Je tousse.
— Je ne sais pas ce que tu as prévu aujourd’hui, tu as une petite mine. Repose-toi, et ce soir, je t’emmène faire la fête.
— La fête ? Ah non, Anna ! J’ai ma dose pour quelque temps.
— Ne sois pas rabat-joie.
J’accompagne Anna dans ma cour et attends avec elle l’arrivée de Clovis. Sa voiture apparaît. La joie envahit le visage de mon amie, elle me fait un clin d’œil, une bise et se dirige vers lui.
Il descend accompagné de… son frère.
— Pas lui, murmuré-je. Anna, passe une bonne journée. À lundi.
Je tourne les talons, récupère mon vélo et me dépêche de pédaler pour m’éloigner le plus vite possible.
— Yaëlle, Yaëlle, bon sang, attends, l’entends-je m’appeler.
J’accélère sans me retourner, des grands coups de pédales, prends de la vitesse et… bute sur une racine d’un arbre. Mon vélo vacille, je perds l’équilibre et m’étale de tout mon long. En quelques secondes, Landry est à côté de moi. Il m’aide à me relever. J’imagine déjà sa tête, sourire narquois, air hautain, sûr de lui. Je relève les yeux. Non, pas cette fois.
— Tu as mal ?
— C’est bon, lâche-moi, ce n’est rien qu’une petite chute de vélo.
Landry me détaille de la tête aux pieds.
— Tu saignes.
— Je t’ai dit que ce n’était rien.
En fait, j’ai très mal. Je serre les dents. Vous savez, les écorchures aux genoux quand on est gamin ? Identique, en version adulte.
— Pourquoi fuis-tu ?
— Je ne fuis pas.
— Tu appelles ça comment, alors ?
— Je n’appelle ça rien. Je ne te fuis pas, je n’ai pas envie de te voir ni de te parler. Nous sommes samedi. Aujourd’hui, c’est ma pause de Landry. Pas obligée de discuter avec toi, pas obligée de te voir.
— Comme tu veux. Avec Clovis, nous allons faire du bateau. Il voulait emmener ta copine. Je n’avais pas envie de leur tenir la chandelle et voulais te proposer.
Moi, faire du bateau, le lendemain d’une cuite ? Il est fou.
— Le bateau, ce n’est pas mon truc. Bonne journée, alors.
— Il faut te soigner.
— Oui, oui, je sais ce que j’ai à faire.
Nous retournons vers ma maison. Anna et Clovis nous attendent. Elle trépigne. Elle a oublié le camion qui a roulé sur sa tête et la mienne au passage. Elle vient à ma rencontre.
— Dis-moi que tu as dit oui, dis-le-moi. S’il te plaît, s’il te plaît.
— Non, Anna. La dernière fois que je t’ai fait plaisir, nous avons fini avec un mal de tête géant. C’était hier !
La porte de ma maison s’ouvre et ma mère sort en titubant.
— C’est quoi ce bordel ? Qu’est-ce que vous foutez chez moi ? hurle-t-elle.
Il ne manquait plus qu’elle pour que le si peu de confiance en moi s’évanouisse.
— Partez d’ici, crie-t-elle, la voix complètement éraillée.
— C’est moi. Ce sont des amis venus me saluer.
— Des amis, tu n’en as pas. Des amis, d’une pauvre fille comme toi. Traînée, va
Quand elle fait des scènes, qu’elle hurle, qu’elle m’insulte, le vin mauvais, la colère monte en moi, vite, fort. Je la ravale et encaisse. Je pourrais exploser, mais je n’ai pas envie de faire une démonstration devant mes patrons et mon amie.
— Rentre, ils vont partir.
Elle titube, nous assassine du regard. Je secoue mon visage. Pitié, rentre. Elle daigne retourner dans notre taudis, sans esclandre supplémentaire. Je sens leurs regards posés sur moi. Dans ma méga vie, je dois subir ce genre d’humiliation, être traitée comme rien par ma seule famille et endurer le jugement des autres. Je ferme les yeux, serre mes poings et prends mon masque, celui qui me permet de tout supporter.
— Cassez-vous, leur dis-je d’une voix neutre.
Anna vient vers moi. Elle essaie de me prendre la main. Je l’esquive.
— Non.
— Je ne te juge pas. Je suis ton amie. Ne reste pas ici, viens avec nous.
Ma poitrine monte et descend. J’essaie de me contenir. Difficile. Ma seule amie a découvert où je vis, avec qui et l’enfer qui rythme mon quotidien. Ses yeux à elle sont pleins de pitié et je déteste. Elle insiste.
— Non, Anna.
— Et tu vas faire quoi, rester avec elle ? me balance Landry.
Il me défie. Je n’aime pas du tout cette façon de me regarder. Il n’a pas son air habituel. Je le sens même en colère, comme s’il était concerné par ma vie pourrie.
— Viens avec nous, poursuit-il.
J’hésite. Je n’ai rien à perdre, après tout, et rien à faire chez moi. Nous montons dans la voiture. Landry se faufile à côté de moi.
— Yaëlle…
— Non, j’ai dit OK pour le bateau, pas pour parler et encore moins parler avec toi.
Je suis en train de passer mes nerfs sur lui. Je me reprends et m’excuse. Je ne suis pas juste et ce n’est pas mon genre de me défouler sur les autres.
4
Le reste du trajet, je regarde le paysage défiler par la fenêtre, triste. Anna fait la conversation pour tout le monde. Clovis rit de ses remarques. Landry est sur son portable. J’essaie de me détendre et n’y arrive pas.
— Voilà, les filles, nous sommes arrivés.
Je ne sais même pas où nous sommes et lis rapidement « Capitainerie de Pornichet ».
— Vous avez de quoi vous baigner ? demande Clovis. C’est jour de chance, la mer est magnifique et il fait chaud.
— Je n’ai pas apporté de maillot, répond Anna, tout ennuyée.
— Ne t’inquiète pas. Bon, pour Yaëlle, ce n’est pas un problème.
Mes joues s’empourprent couleur pivoine.
— Tu es con, le reprend Landry.
— Eh ! Je voulais détendre l’atmosphère. Anna, tu ne sais pas que ta copine se baigne nue dans la rivière et que mon frère a failli faire une attaque quand elle est sortie de l’eau ?
De pivoine, je deviens écarlate. Landry donne un coup dans le siège de son frère.
— Non, je ne savais pas. C’est pour ça que tu lui proposais de vous baigner ? enchaîne-t-elle.
Nous restons sans voix devant cet énoncé tronqué de la vérité.
— Détendez-vous, tous les deux. Yaëlle, ce qui s’est passé chez toi, ça ne nous regarde pas. Nous n’avons pas à te juger. Maintenant, nous allons passer une bonne journée et te changer les idées.
Les mots de Clovis me touchent. De petites larmes perlent au coin de mes yeux. Je les retiens. Elles ne méritent pas de couler, pas pour elle.
Le bateau est impressionnant : un voilier d’un blanc éclatant qui tranche avec le ponton en bois exotique. D’immenses voiles, il doit bien faire quinze mètres de long. Je ne m’attendais pas à un truc aussi démesuré, plutôt à une petite barque. Je reste bouche bée devant ce géant, admirant les détails des voilures, de la barre de navigation, et penche la tête pour lire le nom : Andréa. Bizarre.
— Il te plaît ? me demande Landry.
— Oui, c’est un gros bateau.
— Bah, tu t’attendais à quoi ?
— À rien. Tu sais barrer un truc pareil ?
Il secoue la tête, part à rire et ne répond rien. J’ai dit une bêtise ?
— Le prénom, c’est celui de ta mère ?
Il se fige et tourne les talons sans un mot. J’ai du mal à le suivre et ai l’impression que j’enchaîne les impairs.
Landry prend les commandes et Clovis lâche les amarres. Le bateau sort tranquillement du port pour rejoindre l’océan. La vue sur la Côte d’Amour est grandiose. D’un côté, Porni-chet et son immense port ; de l’autre, la grande plage de sable fin de la Baule, bordée de palaces victoriens et jonchée de petites cabines rayées blanc et bleu. Les deux frères sont complémentaires pour manœuvrer notre embarcation. J’admire leur maîtrise. C’est la première fois que je monte sur un voilier et une des rares fois où je vois la mer. Magique : cette immensité, la sensation de liberté, de grandeur me font un bien fou. Au large, le bateau prend de la vitesse et les voiles claquent contre le vent. Anna s’extasie et enchaîne les commentaires. Pour ma part, je m’assois sur la proue, cheveux au vent, silencieuse, et admire les détails du paysage. Landry s’assoit à côté de moi.
— Donne ta jambe.
Il a un flacon de désinfectant et une boîte de pansements dans sa main. Il prend une compresse et soigne mon écorchure. Je sursaute quand ses doigts frôlent ma peau. Je n’ai pas l’habitude que l’on me touche, encore moins que l’on me soigne. Il relève ses yeux en posant délicatement le pansement et leur couleur me fait frissonner comme hier soir.
Il reste silencieux un moment avant de me demander :
— Elle est comme ça depuis combien de temps ?





























