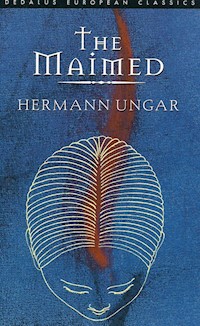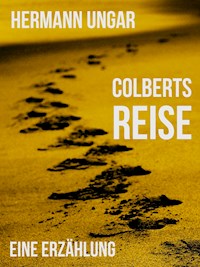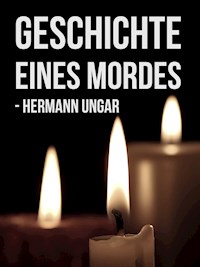Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: A verba futuroruM
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Deux nouvelles qui plongent dans les turpitudes de l'enfance abandonnée. L'obsession de conquérir une femme. La lente descente aux enfers face à la manipulation d'un père.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Hermann Ungar est un écrivain tchécoslovaque (1893-1929) de langue allemande, romancier
Né dans une famille de petits industriels juifs cultivés, il suit à Brno une formation de juriste. Au sortir de la Première Guerre mondiale et parallèlement à une carrière diplomatique décevante menée pour l’essentiel à Berlin, il élabore en allemand, comme ses compatriotes Kafka, Perutz, Rilke et Weiss, une œuvre romanesque et dramatique qui lui vaut une notoriété presque immédiate et l’admiration de nombreux écrivains tels que Thomas Mann, Stefan Zweig, Alfred Döblin, Ernest Weiss ou Bertolt Brecht. En pleine maturité créative, il meurt à l’âge de trente-six ans, d’une crise d’appendicite mal soignée. En publiant après un demi-siècle d’inexplicable oubli, la totalité de ses livres : "Enfants et meurtriers", "La Classe", "Les Mutilés", "Le Voyage de Colbert", "L’Assassinat du capitaine Hanika", "La Tonnelle", les éditions Ombres ont permis, à l’œuvre intense et perturbante de ce singulier écrivain de retrouver la juste place qu’elle mérite.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hermann UNGAR
Enfants et meurtriers
Histoire d'un meurtre
Je ne sais si mon aversion pour les bossus fut la conséquence de celle, profonde, que m’inspirait le coiffeur bossu de notre ville, ou si, au contraire, mon aversion première pour les êtres difformes se vérifia sur celui-ci. Il me semble que j’ai toujours éprouvé une insurmontable répulsion pour tout ce que Dieu a marqué de gibbosités, ulcères, lèpres, dartres et autres tares, et même, au fond, pour tout ce qui est faible et délicat, y compris les animaux, dès lors que la nature ne leur a pas donné la force et la robustesse.
De cela on pourrait conclure que j’ai toujours été moi-même un être robuste et éclatant de santé. Aussi je tiens à déclarer sans attendre que c’est précisément le contraire qui est vrai.J’étais si frêle et souffreteux que je dus quitter au bout de six mois à peine l’école des cadets où j’avais fini par être admis, après que mon père eut fait jouer toutes ses relations. J’ai toujours été petit, maigre, chétif, mon visage avait une invariable pâleur de cire, mes épaules étaient si hautes que je pouvais donner l’impression d’une légère difformité, des cernes bleu sombre bordaient en permanence mes yeux, mes os et mes articulations étaient et sont aujourd’hui encore délicats. S’étonne-t-on que malgré cela je haïsse toute faiblesse ? N’est-il pas vrai plutôt que, dans le fond de son cœur, on ne saurait rien tant haïr et mépriser que soi-même ou sa propre image ?
Je raconterai l’histoire d’un acte, et c’est l’histoire de ma jeunesse. Mes années d’enfance ne furent pas entourées d’amour, comme celles d’autres gens. Personne ne m’a jamais témoigné de bonté. Une fois seulement, un être humain s’est adressé à moi comme à un être humain. Encore n’était-ce que dans une lettre. Je raconterai comment j’ai agi envers lui. Mes juges furent sans pitié, et même mon avocat parla de moi comme d’un être que des circonstances extérieures marquées par la misère et l’héritage d’un père moralement diminué m'avaient eux-même moralement diminué et endurci. Les juges me condamnèrent à vingt années de réclusion, la plus forte peine qu’ils pouvaient m’infliger étant donné mon âge. J’avais alors dix-sept ans. J’en ai aujourd’hui trente et un.
je ne suis pas malheureux dans cette maison. Pas impatient non plus. Je me réjouis de la sévérité de mes gardiens, je me réjouis de la régularité à laquelle je suis soumis pour le sommeil, le travail, la promenade. J’aime ce genre de vie. Parfois j’ai l’impression que je ne suis pas un détenu, mais un soldat, un simple soldat obéissant, ce que j’aurais souhaité devenir. J’aime obéir.
Dans six ans je quitterai cette maison. On dit qu’en général, les gens qui sortent de prison après des années, des dizaines d’années de détention, ne sont plus utilisables pour la société des hommes. Je crois pourtant que je quitterai la prison sans en avoir été brisé. Je franchirai d’un pas tranquille le seuil de cette maison, et ce ne sera pas pour jouir jusqu’à l’excès d’une liberté dont j’aurai été si longtemps privé. Je prendrai un emploi, un travail. J’ai appris ici le métier de tourneur, et j’y ai fait montre d’une telle adresse que notre directeur lui-même m’a commandé plusieurs objets pour son usage personnel. J’espère que je pourrai vivre de ce talent, quand j’aurai purgé ma peine.
J’ai dit que parfois j’avais l’impression d’être un soldat. Je veux ajouter maintenant que ce mot ne résume pas tout ce que je ressens ici. Souvent, le soir, quand je suis assis dans ma cellule et que je lève les yeux vers la petite fenêtre grillagée, il me semble que je ne suis pas un détenu, mais un moine. Un obscur petit moine, tranquille et ingénu, dont le supérieur n’a que des raisons de se louer. Alors je souris, et il m’arrive de joindre les mains au-dessus de mes genoux. Non, il n’y a pas en moi la moindre nostalgie du monde, rien que de la patience, du calme et du contentement. Si mes juges, mon avocat et les femmes qui assistaient à mon procès me voyaient ainsi, nul doute qu’ils me décriraient à nouveau comme un être dur, insensible et moralement diminué. Je suis assis là et je souris. Un meurtrier ! Je suis là, assis, et je souris comme un moine pieux et content !
Suis-je vraiment un meurtrier ? J’ai tué un être humain, c’est vrai. Pourtant, j’ai l’impression que ce n’est pas moi qui ai commis cet acte. Il m’apparaît si lointain, si étranger ! Comme une flagellation monastique que je me serais infligée un jour, à moi, non à ma victime, et dont mon dos porterait encore les cicatrices. Mais guéries. Je goûte encore le souvenir de cette mortification de ma chair, et j’en jouis, n’ayant dans ma pauvre cellule aucun instrument dont je pourrais à nouveau punir mon corps ravagé par l’ascèse ; le punir non par haine, ni par vengeance, ni pour en chasser le plaisir des sens, mais par un sentiment plutôt qu’à défaut de pouvoir le décrire clairement, je nomme obéissance.
Mais trêve de considérations sur mon existence actuelle, c’est l’histoire de ma vie que je veux raconter, aussi brièvement qu'il m’est possible. Je n’avais que dix-sept ans lorsque la chose arriva, et mon expérience du monde était des plus réduites, si l’on songe qu’en dehors de mon bref passage à l’école des cadets, je n’étais jamais sorti de la petite ville où, quelques années après ma naissance, après sa mise à la retraite et la mort de ma mère, mon père était venu s’établir avec moi. C’est là que j’ai grandi, dans une étroite maison située à côté de l’église, en bas de la place du marché, et dont mon père et moi, nous occupions l’unique étage.
Je garde de mon père un souvenir très net, comme s’il se tenait là, vivant, devant moi.Quand bien même, juste avant l’événement,son extérieur s’était délabré, il n’en conservait pas moins la raideur et le buste droit du soldat, et portait encore, haut fermée, sa longue redingote noire à présent plus très propre. Je sais qu’autrefois, chaque jour, ses premiers pas dehors le menaient à l’échoppe du barbier, où, malgré la pauvreté de nos moyens, qui à coup sûr lui pesait fort, il se faisait soigneusement raser le menton, friser les favoris et retrousser la moustache.
Pour tout le monde en ville, il était « le Gênéral ». Sans doute, au début, l’avait-on affublé de ce nom pour se moquer du vieux monsieur aux allures de soldat. Mais il lui était devenu par la suite si naturel que personne ne s’adressait à lui autrement, comme si ce titre lui revenait en quelque sorte de droit. Il est probable aussi que, dans les premiers temps, mon père l’avait ressenti comme une raillerie, voire une insulte. Puis, remarquant que les gens restaient sérieux - ne fût-ce, peut-être, que pour mieux rire ensuite derrière son dos - il avait dû se sentir flatté, et il se peut qu’il ait fini par croire lui-même à son grade de général. Quoi qu’il en soit, il eût été sincèrement offensé si quelqu’un lui avait refusé ce titre. En réalité, mon père n’avait jamais été général et n’aurait jamais pu le devenir, n’étant même pas officier. Il était médecin militaire et avait quitté le service avec le grade de médecin-major de première classe.Il n’y avait pas été contraint par l’âge ou la maladie, mais à la suite d’irrégularités découvertes dans la gestion des fonds dont il avait la charge en sa qualité de commandant d’un grand hôpital militaire. Certes, il était parvenu, avec l’aide d’un parent de ma mère, à remplacer les sommes manquantes et à maquiller l’affaire de telle sorte qu’il n’y eût pas d’enquête. Il ne lui restait plus néanmoins qu’à demander sa mise à la retraite.
Ma mère, déjà souffrante depuis des années, fut, semble-t-il, si affectée par ces émotions qu’elle mourut. Mon père décida alors de quitter la ville où il avait servi en dernier lieu, pour venir s’installer dans le bourg où il était né d’un père employé. Ce changement de résidence fut motivé sans doute autant par le désir d’échapper au bruit que n’avait pas manqué de faire sa soudaine mise à la retraite, que par la nécessité de restreindre au minimum son train de vie. Sa pension était maigre, et il devait en outre en prélever chaque mois une part considérable pour rembourser le parent qui lui avait permis, grâce à un prêt relativement important, de remettre à son successeur des comptes en ordre.
Nous occupions, dans l’étroite et sombre maison à côté de l’église, un logement composé d’une cuisine et de deux pièces d’habitation. Au début nous avions une bonne qui assurait les tâches indispensables et préparait nos repas. Mais mon père ne supporta bientôt plus de manger et de passer ses journées dans nos deux pièces sombres et pauvrement aménagées, et il commença à prendre ses repas à l’auberge. Par la suite, la bonne fut renvoyée. Une femme de ménage vint désormais chaque matin faire les lits, nettoyer les habits et cirer les chaussures. On me donnait mes repas dans la cuisine de l’auberge, tandis que mon père passait de plus en plus ses journées dans la salle d’hôtes. À la maison, on se sentait seul, la peinture des murs s’écaillait, d’épaisses couches de poussière s’accumulaient sur les armoires et sur les coffres, tout donnait une telle impression d’abandon que je préférais, moi aussi, me réfugier dans l’obscur escalier de bois plutôt que de rester dans l’appartement.
Dès ma prime jeunesse, j’évitai toute relation. Après la classe, je ne rentrais pas à la maison avec mes camarades, et jamais je ne jouais avec eux. Comme je ne faisais pas mystère du fait que je voulais devenir soldat - officier, même - ils m’appelaient : "petit soldat" pour me faire enrager. Je les laissais dire, et ils me traitaient de fier. Une seule fois, je me laissai entrainer dans une bagarre avec un camarade de classe. Plus faible physiquement, c’est moi qui eus le dessous, d’autant que tous les autres avaient pris parti contre moi. L’incident avait éclaté lorsqu’un garçon m’avait demandé avec un rire moqueur ce qui me rendait si fier au juste ; si c’était que mon père fût parvenu jusqu’au grade de général.
Étais-je fier alors ? Aujourd’hui, je le sais : j’étais simplement malheureux. L’honneur entaché de mon père, qui avait dû quitter l’uniforme de manière si peu glorieuse et qui maintenant, vieux et gris, jouait un rôle si ridicule dans la ville, me remplissait d’une profonde amertume, m’éloignait de tout et me rendait solitaire. J’aimais ce vieil homme qui sombrait de plus en plus bas, et dont la digne contenance, loin d’imposer le respect dû à son grade, le rendait plus ridicule à mesure qu'il s'enfonçait. Je ne sais pas s'il prit jamais conscience de l’effet qu’il produisait, s’il se doutait que personne en ville n’était dupe de son attitude et de ses histoires, s’il savait que les gens riaient intérieurement quand ils le saluaient d’un coup de chapeau appuyé en lui donnant du « Général », ou bien si, devinant tout cela, il assumait le tragique douloureux d’un destin dont le masque était le seul peut-être sous lequel la vie lui fût encore possible. Je ne sais pas. J’ai l’impression qu’il me craignait, moi, le seul être à le deviner si totalement. Je me souviens avec horreur, et ces souvenirs sont parmi les plus pénibles de ma jeunesse, des rares heures où j’étais seul avec mon père. Le plus souvent, quand tard le soir il rentrait d’un pas incertain, posant les pieds avec prudence de peur de me réveiller, jedormais ou faisais semblant de dormir. Mais il arrivait qu’une attaque de goutte l’empêchât de sortir. Ces jours-là, nous restions ensemble à la maison. Son regard, alors, fuyait le mien. Lui qui d’ordinaire ne se lassait jamais de raconter, il ne disait pas un mot. Toute dignité avait disparu de son visage, qui n’exprimait plus que la crainte et une incertitude abandonnée. On eût dit qu’une angoisse atroce paralysait son cœur à l’idée que moi qui savais tout, je pourrais ouvrir la bouche et parler. Conversait-il avec quelqu’un dans la rue, de sa voix forte et sonore, il suffisait que moi, son fils, je passe à proximité, pour qu’il devienne soudain muet et baisse les yeux au sol d’un air effarouché. Qui plus est, je sentais cette crainte se transformer au fil des jours en hostilité contre moi. Contre celui qui savait, non pas celui qui savait les raisons de sa mise à la retraite - la ville entière les connaissait -, mais le seul être dont le regard lui révélât qu’il savait à quel point lui-même, le “Général“, était peu dupe du triste rôle qu’il assumait avec tant de verve et de fierté. Plus tard, quand mon père fut réellement « entré » dans son personnage, lorsqu’il eut, peut-être , accepté la comédie qu ‘on lui avait imposée, au point qu’ayant perdu presque toute notion des choses, il prenait pour réalité le martyre d’un déguisement à l’origine conscient, il devint mon ennemi et le resta. Sans doute alors sa crainte s’effaça-t-elle, mais avec elle aussi les barrières qui faisaient obstacle à son hostilité : il devint dur et ne m’épargna pas.
Je crois que, dans cette évolution des sentiments de mon père à mon égard, Josef Haschek eut lui aussi sa part de responsabilité, qui ne fut pas la moindre. Chaque fois que je repense à cette époque de ma vie, à la période surtout qui précéda le crime, la silhouette du coiffeur bossu se dresse devant moi, et c’est sans doute la raison pour laquelle, moi qui ne suis pas habitué à rapporter des événements par écrit, je suis parti de ce personnage pour entamer mon récit. L’horrible bossu, dont les longs bras pendaient presque jusqu’aux genoux, m’apparaît aujourd’hui comme le symbole même de cette époque affreuse, solitaire et malheureuse.
Le buste de Josef Haschek avait la forme d’un dé posé sur la pointe et légèrement aplati vers le haut. Deux autres coins de ce dé émergeaient en fortes saillies, de la poitrine et du dos. La tête, qui s’animait d’un balancement tout à fait singulier quand il marchait,reposait sans cou entre les épaules. Je me souviens à ce propos d’une pendule qui était accrochée dans la vitrine d’un horloger de la place du marché, et qui nous fascinait, nous les enfants. C’était une horloge à balancier, dont le bord supérieur s’ornait d’une tête de maure aux yeux mobiles. Cette tête devait être reliée au balancier, qui lui communiquait un mouvement synchrone.Elle non plus ne reposait pas sur un cou, à peine le menton saillait-il en avant, et cette circonstance conférait, me semble-t-il, à son mouvement quelque chose d’horrible et de comique à la fois, qui m’a fait me souvenir d’elle à l’instant de décrire la tête branlante du coiffeur.
J’ignore comment le bossu parvint dans un premier temps à gagner la confiance de mon père, puis à prendre sur lui un ascendant toujours plus grand, pour finir par le dominer tout à fait. Haschek fut l’un des principaux témoins à mon procès, et si le cœur de mes juges s’endurcit contre moi, si je leur apparus comme une créature incapable du moindre sentiment moral, il n’est pas le dernier à qui l’on doit en imputer la faute. Il ne négligea rien, dans sa déposition, de ce qui pouvait me condamner aux yeux de ceux qui avaient à prononcer sur mon cas, et il atteignit son but. Depuis que je pense, il fut mon ennemi.
J’ai dit à quel point tout ce qui est faible, malade ou infirme m’a toujours répugné. Il se peut que le coiffeur ait obscurément senti mon aversion et que cela ait suscité en lui un premier mouvement de haine à mon égard. Il avait dû remarquer, en outre, la silencieuse réprobation que je manifestais face à l’amitié de plus en plus étroite qui se développait entre mon père et lui. Certes, comme tous les autres, il interprétait mon mutisme et ma solitude obstinée, qui n’étaient que les effets de mon malheur, comme des marques d’orgueil, et il se peut que cet être affreux ait pris comme une offense le fait que je ne vinsse jamais m’asseoir à sa table pour parler avec lui et écouter son bavardage. Peut-être devinait-il que je ressentais cette relation comme la pire dégradation de mon père. De tels êtres, en effet, réagissent généralement comme l’assassin en fuite, que le bruit d'une feuille morte tombant de l’arbre suffit à effrayer. De tels êtres, dis-je, et je crains qu’on ne me comprenne pas. Car je n’ai encore rien dit jusqu’ici du coiffeur Haschek, sinon qu’il était laid, faible, bossu, et que sa tête, lorsqu’il marchait, balançait bizarrement sur ses épaules.
De tels êtres sont violents, autoritaires, impitoyables et cruels envers tout ce qui est plus faible qu’eux et tombe sous leur coupe. Faibles, laids et difformes, ils affichent une humilité soumise face à tout ce qui est plusfort qu’eux. Mais ils haïssent cette force, et s’entendent à la détruire, pour peu qu’elle présente une faille ou offre prise à leur violence. De tels êtres sont intelligents. Plus intelligents que les êtres forts, bien portants et normalement constitués.Ils rient de ces bien portants, dont le calme et la sérénité ne procèdent que d’une bonne digestion, ils raillent intérieurement la rectitude de leur maintien, la dignité de leur démarche, purs produits, selon eux, de la médiocrité. Mais leur intelligence ne les élève pas au-dessus de ces médiocres et de ces bien portants. Leur rire n’a pas la clairvoyance aiguë de l’ironie, c’est une arme blessante dont la pointe, tournée vers l’intérieur, mord douloureusement leur propre chair. De tels êtres vivent en permanence dans la peur, cette peur qui oppresse le criminel en fuite, car s’ils n’ont encore commis aucun crime, tout en eux y est prêt à chaque instant. Chez de tels êtres veille toujours le soupçon, la crainte qu’on les méprise, qu’on les trouve laids, que leur laideur prête aux sourires ou suscite le dégoût. Ils sont plus coquets que les êtres beaux. Ils aiment s’habiller de manière voyante, allant jusqu’à piquer une fleur à leur boutonnière, pour provoquer les quolibets. Par goût peut-être des tourments qu’ils en attendent, ils aiment exhiber aux regards leur misérable corps émacié, ce corps qu’ils haïssent et méprisent, plus que les autres ne le méprisent, plus qu’ils ne haïssent et méprisent eux-mêmes quoi que ce soit au monde.
Peut-être est-ce là au fond la principale raison qui fit du coiffeur mon ennemi : j’étais son semblable, et cependant je me distinguais de lui. Car je n’avais pas encore renoncé à moi-même. Lui était déjà terrassé par la conscience de sa faiblesse et de son infirmité, si tant est qu’il eût jamais lutté contre elles. Mais moi, j’étais dominé par la pensée d’un but, qui ne me quitta pas jusqu’au jour où j’accomplis mon acte, et ainsi je n’étais pas encore vaincu. Peut-être était-ce la certitude de cette pensée qui conférait à mon malheur l’apparence de la fierté et me rendait solitaire. Ma solitude fit du coiffeur mon ennemi, non seulement parce qu’il haïssait les solitaires, mais parce que, tout en étant comme lui, j’étais solitaire. Car les êtres de son espèce ne sont pas des solitaires. Ils ont besoin d’un public devant qui se mettre à nu, se prostituer, s’avilir par les mots, les rires, les larmes et les gestes, pour fouetter leur propre misère et maintenir vivant leur désir de revanche sur ceux-là mêmes qui les écoutent.