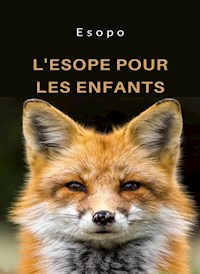2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Les Ysopets
- Sprache: Französisch
Le présent ouvrage recense environ 250 fables d' Esope ayant traversé les siècles. Chambry, quant à lui, en a recensées pas loin de 400, mais à un moment donné, la légende prête à l'homme des écrits ultérieurs. Le terme "Ysopet" ou "Isopet" sera employé au Moyen-Âge pour qualifier les écrits d'inspiration ésopique, apologues et fables.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Esope
Esope - FablesAutres publications de l’auteurA propos d'EsopeFABLESPage de copyrightEsope - Fables
(Les Ysopets - 4)
© - 2020 – Christophe Noël
ISBN : voir dernière page
Édition : BoD – Books on Demand
Dépôt légal : décembre 2020
Autres publications de l’auteur
EBOOKS (Version numérique):
Errances – recueil de nouvelles (BOD)
Exquises Esquisses, Tomes 1 et 2 – galerie de portraits (BOD)
Notes Bleues – écrits divers (BOD)
Nathalie et Jean-Jacques – recueil de nouvelles (BOD)
Les Très-mirifiques et Très-édifiantes Aventures du Hodja Nasr Eddin
Tome 1
(BOD)
Nasr Eddin rencontre Diogène –
Tome 2
(BOD)
Les Ysopets – 1 – Avianus (BOD)
Les Ysopets – 2 – Phèdre version complète latin-français (BOD)
Les Ysopets – 2 – Phèdre version Découverte en français (BOD)
Les Ysopets – 3 – Babrios version Découverte (BOD)
Jacques Merdeuil – nouvelle - version française (Smashwords)
Jacques Shiteye – version anglaise – traduit par Peggy C. (Smash- words)
Ζάκ Σκατομάτης – version grecque – traduit par C. Voliotis (Smash- words)
Le Point Rouge –nouvelle - version française (Smashwords)
The Red Dot - version anglaise – traduit par Peggy C. (Smashwords)
VERSION PAPIER :
Les Très-mirifiques et Très-édifiantes Aventures du Hodja Nasr Eddin
Tome 1
(BOD)
Nasr Eddin rencontre Diogène –
Tome 2
(BOD)
Nasr Eddin sur la Mare Nostrum –
Tome 3
(disponible chez l’auteur)
Le Sottisier de Nasr Eddin –
Tome 4
(disponible chez l’auteur)
Commandes – dédicaces :
A propos d'Esope
ESOPE
Ésope (en grec ancien Αἴσωπος / Aísôpos, VIIe – VIe siècle av. J.-C.) est un écrivain grec d'origine phrygienne[1], à qui on a attribué la paternité de la fable.
Biographie
Conjectures et faits historiques
Il n'existe rien de certain sur la vie d'Ésope. Le témoignage le plus ancien est celui d'Hérodote, selon lequel Ésope avait été esclave de Iadmon[2], avec Rhodopis[3]. Cette information est reprise plus tard par Héraclide du Pont, qui le présente comme originaire de Thrace, près de la mer Noire, une thèse que semble confirmer un certain Eugeiton[4] qui affirme qu’Ésope était de Méssembrie[5], ville des Cicones[6], sur la côte de Thrace.
Mais la tradition la plus répandue faisait d’Ésope un Phrygien. Phèdre, Dion Chrysostome[7], Lucien[8], Aulu-Gelle[9], Maxime de Tyr[10], Aelius Aristide[11], Himérios[12], Stobée[13], Suidas[14] (rapportant le mot prêté à Crésus, « μᾶλλον ὁ Φρύξ » : « Le Phrygien a parlé mieux que tous les autres. »), s’accordent à lui assigner la Phrygie pour patrie. Quelques-uns précisaient même la ville de Phrygie où il était né : c’était, d’après la Souda et Constantin Porphyrogénète[15], Cotyaion ; c’était Amorion, d’après la vie légendaire d’Ésope[16]. »
Selon Chambry encore, « si l’on a cherché la patrie d’Ésope hors de la Grèce, en Phrygie, c’est que le nom Αἴσωπος ne semble pas être un nom grec ; on a cru y voir un nom phrygien, qu’on rapprochait du nom du fleuve phrygien Αἴσηπος, et peut-être du guerrier troyen Αἴσηπος dont il est question chez Homère ; on l’a rapproché aussi du mot Ἢσοπος qu’on lit sur un vase de Sigée[17]. Une Vie d’Ésope le fait Lydien[18], sans doute parce que, d’après la tradition qui apparaît pour la première fois dans Héraclide, il fut esclave du Lydien Xanthos[19]. En somme, toutes ces traditions ne reposant que sur des conjectures, il serait vain de s’arrêter à l’une d'entre elles : mieux vaut se résigner à ignorer ce qu’on ne peut savoir[20]. »
Quant à l'époque où il a vécu, il règne la même incertitude. Si l'on suit Hérodote, qui en fait un contemporain de Rhodopis, il aurait vécu entre -570 et -526. Phèdre le place entre 612 et 527[21] avant Jésus-Christ.
Selon une thèse de M. L. West, c'est à Samos que se serait formée sa légende.
Vie légendaire
Maxime Planude, érudit byzantin du XIIIe siècle, a popularisé une Vie d’Ésope à partir d'un matériau datant probablement du Ier siècle. Ce texte rassemble des traditions diverses, certaines anciennes, d'autres de l'époque romaine. L’emprunt le plus important est celui fait à Babylone[22], transposant pour Ésope un récit de la vie d'Ahiqar[23], qui circulait en Syrie à cette époque. Jean de La Fontaine a lui-même adapté ce récit et l'a placé en tête de son recueil de fables sous le titre La Vie d'Ésope le Phrygien.
Selon ce récit : « Ésope était le plus laid de ses contemporains ; il avait la tête en pointe, le nez camard, le cou très court, les lèvres saillantes, le teint noir, d’où son nom qui signifie nègre ; ventru, cagneux, voûté, il surpassait en laideur le Thersite d’Homère ; mais, chose pire encore, il était lent à s’exprimer et sa parole était confuse et inarticulée[24]. »
Ces traits caricaturaux ont suffi à certains auteurs pour spéculer sur sa négritude[25].
Selon la légende, Ésope, ayant rêvé une nuit que la Fortune lui déliait la langue, s'éveille guéri de son bégaiement. Acheté par un marchand d'esclaves, il arrive dans la demeure d'un philosophe de Samos, Xanthos (dont le nom signifie « Blond »), auprès duquel il rivalise d'astuces et de bons mots, et contre lequel il livre un combat incessant.
Finalement affranchi, il se rend alors auprès du roi Crésus[26] pour tenter de sauvegarder l'indépendance de Samos. Il réussit dans son ambassade en contant au roi une fable. Il se met ensuite au service du « roi de Babylone », qui prend grand plaisir aux énigmes du fabuliste. Il résout aussi avec brio les énigmes qu'aurait posées à son maître le roi d'Égypte.
Voyageant en Grèce, il s'arrête à Delphes, où, toujours selon la légende, il se serait moqué des habitants du lieu parce que ceux-ci, au lieu de cultiver la terre, vivaient des offrandes faites au dieu[27]. Pour se venger, les Delphiens l'auraient accusé d'avoir volé des objets sacrés[28] et condamné à mort. Pour se défendre, Ésope leur raconte deux fables, La Grenouille et le Rat et L'Aigle et l'Escarbot, mais rien n'y fait et il meurt précipité du haut des roches de Phédriades[29].
Un personnage littéraire
On a souvent mis en doute la réalité historique de la prodigieuse destinée de cet ancien esclave bègue et difforme qui réussit à se faire affranchir et en vient à conseiller les rois grâce à son habileté à résoudre des énigmes.
« Tout le récit de la vie d'Ésope est parcouru par la thématique du rire, de la bonne blague au moyen de laquelle le faible, l'exploité, prend le dessus sur les maîtres, les puissants. En ce sens, Ésope est un précurseur de l'antihéros, laid, méprisé, sans pouvoir initial, mais qui parvient à se tirer d'affaire par son habileté à déchiffrer les énigmes[30]. ».
Ésope était déjà très populaire à l’époque classique, comme le montre le fait que Socrate lui-même aurait consacré ses derniers moments de prison avant sa mort à mettre en vers des fables de cet auteur. Le philosophe s’en serait expliqué au philosophe Cébès[31] de la façon suivante : « Un poète doit prendre pour matière des mythes [...] Aussi ai-je choisi des mythes à portée de main, ces fables d’Ésope que je savais par cœur, au hasard de la rencontre[32]. »
Le poète Diogène Laërce[33] attribue même une fable à Socrate, laquelle commençait ainsi : « Un jour, Ésope dit aux habitants de Corinthe qu'on ne doit pas soumettre la vertu au jugement du populaire. » Or, il s'agit là d'un précepte aujourd'hui typiquement associé au philosophe plutôt qu'au fabuliste. Socrate se servait sans doute du nom d'Ésope pour faire passer ses préceptes au moyen d'apologues[34].
Les fables
Le produit d'une tradition orale.
Les fables dites d'Ésope sont de brefs récits en prose sans prétention littéraire. Il est presque certain qu'il ne les écrivait pas[35]. La fable existait avant Ésope[36], mais celui-ci est devenu tellement populaire par ses bons mots qu'on en a fait le « père de la fable » : « le grec ne possédant pas de terme spécifique pour désigner la fable, le nom d'Ésope a servi de catalyseur, et ce d'autant plus facilement que toute science, toute technique, tout genre littéraire devait chez eux être rattaché à un « inventeur ». Ainsi s'explique, en partie, qu'Ésope soit si vite devenu la figure emblématique de la fable[37]. »
Le premier recueil de fables attribuées à Ésope a été compilé par le philosophe Démétrios de Phalère vers 325 av. J.-C.., un ouvrage qui a été perdu. Celui-ci a toutefois donné naissance à d’innombrables versions dont l'une d'entre elles a été conservée sous la forme d’un ensemble de manuscrits datant probablement du Ier siècle, collection appelée Augustana. C’est à celle-ci que l’on se réfère lorsqu’on parle aujourd’hui des « fables d'Ésope ». Elle compte plus de 500 fables, toutes en prose, parmi lesquelles figurent les plus populaires, telles Le Corbeau et le Renard, Le Lièvre et la Tortue, Le Bûcheron et la Mort, Le Vent et le Soleil, etc. Il est probable que le nom d'Ésope a servi à regrouper toutes sortes de récits qui circulaient jusque-là de façon orale et qui présentaient des caractéristiques communes[38]. Dans son édition critique, Chambry a retenu 358 fables.
Une des premières traductions françaises est celle faite par le Suisse Isaac Nicolas Nevelet en 1610, qui compte 199 fables. C'est le recueil qu'a utilisé La Fontaine[39].
Les continuateurs
Ésope inspira notamment :
Phèdre[40] (Ier siècle ; direct inspirateur des fabulistes du XVIIe siècle) ;
Babrius, de date incertaine, qui n'a été redécouvert qu'au XIXe siècle ;
Avianus[41] (IVe siècle ou Ve siècle) ;
Marie de France (XIIe siècle);
Djalâl ad-Dîn Rûmî (XIIIe siècle) ;
Jean de La Fontaine (XVIIe siècle) ;
Benserade (contemporain de La Fontaine) ;
Charles Perrault (contemporain de La Fontaine) ;
Léon Tolstoï (1828-1910).
[1] La Phrygie (du grec ancien : Φρυγία) est un ancien pays d’Asie Mineure, situé entre la Lydie et la Cappadoce, sur la partie occidentale du plateau anatolien. Selon Hérodote, les Phrygiens avaient au début le nom de Briges (ou Bryges) et auraient séjourné en Macédoine et en Albanie, puis ils seraient passés en Thrace, avant de migrer, via l'Hellespont, un peu avant la guerre de Troie, pour s'établir dans cette ville, en Asie Mineure.
[2] Philosophe de Samos.
[3] Hérodote, Histoires, II, 134. Cité par Chambry 1927, p. IX. Rhodope (en grec ancien Ῥοδόπη / Rhodópê) est une hétaïre grecque de l'Antiquité, native de Thrace. Elle fut la maîtresse d'Ésope, esclave comme elle à la cour d'un roi de Samos.
Élien rapporte une anecdote selon laquelle un aigle lui vola une de ses pantoufles alors qu'elle était au bain. L'oiseau laissa néanmoins la pantoufle tomber aux pieds du pharaon Psammétique. Celui-ci frappé de stupeur par la délicatesse de la pantoufle, promit d'épouser la femme à qui cette pantoufle appartenait. Cette anecdote, contée également par Strabon, peut être considérée comme la source du conte de Cendrillon.
[4] cité par Suidas.
[5] Nessebar (en bulgare Несебър, translittération internationale Nesebǎr, « Messembrie » en français classique, d'après son nom grec Μεσημβρία / Messembria qui signifie « midi » et supposément « cité de Melsas ») est une cité historique de la Bulgarie, de population grecque de l'Antiquité à 1923, juchée sur une presqu'île rocheuse s'avançant en mer Noire
[6] Dans la mythologie grecque les Kikones (en grec ancien Κίκονες / Kíkones, nom parfois francisé en Cicones) sont une tribu mythique dont la ville principale est Ismaros sur la côte sud de la Thrace. Ils sont mentionnés à deux reprises par Homère.
[7] Dion de Pruse, ou encore Dion Chrysostome (grec Δίων Χρυσόστομος), c'est-à-dire Bouche d'or, ainsi surnommé à cause de son éloquence, rhéteur grec du courant de la seconde sophistique, né à Pruse en Bithynie vers l'an 40 et mort vers 120.
[8] Lucien de Samosate (en grec ancien Λουκιανὸς ὁ Σαμοσατεύς / Loukianòs ho Samosateús), né vers 120 et mort après 180, est un rhéteur et satirique de Commagène, en Anatolie, qui écrivait en grec, dans un style néo-attique.
[9] Aulu-Gelle (en latin Aulus Gellius), né à Rome entre 123 et 1301 et mort vers 180, est un magistrat, grammairien et compilateur latin du IIe siècle.
Il est l'auteur d'un ouvrage d'érudition en vingt livres intitulé les Nuits attiques.
[10] Maxime de Tyr (en latin Cassius Maximus Tyrius, en grec ancien Mάξιμος Τύριος / Máximos Túrios) est un philosophe et rhéteur grec du IIe siècle, contemporain des derniers empereurs Antonins.
[11] Aelius Aristide, dont le nom complet est, en latin, Publius Aelius Aristides Theodorus (né probablement en 117 - mort après 185) est un rhéteur et un sophiste grec qui vécut à l'époque antonine.
[12] Himérios est un orateur et un sophiste (professeur de rhétorique) du IVe siècle ap. J.-C. (v. 315-386).
[13] Jean Stobée, en latin Ioannes Stobaeus, natif, d'après son nom, de Stobi (Macédoine), est un doxographe et compilateur grec de l'Antiquité tardive (Ve siècle). Son Anthologie nous a légué des fragments nombreux, parfois exclusifs, d'auteurs grecs de l'Antiquité.
[14] La Souda (du grec ancien : Σοῦδα / Soûda) ou Suidas (Σουίδας / Souídas) est une encyclopédie grecque de la fin du Xe siècle. C'est un ouvrage de référence, en particulier pour les citations, très souvent utilisé dans les travaux portant sur l'Antiquité. Le nom de l'ouvrage, la date de sa rédaction, l'identité de son ou de ses auteurs ont posé de délicats problèmes aux chercheurs.
[15] Constantin VII (en grec : Κωνσταντίνος Ζʹ Πορφυρογέννητος, Kōnstantinos VII Porphyrogennētos), né le 3 septembre 905 à Constantinople et mort le 9 novembre 959 dans la même ville, est empereur byzantin de 913 jusqu'à sa mort, bien qu'il n'exerce effectivement le pouvoir qu'à partir de 9441. Il appartient à la dynastie macédonienne.
[16] Chambry 1927, p. XV.
[17] Sigée ou Sigeion (en grec ancien Σίγειον / Sígeion, en latin Sigeum) était une cité grecque située en Troade, à l'embouchure du Scamandre.
[18] La Lydie est un ancien pays d'Asie Mineure, proche de la mer Égée, dont la capitale était Sardes. Elle était connue par Homère sous le nom de Méonie et est parfois citée dans les légendes d'Héraclès et Omphale, d'Arachné, ou de Tantale et de Pélops (ancêtres des Atrides).
[19] Voir plus bas dans le texte.
[20] Chambry 1927, p. XV-XVI.
[21] Chambry 1927, p. XVI.
[22] Babylone (akkadien : Bāb-ili(m)1, sumérien KÁ.DINGIR.RA, arabe بابل Bābil, araméen Babel) était une ville antique de Mésopotamie.Elle est située sur l'Euphrate dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, à environ 100 km au sud de l'actuelle Bagdad, près de la ville moderne de Hilla.
[23] Ahiqar est un sage assyrien-araméen très connu dans les traditions de l'Antiquité proche-orientale, puisqu'il était mentionné par des textes juifs et grecs antiques. On ne peut cependant pas dire s'il a réellement existé. Il est le héros du Roman d'Ahiqar, une œuvre littéraire originaire de Mésopotamie antique, rédigée en araméen au plus tôt durant le dernier siècle de l'empire assyrien, le VIIe siècle av. J.-C. Ce texte se présente comme le récit des mésaventures d'un dignitaire de la cour royale assyrienne, mais aussi comme une compilation de proverbes, donc un texte de « sagesse ». Il est aujourd'hui essentiellement connu grâce à des papyrus retrouvés en 1906 à Éléphantine en Égypte datés du règne du roi perse achéménide Darius II (fin du Ve siècle av. J.-C.).
[24] Chambry 1927, p. XIX.
[25] Thuram 2010, p. 25-29.
[26] Crésus ou Croesus (né vers - 596), en grec ancien Κροῖσος, dernier souverain de la dynastie des Mermnades est un roi de Lydie vaincu par Cyrus le Grand. Durant son règne, qui s’étend d'environ 561 à 547 ou 546 av. J.-C, il conquiert la Pamphylie, la Mysie et la Phrygie jusqu'à l'Halys mais ne parvient pas à s'implanter plus à l'Est de son royaume.
[27] Autre version : il aurait parlé de fraudes commises par les prêtres d’Apollon.
[28] Une coupe d’or qui aurait été mise par les habitants dans son sac de voyage.
[29] Chambry 1927, p. XI-XII. Delphes est surplombée par de hautes falaises rougeoyantes, les Phédriades (Rhodini, la « Rose », au nord et Phlemboucos, la « Flamboyante »).
[30] Canvat 1993, p. 8.
[31] Cébès de Thèbes est un philosophe grec de la fin du Ve siècle et du début du IVe siècle av. J.-C.
[32] Platon, Phédon, 61b.
[33] Diogène Laërce (en grec ancien Διογένης Λαέρτιος / Diogénês Laértios) est un poète, un doxographe et un biographe du début du IIIe siècle.
[34] L'apologue est un court récit narratif démonstratif et fictif, à visée argumentative et rédigé principalement en vers dont on tire une morale pratique. Ésope est considéré comme le fondateur du genre
[35] Chambry 1927, p. XXIII.
[36] Voir texte suivant, de Philippe Renault.
[37] Canvat 1993, p. 11.
[38] Canvat 1993, p. 10.
[39] Voir, en Annexe, la Vie d’Esope le Phrygien, par La Fontaine
[40] Ouvrage paru dans la série : les Ysopets
[41] Idem
FABLES
L’Aigle percé d’une flèche.
Un Aigle s’arracha quelques plumes et les laissa tomber à terre. Un chasseur les ramassa, ensuite il les ajusta au bout d’une flèche, et de cette même flèche perça l’Aigle.
– Hélas ! disait l’Oiseau comme il était sur le point d’expirer, je mourrais avec moins de regret, si je n’avais été moi-même, par mon imprudence, la première cause de ma mort.
L’Aigle et le Corbeau.
Un Aigle venant à fondre du haut des airs sur un Mouton, l’enleva. Un Corbeau qui le vit crut pouvoir en faire autant, et volant sur le dos d’un Mouton, il fit tous ses efforts pour l’emporter, comme l’Aigle avait fait ; mais ses efforts furent inutiles, et il s’embarrassa tellement les pieds dans la laine du Mouton, qu’il ne put jamais se dégager ; de sorte que le Berger survenant, prit le Corbeau et le donna à ses enfants pour les amuser, et pour leur servir de jouet.
L’Aigle et la Corneille.
Un Aigle voulant manger une huître, ne pouvait trouver moyen, ni par force, ni par adresse, de l’arracher de son écaille. La Corneille lui conseilla de s’élancer au plus haut dans l’air, et de laisser tomber l’huître sur des pierres pour qu’elle se rompît. L’Aigle suivit ce conseil. La Corneille qui était demeurée en bas pour en attendre l’issue, voyant qu’il avait réussi, se jeta avidement sur le crustacé qu’elle avala, ne laissant à l’Aigle que les écailles pour le prix de sa crédulité.
L’Aigle et l’Escarbot.
L’Aigle enlevait un Lapin, sans se mettre en peine des cris d’un Escarbot. Celui-ci intercédait pour son voisin, et suppliait l’oiseau de laisser la vie sauve au Lapin ; mais l’Aigle, sans avoir égard aux prières de la bestiole, mit l’autre en pièces. Il ne tarda guère à s’en repentir ; car, quelques jours après, voici que l’Escarbot, qui avait pris le temps que l’Aigle s’était écarté de son nid, y vole, culbute tous les œufs, fracasse les uns, fait faire le saut aux autres, et par la destruction entière du nid, venge la mort de son ami.
L’Aigle et la Pie.
Les Oiseaux n’eurent pas plutôt chargé l’Aigle du soin de les gouverner, que celui-ci leur fit entendre qu’il avait besoin de quelqu’un d’entr’eux sur qui il pût se décharger d’une partie du fardeau qu’il avait à porter. Sur quoi la Pie sortit des rangs de l’assemblée, et vint lui offrir ses services. Elle représenta, qu’outre qu’elle avait le corps léger et dispos pour exécuter promptement les ordres dont on la chargerait, elle avait, avec une très heureuse mémoire, un esprit subtil et pénétrant ; d’ailleurs, qu’elle était adroite, vigilante, laborieuse, et cela sans compter mille autres bonnes qualités ; elle allait en faire le détail, lorsque l’Aigle l’interrompit.
– Avec tant de perfections, lui dit-il, vous seriez assez mon fait, mais le mal est que vous me semblez un peu trop babillarde.
Cela dit, comme il craignait que la Pie n’allât divulguer, lorsqu’elle serait à la cour, tout ce qui s’y passerait de secret, il la remercia, et sur le champ la renvoya.
L’Aigle et le Renard.