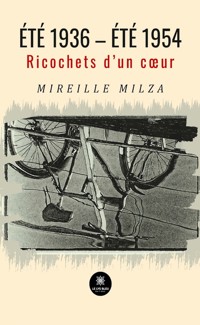
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Sur une plage fluviale, à l’été 36, Adèle, étudiante à la Sorbonne, se sent étrangère à ce monde qui l’intrigue et l’enivre, jusqu’à sa rencontre avec une jeune ouvrière, Camilla. Grâce à son esprit à la fois avenant et audacieux, Adèle gagne la confiance du groupe. Cherche-t-elle à s’émanciper du cercle familial de la Grande Maison bourgeoise ou à découvrir un autre milieu social, avec la complicité de son grand-père Léon ? Au cours d’une soirée populaire, elle s’éprend d’un jeune Espagnol républicain et s’ouvre à la politique, en suivant l’actualité de l’Espagne. Un secret, dévoilé en 1954, viendra éclairer cet été qui a marqué sa vie, ses engagements et ses choix.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Ancienne institutrice et formatrice en arts visuels, Mireille Milza accorde une attention particulière au choix des mots et des formes, qu’elle considère comme des vecteurs de sensibilité et d’intellect. Elle privilégie les récits où les personnages, confrontés à des enjeux sociaux et politiques, se façonnent à travers des dilemmes et des décisions mêlant tendresse, douleur et persévérance. Son roman reflète pleinement cette approche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mireille Milza
Été 1936 – été 1954
Ricochets d’un cœur
Roman
© Lys Bleu Éditions – Mireille Milza
ISBN : 979-10-422-6273-0
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
J’ai habité la ville de Maisons-Alfort jusqu’à l’âge de vingt ans.
Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations ayant existé ne saurait être que fortuite et serait le fruit d’une pure coïncidence.
L’amitié est toujours une douce responsabilité,jamais une opportunité.
Khalil Gibran
Première partie
1936, l’été des rencontres
La nouvelle nageuse
En cet après-midi du 15 juillet 1936, l’effervescence d’une belle jeunesse qui savourait ses premiers congés payés animait les bords de Marne. Du côté de Charentonneau, on avait emprisonné une portion d’eau du fleuve, pour alimenter, comme un bief de partage, un grand bassin nautique qu’on nommait avec fierté la nouvelle Plage ! Sur les berges, des badauds trop âgés pour ses ablutions bruyantes goûtaient, envieux, cette joie de vivre.
Depuis quatre jours, ladite jeune fille choisissait une place près d’un muret pour étaler sa serviette bayadère si semblable aux autres, s’asseoir et enduire son corps d’un voile protecteur. Les autres femmes de la plage prenaient du plaisir, telles des baigneuses de hammam, à masser chaque parcelle de leur anatomie d’Ambre solaire, cette huile parfumée au jasmin qui avait conquis tout l’Hexagone depuis 1935. Son geste à elle était fugace, nécessaire. Discrète, elle extirpait d’un sac de jute, un mouchoir pour s’essuyer les mains, un chapeau blanc en crochet pour coiffer son chignon couleur sable, enfin un livre gris toilé qu’elle ouvrait à la bonne page grâce à un signet.
Pourquoi Adèle attirait-elle l’attention ? Elle n’avait pourtant aucun artifice, aucun signe particulier sinon des ongles neutres bien nets parmi les vernis rouges et roses, qui papillonnaient comme de gros confettis sur la plage. Certes, elle était belle, d’un charme slave, mais certaines jeunes filles des usines proches, dans leur intrépidité, ne manquaient pas d’attraits. Elle était différente, presque studieuse, tout assidue à suivre les lignes de son chapitre.
En réalité, adossée à son muret, Adèle se sentait exclue de cette foule populaire si vivante. Le roman, c’était une contenance. Bien sûr, elle aimait lire, mais cet écran lui permettait d’avoir un œil libre sur toute l’activité humaine qui l’entourait. Elle adorait regarder nageuses et nageurs élaborer des plongeons sophistiqués depuis le grand échassier à trois étages. Seule, elle n’osait pas s’y aventurer. Comme elle enviait les éclats de rire qui fusaient des différents groupes. Cette joie de vivre la grisait. Ici, il n’était pas question de contrôler le timbre, de minimiser les effets, d’étouffer l’émotion. C’était un orchestre urbain qui ne ressemblait nullement aux notes mesurées des salons. Quelquefois, elle remisait son livre au fond du sac pour se fondre dans l’eau, une fusion où chaque partie de son corps pâle se diluait doucement jusqu’à disparaître dans le vert de bleu. L’attache, décrochée du bonnet de bain, annonçait son retour à la surface, et là, elle semblait léviter, quelle que soit la profondeur. Puis elle repartait et chaque brasse l’emportait vers la frontière, la limite des bassins nautiques. La limite, la sécurité, l’interdit. Comme elle aurait aimé s’émanciper de cet espace, nager avec ablettes, anguilles, brèmes vers le pont de Charenton, jusqu’au confluent où, suivant l’histoire, la Seine volait sa partition à la Marne.
Une envie de sortir du cadre familier l’habitait, même si dans la Grande Maison, comme la nommaient les habitants de Maisons-Alfort, Adèle n’était pas malheureuse. Elle musardait à sa guise de sa banlieue à Paris, mais pour rejoindre la plage de Charentonneau, elle dut argumenter son choix. « Ce lieu n’est fréquenté que par les amis du maire Albert Vassart, syndicaliste communiste, tu vas te noyer dans la propagande », avait déclaré son cousin Serge. Adèle n’avait pas fléchi. La Marne, c’était son fleuve, son eau, une sorte de liquide amniotique, depuis que toute petite, son Grand-père Léon lui retirait ses sandales pour qu’elle goûte, assise sur un muret, la caresse fluviale.
Un groupe d’ouvrières de l’usine l’Alsacienne avait remarqué la présence de cette Demoiselle. Railleries et quolibets fusaient, la méconnaissance de l’autre induit souvent le rejet.
Une voix s’éleva, celle de Camilla, une belle brune d’origine italienne.
Pour braver ses amies, elle s’approcha de l’intruse et fit mine de s’intéresser à sa lecture.
Adèle réalisa que son livre paraissait tout droit issu d’une bibliothèque raffinée, alors qu’illustrés et journaux trouvaient davantage leur raison d’être, là. Sans se troubler, elle répondit :
Le mot « enfin » légèrement accentué étonna l’interlocutrice. Camilla pensa aux remarques de son groupe. Elle ne manquait pas d’humour cette jeune fille sage. Alors elle s’enhardit :
Visiblement Adèle était satisfaite d’avoir interrompu sa lecture et Camilla ne se fit pas prier pour partager un espace sur la serviette de plage. Elles discutèrent de l’initiative municipale, des moyens de progresser en natation et s’esclaffèrent devant la témérité d’un plongeur qui, bravant l’interdiction, venait de sauter de la passerelle proche. Le fautif, sous les cris de la foule mêlés au sifflet du maître-nageur, ne réapparut que sur l’autre berge et enfourcha prestement sa bicyclette.
Refusant d’imaginer les commentaires, Adèle éprouvait un réel plaisir pour ce moment de partage. Ce pas vers l’autre, elle aurait pu l’anticiper, mais certains regards n’étaient pas une invitation. Dix-sept heures, il était l’heure pour elle de regagner la Grande Maison. Elle osa se diriger vers le groupe des amies et les salua :
Des réponses sèches et un au revoir plus chaleureux, celui de Camilla, lui firent écho.
Adèle devait aller chercher son Grand-père au cabinet du vieux médecin de famille. Elle admirait toujours la plaque cuivrée bien astiquée qui indiquait le nom du Docteur, le numéro de téléphone, l’étage, et portait dignement un beau caducée. Elle monta, alerte, les deux étages d’un escalier en colimaçon et allégea ses pas sur le parquet ciré de la salle d’attente. Au mur, la défunte femme du vieux médecin avait accroché deux sous-verres, l’un représentant son homme, militaire en 1915, orné de trois croix de guerre et l’autre, une publicité pour l’Urodonal aux mille vertus. Pour la première fois, ce remède miracle qui dissolvait l’acide urique, assouplissait les artères, lavait le foie et les articulations amusa beaucoup Adèle. C’était une potion bénéfique, loin de la décoction à l’arsenic et à la bave de crapaud qui rendit célèbres quelques empoisonneuses. L’humeur d’Adèle était à la taquinerie. Quand la porte de la salle d’auscultation s’ouvrit sur une blouse blanche immaculée et un homme dont les yeux d’un bleu vif signifiaient l’intelligence, elle se dit, étonnée, que le médecin avait dû être beau, car son visage conservait du charme sous des rides profondes et une peau parsemée de taches de vieillesse.
Toute songeuse, Adèle pensa que sa journée avait déchiré quelques voiles d’indifférence. Il y a de simples vécus qui sont des révélateurs de l’âme. Le quotidien, le banal, l’imprévu stimule parfois l’acuité visuelle et mentale. De surcroît, le bilan de santé du Grand-père Léon étant très satisfaisant, elle commenta, avec enthousiasme, sa rencontre avec Camilla.
Quand Adèle lui répondit, il éclata de rire. Comme il l’aimait cette petite frondeuse !
La jeune fille haussa les épaules. Avait-elle nourri un quelconque dessein en répondant à Camilla ? Se faire accepter ? Déstabiliser l’autre ?
Léon jeta un coup d’œil à sa petite-fille. Adèle attendait déjà le jour d’après.
Une amitié imprévisible
Depuis cet échange, malgré la réticence des amies de Camilla, les deux jeunes filles s’apprivoisèrent par de petits gestes, des paroles légères pour partager une baignade.
Le long de la promenade, entre badauds observateurs, les réflexions continuaient à fuser.
Et oui, sur les bords de Marne, les divergences d’opinions, les joutes verbales auraient pu nourrir quelques écrits de Maupassant. Dans la classe semi-bourgeoise, ceux qui s’étaient tus osaient s’exprimer depuis l’arrivée du Front populaire. Ils n’acceptaient pas les accords de Matignon et libéraient leur rage. Certains vainqueurs, quant à eux, avaient le verbe un peu trop haut.
Les nouvelles amies ne se souciaient pas des critiques des quidams. Leur jeunesse et la maturité parfois grisonnante des promeneurs établissaient une réelle frontière, un rempart. Ils étaient au balcon et leur plage était la scène. Cette raillerie plaisait à Adèle, ce qui conforta l’idée de Camilla : Adèle, sous ses airs de petite fille rangée, ne manquait pas d’humour. Un jour, l’organisation théâtrale fut intervertie. La jeune fille offrit une orangeade à tout le groupe de baigneuses, au bar de la piscine construit sur une terrasse. Assises autour d’une table ronde coiffée d’un parasol, elles observaient toute la foule des baigneurs, baigneuses, nageurs et nageuses. Certains se contentaient en effet d’un bain rafraîchissant, d’autres tentaient d’apprendre la brasse à un ami, la main salvatrice sous le menton de l’apprenant. Les plus sportifs décomposaient leur saut comme une chronophotographie sous les hourras des spectateurs.
La remarque était cocasse, mais juste. Alors elles s’amusèrent à chercher quelques ressemblances entre les apparitions flatteuses du premier coup d’œil et les silhouettes dévêtues. Ici l’homme apparaissait dans sa plus simple morphologie, traîtresse ou avantageuse. À part quelques profils à la Marcel Cerdan, les corps perdaient de leur volume.
Le souci d’une quelconque déception ne semblait pas affecter Adèle et Camilla. Elles avaient vingt ans, mais la gent masculine de la plage ne faisait pas partie de leurs préoccupations. Ces deux jeunes pousses fraîches vivaient l’été de leurs vingt ans dans le mélange des genres pour la joie de fendre l’eau côte à côte, d’ouvrir leurs yeux dans les fonds rocailleux puis de s’enrouler telles des momies dans leurs serviettes chaudes de soleil. Leur manque d’appétence ne décourageait pas les regards audacieux. Adèle d’un blanc nacré de nautilus, Camilla aussi ambrée qu’une peau d’amande, l’une et l’autre attisaient les convoitises. Les jeunes hommes attendaient le moment où elles retireraient leur bonnet de béguines, pour libérer leurs longues chevelures et soulèveraient leurs mèches trempées d’un geste vif, innocemment provocant, libérant la forme des seins sous le tissu attendri par l’eau. Ils savaient pourtant que ces deux filles n’accorderaient rien, même pas un baiser furtif derrière une cabine. Si Adèle semblait réservée, Camilla, altière se montrait prête à égratigner d’un coup d’ongles tout contact imposé. Il faut dire que les ouvrières de l’usine l’Alsacienne avaient entamé une éducation rapide de cette petite fille tombée si vite dans un monde de grands où les plaisanteries grivoises rompaient la mécanique des gestes. De son côté, l’étudiante ne connaissait la morphologie masculine qu’à travers les antiquités du Louvre, mais elle n’ignorait en rien les récits mythologiques sur la sexualité débridée des dieux de l’Olympe. Elle en fit quelques récits qui semblèrent plaire au quartet élargi. Les plus jeunes s’imaginèrent en Aphrodite, déesse de l’amour, de la beauté et plaisantèrent sur l’arrivée d’un Triton fluvial prêt à les séduire.
Ce fameux Triton, Adèle et Camilla étaient prêtes à le pêcher pour leurs amies si elles participaient à un défi. Sauter de la passerelle de Saint-Maurice était tout de même risqué et passible d’amende. Elles avaient donc projeté de s’échapper du bassin et de nager en pleine Marne jusqu’au Moulin Brûlé. Ce lieu, détruit en partie par un incendie, offrait deux bras d’eau dont l’un était propice à une remontée aisée sur la berge, loin des regards. Les nageuses se révélèrent solidaires. Elles attirèrent l’attention des maîtres-nageurs et apportèrent ensuite serviettes et robes sur la rive afin d’éviter un retour remarqué. Se promener à l’extérieur de la plage en maillot de bain n’était guère apprécié. Quelle ivresse vécurent les deux jeunes filles ! L’interdit décuplait leur plaisir ; brasser l’eau, plonger en apnée, sentir l’autre proche, synchroniser leurs gestes, relevait d’une complicité magique.
Le tango n’avait pas passé le seuil de la Grand Maison. Cette danse avait pourtant connu ses lettres de noblesse à Buenos Aires et s’était exportée jusqu’aux salons mondains de Paris. Les grèves de mai, en la popularisant, avaient simplifié ses pas. Mais dans la belle demeure, on y préférait largement les danses du Pays d’origine, la Pologne. Les Arrière-grands-parents d’Adèle, spoliés de leurs biens, sous la tutelle russe, avaient fait partie de la Grande Émigration de novembre 1863. Dans les réceptions, la famille continuait à mettre à l’honneur la Polka et la Valse, parfois la Mazurka, d’autant que les deux branches familiales avaient les mêmes racines.
L’univers de Camilla était tout autre. Les Italiens, émigrés en Argentine, avaient rapporté le tango, fiers du métissage de danses populaires et de rythmes africains. À l’occasion, les paliers du petit immeuble d’exilés transalpins permettaient aux parents d’apprendre à danser à la jeune génération quand ils ne servaient pas de tribunes oratoires contre les violences des Chemises Noires de Mussolini. Le dimanche, c’était le jour attendu. Très souvent, les parents de Camilla se rendaient avec famille et amis au Moulin Brûlé où la jeune fille unissait ses pas à ceux de son père.
Les dimanches d’Adèle n’avaient pas le mérite d’être espérés. Dès le rite de la messe accompli, la famille de notables avait coutume de se réunir pour un long et copieux festin. À part la joie d’être assise près de son Grand-père, Adèle détestait ces temps ennuyeux où son oncle Louis se faisait le ténor de causeries mortelles. Léon enviait la place de la jeune fille : elle avait l’autorisation de vaquer à la promenade du lévrier Finaud. Quand ils étaient plus jeunes, son cousin Serge et elle accomplissaient ensemble ce rituel, mais avec les années, le jeune homme, comme son père, se vouait à des harangues politiques qui avaient toutes leurs places au dessert. Pour Léon, les discussions cocardières de Louis, son fils cadet, prenaient, avec les années, le goût d’un vin piqué. De manière obsessionnelle, il vilipendait les nouvelles mesures gouvernementales.
La phrase du Grand-père sonna la fin du combat. On ne remettait pas en cause la parole du Patriarche.
Cet aïeul avait eu pour ses petits-enfants toute l’indulgence dont il avait privé ses propres enfants. Son petit-fils Serge supportait de plus en plus mal les dérives qu’il mettait sur le compte de la sénilité qui guettait son Grand-père. Ces opinions-là étaient glanées sur les bancs des rouges de Maisons-Alfort. Il lui fallait prendre ses distances avec lui, éviter les contaminations de cette gauche écarlate de Karl Marx. Léon avait donc reporté son affection sur Adèle. Il adorait l’esprit fantaisiste de sa petite fille qui agrémentait sa vieillesse de notes fraîches. Elle était sa lumineuse astérie, l’aubier qui adoucissait son esprit si fatigué.
Loin de connaître les vicissitudes de son amie, Camilla gardait avec obstination l’idée d’apporter son carnet de chants et d’initier Adèle au Tango. Les deux jeunes filles avaient partagé si peu de confidences que chacune ignorait un peu le monde de l’autre. Une discussion sur la danse fut en quelque sorte la préface de leur histoire intime. Adèle apprendrait le tango et Camilla la polka.
Un soir, après la fermeture de la baignade, pour ne pas attiser les regards indiscrets, la jeune Italienne entonna El silencio, et les filles de la plage s’entraînèrent pour le dimanche suivant. Adèle écrivit une traduction des paroles de la chanson, ce qui ravit le cercle des nageuses. L’énigme de cette petite bourgeoise qui « n’avait rien à faire sur cette plage ouvrière » finit par se déliter. Le sphinx marnais qui veillait à l’entrée du domaine de ces amazones aquatiques la laissa pénétrer davantage dans leur groupe. Elles oublièrent cette fois le sobriquet de la Comtesse, qui, avec le temps s’accompagnait d’un sourire, pour choisir le surnom d’Ada la Belle. Elle était enfin adoptée !
Entre deux univers
Depuis quelque temps, Éléonore, la maman d’Adèle bourdonnait autour de sa fille.
Difficile d’ajouter un argument qui ne tombe pas dans la discrimination.
Ce fut donc Camilla qui connut, la première, le cadre de vie de son amie. Les quelques maisons bourgeoises, voire aristocratiques de Maisons-Alfort, étaient souvent l’objet de commentaires grinçants, et la Grande Maison n’était pas épargnée. « C’est sur l’échine de l’ouvrier qu’ils construisent leur château. » Mais un parc dissimulait le bâti aux regards envieux, une sorte de cocon végétal qui attisait la curiosité ou la décourageait. C’est donc par une allée fleurie de rosiers que Camilla pénétra chez son amie. Certes, elle avait gardé quelques images des jardins italiens propres à nourrir les rêves, mais là, les effluves s’imposèrent à tel point qu’elle se demanda si un parfumeur en avait conçu l’organisation. La jeune Italienne pensa à son père. Certes ce n’était pas les quatre marronniers de la cour de leur immeuble qui pouvaient rivaliser avec ce parc, d’autant que des fils tendus pliaient sous les cottes de travail. Giorgio avait été hostile à cette invitation : ouvrier, il était, rébarbatif au patronat et Il mondi de dire2, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Maria, sa femme sut trouver les mots : Adèle, qu’elle avait rencontrée, était una ragazza saggia 3, argument décisif pour un père italien.
Après un instant de recul, une léchouille du lévrier Finaud invita Camilla à le suivre et ses aboiements alertèrent Adèle. Elle accourut.
Camilla se fit un plaisir de faire plus ample connaissance avec ce sympathique canin longiligne à toison beige. Caresser le chien des hôtes permet de prendre un peu de distance avant de découvrir les maîtres. Lui aussi échappait aux profils des chiens ouvriers. Il était racé.
Puis elle aperçut une silhouette qui attendait sur le perron. Le rythme de son cœur s’accéléra. Elle ne nourrissait pourtant aucune admiration pour le haut du panier. L’indifférence la protégeait des propos contradictoires. Mais là, c’était la mère de son amie, elle désirait lui plaire. Et quand elle offrit un coffret de baci di dama,3préparés par sa Nonna5,ce fut un gage pour Éléonore qui apprécia sa bonne éducation.
Certes, elle préférait le jardin embaumé à l’immense salle à manger aux meubles de chêne foncé dont l’austérité lui semblait pesante. Elle serait plus à son aise, plus légère, plus sereine. Et ce fut le cas quand Éléonore posa la question habituelle.
Un « Ah ! » non identifiable fut l’unique réponse. Adèle fulminait.
Le goûter fut donc de bon ton et les jeunes filles prirent congé pour aller écouter quelques disques dans la chambre d’Adèle. Que de livres entassés sur les étagères, deux paysages peints, un bestiaire canin en porcelaine qu’Adèle appelait ses petits, tout un autre monde pour Camilla ! Mais c’est le décor d’une image pieuse qui étonna la jeune fille.
Camilla osa s’asseoir sur un fauteuil de velours rose, avec beaucoup de précautions. Elle aperçut un gramophone d’une très belle facture, comme elle en avait vu sur une publicité La voix de son maître.
Camilla contempla la pochette du disque où les costumes traditionnels n’étaient que broderies et rubans. Elle pensa aux fêtes de son Piémont natal qu’elle avait quitté si jeune.
Puis Adèle déposa un nouveau disque et proposa à son amie de lui apprendre la polka. Les pas rapides, les petits sauts répétés, ravirent Camilla et l’après-midi se termina par des éclats de rire qui animèrent la maison de la chambre à l’office. Que Camilla ait accepté d’apprendre les danses polonaises avait certes ravi Eléonore.
Quand Adèle fut à son tour invitée, le samedi suivant, ce fut dans un tout autre contexte. Une fête était organisée près de la plage de Charentonneau avec joutes nautiques et soirée festive. Aidée par sa fille, Maria écrivit une lettre aux parents d’Adèle pour dire à quel point ils se montreraient vigilants et responsables si Adèle leur était confiée. Jean ne fit pas d’objection à cette proposition, mais sa femme Éléonore, réticente, se lamenta sur les excès de cette amitié. Grand-père Léon réussit à la convaincre.
Ce fameux jour, Adèle attendait à la porte de la Grande Maison, impatiente, anxieuse. Comme dans l’eau de la Marne, elle désirait se fondre dans ce monde et choisit une robe fraîche en vichy bleu qui serait plus appropriée que ses robes de tulle blanche. Les parents de Camilla se présentèrent, c’était à cette seule condition qu’elle pourrait participer à cette sortie.
Les joutes de Joinville Le Pont séduisirent Adèle, d’autant que la foule se montrait participative. Rameurs et jouteurs étaient tour à tour encouragés ou vivement décriés.
Le soir, près de leur plage, des guirlandes d’ampoules les accueillirent. Quelle fête ! Une envolée de vélos arriva, chargés de paniers remplis comme des colis de Noël. Elle croqua pour la première fois dans les pains achetés au poids : saucisson, pâté de foie, jambon Olida et fromages fondus de la Vache qui participait à l’hilarité ambiante sans oublier le fameux camembert, à l’odeur très musclée. Certes, ce n’était pas l’univers aseptisé des plateaux d’argent sous cloches.
Camilla lui expliqua combien ces aliments avaient ravitaillé les ouvriers en grève, preuve de la grande solidarité. Ce fut la première fois qu’elles abordaient vraiment le sujet. Adèle lui répondit qu’étant étudiante à la Sorbonne, elle avait subi les manifestations universitaires hostiles au Front populaire, mais avait désapprouvé les séquestrations patronales.
Pour ne pas assombrir la soirée, Camilla enchaîna tout de suite sur le côté festif des grèves et ne cacha pas son entrain.
À l’heure de l’apéritif, Adèle goûta un verre de Suze diluée dans l’eau. Ce liquide couleur de miel, aux effluves de Gentiane qui abreuvait les gosiers de toute La France, était fabriqué dans l’usine toute proche. Ce fut sa seule petite entorse face aux promesses. Arriva l’heure des gourmandises sucrées, des tartes aux fruits des maraîchers qui alimentaient le marché de la ville, des cerises fraîchement cueillies dans quelques jardins ouvriers et des biscuits l’Alsacienne qui avaient pignon sur rue au centre de Maisons-Alfort. La ville respirait langues de Chat, boudoirs, petits exquis, madeleines… les gâteaux sortaient des fours, embaumant le cimetière proche pour accompagner le voyage des défunts.





























