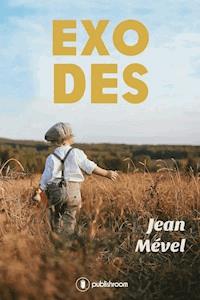
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Paris, 1941. D’origine juive, Samuel Richmann est envoyé en Bretagne et découvre la vie à la campagne.
Sa mère et sa sœur fuient la capitale un peu plus tard grâce au réseau de la résistance. Son père et son frère, eux, sont emportés vers les camps de la mort.
La paix revenue, la traque des nazis est lancée à travers le monde. Chasse aux monstres que prend à cœur la famille Richmann, même si pour cela elle doit traverser des océans.
Dans cette fresque qui rassemble plusieurs générations, la gravité de la vie se mêle à l’insouciance de la jeunesse. Plusieurs portraits se croisent, témoins du temps passé, mais surtout, de l’histoire.
À travers une galerie de portraits, ce récit bouleversant nous plonge dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, depuis l'exode jusqu'à la chasse aux nazis.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Je peux vous dire que Jean Mével m’a ébloui par ce roman. Il a dû faire un travail colossal pour les recherches, les dates, les lieux…. Ce que j’ai surtout aimé de cet auteur, c’est qu’il ne baigne pas dans le sensationnalisme en nous décrivant les actes de barbarie qui se passaient dans les camps de concentration. Un très bon livre que tous les passionnés d’histoires devraient se procurer. - Céline, overblog
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean Mével a passé toute sa carrière dans les transports, à la conduite des trains. Au cours de ses loisirs, il a beaucoup voyagé et est allé à la rencontre d’autres peuples, de nouvelles cultures, qui ont influencé son propre épanouissement.
À la retraite, l'écriture occupe son temps libre et il publie un premier polar. Dans un genre différent,
Exodes est son deuxième roman, cette fois inspiré de l'Histoire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean Mével
EXODES
À ma famille et mes chers parents défunts.
À tous ces humains persécutés, torturés, assassinés, pour s’être opposés à la guerre : Mandela, Gandhi, Luther King, Allende, Jaurès, Moulin, et d’autres encore.
À tous ceux qui ont traqué les nazis après la guerre pour laver l’humanité des souillures qu’ils ont commises.
À mon cher village de Guimiliau que j’ai quitté pour faire grandir ma vie.
YFFIC
Un matin d’octobre 1942, un gendarme frappa à la fenêtre de la cuisine et apostropha ma mère :
« Si Yves est dans la maison dis-lui, Marianne, de sortir par la fenêtre du jardin et d’aller se cacher dans le bois. Je suis mandaté pour l’arrêter et le conduire aux autorités pour le service du travail obligatoire en Allemagne. »
Yves, c’était mon frère de douze ans mon aîné. Il se trouvait dans sa chambre et il déguerpit vite dans la nature. Le gendarme demanda à Marianne de signer un papier, affirmant que son fils était en déplacement et qu’elle ne l’avait pas vu depuis une semaine. Ce papier servirait de justificatif à la demande éventuelle de son supérieur. Cet officier de police et son second qui l’accompagnait étaient des résistants et exerçaient leur zèle pour contrarier leur adjudant de gendarmerie, enclin à obéir au gouvernement de Vichy et aux autorités allemandes. La veille, dans l’après-midi, un officier allemand dont l’accoutrement ressemblait fort à celui de la gestapo : des guêtres, un ciré noir et lisse lui tombant à mi-mollets, était déjà venu chez nous. J’étais là et il demanda à ma mère dans un français approximatif, tout en me regardant :
« Vous, madame, autre enfant ? »
Je sentis bien que ma mère avait très peur. Jamais je ne l’avais vue dans un tel état au point que je ressentis aussi une forte angoisse. Elle avait sans doute bredouillé quelques mots entre ses lèvres, mi-breton, mi-français, pour rendre sa réponse inaudible. L’officier s’en alla mais sans doute ne fut-il pas dupe. Peut-être donna-t-il à l’administration française l’ordre de revenir à la charge ?
Yves ou Yffic, diminutif breton le plus souvent employé, aidait mon père au moulin dans la confection de diverses moutures pour le bétail. La situation devenant de plus en plus dangereuse, il s’informa sur le maquis le plus proche et le rejoignit avec son vieux vélo, dans les Monts d’Arrée, situés à une quinzaine de kilomètres de notre domicile. Le chef du maquis l’accueillit chaleureusement en s’exclamant :
« On n’est jamais trop nombreux pour combattre l’ennemi. Bienvenue à toi et bonjour jeune homme ! Comment t’appelles-tu ? Quel âge as-tu et d’où tu viens ? »
–Mon prénom c’est Yffic et mon nom c’est Sorel, j’ai 17 ans et j’habite à Guimiliau.
–Ah, ma grand-mère aussi était de ton village, elle s’est mariée avec un gars de Berrien et est venue y habiter. Son nom de jeune fille c’était Soazic Calvèz. Tu es trop jeune pour l’avoir connue mais maintenant nous n’avons plus de famille dans ton village. Moi je m’appelle Lucien, j’ai 25 ans et je suis le chef de ce maquis. Il faut que tu saches qu’ici tout le monde se tutoie et on s’appelle par nos prénoms. S’il y avait d’autres Yffic ils s’appelleraient Yffic un, Yffic deux etc. ou bien on te donnerait un autre prénom. C’est une affaire de sécurité pour qu’il n’y ait jamais de relations possibles avec les familles à l’extérieur du maquis. On n’a pas à savoir le fils de qui tu es, car tes parents pourraient être harcelés ou recevoir des lettres anonymes. Au fait, pourquoi nous as-tu rejoints ?
–Lucien, les gendarmes et les Allemands recherchent tous les jeunes pour aller au service du travail obligatoire en Allemagne et je le refuse, car je n’ai pas envie de fabriquer des bombes pour nous tuer.
« Normalement je suis trop jeune, mais comme ils manquent de bras j’ai appris qu’ils prenaient même les adolescents. Les gendarmes sont venus il y a deux jours me chercher à la maison, mais au lieu d’obéir aux ordres ils ont prévenu ma mère qu’il fallait que je m’échappe dans la nature. Eux, ils étaient des résistants et des amis de mon père. La veille, c’était un officier de la Gestapo qui était venu s’informer pour savoir si j’existais et ma mère a eu très peur. Cela ne pouvait plus durer et j’ai donc décidé à mon âge d’entrer dans la résistance. »
–C’est bien, Yffic, c’est un bon sentiment. Ce soir je ferai avec toi “la tournée avancée du crépuscule”. C’est comme ça qu’on l’appelle. On va jusqu’aux abords de la ville de Huelgoat pour constater que l’ennemi ne prépare pas d’offensives contre nous. On reste juste à la limite des sentiers que nous avons minés et nous vérifions s’il n’y a pas eu d’opérations de déminage. Dans notre espace de vie, il y a deux quarts de quatre heures de garde de nuit à faire autour du camp. Pour chaque quart il y a trois équipes de deux personnes qui se relaient et vous avez tous une arme et un sifflet. Tous les jours il y a un mot de passe différent. Il doit rester secret. Il est connu de chacun à 22 heures tous les soirs et reste valide jusqu’au lendemain, même heure. Si de nuit tu entends un bruit quelconque tu demandes le mot de passe. Pas de réponse, c’est une sommation et un tir. Le sifflet sert aussitôt après pour ameuter les copains. Le jour c’est un peu différent. Tu vois le gars, et s’il n’a pas le mot de passe tu lui demandes pourquoi il vient là. Si c’est pour rentrer dans le maquis on le prend en compte de suite. On ne rentre jamais ici la nuit à moins d’être poursuivi par l’ennemi. Avant de partir en service, chacun a le droit à une lampée de gnôle. Cela donne le moral et aide à garder le corps chaud ! Ce soir tu liras aussi le cahier des consignes qui dit tout ce qu’il faut faire, et surtout ce qu’il ne faut pas faire. Quand on est ensemble on peut s’éclater, rire, parler de tout, chahuter, confronter nos idées ; j’ai même vu deux hommes se détester car l’un était l’amant de la femme de l’autre. Ils ne se serraient pas la main mais on a réussi à les réconcilier pour la bonne cause. En perm, en dehors du maquis c’est le secret, pas un mot ne doit filtrer et encore moins trahir, car alors c’est la pendaison pour le fautif. Tu verras, jeune homme, en quelques mois ton cerveau aura fait un bond, tu seras devenu un homme responsable. Tiens compte toujours de ce proverbe : il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. As-tu des questions ?
–Je n’ai pas vu de femmes dans le camp.
–C’est déjà difficile entre hommes ! Mais les perms servent à ça, à retrouver l’épouse ou la fiancée. Et toi, ta belle elle t’attend ?
–Pour l’instant elle est encore dans mes rêves, répondit Yffic.
–Les femmes sont surtout utilisées à l’extérieur pour nous annoncer la position des boches et leurs mouvements inhabituels. Elles passent plus facilement les barrages car elles savent séduire mieux que nous. Par exemple une femme à bicyclette avec un bébé dans un couffin sur son porte-bagages est passée facilement en déclarant qu’elle allait chez la nounou avec sa fille. Elle avait dans son corsage un tas d’informations pour le maquis. Une autre traînait sa vache avec une corde prétextant qu’elle l’amenait voir le taureau dans la ferme d’à côté. Les soldats qui étaient là, goguenards, se mirent à rire en disant sans doute quelques insanités en langue allemande. Cette fermière improvisée avait sur elle un plan pour nous, afin de faire dérailler un train de marchandises dans la nuit suivante. Tu vois, les femmes ne restent pas inactives.
–Tu sais, Lucien, qu’un bruit court qu’une belle femme très connue à Landivisiau est la maîtresse d’un officier allemand haut gradé. On la voit partout avec lui et la garce ne se cache pas pour le bécoter en public. Il faudrait peut-être faire un coup là-bas pour la supprimer.
–Écoute-moi bien Yffic, cette femme est en service commandé. C’est notre agent et elle prend de très grands risques. C’est une personne admirable et courageuse. Elle joue un rôle et son amant est très amoureux d’elle ce qui lui permet d’obtenir une foule de renseignements efficaces pour la résistance. Elle parle assez bien l’allemand et elle n’a qu’à écouter discrètement. Elle a réussi à avoir la confiance de tout l’État-Major, car la plupart des sous-officiers n’espèrent qu’une promotion ou un repos supplémentaire de leur grand patron, alors ils ne font rien pour espionner leur chef dans sa liaison avec cette fille. Récemment, elle nous a fait parvenir à temps un message nous avisant qu’un commando allemand allait s’attaquer au maquis de Plouaret. Une dénonciation avait permis aux Allemands de dénicher le lieu. Les maquisards se sont vite éparpillés et ils n’ont rien trouvé en arrivant, ni armes, ni résistants. Elle a sûrement sauvé des vies. Tu vois, il ne faut jamais parler trop vite et critiquer sans savoir. Par contre, à la fin de la guerre, il faudra vite la protéger et expliquer son rôle dans la résistance pour lui éviter le rasage de ses cheveux, comme c’est le sort de toutes les femmes qui auront flirté sans raison avec les boches. En temps de guerre l’amour doit se donner des frontières.
–Ok. Tu as raison Lucien. J’en tire la leçon. Que fait-on ici pour s’occuper ?
–On est aux ordres de Londres. Il faut aller écouter la BBC au camp de Plounéour-Ménez, aux heures d’informations, car ici à l’orée de la forêt on capte très mal. On doit aussi aider aux parachutages de nuit en éclairant le champ par des torches ou des feux. On reçoit souvent de la nourriture et parfois des armes. Tu verras tu seras bien utilisé ! Il y a quelques jours, par la BBC, on a appris la grande rafle des juifs qui s’est produite à Paris. C’était horrible.
« On est encore au début de la guerre mondiale. On ne sait pas quand elle se terminera, mais en ce moment les Allemands se battent aussi sur le front russe et ils ont beaucoup de mal à supporter le froid et la neige. En Angleterre il y a des rumeurs pour un débarquement en Normandie ou ailleurs. En Afrique ça bouge aussi. On aura sûrement des opérations de sabotage à faire sur les trains et sur les installations allemandes dans les mois à venir. De quoi nous occuper si la guerre devait encore durer longtemps. »
–L’année dernière, annonça Yffic, juste avant la rentrée scolaire de 1941 on a reçu chez nous Samuel qui venait de Paris. C’est l’instituteur Monsieur Lamanda qui l’a fait venir. Il a à peine sept ans et doit déjà quitter ses racines ! Oui Yffic, on connaît bien l’instituteur. Il est des nôtres. Le gamin a été renommé François car Samuel étant de consonance juive, il fallait lui trouver un autre nom et prénom pour garantir sa sécurité parce qu’il y a beaucoup d’antisémites capables de le dénoncer aux Allemands. J’espère que ses parents ont échappé à la rafle. Ici on est en province, mais à Paris ce doit être terrible.
–En effet… »
La famille Richmann
L’année 1942 bien entamée, l’été s’était installé dans une France dominée par la peur, par la guerre et par l’occupation allemande. Dans la capitale, les communautés juives subissaient des contraintes par le port d’une étoile jaune cousue sur leurs vêtements, ce qui générait des interrogations alarmantes. Elles continuaient pourtant à espérer une protection suffisante, à l’abri de ces hostilités intervenues en Allemagne en 1938, lors de cette terrible nuit de cristal quand les nazis s’étaient attaqués à leurs biens, brisant leurs commerces et leurs échoppes. La haine s’était déjà enracinée, mais en France, dans le pays des droits de l’homme, de tels actes ne leur semblaient pas envisageables. Et puis d’autres personnes, non juives, avaient cousu cette étoile sur leurs vestons pour exprimer leur réprobation contre cette humiliante obligation faite à une catégorie de la population. Ce soutien rassurait la communauté juive et personne n’imaginait le pire qui allait pourtant s’inviter dans un proche avenir.
Depuis 1940 la vie devenait de plus en plus exécrable pour la population et les exactions touchaient surtout les juifs et leurs biens. Des attentats contre les synagogues dans de nombreux quartiers et des affichages humiliants sur les murs, dénotaient une ambiance propice aux inquiétudes et à la peur. La croix gammée flottait sur tous les édifices. Certaines presses antisémites voyaient le jour et étalaient à la Une leurs éditoriaux haineux. La radio nationale continuait à diffuser en français, sous surveillance allemande, mais la censure s’appliquait souvent. La pénurie et le rationnement étaient le quotidien des Parisiens et le marché noir se développait partout. Par contre, la vie culturelle continuait à s’exprimer. Les cabarets prospéraient, là où se produisaient des chanteurs et de multiples artistes en recherche de notoriété. La consigne de l’occupant consistait à encourager ces festivités pour atténuer l’ennui des soldats d’occupation. Pourtant des artistes de renom avaient déjà quitté la France pour ne pas avoir à collaborer avec l’ennemi.
C’était donc dans ce contexte particulier qu’en plein Paris, dans le quartier du Sentier, rue Bachaumont, vivait la famille Richmann et leurs trois enfants, Samuel, l’aîné, qui aurait bientôt sept ans, la cadette Chiranne, cinq ans, et le dernier garçon, Âmir, trois ans. Ils étaient heureux. Lui, le père, âgé de trente-deux ans se prénommait David et possédait une petite joaillerie et un rayon de textiles dans le quartier. Sa femme, Aliza, âgée de trente ans était couturière, petite main confectionnant parfois des robes de gala, pour les jeunes filles de bonne famille s’apprêtant pour le bal des débutantes à Versailles. La broderie occupait aussi ses loisirs. Une vie sans problème qui donnait à leur existence assez d’aisance et de lumière pour envisager les jours avec sérénité. Pourtant, le bruit des bottes résonnait sur le macadam et leur écho, jour et nuit, ne tempérait pas l’inquiétude qui s’était déjà emparée de la ville.
Aliza avait déjà vécu une aventure sentimentale en épousant, à l’âge de dix-neuf ans, un homme âgé de trente-deux ans. Il s’appelait Armand Ronnet et exerçait sa profession dans la gestion des fortunes de rentiers parisiens. Le coup de foudre ne dura guère et après deux ans de vie commune ils se séparèrent. Elle se souvenait à peine que cet homme, d’une autre confession, avait un garçon de douze ans d’un premier lit et qu’il se prénommait Hervé. Par ce mariage Aliza s’était coupée de sa communauté religieuse et cela l’avait beaucoup peinée. Quelle autre solution avait-elle dès lors que son amour aveugle dépassait les valeurs attachées à la religion ? Ses parents n’avaient pas approuvé ce mariage car leur fille n’avait pas attendu sa majorité passant outre leur avis. Il n’y eut pas de cérémonies fastueuses comme savaient si bien les organiser les communautés juives.
Très vite, elle s’aperçut que son mari attendait d’elle autre chose qu’une vie de femme dévouée à la réussite du couple. Elle se sentit comme en représentation, sa jeunesse et sa svelte apparence étant des alibis de succès pour son mari qui côtoyait les beaux salons du 16e arrondissement de Paris. Elle était le pot de fleurs posé là, avec la consigne de paraître, de sourire, et surtout de se taire. Elle se sentait comme dans une galerie où de riches mondains l’admiraient en flattant son époux d’avoir la plus belle femme du monde. Pour elle c’était de l’humiliation. Cette vie n’allait pas tarder à lui déplaire et la détacha rapidement d’une situation qui devenait insoutenable, même si financièrement son mari lui laissait toute autonomie. Derrière cette façade elle verrait se pointer, tôt ou tard, les contours d’une prostitution de salon dont elle serait la victime mise devant le fait accompli. Peut-être aurait-elle à subir un jour, contre son gré, les caresses de ces bourgeois ventrus qui paradaient dans la sphère de son mari, prêts à payer cher pour assouvir leur plaisir charnel. Il était temps qu’elle ouvre les yeux pour s’extirper de ce piège où elle s’enfermait sans pouvoir maîtriser librement sa volonté. Elle divorça rapidement.
C’est à vingt et un an qu’elle rencontra David, l’homme de confession juive qui deviendrait bientôt son nouveau mari. Elle retrouverait ainsi sa religion d’origine et la communauté qui la représentait. Elle avait déjà connu David à la petite école, mais à cet âge elle jouait encore à la poupée, et lui était indifférent aux belles jupettes. Par ce mariage le premier revers de sa vie fut vite oublié, elle retrouvait un autre style d’existence qui correspondait mieux à son équilibre et à ses valeurs culturelles. De même ses rapports avec ses parents retrouvaient leurs habitudes naturelles. Trois enfants naîtraient de leur union, apportant de la lumière à leur vie et une grande espérance en l’avenir. Son nouvel époux, croyant, officiait dans la proche synagogue où il exerçait des responsabilités dans l’organisation des évènements qui s’y déroulaient. Cette fonction s’adaptait bien avec son travail de joaillier dans une petite échoppe du quartier. Une vie paisible cadencée par des horaires qui convenaient à une vie familiale sans histoire.
En France, depuis plus de deux ans maintenant, les autorités obéissaient à l’ennemi, celui-ci trouvant des collaborateurs pour seconder la gestapo, cette unité allemande aguerrie aux pires violences. Dans l’ombre, la résistance à l’ennemi se préparait guidée par les informations qui parvenaient de Londres. Les premiers sabotages sur les lignes SNCF et contre des entrepôts allemands intervenaient au prix de sacrifices d’otages. Cette sorte de guérilla urbaine faisait monter d’un cran la violence et les conséquences qui en découlaient. De quoi demain serait-il fait ? Depuis 1941 des rafles de juifs se faisaient déjà discrètement par les Allemands avec l’aide d’une administration collaboratrice. Les prisonniers étaient parqués à Pithiviers dans la grande ceinture de Paris.
Samuel en Bretagne
David, de plus en plus inquiet, avait pris la décision d’amener son fils aîné, âgé de six ans et demi, en Bretagne, dès la rentrée scolaire de 1941. Il le confia d’abord à son beau-frère Victor, cheminot à Trappes, dont les origines étaient bretonnes. Celui-ci prit contact avec un ami mécanicien qui conduisait un train de nuit de Paris à Brest. Il accepta de prendre en charge le jeune garçon avec la complicité du contrôleur. Au terminus, un autre relais prendrait le gamin en charge pour le conduire à sa nouvelle résidence où une famille était prête à l’accueillir. Certes, il y avait un petit risque dans le train en cas de perquisitions inopinées de soldats allemands, mais le contrôleur connaissait bien un lieu où une cachette pouvait être aménagée rapidement, dans une double cloison invisible à un œil non averti.
Samuel arriva un beau matin dans un lieu-dit perdu, à un kilomètre du centre d’une petite bourgade d’un millier d’habitants. Il était triste et s’interrogeait de savoir pourquoi il débarquait dans ce trou perdu, si loin de l’animation de la ville. « Suis-je puni d’avoir fait du mal à quelqu’un ? » pensait-il en silence.Quand il rentra dans la maison au plafond bas, avec des poutres couvertes de suie, il eut un mouvement de recul. L’endroit était sombre, mal éclairé par deux fenêtres minuscules. Deux ampoules accrochées au plafond fournissaient une lumière saccadée en vagues ondulantes. Le long du mur, un lit clos sculpté en bois vernis. On y accédait par un tabouret, d’abord sur un long banc fermé dans lequel se trouvait entreposée la literie de rechange. Il suffisait ensuite de se glisser lentement à l’intérieur de l’habitacle. C’était le lit de la grand-mère qui s’enfermait là en tirant la porte coulissante, la plongeant ainsi dans l’obscurité totale. En face, une cheminée assez large avec ses chenets prêts à recevoir la bûche, réchauffait la pièce à la demande. Sur la droite, près de la fenêtre, une grande table en chêne, entourée de bancs du même bois, occupait l’alcôve. Au sol, une terre battue durcie par la fréquence des pas laissait paraître quelques creux, comme si parfois une poule venait y quérir des miettes de pain tombées par terre, ou quelques autres matières à picorer. Découvrir ce lieu fut pour Samuel un choc, et peut-être eut-il à cet instant une vision de ce qu’était la pauvreté par rapport à sa vie parisienne pourtant modeste. Que pouvait-il ruminer dans sa petite caboche de titi parisien qui débarquait là, en ce sombre jour de 1941 ? Il ne dira rien car sa bonne éducation le lui interdisait, mais peut-être pensa-t-il un court instant vivre dans un royaume de « ploucs », tant le changement de décor était énorme ?
Un homme d’un certain âge et son épouse l’accueillirent. Le jeune garçon était timoré comme s’il sortait d’un mauvais rêve. Le maître de maison lui parlait tantôt en breton, tantôt dans un mauvais français. La femme prit le relais pour le rassurer dans une élocution plus compréhensible. Près d’eux, il y avait un gamin de quatre ans, leur dernier fils qu’on lui présenta, arrivé dix et douze ans après les aînés. Il n’avait pas l’air d’apprécier la présence de Samuel et il le faisait savoir en parlant en breton. Son père le gronda: « Tais-toi Marmouz ou je te mets au trou ! » (Sous-entendu la soue libérée par le cochon). Marianne, la mère de famille, attira Samuel à l’écart dans le salon et lui expliqua la situation en la truffant de mensonges :
« Ton papa t’a fait venir chez nous pour quelque temps car il doit se soigner bientôt dans un hôpital spécialisé. Il devra ensuite se reposer dans un sanatorium. On craint qu’il ait contracté la tuberculose qui est une maladie souvent contagieuse. Alors il a préféré te mettre à l’abri ici. La tuberculose se guérit très bien tu sais, mais il faut du temps pour éviter la rechute. »
Samuel se sentit rassuré et il était fier de constater que des adultes prenaient soin de lui.
« Dans un mois ce sera la rentrée scolaire à l’école publique du village. Les filles iront toutes à l’école catholique à l’autre extrémité du bourg », ajouta Marianne.
Samuel intervint : « À Paris les filles et les garçons sont dans la même école. Ma sœur et moi on y allait tous les jours en se tenant la main. » Prise de court Marianne lui répondit :
« Oui, mais à Paris il n’y a plus beaucoup de terrains pour construire des écoles ! Il faut que je te dise Samuel, tu vas devoir changer de nom et de prénom tout le temps que tu seras chez nous. Tu vas porter une identité qui ressemble à celle des gens de notre région. Ton nom sera Jaouen et ton prénom François. Ainsi les autres écoliers ne te poseront pas de questions. Tu sais, si l’on fait cela c’est pour ton bien. Si des copains te demandent d’où tu viens tu leur répondras que ton père est gravement malade à Paris et que tonton Baptiste du moulin a accepté de t’héberger pour quelque temps. »
Il faisait la moue car cette réponse ne le satisfaisait pas. Pourquoi changer de nom ? Il avait le droit de savoir, pensait-il, du haut de sa petite personne. Voudrait-on le débaptiser de son identité parce que la sienne ne plaisait pas aux personnes de la région ? Ou bien voudrait-on à jamais le séparer de ses parents ? Autant de questions qui se bousculaient dans sa tête après une nuit éreintante passée dans le train.
Ce temps fut interminable car le train s’arrêtait souvent et longtemps dans les grandes gares. Il y avait des bruits de voix sur les quais, entremêlés du souffle ralenti des échappements de la locomotive qui crachait sa fumée noire sous les abris aménagés. À chaque arrêt prolongé il était caché dans un endroit très étroit et devait éviter de tousser. Enfin, pour gâcher le tout et accentuer encore la tristesse des lieux, la pluie redoubla de violence au petit matin à l’arrivée du train à Brest. Des rafales de vent s’engouffraient entre de vieilles tôles déposées là contre un mur, faisant un vacarme épouvantable digne d’un film d’horreur. C’était tel un vent froid pénétrant dans les coursives d’un château hanté en y faisant claquer les volets entrouverts des fenêtres. Samuel se sentait très fragile et angoissé dans ce décor apocalyptique. Il ne comprenait pas non plus pourquoi ses accompagnateurs, le contrôleur et le mécanicien, le firent descendre à contre-voie sur le ballast. Il attendit là un bon quart d’heure sous la pluie, à demi caché sous une voiture. Les soldats allemands étaient dans le hall de la gare, sans doute aussi la gestapo en civil et ils inspectaient les voyageurs peu nombreux à l’arrivée. Samuel par son accoutrement de citadin aurait certainement attiré l’attention. Une demi-heure après l’arrivée le contrôleur et l’enfant longèrent la rame sur le ballast. M. Lamanda, l’instituteur du village où il devait se rendre, approcha rapidement sa vieille voiture près de la sortie et l’enfant s’y engouffra très vite. Désormais il restait une soixantaine de kilomètres à faire en utilisant l’itinéraire le moins surveillé que les résistants avaient préalablement indiqué au conducteur.
Marianne, ayant compris qu’elle ne l’avait pas convaincu sur sa présence en Bretagne, fit appel à M. Lamanda qui vint le rencontrer à la maison. Dans quelques jours Samuel, devenu François, prendrait le chemin de l’école et de rencontrer en personne son futur maître, c’était à ses yeux lui faire le plus grand honneur ; lui donner une importance qu’il n’osait même pas imaginer. Cette rencontre fortifia son besoin de reconnaissance et facilitera beaucoup son intégration future à l’école.
Cette première rentrée scolaire en province le troubla un peu. Il débarquait dans un univers tellement différent du sien qu’il inquiéta quelque peu les autres élèves du même âge, habitués à se retrouver à chaque rentrée.
Qui était donc celui-là d’une demi-tête plus grand que tout le monde qui venait perturber des habitudes bien rodées ? Le caïd de la bande s’approcha de lui en essayant de le toiser bien qu’atteignant à peine son épaule. C’était un gars du cru qui portait pourtant un nom étranger à la région. Il s’appelait Alex Mathurin. Son père était originaire du centre de la France, mais sa mère était une fille du village, d’une famille bien connue de tous depuis plusieurs générations.
« D’où tu viens toi et comment tu t’appelles ! lui demanda Alex d’un ton autoritaire pour mieux asseoir sa place de leader.
–Je m’appelle François Jaouen et mon père travaille à Paris. Il est malade et doit se soigner pendant longtemps encore, alors tonton Baptiste du moulin va m’héberger jusqu’à sa guérison.Ah, s’exclame Alex, tu vas chanter « meunier tu dors ton moulin va trop vite »… mais n’oublie pas d’être à l’heure à l’école ! »
Il se mit à rire comme s’il avait trouvé un bon mot. Et tous les autres rirent aussi par habitude.
François ne rit pas. Il sourit à peine comme s’il avait décelé en quelques bribes le niveau d’humour de son auditoire. Au fil des jours, conservant de la prestance dans son attitude, il observait les comportements des autres vis-à-vis de sa personne et semblait s’en désintéresser. Son esprit était ailleurs. Cela gênait beaucoup Alex et ses suiveurs car il n’y a rien de plus vexant que de rester insensible à tous les regards, à toutes les réflexions, cela déstabilisait le petit caïd car François n’obéissait pas à ses prévisions. Alex choisit alors un autre stratagème en parlant breton avec quelques copains tout en le dévisageant. Mais rien n’y fit : François restait de marbre, impassible, imperturbable. En plus, dans la cour de l’école, il ne s’intéressait qu’au plus timide de la bande, souvent rejeté : Hector, appelé Totor ou Toto par les autres pour se moquer.
De voir François s’intéresser à ce minable ça leur hérissait la peau. Pour Alex, François était trop grand pour qu’il lui cherche la bagarre et s’il perdait il serait récusé par tous, humilié. En plus, dès la rentrée l’instituteur avait demandé à tous de respecter François qui était le seul nouvel élève dans la classe moyenne. De semaine en semaine le climat se stabilisait mais un garçon s’épanouissait : c’était le timide Hector apprenant beaucoup de son nouveau copain qui connaissait tant de choses que tous les autres ignoraient, du fait de leur immersion dans la banalité d’une vie rurale ne se renouvelant pas. Hector le timide, le-laissé-pour-compte, abandonné dans son coin, appréciait quand François lui racontait sa vie parisienne en lui révélant tous les monuments et les lieux qu’il avait visités : l’Arc de triomphe, la tour Eiffel, les Champs-Elysées, le parc des princes, temple sportif de la capitale etc. et bien d’autres choses encore. Il faisait rêver Hector qui ne se gênait plus de raconter, à qui voulait l’entendre, que François était un savant tant il le subjuguait par ses connaissances. Peu à peu, d’autres garçons du groupe se rapprochèrent par curiosité d’abord, puis par intérêt, de François, et même Alex le caïd jeta l’éponge en rangeant son amertume aux oubliettes de sa vanité naissante. Chaque écolier voulait désormais être le copain privilégié de ce nouvel élève qui par sa taille dégageait en plus de la sérénité et jouait un rôle protecteur.
De son côté, l’instituteur, actif dans la clandestinité, connaissait bien la situation du jeune garçon et il veillait que tout se passe au mieux dans son établissement. Très attentif à l’évolution de la situation il se réjouissait de n’avoir jamais eu besoin d’intervenir.
Finalement, François faisait son chemin dans sa nouvelle vie, même si de temps à autre lui revenaient en mémoire les larmes qu’il versa quand son père vint l’accompagner à la gare de Montparnasse, lorsqu’il agita son mouchoir par la vitre baissée pour lui dire au revoir.
Un soir, alors qu’il venait juste de rentrer de l’école et se trouvait encore sur la cour, arriva un cultivateur avec sa haute charrette étroite aux grandes roues cerclées de fer. Il amenait deux sacs de seigle pour les faire moudre au moulin. Il s’approcha de François et lui demanda :
« Comment t’appelles-tu petit ! D’où viens-tu ? Sam… pardon ! Je m’appelle François… François Jaouen, monsieur. J’habite Paris mais tonton Baptiste m’a pris dans sa maison car mon papa est malade. »
Il aura suffi d’un rien pour qu’il décline son prénom Samuel, mais il se reprit en bafouillant un peu.
Entre temps Baptiste arriva et la conversation se poursuivit en breton. Avec le plus grand naturel le meunier raconta une histoire déjà pré inventée :
« Son père souffre des poumons et il y a une crainte de tuberculose. Il est mieux ici. L’air est pur et les poumons respirent mieux. On l’a quand même conduit chez le docteur pour vérifier sa santé. Il est en très bonne forme. C’est l’instituteur qui l’a fait venir car c’est un ami de jeunesse de son père. Il nous a demandé de le garder car lui ne possède qu’une habitation de fonction mise à disposition par l’Éducation nationale. »
Certes, ce paysan était un homme de confiance et, si même il avait su la vérité, il n’avait aucune intention belliqueuse. Mais peut-être aurait-il pu dans le fil d’une conversation en parler plus tard à une tierce personne intéressée par une action de nuisance. On n’est jamais assez prudent par ces temps instables.
En avril 1942, pour les fêtes de Pâques, sa mère, Chiranne sa sœur et son petit frère Âmir, accompagnés de l’oncle Victor, de la tante Yanna de Trappes et de leur fille Lisa, viendraient le voir pendant quelques jours. C’était promis. Il aurait tant de choses à leur raconter. Seul le père serait absent car présumé être un grand malade. En attendant, le jeune garçon voyait s’épanouir le printemps naissant, la floraison des jonquilles sur les talus et les primevères tapissant les jardins en partageant l’espace avec les pâquerettes. Les arbres aussi s’habillaient de bourgeons puis se métamorphosaient d’une parure verdoyante. Il était à la fois admiratif et pensif devant cette nature qui renaissait et se révélait à ses yeux.
Bientôt, quand sa mère serait là, ils iraient tous ensemble à la mer, à trente kilomètres, avec le vieux fourgon que tonton Baptiste avait bricolé pour ses besoins quotidiens. Voir la mer pour la première fois ! Voilà le rêve qui hantait déjà son sommeil de chaque soir. Sa mère Aliza était décidée à lui dire toute la vérité sur sa présence en Bretagne. Mais quand elle fut là, enfin, elle retarda de jour en jour l’échéance, laissant toujours l’instant à la joie d’être ensemble. Comment évoquer la maladie supposée de son père devant sa sœur et son frère qui n’en n’avaient pas connaissance ? C’était un imbroglio impossible à clarifier sans risquer de compliquer les choses. Mentir, toujours mentir, ne ferait qu’amplifier une situation opaque qui générerait des contradictions malsaines et suspicieuses. Le séjour s’écoula et le statu quo demeura sans qu’elle ait eu le courage d’expliquer à son fils l’atmosphère dramatique qui se profilait dans Paris.
Quand toute sa famille repartit Samuel pleura beaucoup. Pendant huit jours il avait retrouvé son prénom d’origine pour ne pas heurter l’attention de son frère, de sa sœur et de Lisa qui ignoraient tout de ce changement. Pendant ses vacances, en partie au moulin, en partie au bord de la mer, il avait peu de chance de rencontrer un copain qui d’instinct l’appellerait François. Sa mère l’avait tiré à l’écart pour lui expliquer les raisons de cette manipulation. Il serait donc attentif s’il voyait un copain. Il irait vers lui à distance pour que personne ne l’entende prononcer son prénom. Que ne fallait-il pas faire pour simuler cette tricherie, pensait Samuel au fond de lui-même ! Si un seul camarade avait un doute sur son prénom et en parlait, nul n’imaginait l’ampleur que prendrait cette histoire, pourtant bénigne, soudain jetée en pâture dans le concert des bavardages d’adultes.
Pourtant l’incident se produisit. Totor, son copain d’école un peu rejeté par les autres, vint au moulin à l’improviste et se trouva en présence de la famille Richmann. Il appela François par son prénom d’emprunt. Celui-ci s’éloigna vite à distance pour jouer avec son ami Totor. Au retour Chiranne entreprit son frère :
« Pourquoi ton copain t’a appelé François ? »
Pendant son absence Samuel avait imaginé une réponse si un membre de sa famille lui posait une question à ce propos.
« À l’école nous faisons des courses à pied autour de la cour et nous empruntons les noms des coureurs cyclistes d’avant-guerre. Avec une épingle on attache le nom du favori que l’on a choisi sur notre poitrine. Dans la liste moi j’ai pris François Faver, un coureur qui a gagné le Tour de France dans les années 1920. Donc parfois les copains m’appellent François, surtout ceux qui sont passionnés par ce jeu. »
Sa réponse satisfaisait Chiranne et la bourde involontaire de Totor n’eut pas de conséquence.
Dès le départ de toute sa famille Samuel reprit très vite son prénom d’emprunt pour ne pas laisser revenir le naturel au galop.
Depuis le printemps 1942 les juifs en France devaient porter l’étoile jaune, y compris les enfants dès l’âge de six ans. Hors de question d’appliquer la loi à Samuel. Une raison de plus pour que son identité réelle ne soit pas divulguée. Monsieur Lamanda et sa mère quand elle vint le voir lui demandèrent même de tricher sur le métier de son père. À toute question dans ce sens il lui faudrait répondre que son papa travaillait aux usines Citroën, quai de Javel à Paris ; qu’il était aussi membre de l’association des Bretons du quartier. Le métier de joaillier s’exerçait davantage dans les milieux huppés et dans des concentrations humaines comme au quartier du Sentier à Paris, où demeuraient beaucoup de juifs. Tout était calculé dans le sens de la prudence extrême.
François Jaouen passa toutes les vacances de l’été 1942 à la campagne avec ses nouveaux copains. Il découvrit un nouvel univers : celui des animaux domestiques dans les prés, de la volaille grouillante en liberté dans la basse-cour et des lapins punis dans leurs clapiers. Il admirait aussi les hirondelles qui tournoyaient dans le ciel, le héron au long cou et au bec pointu qui s’approvisionnait dans la rivière poissonneuse, ou encore le martin-pêcheur se posant délicatement sur la poutre, au-dessus de la roue à aubes. Il entendait le hululement lugubre de la chouette à la tombée de la nuit ou le cri saccadé du coucou dont l’écho lui semblait très lointain, cadencé comme le tic-tac d’une horloge. Puis encore l’insupportable tourterelle qui ne cessait de roucouler dans le grand sapin.
Parfois, dans le ciel, de pesants nuages noirs, à peine à hauteur de clocher, semblaient s’y accrocher avant de déverser leurs eaux en abondance. De ce décor lugubre s’échappait le croassement d’un corbeau se dirigeant à tire-d’aile vers un horizon inconnu. C’était cet ensemble de plaisirs que lui révélait la campagne dont il découvrait l’immensité des nuances et des couleurs.
Il aimait aussi se lever très tôt pour voir, au chant du coq, la rosée matinale s’élever peu à peu dans le ciel, sous l’action chauffante d’un soleil naissant. C’était, comme un rideau de fenêtre que l’on écarterait lentement, en y découvrant le nouveau paysage d’une campagne épanouie et vivante. Pour lui, ces instants colleraient à sa peau pour l’éternité, et jamais à Paris il n’aurait pu admirer ces miracles de la nature.
L’été, les jours de grande chaleur, le chant du grillon au bord de son étroit terrier égayait la pelouse. Dès l’approche il rentrait dans son trou et se taisait. François avec un brin d’herbe lui chatouillait les narines, comme le lui avait montré Marmouz, et d’instinct il ressortait vite de son logement. Il le capturait afin d’en faire un appât pour la pêche, mais il le regrettait après coup car il rentrait toujours bredouille et aurait pu épargner la vie de ce grillon. Parfois encore, il découvrait une fourmilière au pied d’un talus et restait ébahi devant la dextérité de ces minuscules bestioles, portant sur leur dos des brindilles d’un poids supérieur à celui de leur propre corps. Sans le savoir il faisait de la science d’observation qui renforçait et consolidait ses connaissances scolaires. Mais surtout il se sentait envahi par des sentiments nouveaux, à la fois fragiles et généreux : le respect de la nature et de toutes les espèces qui se partageaient l’espace.
À l’école, le cours de science le hérissait et le duvet sur ses bras tendres se dressait parfois comme des épines. Quand le boucher du village en informait l’instituteur, celui-ci déléguait un élève pour récupérer des poumons, délicatement enveloppés dans du papier journal, pour un cours de science improvisé. La classe moyenne et les grands, des deux classes réunies, avaient le droit au même cours. Le maître disséquait la matière pour montrer les alvéoles des poumons et faire mieux comprendre le fonctionnement du système respiratoire. Une autre fois ce serait le fonctionnement du cœur ou encore les rouages osseux d’une articulation quelconque etc. Pour François, dont l’imagination était débordante de sensibilité, cette heure durait une éternité et d’autres élèves ressentaient aussi un mal être. Ces cours, hors programme scolaire, n’étaient pas réguliers ce qui atténuait l’appréhension qu’ils suscitaient chez les écoliers les plus allergiques. Hormis cela, tous les autres programmes étaient conformes à l’attente de tous. Seule la discipline du sport n’existait pas et c’était dommage, pensait François. De l’avis du maître les enfants se dépensaient assez pendant les récréations en faisant des courses de relais autour de la cour. Le vélo étant le sport en vogue dans la région, chaque élève qui participait à ces courses pédestres épinglait sur sa poitrine le nom d’un coureur connu parmi les géants de la route de l’avant-guerre dont les parents leur parlaient. Chaque jour les classements évoluaient et quelquefois l’infirmerie improvisée soignait les « bobos » consécutifs aux chutes qui se produisaient.
Certaines habitudes quotidiennes avaient aussi leurs revers. François ne supportait plus l’accoutumance à une nourriture presque chaque jour identique. C’était la fameuse bouillie d’avoine qui se consommait dans un grand chaudron disposé sur la table, accompagnée de la bolée de lait chaud de la vache Rosine. Avec sa cuillère chacun puisait sa part en creusant un trou dans la matière visqueuse. Cette bouillie était lourde et fade mais possédait, disait-on, des vertus fortifiantes pour les enfants. C’était aussi l’avoine du cheval et chacun savait combien cet animal était robuste. Pour inciter les enfants à manger les adultes organisaient une course entre tous pour savoir qui ferait le plus grand trou, c’est-à-dire consommerait le plus. Marmouz et François se prêtaient à ce jeu car en finalité, il y avait une récompense : le droit d’avoir deux ou trois morceaux de sucre ou encore des pommes du jardin que les gamins cachaient en des lieux précis en cas de petite faim. Parfois c’était le père, Baptiste, qui gagnait et il avait droit à une rasade de vin rouge. Les dés étaient relancés et l’habitude cassée. Il fallait faire vrai pour titiller l’esprit de revanche chez les gamins !
Et puis le matin il fallait absorber une cuillérée à café d’huile de foie de morue avant de partir à l’école. Elle était censée fortifier l’ossature corporelle par les vitamines qu’elle apportait. Pour avaler cette « liqueur » il fallait un moment de concentration et fermer les yeux en poussant la petite cuillère au fond de la gorge, afin d’atténuer le goût du liquide sur le palais. À l’approche de la saison grippale la maman de Marmouz avait d’étranges façons de conjurer le sort d’une maladie latente : elle confectionnait un collier avec des particules d’ail et les enfants devaient porter ce « trésor » autour du cou toute la nuit. L’odeur chassait les microbes disait-on ! Parfois, François s’exclamait, un peu grognon : « Mais où vont-ils donc chercher tout ça nos aînés !? » Simple remarque qui n’avait rien d’offensant.
Dans le quartier du Sentier à Paris l’atmosphère était criarde alors qu’ici c’était la belle rengaine printanière des concerts d’oiseaux. François se plaisait beaucoup dans ce coin perdu et dès qu’il ferait chaud, disait-il, ses copains le convieraient à participer à la chasse aux vipères, cet exercice que les gamins aimaient réaliser pour vaincre leur peur et se mesurer ainsi au courage reconnu aux adultes. Pour François ce serait dramatique de tuer ces reptiles qui avaient mauvaise presse dans les campagnes, car leurs morsures pouvaient être mortelles par grandes chaleurs. Il serait donc observateur s’appliquant à admirer la dextérité de ses petits camarades. Quant aux adultes ils se contentaient de recommandations de prudence pour ces jeunes souvent un peu trop téméraires.
D’autres jours, en petits groupes, ils cherchaient les nids d’oiseaux dans les bosquets et dans les ronces. Surtout les œufs de merles étaient dans le collimateur des chercheurs car ils étaient des mangeurs de cerises. Les adultes encourageaient les gamins à les dénicher et à collectionner les œufs. La pie non plus n’était pas épargnée mais parfois il fallait grimper très haut dans l’arbre. Les cuisses chauffaient et s’écorchaient au contact du tronc, et, à l’approche du nid, les pies jacassaient très fort au-dessus de la tête de l’enfant, défendant, bec et ongles leur nid. Marmouz, bien qu’âgé de cinq ans, était déjà très agile ; il se glissait dans tous les espaces confinés et n’avait peur de rien. C’était un dénicheur actif mais parfois les nids de pie étaient si hauts dans les arbres qu’ils devenaient inaccessibles. Cela signifiait aussi que l’été ne serait pas venteux. La pie avait le don, disait-on, d’anticiper l’avenir sur la connaissance météorologique. Par on ne sait quel mystère elle sondait l’atmosphère comme un être humain inspecterait le sol avant de construire sa maison. Cette année, pas d’œufs de pie, disait Marmouz, mais un bel été assuré ! Il parlait déjà comme un stratège, un grand expert qui maîtrisait la nature.
Pourtant Marmouz inquiétait un peu François. Il était toujours aussi peu bavard en français mais très loquace en breton. Il avait également remarqué qu’il ne fallait pas s’approcher de son chien blanc Boby, qu’il protégeait aussitôt, clamant quelques mots bien pesés pour exprimer son intolérance à vouloir partager le petit animal. Pourquoi l’appelait-on Marmouz alors que son véritable prénom était Jeannot ? François alla demander la réponse à tante Marianne. « Marmouz en breton, lui dit-elle, est le surnom que l’on donne à des garçons espiègles qui s’occupent de problèmes qui ne les regardent pas, réservés aux grandes personnes. C’est aussi un petit fripon affectif dépourvu de méchanceté. C’est encore la personnalité d’un enfant gâté, comme un fils unique à qui l’on cède tout. »
Pour Jeannot ce mot signifiait qu’on lui portait attention, ce qui flattait sa personnalité et sa précoce vanité.
François aida aussi à la fenaison, début juillet, et à la moisson en août. Il suivait la batteuse de ferme en ferme et se surprenait à écouter la machine qui avalait les gerbes déliées. Avec un adulte on l’autorisait à grimper sur la meule pour aider à la transmission des gerbes sur le grand tablier d’où elles seraient reprises et offertes dans la gueule de la machine. Tout était nouveau dans sa vie et il s’en réjouissait, oubliant la ville de ses premières années. En plus il recevait parfois un peu d’argent de poche qu’il mettait précieusement dans sa tirelire.
Cependant, une chose le troublait quand ses copains d’école lui demandaient pourquoi il ne participait jamais à l’office du dimanche à l’église. À Paris, disait-il, les églises n’étaient pas les mêmes, elles n’avaient pas des clochers pointus comme ici. Il n’employa pas le mot de synagogue car il ne l’avait plus en mémoire et il valait mieux qu’il en fût ainsi pour ne pas éveiller un éventuel soupçon sur sa confession. Tante Marianne lui expliqua qu’elle n’avait pas de convictions religieuses. Il était donc dispensé d’église et de catéchisme. Les rites des prières étaient très différents ici et l’on ne referait pas tout le programme pour un seul enfant. Il se contenta de cette explication.
Au moulin, comme Marmouz, il avait reçu des recommandations fermes : interdiction de franchir ce talus à l’orée du bois car le loup s’y trouvait souvent en attendant sa proie. Interdiction aussi de s’approcher de l’étang où, en eau trouble, nageaient souvent des vipères d’eau venimeuses. Pour les en dissuader Baptiste pêcha une anguille qu’il présenta comme une vipère à l’un et à l’autre. Attention danger ! Partout ailleurs ils étaient libres d’aller et venir à leur guise.
Un jour pourtant on frisa le drame au moulin. Arrivèrent haut perchés sur leurs vélos aux guidons surélevés les deux gendarmes en tournée. Chaque jour ils faisaient des circuits différents d’une trentaine de kilomètres pour surveiller l’environnement et sanctionner les actes verbalisables. Ils vivaient un peu au rythme lent du travail de la terre à la différence qu’à l’heure de l’Angélus, à 19 heures, ils étaient rentrés depuis longtemps à la gendarmerie. L’habitude les amenait à voir Baptiste au moulin pour trinquer avec lui une chopine de vin, d’un mauvais millésime par les temps qui couraient. Parfois il fallait se contenter du verre de cidre amer, issu des pommes galeuses du jardin.





























