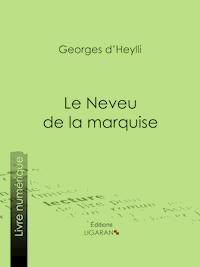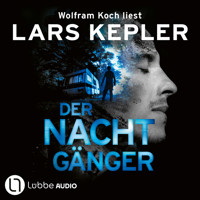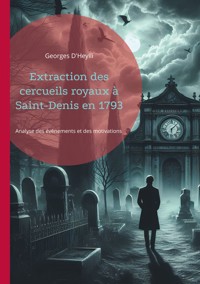
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
"Extraction des cercueils royaux à Saint-Denis en 1793" de Georges d'Heylli est un compte-rendu détaillé des événements dramatiques qui ont eu lieu lors de la profanation des tombes royales à l'abbaye de Saint-Denis pendant la Révolution française. Publié en 1851, cet ouvrage constitue une source précieuse pour comprendre les tensions politiques et les symboles du pouvoir qui ont marqué cette période tumultueuse. Georges d'Heylli, historien et journaliste, présente une analyse minutieuse de la décision révolutionnaire de déterrer les restes des rois et reines de France, un acte symbolique fort qui visait à affirmer le renversement de l'Ancien Régime et à effacer les traces de la monarchie. L'ouvrage décrit en détail les circonstances entourant cette décision, les conditions dans lesquelles les cercueils ont été extraits, ainsi que les réactions publiques et politiques. D'Heylli explore les raisons politiques et idéologiques derrière cet acte de profanation, soulignant comment il reflète les sentiments anti-monarchiques et les tensions entre les forces révolutionnaires et les vestiges de l'Ancien Régime. Il examine également l'impact de cet événement sur la mémoire collective et les symboles nationaux, ainsi que les implications pour la gestion des patrimoines historiques en période de révolution. L'ouvrage offre des descriptions vivantes des scènes macabres qui se sont déroulées, illustrant le choc et la consternation que cet acte a pu provoquer parmi les contemporains. En plus de la narration des faits, d'Heylli fournit des analyses critiques des motivations et des conséquences de l'extraction des cercueils, mettant en lumière les enjeux de pouvoir et les conflits idéologiques de l'époque. "Extraction des cercueils royaux à Saint-Denis en 1793" est un texte essentiel pour quiconque s'intéresse à l'histoire de la Révolution française, aux symboles de la monarchie et à la manière dont les événements révolutionnaires ont redéfini les valeurs nationales et culturelles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A MADAME RUE HOMMAGE DE RESPECTUEUSE AMITIÉ
GEORGES D’HEILLY.
Sommaire
AVANT-PROPOS - LE SAINT-DENIS DE M. VIOLLET- LEDUC
LES TOMBES ROYALES DE SAINT-DENIS
PREMIÈRE PARTIE - SAINT-DENIS AVANT LA REVOLUTION
EMPLACEMENT DES TOMBEAUX - AVANT 1793
DEUXIÈME PARTIE - PROFANATION DES TOMBES ET VIOLATION DES CERCUEILS ROYAUX
TROISIÈME PARTIE - SAINT-DENIS DEPUIS 1793 JUSQU’A NOS JOURS
APPENDICES
I - Trois épitaphes royales.
II - Le caveauroyal des Bourbons
III - Le caveau impérial
IV - Exhumation, faite en 1817, des restes enfouis en 1793 dans le cimetière des Valois
V - Rétablissement des sépultures royales à Saint-Denis, en 1817
VI - La moustache de Henri IV
VII - Discours de M. de Montalembert à la chambre des pairs au sujet de la restauration de Saint-Den
VIII - Objets précieux retirés des cercueils royaux en 1793
IX - Cérémonial des obsèques royales
X - Funérailles de Louis XVIII
XI - Extraits d’articles et de lettres de MM. Ad. Perreau et Viollet-Leduc sur le Saint-Denis actuel
XII - Légende des armes de l’abbaye de Saint-Denis
XIII - Emplacement actuel des tombeaux
AVANT-PROPOS
LE SAINT-DENIS DE M. VIOLLET-LEDUC
L E Saint-Denis de M. Viollet-Leduc — terminé — sera certainement le plus beau titre de gloire de ce savant et habile architecte Il ne faut point se dissimuler qu’il a entrepris la tâche la plus difficile, la plus délicate et en même temps la plus considérable qu’aucun architecte ou homme d’art de ce temps-ci ait tenté de mener à bonne fin. Rendre à nos yeux le Saint-Denis primitif, le Saint-Denis de Suger et de Saint-Louis, le Saint-Denis absolument complet, tel que l’avait trouvé la Révolution à la veille de la dévastation des caveaux où gisaient ensevelis les restes de la monarchie française, M. Viollet-Leduc n’a pas entrepris moins que cela ! Il s’est pris d’une belle et noble passion pour la basilique amoindrie, il a re-cueilli, partout où il a pu les retrouver, les richesses arrachées à ses murs et à ses tombes ; il a réuni et fouillé tous les documents, tous les plans, tous les livres qui pouvaient retracer à ses yeux et livrer à ses investigations les indices certains d’un passé si violemment disparu, et il s’est mis héroïquement à l’ouvrage avec des ressources relativement restreintes et qui n’ont pas toujours permis un travail sans interruption1.
Il ne s’agissait pas seulement de réédifier, de replacer les tombeaux où ils étaient, les colonnes où on les avait arrachées, les statues où on les avait brisées. Il fallait avant tout et surtout détruire les embellissements maladroits apportés par les gouvernements antérieurs, qui n’avaient point compris la restauration de l’église au même point de vue, et qui au contraire avaient voulu coûte que coûte et de n’importe quelle manière, en hâter le rétablissement et l’achèvement en poussant les travaux au point où M. Viollet-Leduc les à trouvés. C’est à cette soi-disant restauration que nous devons l’église royale de Saint-Denis, bien connue de tout le monde, et si souvent visitée pendant les règnes de Louis XVIII, de Charles X et de Louis-Philippe. Cette église admirable, dont le splendide vaisseau étonnait à bon droit nos pères par sa légèreté et son élévation, on avait haussé son sol de plus d’un mètre pour la rendre, disait-on, moins humide ; ses vitraux disparus, on les avait remplacés, sous le dernier règne, par cette longue série d’absurdes portraits de rois et d’abbés d’une ressemblance contestable et d’une médiocrité incontestée ; ses tombeaux enfin, on les avait placés tant bien que mal dans une crypte obscure, où ils n’avaient jamais été, et où l’humidité en même temps que l’indiscrétion des visiteurs auraient en peu d’années consommé leur complète détérioration. Nous les avons tous vus ces grands cénotaphes royaux, ces tombes magnifiques, ces bustes, ces statues, ces colonnes, tous rangés en lignes dans un ordre chronologique absolu, catalogués historiquement et souvent à faux ! Nous avons vu surtout introduits parmi eux des bustes et des statues de princes et de personnages qui n’avaient jamais été inhumés à Saint-Denis, et dont la présence au milieu de ces vénérables tombeaux était un mnsonge officiel qui trompait le public en dénaturant l’histoire.
Détruire et restaurer, tel a été le point de départ du travail immense entrepris par M. Viollet-Leduc. Allez voir aujourd’hui à Saint-Denis cette intelligente et magnifique restauration parvenue à un degré d’achèvement qui peut permettre de la juger déjà tout entière. Contemplez autour de vous et de toutes parts ces grands tombeaux échappés comme par miracle aux iconoclastes de 93, et rétablis dans leur place primitive. La voilà bien cette royale nécropole, brillante de sa nouvelle beauté, parée comme aux plus grands jours de sa glorieuse histoire ! Voyez dans le passé, comme dans un rêve, une de ces cérémonies funèbres dont l’une, encore présente à la mémoire des contemporains, — l’enterrement de Louis XVIII, — avait reproduit les moindres circonstances et les antiques détails ; suivez pas à pas le lugubre cortége depuis l’entrée de l’église jusqu’à la porte du caveau royal, à droite du grand autel ; debout devant l’ouverture béante où le roi mort va tomber dans l’éternité, voici les hérauts d’armes, tenant à la main le gantelet de fer, l’épée de combat et l’oriflamme de bataille, qu’ils vont jeter successivement sur le cercueil du roi, lequel attendra là, à l’entrée de la funèbre salle où ses aïeux royaux l’ont devancé, que son successeur, qui règne à peine encore, vienne le pousser à sa place, pour attendre à son tour qu’un autre lui rende un jour le même office ! 2
Je voyais tout cela dans un de ces derniers jours d’hiver où l’église, as-sez sombre, semblait remplie de fantômes blancs et noirs, et où ma pen-sée errait rêveuse au milieu de ses tombeaux. J’étais descendu aussi dans la crypte ; j’avais vu le caveau royal où dorment du sommeil éternel quelques-uns des membres bannis ou assassinés de la famille des Bourbons ; au travers du grillage, à la lueur vacillanie d’une chandelle fumeuse, j’avais aperçu le cercueil du dernier roi, qui avait attendu, lui aus-si, mais en vain, son successeur Charles X, oublié dans l’exil. Je voyais ce cercueil qu’on a replacé auprès de celui de Louis XVI pour édifier le ca-veau impérial, ce cercueil délabré dont le velours, usé et pourri, tombe en lambeaux dans l’humide et impénétrable refuge ; et je songeais qu’avant lui cinquante rois, cent princes, cent princesses et vingt reines étaient venus aussi dans la funèbre église pour y trouver le repos de la mort.... et que de tant de dynasties qui s’étaient crues immortelles, de tant de grandeurs illustres qui l’avaient précédé là même où je le voyais, il était le seul roi mort sur le trône qui fut alors à Saint-Denis, à côté des restes douteux de son frère guillotiné, de sa belle-sœur guillotinée, et en-touré des cercueils de ses tantes mortes en exil, de son neveu assassiné et de ses deux petits neveux morts au berceau !...
Aussi, en quittant la crypte, quand on remonte dans l’église haute, que le grand jour éclaire, et qu’il éclairera beaucoup plus encore et beaucoup mieux lorsque M. Viollet-Leduc aura rouvert toutes les baies magnifiques maladroitement replâtrées et rebouchées, on se sent moins impressionné. On n’a plus réellement la mort devant soi. Toutes ces tombes, qui ont abrité les corps mêmes de nos rois, sont vides au-jourd’hui et ne recouvrent plus rien que le sol. On admire ces monuments magnifiques illuminés par le soleil ; mais on se promène au milieu d’eux sans émotions et presque sans souvenir. Toute cette foule de visiteurs empressés sait bien qu’elle n’est point dans un sépulcre, que ces tombes sont vides, que la plupart même sont refaites, et que les cendres de Dagobert, aussi bien que celles de Henri II, ont été dispersées au vent et leurs corps brûlés dans de la chaux.
Le vice irremédiable de cette magnifique restauration est là tout entier ; l’église royale n’est plus une église, ni une nécropole, ni un lieu de tristesse et d’impression pour l’immense majorité du public indifférent qui la visite : c’est un musée. Elle vient voir là, cette foule oisive et cu-rieuse, la représentation du passé, comme elle va voir au Louvre les vieux vases et les vieux tableaux. Elle visite aujourd’hui les tombes réta-blies de nos rois sans plus de souci qu’elle va regarder au musée Egyp-tien les longs coffres vides qui ont contenu les momies des souverains de l’Egypte. Elle s’étonne, elle admire, elle s’extasie, mais elle part calme et souriante, comme elle est venue, sans que son imagination préoccupée voyage dans le passé mort pour le reconstruire et le vivifier. M. Viollet-Leduc n’y peut rien, et l’éclat même de la restauration de l’église lui donne plus encore le caractère que je viens d’indiquer. Ces tombes neuves, ces vitraux neufs, ces chapelles neuves, ce ne sont ni les chapelles, ni les vitraux, ni les tombes du vieux temps, ce sont ceux de M. Viollet-Leduc ! C’est la différence, en un mot, qui existe entre une copie admirablement réussie et un original introuvable.
Mais je ne viens pas diminuer le mérite de la tentative de M. Viollet-Leduc ! Comme vérité historique, comme représentation scrupuleuse et exacte du passé, le Saint-Denis terminé sera certainement la merveille ar-chéologique de ce temps-ci, qui a vu tant de restaurations et tant de re-nouvellements ! Ce sera un vieux Saint-Denis tout neuf, un catalogue de pierre qui nous dira : « Ici était le tombeau de tel roi ; là dormait telle reine ; voici la place qu’occupait Duguesclin dans la royale nécropole !.. » Certes, cela vaudra mieux qu’un plan sur le papier avec un catalogue im-primé ! Mais qu’on ne dise point : « C’est Saint-Denis restitué ! Vous êtes dans le Saint-Denis royal de nos pères ! » Je vous répondrai une fois en-core : «Je suis dans le musée du Saint-Denis magnifique, splendide et admirable de l’habile M. Viollet-Leduc ! »
Ce qui prouve d’autant mieux ce que j’avance, c’est que depuis bien longtemps Saint-Denis n’est presque plus une église3. M. Viollet-Leduc a même dû en construire une nouvelle à l’autre bout de la ville pour y célébrer les offices, incélébrables dans la cathédrale. L’envahissement de la foule curieuse a chassé les chanoines du sanctuaire, et depuis plus de cinquante ans ce qu’on appelle le chœur d’hiver est devenu pour ces messieurs le chœur de toute l’année. Il est à droite en entrant dans l’église, fermé à tous les vents, étroit, assez mesquin, bien qu’on ait voulu reproduire dans son ornementation quelques-unes des décorations de la Sainte-Chapelle, et on peut dire aussi presque inaccessible au public à cause de son exiguïté et de son insuffisance. C’est là que se sont réfugiés messieurs les chanoines, autant pour éviter le froid que pour suivre en paix les offices, loin de la foule bruyante et remuante qui visite les tom-beaux.
Il y a quelques années, j’étais venu à Saint-Denis avec le désir d’assis-ter à l’une des cérémonies célébrées par ces vétérans du sacerdoce, et que je me figurais magnifiques. On lit en effet ce qui suit dans le budget de l’État :
Chapitre impérial de Saint-Denis,
10 Chanoines-évêques à 10,000 fr
100,000
fr.
18 Chanoines du 2e ordre à 4,000 fr.
72,000
Traitements des diacres, sacristains, chantres, aides de chœur
20,600
Frais de maîtrise et entretien des enfants de chœur
3,560
Huissiers, suisses, etc
5,900
Frais d’entretien du matériel et des ornements, et menus frais
8,940
211,000
fr.
J’avais pensé, dans ma naïveté, qu’à ce prix-là on devait célébrer à Saint-Denis des messes brillantes de splendeur et de magnificences ; je voyais déjà ces dix chanoines-évêques, la crosse en main et la mitre en tête, suivis de ces dix-huit chanoines du second ordre, emplir de leur majesté le sanctuaire de la royale basilique. Je songeais à quelque cérémonie inusitée accomplie avec des traditions spéciales, et je me disais que, moyennant 24,160 francs pour frais de chœur et de maîtrise, et 14,840 francs pour ornements d’église, huissiers et suisses, etc., j’allais assister à l’une de ces pompes merveilleuses dont l’Église entoure parfois la célébration du culte. Quels ne furent pas mon étonnement, ma stupéfaction, mon ébahissement ! C’était l’heure de la messe ; le sanctuaire était vide, et je ne pus entendre l’office que dans ce petit chœur d’hiver dont je viens de parler ; d’évêques, de crosses et de mitres, pas le moindre vestige ; trois ou quatre chanoines, épars dans les stalles nombreuses, suivaient benoîtement la messe, qui était célébrée de la manière la plus simple, la plus ordinaire et la plus usitée.
J’interrogeai le suisse ; je voulais au moins voir un évêque du chapitre impérial. J’appris que ces prélats ne sont pas tenus « à la résidence », c’est-à-dire qu’ils ont le droit d’habiter Castelnaudary ou Boulogne-sur-Seine, aussi bien que Saint-Denis, si cela leur plaît, et d’exercer ainsi leurs fonctions à distance. Messieurs les chanoines du second ordre seuls sont obligés d’habiter la ville, et ils ne peuvent s’en éloigner qu’avec une autorisation. Il est vrai qu’ils n’ont que 4,000 francs de traitement pendant que messieurs les évêques en ont 10,000 ; et sans doute la prescription qui les oblige « à résider » a pour but de les forcer à faire des économies malgré eux.
La restauration actuelle ne satisfait pas complètement messieurs les chanoines, car il est évident que Saint-Denis terminé sera beaucoup plus visité encore que Saint-Denis en cours d’exécution. Il se peut aussi qu’on oblige ces dignes prêtres à réintégrer le grand sanctuaire, où le froid les effraye, attendu qu’on doit démolir, dans un temps prochain, ce chœur sybaritique d’hiver, où il fait si chaud, et que la foule n’envahit pas. Cette démolition est dans le plan de restauration ; elle ne peut tarder d’avoir lieu, et nos seigneurs les évêques — chanoines à distance — doivent être les seuls à ne pas s’en inquiéter. Les chanoines à demeure, au contraire, sont très-émus des bouleversements au milieu desquels il leur faut vivre ; on change leur église ; le lieu de leur repos devient peu à peu l’endroit le plus fréquenté de la ville ; les promeneurs et les curieux se succèdent dans la basilique, ils la remplissent de leur bruit, de leurs causeries, de leur mouvement, et la quiétude de messieurs les chanoines est troublée au suprême degré ! Ils n’ont pas tous, tant s’en faut, l’enthousiasme archéologique bien fervent à l’endroit des restaurations actuelles, que quelques-uns qualifient même avec une sévérité qui n’est peut-être pas toujours exempte de prévention.
Toutefois, messieurs du chapitre impérial de l’église royale de Saint-Denis — et ici il faut s’expliquer un moment sur cette double qualification. Le chapitre est impérial ou royal — il pourrait même être national en cas de république — parce qu’il est nommé directement par le prince qui gouverne, qu’il soit empereur, roi ou président d’une république. Au-jourd’hui, il est d’autant mieux impénal qu’il a été créé par un empereur. En effet, Napoléon Ier voulant remplacer les bénédictins de l’abbaye royale, qui avaient eu entre autres fonctions la garde des tombeaux et celle du trésor de l’église, créa un chapitre épiscopal, composé de dix chanoines ayant pour chef le grand aumônier de sa cour. Ces chanoines étaient choisis parmi les évêques âgés de plus de soixante ans, et que leur santé, leurs infirmités, ou tout autre motif valable obligeaient à se démettre de leurs fonctions épiscopales. C’est seulement Louis XVIII qui créa les chanoines du second ordre, qu’il obligea à la résidence fixe, car messieurs les évêques nommés par l’empereur résidaient alors, comme aujourd’hui, en beaucoup d’endroits, excepté à Saint-Denis, et le but de l’institution, établie en vue de la garde des tombeaux, était manqué, puisque, en l’absence de ces prélats, les tombeaux s’étaient jusque-là gardés tout seuls.
Donc, le chapitre est impérial, cela n’est pas à discuter ; mais l’église est royale. Elle a été créée par nos rois, elle les a reçus tous au seuil du tombeau, et la qualification de royale lui appartiendra dans les siècles. Elle n’était pas impériale sous Charlemagne, qui était empereur, non plus que pendant le règne de ceux de ses descendants qui le furent aussi, et dont elle a reçu les cendres. On ne change pas ainsi certains titres vieux comme le monde, nés dans les sources mêmes d’une nation et ayant vieilli avec elle. C’est une tradition qui a plus de dix siècles d’existence que cette royale dénomination ; elle est inscrite dans nos chartes les plus anciennes ; elle se retrouve à toutes les époques diverses de notre his-toire, et il n’appartient à personne de la modifier. L’église de Saint-Denis est royale comme le palais de Richelieu, légué à Louis XIII, est le Palais-Royal ; comme la place, dite un moment des Vosges, est la place Royale ; ou comme la rue qui conduit de la Madeleine à la place de la Concorde est la rue Royale. La République de 1848 a pu changer tous ces noms sur les écriteaux publics ou dans son Moniteur, elle n’a pas empêché que le nom connu ne restât quand même à ce palais, à cette place, à cette rue ; et aussitôt qu’un gouvernement nouveau est venu débrouiller le chaos qu’elle avait fait, l’un de ses premiers actes a été de restituer ces vieux noms de l’histoire au palais de Richelieu et de Louis XIII, à la place des Vosges et à la rue dite un moment Nationale.
Je ne faisais donc pas un jeu de mots quand je disais tout à l’heure, le chapitre impérial institué auprès de l’église royale de Saint-Denis, car c’est là son vrai titre. Ces prêtres, qui tiennent leur mission de l'Empereur, gardent en son nom comme au nom de la France ce qui reste, dans ce Saint-Denis dévasté, des cendres de nos rois. Et s’ils ne sont pas très-partisans des travaux nombreux qui renouvellent l’antique basilique, ils l’aiment cependant assez pour se consacrer presque tous à son histoire. Messieurs les chanoines, à peu d’exceptions près, ont écrit ou écrivent l’histoire de l’abbaye ; mais la plupart ne publient point leur travail, qui n’offrirait d’ailleurs, je suppose, que le même genre d’intérêt, car, puisés aux mêmes sources, — celles que fournissent les archives de l’église ou la bibliothèque de Saint-Denis, Félibien, dom Doublet, dom Millet, dom Robert, Mad. d’Ayzac, M. de Guilhermy, et beaucoup d’autres, — ces divers travaux doivent se ressembler à peu près tous. D’ailleurs, il ne se trouve pas toujours d’éditeurs assez courageux ou aventureux pour se dévouer, à ses risques et périls, à une publication aussi hasardeuse.
L’un de ces messieurs a cependant publié, lui-même et à ses frais, en 1867, à l’occasion de l’Exposition, un volume relativement considérable — puisqu’il doit tenir lieu de catalogue — à l’usage des visiteurs de l’abbaye. J’ai eu entre les mains ce petit livre que vend une bonne femme installée dans une baraque de bois devant le portail de l’église. Il n’est pas possible qu’il serve jamais de « renseignements sur place » à un pro-meneur de passage, auquel le temps manquera toujours pour lire, devant les tombeaux de la royale nécropole, les pages nombreuses, et dont je suis bien loin de nier l’intérêt, que le savant chanoine leur a consacrées. C’est là ce qui manque précisément à Saint-Denis. Des livres comme celui que je cite peuvent être utilement consultés chez soi ; mais, pour en tirer quelque profit dans une visite à l’abbaye, il faudrait d’abord et avant tout le résumer soi-même par écrit et en extraire l’indispensable ; les trois quarts du volume subiraient ainsi l’amputation.
Je signale cette absence complète de renseignements imprimés à M. Viollet-Leduc. Il serait facile de publier un petit plan de l’église accom-pagné d’une explication rapide et intelligemment faite, qui permettrait au visiteur de se reconnaître dans la nécropole. Cela donnerait en même temps l’occasion d’enlever l’affreuse petite étiquette en bois blanc qui a été placée devant chaque tombeau, et qui n’est pas l’un des indices les moins frappants du caractère absolument musée que ne dépouillera ja-mais l’église, même après sa restauration définitive.
M. le baron de Guilhermy a publié sur Saint-Denis le travail moderne le plus complet et le plus intéressant qu’on puisse lire. Malheureusement, son livre est épuisé, et d’ailleurs il date de 1848. S’il était vrai à cette époque il ne l’est plus complètement aujourd’hui. Je voudrais toutefois le voir rééditer pour les documents curieux que contient sa deuxième partie, documents auxquels j’ai fait plus d’un emprunt pour le travail que j’offre aujourd’hui au public.
Le présent livre n’est pas une histoire de Saint-Denis ; c’est l’histoire seule de ses tombeaux que j’ai voulu écrire, en rattachant au souvenir de chaque roi quelques circonstances de sa mort et de ses funérailles. Je donne, d’après l’intéressant rapport du bénédictin Poirrier, augmenté et complété autant que j’ai pu le faire, le récit de l’extraction des cercueils de nos rois en 1793, et j’ajoute à ce travail tous les documents que j’ai crus de nature à intéresser le lecteur, relativement aux destinées passées et futures de la royale abbaye.
Le public avait accueilli avec faveur, il y a deux ans, la publication un peu sèche que j’avais alors faite du rapport de dom Poirrier ; je veux croire qu’il ne sera pas indifférent à la nouvelle édition que je lui donne de cette relation, qui est dans sa simplicité naïve l’une des plus dramatiques et des plus émouvantes lectures qu’on puisse faire.
GEORGES D’HEILLY.
Neuilly-sur Seine. janvier 1868.
1 Aucun gouvernement n’avait fait autant pour Saint-Denis que celui de Napoléon III, sous le règne duquel aura eu lieu la restauration logique et définitive de l’église. Le budget — exercice clos — de 1865 porte 179,565 francs pour les travaux de Saint-Denis.
2 Combien peu, malheureusement, parmi la foule des visiteurs, feront dans le passé cette promenade et ce rêve !...
3 Non, ce n’est plus un temple, puisque c’est même devenu un marché ! On y vend aux visiteurs des livrets soi-disant explicatifs et des photographies ; un tombeau même, celui de quelque Valois, sert de comptoir pour la vente et le trafic, et l’échange de la monnaie a lieu entre la tombe de Philippe-Auguste et le cénotaphe des fils de saint Louis !
LES TOMBES ROYALES DE SAINT-DENIS
PREMIÈRE PARTIE
SAINT-DENIS AVANT LA RÉVOLUTION
L A royale église de Saint-Denis doit sa véritable fondation à Dagobert et sa grandeur et sa fortune à l’abbé Suger. Dagobert fit reconstruire la primitive église, dont l’origine se perd un peu dans la nuit des temps, et que son caractère tout à fait légendaire empêche même de constater bien authentiquement. « La générosité de Dagobert, dit Henri Martin, brilla surtout envers le monastère de Saint-Denis ; il avait changé la petite et obscure chapelle du martyr parisien en une basilique éclatante de marbre, d’or et de pierreries, et il lui avait octroyé une multitude de terres et de villas situées en diverses provinces avec une partie des péages qui appartenait au roi dans le pays de Parisis1. »
Saint Éloi, dit-on, ce ministre-orfévre, travailla lui-même de ses propres mains à l’embellissement de la basilique ; il cisela deux taber-nades, deux chaises2 ornées de pierreries, et plusieurs autres merveilles qui ont été pillées lors des invasions qu’eurent à subir l’abbaye et l’église. Dagobert y fut le premier enterré et inaugura cette longue suite de rois et de reines, de princes et de princesses qui ont dormi à sa suite pendant douze siècles dans les caveaux aujourd’hui dévastés.
Pépin le Bref, vers le milieu du VIIIe siècle, commença la restauration de l’église, qui menaçait déjà ruine, et Charlemagne l’acheva et en fit une inauguration solennelle vers l’année 775.
Elle ne fut pas épargnée lors des invasions multipliées des Normands du VIIIe au XIIe siècle ; son trésor, ses richesses, ses merveilles précieuses furent pillés et dilapidés ; l’église elle-même fut ébranlée jusque dans ses fondements par ces furieuses attaques ; elle eut à subir, on peut le dire, le fer et la flamme de la part des envahisseurs, qui ne respectaient rien dans le pays envahi, et traitaient comme conquête et comme butin ce qui appartenait aux hommes « comme ce qui appartenait à Dieu ».
Suger, l’abbé, le grand abbé Suger, ministre et conseiller des rois Louis VI et Louis VII, entreprit de relever ces ruines et de rendre à l’église et à l’abbaye la splendeur qu’elles avaient eue sous Dagobert et sous Charlemagne. Il éleva le portail et les tours, le chœur et la nef, les chapelles, l’abside ; il plaça les vitraux admirables, — nous ne pouvons les juger que sur de bien minces vestiges, — enrichit le chœur de merveilleux objets d’orfévrerie et le trésor de présents inestimables. Il assista lui-même aux travaux, les surveillant, pressant les ouvriers, voulant en quelque sorte que la mort ne l’empêchât point de voir l’édifice terminé et d’en faire lui même une nouvelle dédicace. Il eut cette joie bien méritée, et par deux fois, en 1140 et en 1144, il put, dans de pompeuses et touchantes cérémonies, rendre à sa destination première l’église restau-rée et enrichie3.
Quand il mourut, — le 13 janvier 1152, — on lui fit, par les ordres et aux frais du roi Louis VII, des funérailles « d’une grande dépense » et d’une royale magnificence. Le roi suivit lui-même à pied, au milieu de ses conseillers et de ses prélats, le convoi de son vieux serviteur, dont il or-donna l’ensevelissement à Saint-Denis. Mais l’austère abbé avait indiqué lui-même, de son vivant, l’endroit qu’il voulait pour sépulture. Une niche, pratiquée sous l’une des arcades dans l’épaisseur du mur de la croisée, du côté du midi, entre la porte du cloître et la chapelle des Charles, reçut le cercueil de Suger. On ferma l’ouverture avec du plâtre et de la pierre, où l’on grava son effigie. Dans la restauration de l’église faite au siècle suivant, l’abbé Mathieu de Vendôme, voulant honorer la mémoire de Suger par un simple monument qui fût digne de sa modes-tie et de son humilité, fit exhausser à trois pieds de terre, au-dessous de l’emplacement du cercueil, une pierre tumulaire avec cette seule inscription :
Hic jacct Sugerius abbas.
Et cependant l’un de ses contemporains, qui admirait ses vertus, qui peut-être aussi les imitait, — ce qui est plus difficile et plus rare, — Simon Chèvre-d’Or, chanoine de Saint-Victor, avait composé en l’hon-neur du pieux ministre une épitaphe que je tiens à citer, d’abord parce qu’elle offre un véritable intérêt historique, et aussi parce que je la crois peu connue :
Decidit ecdesiæ flos, gemma, corona, columna,
Vexillum, dypeus, galea, lumen, apex,
Abbas Sugerius, specimen virtutis et æqui,
Cum pietate gravis, cum gravitate plus ;
Magnanimus, sapiens, facundus, largus, honestus
Judiáis prœsens corpore, mente sibi.
Rex per eum cauté rexit moderamina regni
Ille reqens regem, rex quasi regis erat.
Dumque moras ageret rex trans mare plurïbus annis
Præfuit hic regno regís agendo vices.
Quæ dum vix alius potuit sibi, jungere, junxit ;
Et probus ille viris et bonus ille Deo.
Nobilis ecclesiœ decoravit, repulit, auxii,
Sedem, damna, chorum, laude, vigore, vins.
Corpore, gente brevis, gemina brevitate coactus,
In brevitate sua noluit esse brevis.
Cui rapuit lucem lux septima Theophaniæ,
Veram vera Deo Theophania dédit4.
Il avait donc, ce pieux abbé, rendu à l’église royale son lustre et sa splendeur ; il avait restauré le temple et renouvelé les solennelles cérémonies ; les rois lui devaient un tombeau digne de leur grandeur, et il avait ouvert à leurs descendants d’immenses caveaux funèbres où des générations de monarques, escortés des reines, des princes et des illustres personnages de leur époque, s’en allaient venir trouver l’éternel repos. Il avait fait plus encore, car il avait accompli l’acte d’humilité le plus beau et le plus grand qu’un homme, parvenu aux dignités qu’il occupait, pût accomplir sur la terre. Il commandait, il menait par sa volon-té le royaume même de son maître ; il était, comme il est dit plus haut, en quelque sorte le roi du roi, et de son vivant il aurait pu se préparer une tombe fastueuse au milieu de ce Saint-Denis qu’il avait fait sien, et qui lui devait sa nouvelle jeunesse et sa nouvelle beauté. Il pouvait se placer parmi ces rois de l’histoire qui étaient moins grands que lui par le talent, par la vertu, par le génie ; sa tombe, confondue au milieu des leurs, eût été découverte bien vite par la reconnaissance et l’admiration des peuples, et elle eût éclipsé de son illustration magnifique toutes celles qui l’entouraient. Mais cet homme si puissant, il était né pauvre, il avait vécu dans l’humilité, il était mort humble devant Dieu, et il n’avait point voulu de monument pour tombeau.
Aujourd’hui sa tombe a disparu tout à fait, et rien n’indique, dans l’église restaurée de M. Viollet-Leduc, qu’elle y ait jamais existé. Une statue, une croix, une pierre, un nom, quelque chose enfin qui rappelle au passant qu’au XIIe siècle Suger a refait Saint-Denis, qu’il l’a rajeunie et consolidée : voilà ce que nous demandons en grâce à l’habile architecte, au nom de l’histoire et de la reconnaissance publique d’un pays qui sait honorer ceux qui ont fait sa grandeur, comme une réparation véritable bien due au pieux abbé. Que sa tombe obscure, ignorée, si ignorée même que personne n’a songé à la rétablir, reparaisse là où elle était ja-dis, afin qu’en parcourant l’église où l’on a la prétention de rétablir scrupuleusement le passé, le visiteur ne puisse pas se dire qu’on a omis précisément d’y consacrer la mémoire de celui qui avait droit à l’une des pre-mières places.
Au XIIIe siècle, l’église, qui menaçait ruine une fois encore, fut répa-rée surtout par les soins pieux du saint roi Louis IX. L’abbé Eudes Clé-ment, et après lui l’abbé Mathieu de Vendôme, réédifièrent ou consoli-dèrent les tours, l’abside et la nef, et, cette fois, si parfaitement et si com-plètement, que l’église que nous voyons aujourd’hui est à peu près la leur ; en tenant naturellement compte aux siècles qui suivirent des rema-niements et des travaux d’embellissements divers qui modifièrent l’orne-mentation de l’édifice, sans altérer ses proportions ni ses formes.
Saint Louis a fait réédifier, pour sa part, les tombeaux des rois ses prédécesseurs. En 1263 et 1264, il fit replacer leurs restes sous les tombes uniformes supportant leurs statues couchées et toutes en pierre, dont quelques-unes sont parvenues jusqu’à nous dans un état de conservation à peu près complet. Il n’y a donc pas à Saint-Denis un seul tombeau an-térieur à l’époque de saint Louis. Il faut encore remarquer que les princes qui lui succédèrent furent ensevelis soit sous des tombes de mé-tal, soit sous des tombeaux de marbre blanc et noir. La pierre ne fut plus que très-rarement employée dans les monuments élevés dès lors à Saint-Denis, à l’exception de ceux de quelques princes et personnages admis par faveur à être inhumés dans la royale église. Enfin il ne faut pas atta-cher une foi bien grande à la ressemblance des statues couchées sur les tombeaux, et refaites sous saint Louis. Rien ne prouve que les artistes de l’époque se soient préoccupés de cette question, que d’ailleurs ils auraient été bien embarrassés sans doute de résoudre, à cause de l’absence de portraits ou de documents sur lesquels ils auraient pu se guider dans l’accomplissement de leur travail. Les costumes eux-mêmes ne sont pas conformes à la vérité historique, et ces Mérovingiens, Carlovingiens et même Capétiens de pierre sont recouverts de vêtements et d’ornements de fantaisie à l’exactitude desquels il ne faut pas se laisser prendre.