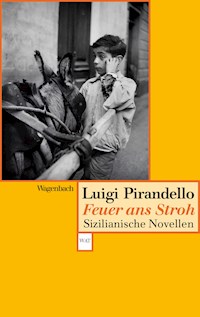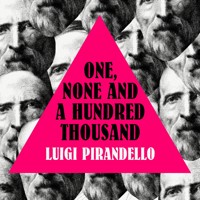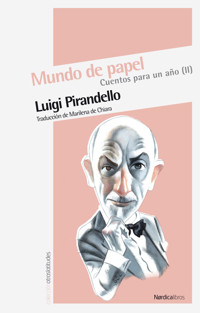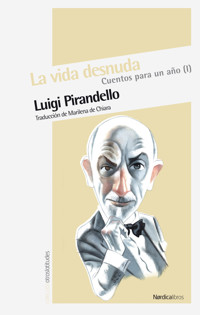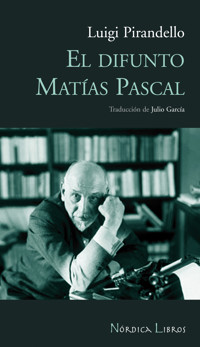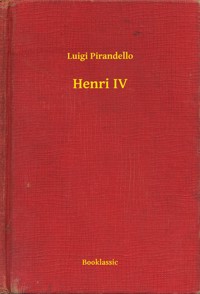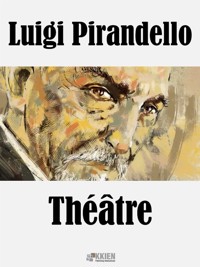Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Mathias, garçon timoré, vit en province: il abandonne le foyer conjugal après une querelle avec sa femme et sa belle-mère et se rend à Montecarlo. Là, il gagne au jeu plusieurs dizaines de milliers de lires. En lisant les faits divers, il apprend qu'on le croit mort, suite à la fausse identification du cadavre d'un désespéré, qui s'est jeté dans le puits de Mathias. Cette étrange situation lui suggère de faire croire à sa mort véritable et de tenter de commencer une vie nouvelle. Feu Mathias Pascal prend alors le nom d'Adrien Meis. Il s'installe à Rome dans une pension de famille, tenue par Anselme Paleari et sa fille Adrienne, mais dirigée en fait par un dangereux individu, Terence Papiano, veuf d'une seconde fille de Paleari. Dans la maison vivent deux autres personnages: Scipio, le frère de Terence, à demi épileptique, et voleur, ainsi que Silvia Caporale, professeur de musique, victime de Papiano, mais que le maître de céans, fanatique de spiritisme, estime pour ses éminentes qualités de médium. Tels sont les personnages qui recréent autour de Mathias Pascal la vie de société qu'il avait pensé fuir à jamais. La vie quotidienne recommence, avec ses petits événements, ses aventures agréables ou désagréables, sans oublier l'humble amour dont la pauvre Adrienne entoure le fugitif. Mathias est partagé entre la crainte de voir se découvrir sa situation équivoque et le besoin de se sentir vivre en se liant à ses semblables par un nouveau réseau d'intérêts et de sentiments...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Feu Mathias Pascal
Feu Mathias PascalI. AVANT-PROPOSII. DEUXIÈME AVANT-PROPOS (PHILOSOPHIQUE) EN MANIÈRE D’EXCUSEIII. LA MAISON ET LA TAUPEIV. CE FUT AINSIV. MATURATIONVI. TAC TAC TAC…VII. JE CHANGE DE TRAINVIII. ADRIEN MEISIX. UN PEU DE BRUMEX. LE BÉNITIER ET LE CENDRIERXI. UN SOIR, EN REGARDANT LE FLEUVEXII. L’ŒIL ET PAPIANOXIII. LA PETITE LANTERNEXIV. LES PROUESSES DE MAXXV. MOI ET MON OMBREXVI. LE PORTRAIT DE MINERVEXVII. RÉINCARNATIONPage de copyrightFeu Mathias Pascal
Luigi Pirandello
I. AVANT-PROPOS
Une des rares choses, peut-être même la seule dont je fusse bien certain, était celle-ci : je m’appelais Mathias Pascal. Et j’en tirais parti. Chaque fois que quelqu’un perdait manifestement le sens commun, au point de venir me trouver pour un conseil, je haussais les épaules, je fermais les yeux à demi et je lui répondais :
– Je m’appelle Mathias Pascal.
– Merci, mon ami. Cela, je le sais.
– Et cela te semble peu de chose ?
Cela n’était pas grand-chose, à vrai dire, même à mon avis. Mais j’ignorais alors ce que signifiait le fait de ne pas même savoir cela, c’est-à-dire de ne plus pouvoir répondre, comme auparavant, à l’occasion :
– Je m’appelle Mathias Pascal.
Il se trouvera bien quelqu’un pour me plaindre (cela coûte si peu) en imaginant l’atroce détresse d’un malheureux auquel il arrive, à un certain moment, de découvrir qu’il n’a ni père ni mère. On pourra alors s’indigner (cela coûte encore moins) de la corruption des mœurs, et des vices, et de la tristesse des temps, qui peuvent occasionner tant de maux à un pauvre innocent.
Eh bien ! ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Je pourrais exposer ici, en effet, dans un arbre généalogique, l’origine et la descendance de ma famille et démontrer que j’ai connu non seulement mon père et ma mère, mais encore mes aïeux.
Et alors ?
Voilà : mon cas est étrange et différent au plus haut point ; si différent et si étrange que je vais le raconter.
Je fus, pendant environ deux ans, chasseur de rats ou gardien de livres, je ne sais plus au juste, dans la bibliothèque qu’un certain monsignor Boccamazza, en 1803, légua par testament à notre commune. Évidemment ce monsignor devait connaître assez mal l’esprit et les aptitudes de ses concitoyens, ou peut-être espérait-il que son legs, avec le temps et la commodité, allumerait dans leur âme l’amour de l’étude. Jusqu’à présent, je puis en rendre témoignage, rien ne s’est allumé, et je le dis à la louange de ses concitoyens. Ce don fit même naître si peu de reconnaissance pour Boccamazza que la commune alla jusqu’à refuser de lui ériger un simple buste, et quant aux livres, elle les laissa des années et des années entassés dans un magasin vaste et humide, d’où elle les tira ensuite, jugez un peu dans quel état ! pour les loger dans la petite église solitaire de Santa-Maria-Liberale, désaffectée je ne sais pour quelle raison. Là, elle les confia sans aucun discernement, à titre de bénéfice et comme sinécure, à quelque fainéant bien protégé, qui, pour deux lires par jour, surmonterait le dégoût d’endurer pendant quelques heures leur relent de moisi et de vieillerie.
C’est le sort qui m’échut à mon tour, et, dès le premier jour, je conçus une si piètre estime des livres, imprimés ou manuscrits (comme d’aucuns, fort antiques, de notre bibliothèque), que maintenant je ne me serais jamais, au grand jamais, mis à écrire si, comme je l’ai dit, je n’estimais mon cas véritablement étrange et fait pour servir d’enseignement à quelque lecteur curieux, qui par aventure, réalisant enfin l’antique espérance de cette bonne âme de monsignor Boccamazza, mettrait les pieds dans cette bibliothèque, à laquelle je lègue le présent manuscrit, à charge pourtant de ne le laisser ouvrir par personne moins de cinquante ans après mon troisième, ultime et définitif décès.
Car, pour le moment (et Dieu sait combien il m’en chaut !), je suis mort, oui, déjà deux fois, mais la première par erreur, et la seconde… vous allez voir.
II. DEUXIÈME AVANT-PROPOS (PHILOSOPHIQUE) EN MANIÈRE D’EXCUSE
L’idée ou plutôt le conseil d’écrire m’est venu de mon révérend ami don Eligio Pellegrinotto, qui a présentement en garde les livres de Boccamazza, et auquel je confierai ce manuscrit à peine terminé, s’il l’est jamais.
Je l’écris ici, dans la petite église désaffectée, sous la lumière qui me vient de la lanterne, là-haut, de la coupole ; ici, dans l’abside réservée au bibliothécaire et entourée d’une clôture basse en bois, à colonnettes, tandis que don Eligio s’ébroue sous le fardeau, qu’il a héroïquement assumé, de mettre un peu d’ordre dans cette véritable babylone de livres. Je crains fort qu’il n’en vienne jamais à bout.
Maints livres curieux et plaisants ont été ainsi pêchés sur les rayons de la bibliothèque par don Eligio Pellegrinotto, grimpé tout le long du jour sur une échelle de lampiste. Chaque fois qu’il en trouve un, il le lance d’en haut, élégamment, sur la grande table qui est au milieu ; la petite église en retentit ; un nuage de poussière s’élève, d’où deux ou trois araignées s’enfuient épouvantées ; j’accours de l’abside, enjambant la balustrade ; je donne d’abord, avec le livre lui-même, la chasse aux araignées tout par la grande table poudreuse, puis je l’ouvre et je me mets à le parcourir.
Ainsi, peu à peu, j’ai pris goût à semblable lecture. À présent, don Eligio me dit que mon livre devrait être conduit sur le modèle de ceux qu’il va dénichant dans la bibliothèque.
Tout suant et poussiéreux, mon révérend ami descend de l’échelle et vient prendre une gorgée d’air dans le jardinet, qu’il a trouvé moyen d’improviser ici, derrière l’abside, protégé tout à l’entour par des palissades et des grillages.
Eh bien ! en vertu de l’étrangeté de mon cas, je parlerai de moi, mais le plus brièvement qu’il me sera possible, c’est-à-dire en me bornant à donner les renseignements que j’estimerai nécessaires.
Quelques-uns d’entre eux, certes, ne me font guère honneur ; mais je me trouve maintenant dans une condition si exceptionnelle que je puis me considérer comme déjà hors de la vie, donc sans obligations et sans scrupules d’aucune sorte.
Commençons.
III. LA MAISON ET LA TAUPE
Je me suis trop hâté de dire, au début, que j’avais connu mon père. Je ne l’ai pas connu. J’avais quatre ans et demi quand il mourut. Étant allé sur une de ses balancelles, en Corse, pour certain négoce qu’il y faisait, il y mourut d’une fièvre pernicieuse, à trente-huit ans. Il laissait toutefois dans l’aisance sa femme et ses deux fils : Mathias (ce serait moi, et ce fut moi) et Robert, mon aîné de deux ans.
Jusqu’à ces derniers temps vivait, tout près d’ici, sur la plage déserte, un très vieux pêcheur, qui fut matelot dans sa jeunesse sur la balancelle de mon père. Il n’était pas du pays et on ne sut jamais de quel pays il était : il se faisait appeler d’un drôle de surnom dont l’avaient sans doute affublé autrefois les mariniers d’Abruzze et d’Otrante : Giaracannà. Il possédait une petite barque, des nasses et des filets, et, depuis plus de trente ans, pratiquait la pêche sur ce coin de plage solitaire où il s’était construit avec quelques roches une espèce de tanière, dans laquelle il dormait la nuit, comme une bête heureuse, sans amours, sans pensées et sans peur. Les jours de vent et de mauvaise mer, il restait assis devant sa tanière, ses pieds déchaussés enfouis dans le sable, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains ; il regardait les flots de ses yeux verdâtres et injectés de sang, et fumait une pipe presque sans tuyau, délicieusement culottée.
C’est dans une de ces journées que j’allai le trouver, pour parler de mon père avec lui. Je dus faire mille efforts pour me faire entendre. Heureux homme, qui, par surcroît, était sourd !
Je le vois encore devant moi, dans sa vieille chemise toute rapiécée, coiffé d’une espèce de chapeau qui avait perdu toute forme et toute couleur et avait fini par ne plus faire qu’un avec la tête qui le portait ; une fière tête, au visage brûlé par le soleil et les embruns, encadré par une barbe courte, épaisse et blanche, comme l’écume des vagues.
– Ah ! Fils de Gian Luca, c’est toi ?
Il me toisa de la tête aux pieds, puis souleva d’une main son chapeau et se gratta le chef.
– Tu veux rire ? Car Gian Luca, d’un coup de poing, terrassait un brave taureau.
Et il me raconta, à sa façon, en de rudes phrases incisives et avec des gestes violents, une aventure de mon père, à Nice, avec quelques marins anglais à moitié ivres.
– Et que penses-tu, lui demandai-je alors, de ce capitaine anglais et de son chien, dont quelques vieux s’obstinent encore à parler, là, au pays ?
Giaracannà hocha le corps tout entier, dédaigneusement, puis se frappa vigoureusement la poitrine, plusieurs fois, de ses paumes énormes :
– Il a tout fait, avec celui-là, Gian Luca !
Quelques vieillards du pays, en effet, se plaisent encore à donner à entendre que la richesse de mon père (qui pourtant ne devrait plus leur donner ombrage, passée comme elle l’est depuis un bout de temps en d’autres mains) avait des origines… disons mystérieuses.
Certains veulent qu’il se la soit procurée en jouant aux cartes, à Marseille, avec le capitaine d’un vapeur marchand anglais, lequel, après avoir perdu tout l’argent qu’il avait sur lui, et ce ne devait pas être peu, avait joué encore une grosse charge de soufre embarquée dans la lointaine Sicile pour le compte d’un négociant de Liverpool (ils savent aussi ce détail ! et le nom !) qui avait affrété le vapeur ; ensuite, de désespoir, levant l’ancre, il s’était noyé au large. Ainsi le vapeur était rentré à Liverpool allégé aussi du poids du capitaine. Une chance qu’il avait pour lest la malignité de mes concitoyens…
D’autres veulent, par contre, que ce capitaine n’ait point du tout joué aux cartes avec mon père, lequel – bonnes âmes ! – était sans doute enclin aux jeux de main, à la violence, à la débauche et même… au vol, là ! Mais le vice du jeu, non, non, cent fois non, il ne l’avait pas, il ne l’avait pas, et il ne l’avait pas. Le capitaine anglais, selon ceux-là, avait été assez bonasse pour confier à mon père, en partant, une certaine cassette que naturellement mon père s’était hâté de forcer ; il l’avait trouvée pleine de pièces d’or et d’argent et se l’était appropriée, niant ensuite, au retour du capitaine, l’avoir jamais reçue en garde. Et le capitaine ? Pauvre homme ! il n’avait su prendre d’autre parti que de mourir de crève-cœur.
D’autres, enfin, soutiennent que ce capitaine anglais n’est pas vrai ; mieux, qu’il est bien vrai, mais qu’il n’a rien à voir dans la richesse de mon père, sinon par un beau chien de garde qu’il lui voulut laisser en souvenir. Un jour que mon père se trouvait à la campagne, dans la terre dite des Deux Rivières, ce chien, qui était rouge de poil et gros comme cela, se mit à gratter, à creuser au pied d’un mur… où mon père trouva la précieuse cassette.
Quels chiens, hein ? mon vieux Giaracannà, il y a en ce monde ! Mais je connais encore d’autres chiens qui un jour te découvrirent mort dans ta tanière sur la plage déserte et, chose horrible à dire, t’outragèrent aussi, déchirèrent ton pauvre corps. Ta petite barque resta quelques jours tirée à sec sur la rive ; puis la mer la reprit et qui sait où elle est ? Perdue comme la richesse de mon père. Je te serai toujours reconnaissant de l’affection et du souvenir que tu avais conservés à Gian Luca Pascal.
Nous possédions terres et maisons. Sagace et aventureux, mon père n’avait pour ses commerces aucun siège stable : toujours en tournée sur quelqu’une de ses balancelles, là où il se trouvait le mieux et achetait avec le plus d’opportunité, pour les revendre aussitôt, marchandises de toutes sortes, et, pour ne pas se laisser aller à des entreprises trop pleines de grandeur et de risques, il transformait à mesure ses gains en terres et maisons, ici, dans son propre petit pays, où peut-être il comptait se reposer bientôt, dans l’aisance péniblement acquise, content et paisible, entre sa femme et ses enfants.
C’est ainsi qu’il acquit d’abord la terre des Deux Rivières, riche en oliviers et en mûriers ; puis le domaine de l’Épinette, richement pourvu, lui aussi, et avec une belle source, qui fut captée dans la suite, pour le moulin ; puis toute la montée de l’Éperon, qui était le meilleur vignoble de notre contrée, et enfin San-Rocchino, où il bâtit une villa délicieuse. En ville, outre la maison que nous habitions, il en acheta deux autres et tout cet îlot qu’on a aujourd’hui arrangé en arsenal.
Sa mort, qui survint presque à l’improviste, fut notre ruine. Ma mère, inapte à l’administration de l’héritage, dut la confier à un homme qui, pour tous les bienfaits reçus de mon père, devait, pensait-elle, se sentir tenu au moins à un peu de gratitude, et celle-ci, à part le zèle et l’honnêteté, ne lui aurait coûté de sacrifice d’aucune sorte : il était, en effet, grassement rémunéré.
Une sainte femme, ma mère ! D’une nature réservée et très paisible, qu’elle avait peu d’expérience de la vie et des hommes ! À l’entendre parler, on eût dit une petite fille. Elle parlait du nez et riait aussi du nez ; car, à chaque fois, comme si elle eût eu honte de rire, elle serrait les lèvres. Très délicate de complexion, elle n’eut jamais, après la mort de mon père, une santé bien solide ; mais elle ne se plaignit jamais de ses maux, et je ne crois pas qu’elle-même s’en chagrinât à l’extrême ; elle les acceptait, résignée, comme une conséquence naturelle de son malheur. Peut-être s’attendait-elle à mourir, elle aussi, de douleur ; elle devait donc remercier Dieu qui la gardait en vie, tout humble et éprouvée qu’elle était, pour le bien de ses enfants.
Elle avait pour nous une tendresse absolument maladive, toute palpitante et épouvantée ; elle nous voulait toujours près d’elle, comme si elle eût craint de nous perdre, et souvent, à peine l’un de nous s’était-il un peu éloigné, qu’il fallait que les servantes se missent en quête par la vaste maison.
Comme une aveugle, elle s’était abandonnée à la direction de son mari ; restée sans lui, elle se sentit perdue dans le monde. Et elle ne sortit plus de la maison, sauf les dimanches, le matin de bonne heure, pour aller à la messe à l’église voisine, accompagnée de deux vieilles servantes, qu’elle traitait comme des parentes. Dans la maison même, elle resserra son existence dans trois chambres seulement, abandonnant toutes les autres aux soins avares des servantes et à nos polissonneries.
Il s’exhalait, dans ces pièces, de tous les meubles démodés, des tentures décolorées, cette odeur spéciale des vieilles choses, comme l’haleine d’un autre temps ; et je me rappelle que plus d’une fois je regardai autour de moi avec une étrange consternation qui me venait de l’immobilité silencieuse de ces vieux objets restés là depuis tant d’années sans usage et sans vie.
Parmi les gens qui venaient le plus souvent rendre visite à notre mère, était une sœur de mon père, vieille fille capricieuse, avec une paire d’yeux de furet, brune et intraitable. Elle s’appelait Scholastique. Mais à chaque fois elle s’arrêtait fort peu, car tout d’un coup, en causant, elle s’emportait et s’en allait, furieuse, sans saluer personne. Pour moi, tout petit, j’en avais grand-peur. Je la regardais avec de grands yeux, surtout quand je la voyais se lever d’un bond en furie et que je l’entendais crier, tournée vers ma mère et frottant rageusement un pied sur le parquet :
– Tu sens le vide ? La taupe ! La taupe !
Elle faisait allusion à Malagna, l’administrateur qui nous creusait dans l’ombre la fosse sous les pieds.
Tante Scholastique (je l’ai su depuis) voulait à tout prix que ma mère se remariât. D’ordinaire les belles-sœurs n’ont pas de ces idées et ne donnent pas de ces conseils. Mais elle avait un sentiment âpre et farouche de la justice ; et à cause de cela, sans doute, plus que par amour pour nous, elle ne pouvait souffrir que cet homme nous dérobât ainsi, impunément. Or, étant donné l’inaptitude absolue et la cécité de ma mère, elle n’y voyait d’autre remède qu’un second mari. Et elle le désignait même en la personne d’un pauvre homme, qui s’appelait Jérôme Pomino.
Celui-ci était veuf, avec un fils, qui vit encore et s’appelle Jérôme, comme son père : mon ami intime, même plus que mon ami, comme je le dirai par la suite. Tout enfant, il venait avec son père dans notre maison et était notre désespoir, à moi et à mon frère Berto.
Le père, dans sa jeunesse, avait aspiré longuement à la main de tante Scholastique, qui n’avait pas voulu en entendre parler, pas plus, du reste, que d’aucun autre ; non pas qu’elle ne se sentît point disposée à aimer, mais parce que le plus lointain soupçon que l’homme aimé d’elle aurait pu, ne fût-ce qu’en pensée, la trahir, lui aurait fait commettre, disait-elle, un crime. Tous faux, pour elle, les hommes, tous coquins et traîtres. Pomino aussi ? Non, pour cela, non, pas Pomino. Mais elle s’en était aperçue trop tard. De tous les hommes qui avaient demandé sa main et qui s’étaient mariés ensuite, elle avait réussi à découvrir quelque trahison et en avait eu une joie féroce. De Pomino seulement, rien : même, le pauvre homme avait été un martyr de sa femme.
Et pourquoi donc, maintenant, ne l’épousait-elle pas, elle ? Oh ! la belle histoire ! parce qu’il était veuf ! Il avait appartenu à une autre femme, à laquelle peut-être il aurait pu penser quelquefois. Et puis, parce que… eh ! cela se voyait de cent lieues, malgré sa timidité : il était amoureux, il était amoureux… vous comprenez de qui, le pauvre Pomino.
Figurez-vous si ma mère allait y consentir ! Cela lui aurait paru un véritable sacrilège. Mais elle ne croyait peut-être même pas, la pauvrette, que tante Scholastique parlât sérieusement ; et elle riait, de son rire particulier, aux emportements de sa belle-sœur, aux exclamations du pauvre M. Pomino, qui se trouvait présent à ces discussions.
C’était un petit homme propret, ajusté, aux yeux bleus pleins de mansuétude ; je crois qu’il se poudrait et qu’il avait même la faiblesse de se passer un peu de rouge, à peine, à peine, sur les joues ; certes, il était fier d’avoir conservé à son âge tous ses cheveux, qu’il se peignait, avec un soin extrême, en ailes de pigeon, et se rajustait continuellement avec les mains.
Je ne sais comment seraient allées nos affaires, si ma mère, non pas certes pour elle, mais en considération de l’avenir de ses enfants, avait suivi le conseil de tante Scholastique et épousé M. Pomino. Il est pourtant hors de doute qu’elles n’auraient pu aller plus mal qu’elles n’allèrent, confiées à Malagna (la Taupe) !
Quand nous fûmes devenus grands, Berto et moi, une grande partie de nos biens s’en était allée en fumée ; mais nous aurions pu au moins sauver des griffes de ce voleur le reste qui nous aurait permis de vivre, sinon encore dans l’aisance, du moins à l’abri du besoin. Nous fûmes nonchalants ; nous ne voulûmes nous inquiéter de rien, continuant, grands, à vivre comme notre mère nous avait habitués, petits.
Elle n’avait même pas voulu nous envoyer à l’école. Un certain Pinzone fut notre gouverneur et précepteur. Son vrai nom était François ou Jean del Cinque ; mais tous l’appelaient Pinzone, et il s’y était déjà si bien habitué qu’il s’appelait Pinzone lui-même.
De très haute taille, il était d’une maigreur effrayante ; et, mon Dieu ! il aurait été encore plus grand, si son buste, tout d’un coup, comme fatigué de monter, ne s’était courbé sous la nuque en une gibbosité discrète, d’où le cou paraissait sortir péniblement, comme celui d’un poulet plumé, avec une grosse pomme protubérante qui montait et descendait. Pinzone s’efforçait souvent de retenir ses lèvres entre ses dents, comme pour mordre, châtier et cacher un rire tranchant, qui lui était propre ; mais ses efforts restaient en partie vains, parce que ce petit rire, ne pouvant s’échapper par les lèvres ainsi emprisonnées, le faisait par les yeux, plus aigu et plus impertinent que jamais.
Avec ces petits yeux il devait voir dans la maison bien des choses que ni notre mère ni nous ne voyions. Il n’en disait rien, peut-être parce qu’il n’estimait pas que ce fût son devoir de parler ou parce que – comme il me semble aujourd’hui plus probable – il se réjouissait en secret, le serpent !
Nous faisions de lui tout ce que nous voulions ; il nous laissait faire ; mais ensuite, comme s’il eût voulu rester en paix avec sa propre conscience, au moment où nous nous y attendions le moins, il nous trahissait.
Un jour, par exemple, notre mère lui ordonna de nous conduire à l’église ; Pâques était proche et nous devions nous confesser. Après la confession, une toute petite visite à la femme infirme de Malagna et vite à la maison. Pensez un peu quel divertissement ! Mais à peine dans la rue, nous proposâmes à Pinzone une escapade ; nous lui paierions un bon litre de vin à condition qu’au lieu de l’église et de Malagna il nous laissât aller à l’Épinette chercher des nids. Pinzone accepta, tout heureux, en se frottant les mains. Il but ; nous allâmes à la ferme : il fit le fou avec nous pendant trois bonnes heures, nous aidant à grimper aux arbres, y grimpant lui-même. Mais, le soir, de retour à la maison, à peine notre mère lui eut-elle demandé si nous avions fait notre confession et la visite à la Malagna :
– Voilà, je vais vous dire…, répondit-il le plus effrontément du monde.
Et, de fil en aiguille, il raconta tout ce que nous avions fait.
Et les vengeances que nous prenions de ses trahisons ne servaient à rien. Pourtant je me rappelle, que, quand nous nous y mettions, ce n’était pas pour rire.
Combien avec un tel précepteur nous devions progresser dans nos études, on l’imaginera sans peine. La faute pourtant n’en était pas toute à Pinzone, au contraire ; pourvu qu’il nous fît apprendre quelque chose, il ne regardait pas aux méthodes et aux disciplines et recourait à mille expédients pour arrêter notre attention. Il y réussissait souvent avec moi, qui étais de nature très impressionnable. Mais il avait une érudition à lui, toute particulière, curieuse et fantasque. Il était par exemple très versé dans les calembours ; il connaissait la poésie macaronique ; il citait des allitérations, des onomatopées et des corrélatifs de tous les poètes gâte-métier ; il composait lui-même nombre de rimes extravagantes.
Ma mère était convaincue que ce que nous enseignait Pinzone pouvait suffire à nos besoins. D’un tout autre avis était tante Scholastique, qui – ne réussissant pas à coller à ma mère le Pomino de son cœur – s’était mise à nous persécuter, Berto et moi ; mais nous, forts de la protection de notre mère, nous ne l’écoutions pas, et elle s’irritait si terriblement que, si elle l’avait pu sans se faire voir ni entendre, elle nous aurait certainement battus jusqu’à nous enlever la peau. Je me souviens qu’une fois, se sauvant, comme à l’ordinaire, furieuse, elle vint donner sur moi dans une des pièces abandonnées ; elle m’attrapa par le menton, me le serra de toutes ses forces entre ses doigts, en me disant : « Mon chéri ! mon chéri ! mon chéri ! » et en rapprochant de plus en plus, à mesure qu’elle parlait, mon visage du sien, les yeux dans les yeux, pour finir par émettre une sorte de grognement et par me lâcher, en rugissant entre ses dents :
– Museau de chien !
C’est surtout à moi qu’elle en avait, à moi qui pourtant m’appliquais aux étranges enseignements de Pinzone sans comparaison plus que Berto, mais ce devait être ma face placide et irritante et ces grosses lunettes rondes qu’on m’avait imposées pour me redresser un œil, lequel je ne sais pourquoi, avait tendance à regarder pour son compte, autre part.
C’était pour moi, ces lunettes, un vrai martyre. Au point qu’un jour je les envoyai promener et laissai l’œil libre de regarder où il lui plairait. D’ailleurs, même droit, cet œil ne m’aurait pas rendu beau. Il était plein de santé et cela me suffisait.
À dix-huit ans, j’eus la face envahie par une forêt de poils roussâtres et crépus, au grand dam de mon nez plutôt petit, qui se trouva comme perdu entre eux et mon front spacieux et grave.
Peut-être, s’il était au pouvoir de l’homme de se choisir un nez approprié à sa face, ou, si, en voyant un pauvre homme accablé par un nez trop gros pour son mince visage, nous pouvions lui dire : « Ce nez me va, et je le prends pour moi », peut-être, dis-je, aurais-je changé le mien volontiers, et aussi mes yeux et tant d’autres choses de ma personne. Mais, sachant bien que c’est impossible, je me résignais à mes traits et je ne m’en souciais pas plus que cela.
Berto, au contraire, beau de corps et de visage (au moins comparé à moi), ne pouvait se détacher du miroir et se lissait et se caressait et dépensait sans compter pour les cravates les plus nouvelles, pour les parfums les plus exquis et pour le linge et le vêtement. Pour le faire enrager, je pris un jour dans sa garde-robe une jaquette flambant neuve, un très élégant gilet de velours noir, un chapeau haut de forme, et je m’en allai à la chasse ainsi paré.
Batta Malagna, cependant, s’en venait déplorer près de ma mère les mauvaises années qui le contraignaient à contracter des dettes fort onéreuses pour pourvoir à nos dépenses excessives et aux nombreux travaux de réparation, dont les fermes avaient continuellement besoin.
– Encore une belle tuile qui nous tombe ! disait-il chaque fois en entrant.
La neige avait détruit les oliviers en fleurs, aux Deux-Rivières, ou bien le phylloxéra avait ravagé les vignes de l’Éperon. Il fallait recourir aux plants américains, résistant au mal. Donc, autres dettes. Puis le conseil de vendre l’Éperon, pour se délivrer des « vautours » qui l’assiégeaient. Et ainsi furent vendus d’abord : l’Éperon, puis les Deux-Rivières, puis San-Rocchino. Restaient les maisons et le domaine de l’Épinette, avec le moulin. Ma mère s’attendait à ce qu’il vînt un jour lui dire que la source s’était tarie.
Nous fûmes, il est vrai, paresseux, et dépensâmes sans mesure ; mais il n’en est pas moins vrai qu’un voleur plus voleur que Batta Malagna ne naîtra jamais plus sur la face de la terre. C’est le moins que je puisse lui dire, en considération de la parenté que je fus amené à contracter avec lui.
Il eut l’air de ne nous faire manquer jamais de rien, tant que vécut ma mère. Mais cette aisance, cette liberté poussée jusqu’au caprice, dont il nous laissait jouir servait à cacher l’abîme qui, ensuite à la mort de ma mère, m’engloutit tout seul, car mon frère eut la chance de contracter à temps un mariage avantageux.
Mon mariage, au contraire…
– Il faudra pourtant que j’en parle, eh ! don Eligio, de mon mariage ?
Grimpé là-haut, sur son échelle de lampiste, don Eligio Pellegrinotto me répond :
– Et comment donc !
Courage, donc ; en avant !
IV. CE FUT AINSI
Un jour, à la chasse je m’arrêtai étrangement impressionné, devant un tas de gerbes, court et pansu, dont le bâton central était surmonté d’une casserole.
– Je te connais, lui disais-je, je te connais… Puis, tout à coup, je m’écriai :
– Tiens ! Batta Malagna.
Je pris une fourche, qui traînait là par terre, et je la lui plantai dans la panse avec tant de volupté, qu’il s’en fallut de peu que la casserole ne tombât. Et voilà mon Batta Malagna, quand, suant et soufflant, il portait son chapeau en casseur d’assiettes.
Tout glissait en lui : ses sourcils et ses yeux glissaient de-ci de-là sur sa longue face ; son nez glissait sur ses moustaches niaises et sur sa barbiche ; ses épaules glissaient depuis la jointure du cou ; sa panse énorme et flasque glissait presque jusqu’à terre, car, vu la proéminence qu’elle formait sur ses jambes cagneuses, le tailleur, pour l’habiller, était forcé de lui tailler des pantalons démesurément larges, de sorte que de loin il semblait avoir endossé, beaucoup trop bas, une veste dont la panse lui arrivait aux pieds.
Maintenant, comment, avec une face et un corps ainsi bâtis, Malagna pouvait-il être aussi voleur ? Je ne sais. Même les voleurs, j’imagine, doivent avoir une certaine surface qu’il ne me paraissait pas avoir. Il allait tout doucement, avec ce bedon pendant, toujours les mains derrière le dos, et semblait peiner infiniment pour émettre cette voix molle et miaulante ! Il me plairait de savoir comment il mettait sa conscience d’accord avec les larcins qu’il perpétrait continuellement à notre préjudice. Il n’en avait nul besoin. Il lui fallait donc bien se donner à lui-même une raison, une excuse… Peut-être, tout simplement, volait-il pour se distraire un peu, le pauvre homme ?
Car, dans son intérieur, il devait être épouvantablement affligé d’une de ces épouses qui savent se faire respecter.
Il avait commis l’erreur de choisir une femme de rang supérieur au sien, qui était fort bas. Or cette femme, mariée à un homme de condition égale à la sienne, n’aurait peut-être pas été aussi insupportable qu’elle l’était avec lui, à qui naturellement elle devait démontrer, à la moindre occasion, qu’elle était de bonne naissance et que chez elle on faisait ainsi et ainsi. Et voilà mon Malagna docile à faire ainsi et ainsi, comme elle disait, pour paraître un monsieur lui aussi. Mais il lui en coûtait tant ! Il suait toujours, il suait !
Par surcroît, madame Guendoline, peu après le mariage, fut prise d’un mal dont elle ne put jamais guérir, car, pour en guérir, elle aurait dû faire un sacrifice supérieur à ses forces : se priver, ni plus ni moins, de certains gâteaux aux truffes, qu’elle aimait tant, et d’autres semblables gourmandises, et même, et avant tout, de vin. Non qu’elle en bût beaucoup, madame Guendoline ; pensez donc : elle était de noble naissance ; mais elle n’en aurait pas dû boire même un doigt.
Berto et moi, tout gamins, étions parfois invités à déjeuner par Malagna. C’était un plaisir de l’entendre faire, avec tous les égards convenables, un sermon à sa femme sur la continence, tandis que lui mangeait, dévorait avec volupté les mets les plus succulents :
– Je n’admets pas – disait-il – que pour le plaisir momentané qu’éprouve le gosier au passage d’un morceau, par exemple, comme celui-ci (et il avalait le morceau) on puisse se faire mal pour une journée entière. La belle affaire ! Pour moi, je suis sûr que je m’en sentirais, ensuite, profondément avili. Rosine ! (il appelait la servante) donne-m’en encore un peu. Excellente, cette sauce mayonnaise !
– En attendant, éclatait son épouse, piquée au vif, en s’agitant sur sa chaise, je te ferai observer qu’il est de bien mauvais goût de parler la bouche pleine.
Malagna restait mal à l’aise ; il avalait la bouchée rendue amère et disait, en se nettoyant la bouche :
– Tu as raison, chère amie.
– Et puis, poursuivait la dame, merci bien ! Tu parles ainsi parce que tu es sûr que rien ne te fait mal. Je voudrais te voir si tu avais un estomac de papier mâché, comme celui que je me suis fait, moi. Tiens, le Seigneur devrait t’en faire tâter ! Tu apprendrais ainsi à avoir un peu de considération pour ton épouse.
– Comment, Guendoline ! Est-ce que je n’en ai pas ? se récriait Malagna.
– Mais oui, beaucoup ! Veux-tu te taire ! Si tu aimais vraiment ton épouse, si tu t’intéressais un tant soit peu à sa santé, sais-tu comment tu devrais faire ? Comme cela…
Elle se levait de sa chaise, lui prenait des mains son verre et allait verser le vin par la fenêtre !
– Comme cela !
– Et pourquoi ? demandait Malagna, restant là, ahuri.
– Pourquoi ? Parce que pour moi, c’est du poison ! Et chaque fois que tu m’en vois verser un doigt dans mon verre, tu devrais me le prendre des mains et aller le jeter par la fenêtre, comme j’ai fait, comprends-tu ?
Malagna mortifié, souriant, regardait un peu Berto, un peu moi, un peu la fenêtre, puis disait :
– Oh ! Mon Dieu ! mais es-tu donc une gamine ? Moi, par la violence ? Mais non, chère amie ; c’est toi, toi, toute seule, avec ta raison, qui dois t’imposer le frein…
– Oui, concluait sa femme, oui, avec la tentation sous les yeux, en te regardant boire d’autant, et le savourer et le regarder à contre-jour pour me dépiter. Veux-tu te taire, te dis-je ! Si tu étais un autre mari, pour ne pas me faire souffrir…
Eh bien ! Malagna en arriva là : il ne but plus de vin pour donner un exemple de continence à sa femme, pour ne pas la faire souffrir.
Et puis, il volait… Eh ! parbleu ! Il fallait pourtant bien qu’il fît quelque chose.
Cependant, peu après, il vint à savoir que madame Guendoline le buvait en cachette, elle, son vin. Comme si, pour que cela ne lui fît point de mal, il pouvait suffire que son mari ne s’en aperçût point. Et alors, lui aussi, Malagna, se remit à boire, mais au-dehors, pour ne pas mortifier sa femme.
Il continua toutefois à voler, c’est vrai. Mais je sais qu’il désirait de tout son cœur que sa femme lui donnât une compensation aux afflictions sans fin qu’elle lui ménageait ; il désirait qu’un beau jour elle se résolût à lui mettre au monde un fils. Voilà ! Le vol aurait eu alors un but, une excuse. Que ne fait-on pas pour le bien de ses enfants ?
Sa femme pourtant dépérissait de jour en jour et Malagna n’osait même pas lui exprimer son désir le plus ardent. Peut-être était-elle aussi stérile, de nature. Il fallait avoir tant d’égards pour son mal ! Si ensuite elle allait mourir en couches, grands dieux ?…
Ainsi, il se résignait.
Était-il sincère ? Il ne le prouva pas à la mort de madame Guendoline. Il la pleura, oh ! Il la pleura beaucoup, et il en garda le souvenir avec une dévotion si respectueuse qu’il ne voulut plus mettre à sa place une autre dame, – comment donc ! – et il l’aurait bien pu, riche comme il était déjà ; mais il prit la fille d’un fermier de campagne, saine, florissante, robuste et allègre, et cela uniquement pour qu’il ne pût être douteux qu’il n’en dût avoir le rejeton désiré. S’il se hâta un peu trop, bah !… Il faut pourtant considérer qu’il n’était plus un jeune homme et n’avait pas de temps à perdre.
Olive, la fille de Pierre Salvoni, notre fermier aux Deux-Rivières, je la connaissais bien depuis son enfance.
Grâce à elle, que d’espérance je fis concevoir à ma mère ; si j’allais devenir sérieux et prendre goût à la campagne ! Elle en était aux anges, de cette consolation, la pauvrette ! Mais, un jour, la terrible tante Scholastique lui ouvrit les yeux :
– Et ne vois-tu pas, sotte, qu’il va toujours aux Deux-Rivières ?
– Oui, pour la récolte des olives.
– D’une olive, d’une olive, d’une seule olive, nigaude !
Ma mère me fit alors une mercuriale soignée :
– Garde-toi bien d’induire en tentation et de perdre pour toujours une pauvre fille ! etc.
Mais il n’y avait pas de danger. Olive était honnête, d’une honnêteté inébranlable, parce que enracinée dans la conscience du mal qu’elle se ferait en cédant. C’était justement cette conscience qui lui enlevait toutes ces fades timidités de pudeurs feintes, et la rendait hardie et libre.
Comme elle riait ! Deux cerises, ses lèvres. Et quelles dents ! Mais, de ces lèvres, pas même un baiser ; des dents, oui, quelques morsures, pour me punir, quand je lui donnais un baiser sur les cheveux.
Rien de plus.
À présent, si belle, si jeune et si fraîche, épouse de Batta Malagna… Eh ! qui a le courage de tourner le dos à certaines fortunes ? Et pourtant Olive savait bien comment Malagna était devenu riche ! Elle m’en disait tout le mal possible, un jour ; et puis, justement pour cette richesse, elle l’épousa.
Cependant, il se passa un an après les noces ; il s’en passa deux, et pas de fils.
Malagna, ancré depuis si longtemps dans la conviction que, s’il n’en avait pas eu de sa première femme, c’était seulement à cause de la stérilité de celle-ci, commença à tenir rigueur à Olive.
Il attendit encore un an, le troisième, en vain. Alors il commença à la rabrouer ouvertement, et, à la fin, après une autre année, désespérant cette fois pour toujours, au comble de l’exaspération, il se mit à la malmener sans aucune retenue, lui criant dans la figure qu’avec cette apparence florissante elle l’avait trompé, trompé, trompé ; que c’était seulement pour avoir d’elle un enfant qu’il l’avait élevée jusqu’à cette situation, occupée autrefois par une dame, une vraie dame, à la mémoire de laquelle, si ce n’eût été pour cela, il n’aurait jamais fait un tel tort.
La pauvre Olive ne répondait pas ; elle venait souvent s’épancher avec ma mère, qui l’engageait avec de bonnes paroles à espérer encore, car enfin elle était jeune, si jeune !
– Vingt ans ?
– Vingt-deux…
– Eh bien ! donc ! On avait vu plus d’une fois avoir des enfants même après vingt ans de mariage. Quinze ? Mais lui était déjà vieux, et si…
Olive, en se mariant, s’était juré à elle-même de se conserver honnête, et elle ne voulait pas, même pour retrouver la paix, manquer à son serment.
Comment sais-je ces choses ? Oh ! Parbleu ! Comment je les sais !… N’ai-je pas dit qu’elle venait s’épancher chez nous ? N’ai-je pas dit que je la connaissais depuis son enfance ? Et, à présent, je la voyais pleurer à cause de l’indigne façon d’agir de ce vilain vieillard.
Pourtant, je m’en consolai vite. J’avais alors, ou je croyais avoir (ce qui revient au même), tant de choses en tête ! J’avais aussi de l’argent, ce qui – outre le reste – fournit encore certaines idées qu’on n’aurait pas sans cela. J’avais pour m’aider à le dépenser Jérôme Pomino, qui n’en était jamais pourvu à suffisance, grâce à la sage parcimonie paternelle.
Mino était comme notre ombre : la mienne et celle de Berto tour à tour ; il se transformait avec une facilité simiesque merveilleuse, selon qu’il fréquentait Berto ou moi. Quand il s’attachait à Berto, il devenait tout à coup un damoiseau, et alors son père, qui avait lui aussi des velléités d’élégance entrouvrait un peu son sac. Mais avec Berto cela durait peu. À se voir imité jusque dans sa démarche, mon frère perdait tout de suite patience, peut-être par peur du ridicule, et il le maltraitait jusqu’à ce qu’il en fût débarrassé. Alors Mino revenait s’attacher à moi, et son père de resserrer les cordons du sac.
J’avais plus de patience avec lui, parce que je prenais plaisir à m’amuser de lui. Puis je m’en repentais. Je reconnaissais avoir, à cause de lui, forcé ma nature dans quelques entreprises ou exagéré la démonstration de mes sentiments pour le plaisir de l’étourdir ou de le pousser dans des embarras dont naturellement je souffrais, moi aussi, les conséquences.
Or, Mino, un jour, à la chasse, à propos de Malagna, dont je lui avais raconté les prouesses matrimoniales, me dit qu’il avait jeté les yeux sur une jeune personne, fille d’une cousine de Malagna justement, pour laquelle il aurait volontiers commis quelque sottise. Il en était capable ; d’autant plus que la jeune fille ne paraissait pas farouche ; mais jusqu’à présent, il n’avait même pas trouvé le moyen de lui parler.
– Tu n’en auras pas eu le courage, parbleu ! lui dis-je en riant.
Mino nia, mais rougit un peu trop en riant.
– J’ai parlé pourtant avec la servante, se hâta-t-il d’ajouter. Et j’en ai su de belles, tu sais ? Elle m’a dit que ton Malagna était chez elles, et qu’à son air, il lui semblait méditer quelque vilain tour, d’accord avec la cousine, qui est une vieille sorcière.
– Quel tour ?
– Eh ! Elle dit qu’il va là pleurer son infortune de n’avoir pas d’enfants. La vieille dure, renfrognée, lui répond que c’est bien fait. Il paraît qu’à la mort de la première femme de Malagna, elle s’était mis en tête de lui faire épouser sa propre fille, et s’était employée de toutes les manières pour y réussir. À présent, enfin, que le vieux manifeste tant de repentir de ne l’avoir pas écoutée, qui sait quelle autre idée perfide cette sorcière pouvait avoir conçue ?
Je me bouchai les oreilles avec les mains en criant à Mino :
– Tais-toi.
Tout naïf que j’étais alors pourtant, – ayant connaissance des scènes qui s’étaient produites et se produisaient chez Malagna, – je pensai que le soupçon de la servante pouvait être fondé dans une certaine mesure, et je voulus voir, pour le bien d’Olive, si je réussirais à éclaircir un peu la situation. Je me fis donner par Mino l’adresse de cette sorcière. Mino se recommanda à moi pour la jeune fille.
– N’aie pas peur ! lui répondis-je.
Et le lendemain, sous le prétexte d’une traite échue le matin même, comme je l’avais su par hasard de ma mère, j’allai dénicher Malagna dans la maison de la veuve Pescatore.
J’avais couru exprès, et je me précipitai à l’intérieur tout échauffé et en sueur.
– Malagna, la traite !
Si je n’avais pas su déjà qu’il n’avait pas la conscience nette, je m’en serais aperçu sans doute possible ce jour-là, en le voyant se lever d’un bond, tout pâle, décomposé, balbutiant :
– Quelle… quelle tr…, quelle traite ?
– La traite échue aujourd’hui… C’est maman qui m’envoie ; elle en est bien en peine.
Batta Malagna retomba assis, exhalant en un « ah ! » interminable toute la terreur qui, pour un instant l’avait oppressé.
– Mais c’est fait !… tout est fait !… Bon Dieu ! quelle secousse !… Je l’ai renouvelée, eh ! à trois mois, en payant les intérêts, naturellement. Tu as fait cette course pour si peu ?
Et il rit, rit, faisant sursauter sa bedaine ; il m’invita à m’asseoir, me présenta aux dames.
– Mathias Pascal, Marianne Dondi, veuve Pescatore ; Romilda, sa fille, et… ma nièce.
Il voulut que, pour me remettre de ma course, je busse quelque chose.
– Romilda, si cela ne te dérange pas…
Comme s’il eût été chez lui.
Romilda se leva, en regardant sa mère pour prendre conseil dans ses yeux, et, un instant après, malgré mes protestations, revint avec un petit plateau sur lequel étaient un petit verre et une bouteille de vermout. Aussitôt, à cette vue, sa mère se leva, dépitée, lui disant :
– Mais non ! mais non ! Donne ici !
Elle lui prit le plateau des mains et sortit pour rentrer au bout d’un instant avec un autre plateau de laque, flambant neuf, qui supportait un magnifique service à liqueurs : un éléphant argenté, un tonneau de verre sur l’échine et un grand nombre de petits verres suspendus tout autour qui tintaient.