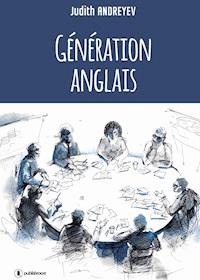
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un récit d'aventures linguistiques !
Laure Anselme, psychologue française, apprend avec plaisir qu’elle est invitée à présenter son travail dans une conférence à New York. Seulement, la conférence se déroulera en anglais, et elle est saisie de panique à l’idée de parler anglais en public – elle ne se souvient plus d’aucune règle de grammaire, elle prononce mal, elle a peur de se rendre ridicule – donc elle hésite. Mais plutôt que d’y renoncer, elle décide de reprendre l’anglais à zéro, passant d’abord par des lectures à la bibliothèque, où elle se demande si la grammaire n’est peut-être qu’un roman, ensuite par une école de langues bien sympathique mais dont le résultat laisse à désirer, et se confie à la fin aux soins d’un professeur privé qui, malgré sa manière farouche, finit par l’aider à surmonter ses angoisses et à parler « correctement ».
Cette fiction se développe dans un contexte familial et social où chacun des personnages vit à sa manière les conséquences, souvent intimes, de la « génération anglais ».
EXTRAIT
Pour revenir à l’anglais ‒ mais sans approfondir les raisons pour lesquelles (d’ailleurs vous pouvez les deviner), malgré des années d’analyse, j’ai appelé ma mère en premier pour une grammaire anglaise ‒ ce que je voudrais souligner en premier lieu, c’est que c’est tout de même mon travail de psychothérapeute qui m’a permis de dire oui à l’expérience redoutable d’affronter un public dans une langue que je ne parlais pas ‒ enfin, que je ne parlais pas
encore. C’est que les patients (selon les cas et l’humour du moment je les appelle patients, malades, familles et même « mes fous », ce dernier étant le plus gai, surtout le plus universel et innocent) constituent un tremplin formidable pour aller de l’avant ‒
to move on, comme j’ai souvent entendu dire par les psys américains. La preuve, c’est que ce fut suite à mes trois entretiens du matin ‒ le premier avec Anna, 14 ans (double sa quatrième, fait des fugues, parents alcooliques), puis avec Frédéric, 11 ans (mère abusive, père absent, persécute son petit frère de 9 ans, ne travaille pas à l’école), et pour finir, la famille Denis (couple insatisfait, n’ont pas pu avoir d’autres enfants, espèrent tout de leur fils Pascal, 8 ans, asthmatique, comportement antisocial à l’école) ‒ que j’ai pris spontanément la décision d’accepter l’invitation de New York et, coûte que coûte, de reprendre l’anglais à zéro.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Judith Andreyev, née à New York mais ayant fait de Paris sa ville adoptive, est bien connue des élèves et étudiants comme l’auteure des ouvrages d’anglais devenus des classiques,
Journal’ease, et
Say it with Style. Avec une carrière de trente ans dans l’enseignement à tous les niveaux et pour tous les publics, elle nous livre ici un mélange de faits et de fiction, le tout épicé de réflexions diverses et d’une transformation savoureuse des fautes d’anglais en fautes de français et vice versa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Judith Andreyev
Génération anglais
Mes remerciements à Catherine Perrel d’avoir pris soin du français de la narratrice et de l’anglo-français de ses co-stagiaires à Welcome. Rassurez-vous, lecteurs et lectrices, ces derniers sont fictifs (dans la mesure du possible...), comme tous les autres personnages de l’histoire.
L’invitation
C’était le matin du 22 octobre 2002. Encore un peu endormie, je prenais mon petit déjeuner en triant distraitement le courrier de la veille lorsque mon regard tombe sur une enveloppe qui se distingue des autres par sa forme allongée et un timbre des USA. Je la déchire et déplie le contenu à l’entête suivante :
« Institute for the Study of Emotional Disturbances in Adolescents, 444 Sixth Avenue, New York City 10026. »
La lettre est en anglais et m’est adressée personnellement. Je la reproduis ici, ainsi que les réactions que j’ai eues sur le moment, alors que j’étais loin d’imaginer les bouleversements qui allaient suivre.
« Dear Ms. Anselme,
I have just read with interest your article “La résilience : un regard sur la thérapie par la parole” in the June issue of “Problèmes de Psychothérapie”, and on behalf of our institute I would like to invite you to give an introductory talk on your work at our annual conference in New York, April 16-18 2003.1 »
Je me sens rougir de plaisir. Est-il vraiment possible qu’on ait lu un article de moi aux États-Unis ? Qu’on m’invite à un colloque ? Je prends ma tasse de café et poursuis la lecture…
« The focus of the talk is at your discretion, but we suggest, broadly speaking of course, relating it to the central theme of the week, “Recovering from a Traumatic Childhood”. Each 45-minute talk will be followed by a 15-minute question period, after which speakers will be expected to lead a one-hour workshop.2 »
Oui, d’accord…
« The aim of this colloquium is to become acquainted with experiences and approaches to the psychology of adolescents in other parts of the world, and for that purpose we have invited (along with American specialists) participants from Europe and South America.3 »
Les Américains s’intéresseraient-ils à notre préférence très française pour la parole ? Commenceraient-ils à avoir des doutes sur les médicaments ?… bien sûr que je veux partager avec eux mon expérience. Avec un mélange de joie et d’incrédulité je continue à lire…
« As our budget does not permit simultaneous interpretation, we request that you make your presentation in English. I trust this will be no problem for you.4 »
… no problem for you… je relis encore une fois… we request that you make your presentation in English. I trust this will be no problem for you. Soudain je sens mon cœur qui fait du cent à l’heure… we request that you make your presentation in English. I trust this will be no problem for you.
Ensuite le tarif :
« we regret that we are unable to pay for your trip, but…5 »
Je passe sur les détails…
« Please let us know as soon as possible whether we can count on your participation.
Looking forward to hearing from you,
Yours sincerely,
Bertram Hepburn, Institute for the Study of Emotional Disturbances in Adolescents, (ISEDA6) »
Je n’ai jamais eu le don d’exprimer par écrit mes états d’âme, mais je vais essayer de vous communiquer la terreur qui m’a saisie à l’idée de faire une présentation en anglais, car il s’agissait vraiment de terreur. En l’espace d’une seconde je me revois en cours d’anglais au lycée, j’entends appeler, « Laure ? » je lève la tête, regarde la prof comme un enfant qui ne sait pas ce qu’on veut de lui ‒ je vais dire une bêtise, tomber dans un piège, je balbutie quelque chose, j’ai l’impression que tout le monde se moque de moi, c’est le cauchemar, j’ai le cœur qui tambourine…
Je serre ma tasse de café, froid maintenant. Ai-je encore le temps d’en refaire avant de partir ? Non, pas vraiment. Il faut que je me dépêche pour aller au travail. Déjà 8 heures 10. C’est tout de même flatteur d’être invitée ‒ seulement, we request that you make your presentation in English… comment faire ? Depuis vingt ans que j’ai fini mes études, lire l’anglais je peux, mais parler ?! J’ai complètement occulté tout ça, l’idée qu’un jour il faudrait peut-être revivre ce cauchemar ! Et puis cette lettre qui arrive et me dit nonchalamment we request that you make your presentation in English ‒ comme si ça allait de soi ! We trust this will be no problem for you. No problem ?! Autant me mettre à poil devant la classe ! Je ne sais plus la moindre règle de grammaire ! Plus un mot de vocabulaire ! Même si je fais traduire ma présentation, je n’arriverai jamais à me faire comprendre avec ma prononciation minable ! Et comment répondre aux questions, mener un workshop en anglais ?
Impossible, je m’entends dire, je n’irai pas, je regrette mais j’ai un autre engagement. Je plie la lettre, la fourre dans l’enveloppe et avale le reste du café, rince la tasse et balaye quelques miettes dans le creux d’une main. Dans la salle de bain je m’installe devant la glace, me maquille, retrouve mon regard équilibré de psy. Je prends mon sac, enfile ma veste et claque la porte derrière moi. De quel droit obliger tout le monde à parler anglais, j’ai autre chose à faire, moi.
Cependant mon inconscient, ruminant à sa guise, ne manque pas l’occasion de me rappeler à l’ordre, et quelques heures plus tard je me surprends, seule dans mon bureau, en train d’appeler ma mère.
–Allô, maman ? tu peux me rendre un petit service ?
–Bien sûr, c’est quoi ?
Elle a la voix sûre d’elle d’une mère heureuse de croire que sa fille a encore besoin d’elle. Tant mieux, je pense.
–Tu peux regarder s’il y a mes livres d’anglais à la maison ?
–Tes livres d’anglais ? Pourquoi ? Tu te remets à l’anglais maintenant ?
J’hésite avant de répondre. À la retraite depuis un an, elle déprime, c’est elle qui a soudain besoin de moi.
–Je dois aller à New York. On m’a invitée pour un colloque.
J’essaie de répondre d’un ton naturel, comme s’il s’agissait d’encore une réunion pénible quelque part. Sans doute aurais-je dû dire autre chose, pour aider mon fils, n’importe quoi mais pas ça.
–Ah bon ? alors en effet, c’est obligatoire. Les Américains ne parlent pas français, ni aucune autre langue paraît-il, à peine la leur.
Ma mère avait été prof de français, ce qui ne la mettait pas au-dessus d’un certain type de chauvinisme. Cela dit, sans faire exprès, elle me donnait de l’espoir. Bêtement, je dis :
–Ah bon ? tu veux dire qu’ils ne parlent pas grammaticalement…
–Ils ne savent même pas ce que c’est que la grammaire, rebondit-elle avec dédain. Il paraît que ça fait des années qu’ils ne l’enseignent plus à l’école. Tu peux être contente d’être Française.
Je ne lui demande pas d’où elle tient cette information, qui de toute façon ne me sert à rien puisque je n’ai même pas assez de vocabulaire pour faire une phrase. D’ailleurs, je dois faire court pour ne pas lui donner un prétexte pour me rappeler mes années peu brillantes du lycée.
–Regarde quand même, je ne me souviens plus du nom du bouquin mais n’importe quoi m’ira, c’est juste pour me rafraîchir la mémoire. Je te rappellerai plus tard.
–Si tu y tiens, dit-elle, de ce ton résigné qu’elle avait élaboré à mon égard depuis deux décennies. Je vais regarder dans ta chambre.
J’ai beau avoir fini des études supérieures, avoir publié des articles et avoir un fils de 16 ans, pour ma mère je serai toujours une élève, une mauvaise élève même.
Ici, je vais vous parler brièvement d’elle et de moi. Vous pouvez sauter cette partie si cela vous paraît superflu, mais vous savez comme moi que surtout pour une psy, tout a de l’importance, la famille en particulier.
Ma mère a dit : « Je vais regarder dans ta chambre. » Je n’y ai pas vécu depuis vingt ans et pourtant pour ma mère, cette chambre, qui sert maintenant de débarras pour toutes sortes de vieilleries ‒ objets disparates dont elle ne sait pas quoi faire, meubles cassés dans l’attente d’un menuisier pas trop cher, mon ancien bureau et mes livres de jeunesse, et bientôt très probablement le meuble classeur portant le poids de ses trente ans d’enseignement du français ‒ cette chambre s’appelle encore « ta chambre ». Par moments je me demande si elle ne devrait pas l’appeler ouvertement le débarras, comme dans « bon débarras », mais à d’autres je me dis que cette pièce est restée « ta chambre » plutôt par nostalgie, peut-être même par regret d’une relation mère-fille qui était tout sauf parfaite. En tout cas, voilà où nous en étions au moment où je l’ai appelée, celui du retour inattendu de l’anglais de ma vie.
Je ne veux pas non plus vous donner une fausse impression d’elle, c’est seulement qu’à ce moment-là elle souffrait des effets déstabilisants de la retraite. Elle a toujours été quelqu’un qui ne se plaignait pas, qui aimait le travail et respectait un travail bien fait, et si je me suis accrochée comme je l’ai fait dans ce qui va suivre, c’est un peu grâce à elle, même indirectement. Quand on a une mère qui est prof de français, même prof tout court ‒ cela dit, les profs de français sont particulièrement sûrs d’eux, comme si tout ce qui était français, tout ce qui était connaissance même, leur appartenait personnellement ‒ bref quand on a une mère qui croit, et, pour tenir sa classe, doit, tout savoir, on s’accroche ou on meurt, du moins psychiquement. J’en connais d’autres qui ont fait la même expérience que moi, des filles qui, comme moi, ont fait des thérapies ou des analyses et sont devenues psys, d’autres qui se sont échappées en allant vivre aux antipodes et encore d’autres qui, miraculeusement, ont couronné leur révolte en devenant profs à leur tour.
Pour terminer, au cas où vous vous seriez déjà posé une question clé, côté couple, mon père, prof d’allemand, est parti à Hambourg refaire sa vie avec une Allemande quand j’avais 11 ans et ma mère vit seule depuis ; le père de mon fils, prof de philo, est parti (seul, lui) cultiver des plantes aromatiques dans le Midi quand David était encore tout jeune. À la défense des deux hommes (et à l’honneur de ma mère), j’ajoute qu’il est extrêmement stressant d’être prof, bien plus que d’être psy comme moi, ne serait-ce que parce que le plus souvent un psy ne voit qu’un malade à la fois, alors qu’une classe peut en contenir huit ou dix en plein chaos existentiel en plus d’une vingtaine de soi-disant « normaux ». N’empêche que certains voient la « faute » de notre côté, comme le mari d’une amie de la fac par exemple, qui prétend que ces abandons successifs laissent supposer quelque gène que j’aurais hérité de ma mère. Lui bien sûr, à sa troisième femme, ne se sent concerné en rien. D’ailleurs, ceux qui me connaissent savent que, sans que ce soit une obsession, j’ai tout de même l’espoir de refaire ma vie un de ces jours.
Pour revenir à l’anglais ‒ mais sans approfondir les raisons pour lesquelles (d’ailleurs vous pouvez les deviner), malgré des années d’analyse, j’ai appelé ma mère en premier pour une grammaire anglaise ‒ ce que je voudrais souligner en premier lieu, c’est que c’est tout de même mon travail de psychothérapeute qui m’a permis de dire oui à l’expérience redoutable d’affronter un public dans une langue que je ne parlais pas ‒ enfin, que je ne parlais pas encore. C’est que les patients (selon les cas et l’humour du moment je les appelle patients, malades, familles et même « mes fous », ce dernier étant le plus gai, surtout le plus universel et innocent) constituent un tremplin formidable pour aller de l’avant ‒ to move on, comme j’ai souvent entendu dire par les psys américains. La preuve, c’est que ce fut suite à mes trois entretiens du matin ‒ le premier avec Anna, 14 ans (double sa quatrième, fait des fugues, parents alcooliques), puis avec Frédéric, 11 ans (mère abusive, père absent, persécute son petit frère de 9 ans, ne travaille pas à l’école), et pour finir, la famille Denis (couple insatisfait, n’ont pas pu avoir d’autres enfants, espèrent tout de leur fils Pascal, 8 ans, asthmatique, comportement antisocial à l’école) ‒ que j’ai pris spontanément la décision d’accepter l’invitation de New York et, coûte que coûte, de reprendre l’anglais à zéro.
À 16 heures, j’ai rappelé ma mère :
–Allô, maman, t’as trouvé quelque chose ?
–Eh bien non, tes livres à toi je ne les ai pas trouvés, mais figure-toi que j’ai gardé les miens et je peux te les passer si tu veux. Remarque, l’anglais s’est beaucoup détérioré depuis mon époque, mais ça peut au moins te servir de base de grammaire.
Évidemment, il n’était pas question que je travaille dans les livres grâce auxquels ma mère avait eu son bac avec cette mention très bien dont elle me rebattait les oreilles depuis la sixième.
–Merci maman, c’est pas la peine, je me débrouillerai.
–Et David, il fait de l’anglais n’est-ce pas ? Tu peux peut-être t’entraîner avec lui ?
Entraîner, encore un mot que j’ai toujours détesté dans la bouche de ma mère. Pour elle, comme pour la population enseignante en général, tout est question d’entraînement. Comme si on était des chiens de Pavlov.
–David ? Tu veux rire ? Un jour il m’a demandé de l’aider à faire une rédaction en anglais et à deux on a eu neuf sur vingt. Ce que je veux, c’est revoir le b.a-ba. La grammaire.
–Oui oui, tu as parfaitement raison, c’est la grammaire qu’il te faut. Revoir les bases. C’est essentiel, la grammaire.
J’aurais pu l’embrasser. Pour une fois, on était d’accord.
–Alors, quand est-ce qu’on se voit, chérie ?
–Peut-être la semaine prochaine ?
Depuis qu’elle avait pris sa retraite, ma mère exprimait plus souvent l’envie de me voir. Sans doute était-elle en manque de jeunes, et je devais quand même la rassurer sur le fait qu’elle avait encore de l’autorité sur quelqu’un.
–Bon, d’accord, on se rappellera.
Puis, d’une voix plus douce, celle qu’elle réservait à son petit-fils :
–Embrasse David pour moi, chérie.
–Je n’oublierai pas, maman. À bientôt.
Et je raccrochai, un peu violemment, peut-être.
David, c’est mon fils. Seize ans, un mètre quatre-vingt, le caractère plutôt doux mais pas mou, même assez sûr de lui. Je me demande souvent comment il reçoit la tendresse de ma mère ; cette douceur nouvelle dont moi-même je n’ai jamais bénéficié, qu’elle ne possédait pas encore lorsque j’avais seize ans, mais qui est venue l’habiter plus tard à l’égard de mon fils, sans pourtant s’infiltrer dans d’autres zones de sa personnalité ‒ en tout cas pas dans celles que je connaissais, qu’elle voulait bien me montrer. Ou que je voulais bien voir. Tout cela est compliqué, et pour le moment, accessoire. Revenons à l’anglais.
1. Je viens de lire avec intérêt votre article “La résilience : un regard sur la thérapie par la parole” dans le numéro du mois de juin de la revue “Problèmes de Psychothérapie”, et de la part de notre Institut, j’aimerais vous inviter à présenter votre travail à notre colloque annuel à New York, du 16 au 18 avril 2003.
2. C’est à vous de choisir le sujet de la présentation, mais nous suggérons, en général, bien sûr, un lien avec le thème central de la semaine “Comment se rétablir après un traumatisme de jeunesse”. Chaque présentation de 45 minutes sera suivie d’une séance de questions, à la suite de laquelle le conférencier mènera un atelier d’une heure.
3. Le but de ce colloque est de découvrir des expériences et approches de la psychologie des adolescents existant ailleurs dans le monde, et c’est pourquoi nous avons invité (avec des spécialistes américains) des participants venant d’Europe et d’Amérique du Sud.
4. Notre budget ne nous permettant pas l’interprétation simultanée, nous vous demandons de faire la présentation en anglais. Je suppose que cela ne vous posera pas de problème.
5. Nous regrettons d’être dans l’impossibilité de vous payer le voyage, mais…
6. Veuillez nous dire dès que possible si nous pouvons compter sur votre participation. Dans l’attente de vous lire…
Avant-propos
Évidemment, l’histoire du colloque me tournait dans la tête – j’y pensais constamment. J’avais bien sûr très envie d’y aller, et pourtant, je n’avais pas encore confirmé à cause de l’anglais. Comment ferais-je d’ailleurs pour écrire à ce Bertram Hepburn, sans la moindre notion de grammaire ni de vocabulaire ? Je ne pouvais quand même pas répondre en français à une invitation en anglais ! Et puis je pensais à mon accent épouvantable et de nouveau la terreur m’envahissait à l’idée que j’allais me rendre ridicule devant des centaines de personnes. Peut-être, après tout, fallait-il y renoncer ? En tout cas il me semble maintenant que ma décision était déjà prise, puisque j’avais prévu d’aller le samedi suivant à la bibliothèque lire des journaux psys et me mettre au courant de ce qui se faisait dans le domaine en question, en particulier aux États-Unis.
J’adore cette nouvelle BnF, avec son ambiance utérine gris-orange, ses petits arbres et touffes de verdure qu’on voit à travers les grandes vitres. C’est un lieu bienveillant, isolé du monde, une fois à l’intérieur le temps s’arrête, on oublie tout. Un seul endroit me gratifie presqu’autant, c’est l’aire Truffaut sur la nationale 20. En arrivant tôt le dimanche, avant l’invasion des propriétaires des maisons individuelles autour, on peut se promener à loisir dans les allées fraîchement arrosées, plonger le nez dans le miel des giroflées, s’enivrer du pourpre d’un pétunia, admirer en détail le charme d’un périanthe – bref, Truffaut pour moi, avec sa variété infinie de flore étiquetée en latin, c’est la bibliothèque en plein air, la salle de lecture de la nature réunie. Son seul inconvénient étant le fait d’être un lieu de vente, alors que la bibliothèque ne suscite absolument pas cette envie compliquée de posséder, qui gâche tout. Une carte d’entrée vous autorise à lire et à réfléchir, et que ce soit le dernier Que sais-je ou un livre ancien relié cuir et doré, on vous l’apporte avec le même sourire fraternel.
Ce samedi matin, j’ai donc glissé ma carte dans la fente du tourniquet, puis poussé la lourde porte en acier qui s’ouvre sur un escalator à pic qui descend comme un long boyau jusque dans l’antichambre de la bibliothèque rez-de-jardin, espace à la fois neutre et intime, haut de plafond, aux murs boisés et sols tapissés rouille, ponctués le long des allées de postes d’ordinateurs, de fauteuils design, de téléphones, et puis au fond et à droite, des portes métalliques signalant par des icones discrètes les toilettes hommes-femmes et les locaux de maintenance d’où sortent des femmes poussant des chariots chargés de balais, de seaux et de rouleaux, des femmes qui ont sans doute une vision de ce lieu différente de la mienne. À nouveau je glisse la carte, la bibliothèque me reconnaît, je pousse une autre porte en acier et traverse le hall jusqu’à la salle S, Sciences de la vie, où ma place est réservée.
J’éprouve toujours une excitation particulière en entrant dans la salle de lecture. Quelle découverte m’attend et en quoi me changera-t-elle ? Quelle lumière va-t-elle jeter sur ma vie, sur la voie que j’ai choisie ? Une fois, dans une salle que je ne connaissais pas, je suis allée « brouter » dans les rayons pour me changer les idées. Au hasard, j’ai ouvert un livre sur l’époque révolutionnaire où un témoin décrivait la décapitation des jeunes militants de 16, 17 ans et la pitié qui l’envahissait à la vue de ces têtes innocentes privées de leur corps. Il citait les lettres de ces jeunes révolutionnaires la veille de leur exécution où ils disaient à leurs frères et sœurs combien ils les aimaient et qu’il ne fallait pas les regretter, où ils conseillaient aux cadets de bien travailler à l’école, où il y avait des mots tendres et des baisers pour chaque membre de la famille, et depuis, je n’écoute plus mes Anne, Frédéric et autres jeunes « fous » sans y penser. Je sais, bien sûr, que leur désarroi et surtout la haine qu’ils expriment n’est que la dissimulation d’une quête d’amour, d’un idéal quelconque, mais cette rencontre dans le silence de la bibliothèque me donna d’autant plus envie de les sauver de ce monde hypocrite qui risque de leur couper la tête – car d’une manière ou d’une autre, pour un psy, il s’agit toujours de ça.
C’est donc dans cet état d’attente que je me suis installée devant l’écran et que j’ai commandé les revues qui m’intéressaient. Puis, sans doute parce que j’y pensais en permanence, l’idée m’est venue de taper dans la boîte « Sujet », les mots « grammaire anglaise ».
Ce fut le début de l’aventure que je vous raconte ici, car j’ai eu immédiatement la réponse amicale (ce qu’elle n’est plus, hélas, grâce aux progrès techniques) « 378 titres répondent à votre demande », suivie des 378 grammaires anglaises présentées par ordre de date de publication, la première de 1639, intitulée « Grammaire Angloise pour facilement et promptement apprendre la langue angloise ». Le cœur battant, j’ai cliqué dessus pour la réserver et continué à faire défiler la liste, faisant pareil pour Siret, 1846 (l’ouvrage ayant été réédité année après année, j’en conclus qu’il fut plébiscité par le public) de même pour Cobbett, 1801, Johnson 1863, comme autant de bons vins, Meadmore 1899, Aigre 1900, la Réunion des Professeurs 1954, puis au hasard quelques ouvrages plus récents, représentés en quantité nettement moindre. Tout cela dans l’émerveillement de la découverte, car jusque-là, tout comme la tour Eiffel, la grammaire anglaise avait été pour moi un édifice unique, et voilà que des centaines de clones défilaient devant mes yeux ! Je ne pouvais pas savoir que ce qui m’apparaissait comme une libération allait m’enfermer dans un labyrinthe sans fin, mais pleine d’espoir, j’ai retiré ma carte, ramassé mes affaires, et fait une pause à la cafétéria.
Le jeune bibliothécaire était plongé dans une revue d’art lorsque je suis revenue dans la salle (est-ce parce qu’ils sont autorisés à lire qu’ils lèvent la tête vers vous avec le sourire ?). Il prit ma carte, disparut dans les coulisses et réapparut quelques minutes plus tard chargé de documents qu’il soumit aux « bips » de l’ordinateur avant de me les tendre avec un regard distrait. J’adore observer les bibliothécaires, recevoir leur intériorité, leur authenticité, imaginer ce qui a pu amener chacun à faire le choix de vivre dans ce souterrain, entouré de livres.
Une fois assise, j’ai pris entre les mains l’ouvrage en haut de la pile, la « Grammaire Angloise » de 1639, dont le « pour facilement et promptement apprendre » du titre m’avait tout à l’heure inspiré confiance. C’était un joli petit livre ancien relié en cuir usé, à peu près la taille d’un livre de poche et contenant environ deux cents pages à peine jaunies, des feuilles épaisses au toucher doux et gras comme la peau de chamois, sur lesquelles étaient imprimées en relief de belles lettres joyeusement ornées. J’ai lu :
« Things unprofitable unto husbandry
a hen without eggs and chicks
a barren sow
a sleeping cat
obstinate children
a purse without money7 »
À la page suivante :
« One lendeth not willingly these three things
1 his wife
2 his horse
3 his armes8 »
Si tout le monde sait qu’il y a peu de temps encore on prêtait sa femme, volontiers ou non, comme on prêtait son cheval, ce fut seulement après réflexion que j’ai compris pourquoi un sleeping cat n’aurait pas été apprécié dans l’Angleterre rurale du xviiesiècle. Cela dit, ces préoccupations n’étant pas les miennes, j’ai mis de côté ce petit recueil charmant, où il ne figurait d’ailleurs pas d’enseignement grammatical. Car depuis quelques jours j’étais obsédée par les verbes irréguliers et ces diaboliques « règles de grammaire », vieilles angoisses qui revenaient maintenant accompagnées de cet ancien sentiment de culpabilité lié à la relation conflictuelle que j’entretenais avec l’autorité maternelle et qui se déplaçait sur toute forme de soumission, entre autres à ces maudits verbes anglais que j’avais toujours faux et pour lesquels je nourrissais une haine particulière. Et pourtant, si on m’avait demandé à cette époque qui était mon écrivain préféré, ma réponse aurait été sans hésitation l’anglaise Margaret Drabble, à cause des extraits de ses romans juteux que la prof nous faisait lire en terminale, avec leurs personnages féminins drôles et affranchis qui se fichaient du qu’en-dira-t-on, qui avaient droit à leur pensée comme à leur corps, qui faisaient des enfants sans épouser le père. Autant dire que, comme c’est toujours l’affectif qui l’emporte, dans le fond j’aimais l’anglais plus que je ne le détestais, et il était grand temps, puisque j’avais fini par me réconcilier plus ou moins avec ma mère, que j’en fasse autant avec la langue de la libre Margaret.
Mais je m’aperçus bientôt que ce n’était pas gagné d’avance, car à mesure que je feuilletais les ouvrages devant moi, mon enthousiasme fléchissait, face à la tristesse bavarde de ces vieux grammairiens qui, au lieu de se donner des ailes drabblésiennes, s’inclinaient devant l’autorité institutionnelle. Voici quelques exemples que j’ai recopiés pour un usage prochain possible (je vous en parlerai plus loin). « Nous avons conservé la vieille division des parties du discours dans l’ordre consacré par un usage séculaire… », « L’idée première qui a présidé à la composition de ces ouvrages se trouve en parfait accord avec les considérations développées dans le chapitre des “Instructions, Programmes et Règlements” consacré à l’enseignement des Langues Vivantes par le Conseil Supérieur de l’Instruction Publique. » Et il n’y a guère cinquante ans – à peu près à l’époque où ma mère faisait ses études – que des « hauts responsables de l’enseignement de l’anglais » dictaient aux professeurs « les grands principes du fonctionnement de l’anglais », « les exhortant à [y] exercer la réflexion de leurs élèves. »
Il va sans dire qu’à lire ces phrases, on sent nettement la camisole de force imposée il n’y a pas si longtemps aux élèves adolescents. Voici un dernier extrait, directement dans la lignée des médecins de Molière : « Les verbes irréguliers se conjuguent différemment s’ils sont auxiliaires ou principaux, s’il y a affirmation, négation ou interrogation. Il faut donc plier l’enfant [l’italique est de moi] à la conjugaison des verbes sous toutes les formes. »
Il ne manquait plus que ça !
J’ai continué ma lecture et au fur et à mesure, j’ai fini par comprendre, sans surprise d’ailleurs, étant donné ma propre situation, qu’à long terme les résultats de ces grands projets pédagogiques ne devaient pas être brillants. Car année après année on se corrige la copie, chaque auteur rejette la méthode de son prédécesseur et prétend avoir trouvé mieux, mais les élèves continuent à s’ennuyer : « Un enseignement qui manque d’une base solide fatigue et décourage les élèves par son uniformité. » Trente ans après : « Nous espérons que la clarté du texte et la valeur des exemples contribueront à rendre facile et attrayante l’étude, d’ordinaire si aride, du code grammatical… » Encore une trentaine d’années plus loin : « Il faut corriger l’aridité d’une matière que les élèves n’abordent pas toujours avec plaisir. » Puis au milieu du siècle dernier la Réunion des Professeurs tente l’impossible : « Nous avons essayé d’égayer le sujet, mais nous avons conscience qu’il reste encore… d’immenses zones désertiques, sèches et arides. » Enfin, dans les années 1980 – justement, mon époque à moi : « Les verbes irréguliers font l’objet d’une série d’exercices permettant une mise en œuvre en situation, ce qui paraît moins rébarbatif qu’une vérification fondée sur le rabâchage fastidieux… »
« C’est donc un cas désespéré ! » me dis-je, me demandant si c’était la peine que moi, sans doute une « pas douée pour les langues », j’essaie d’apprendre l’anglais. Et pourtant, il y a des gens qui y arrivent, qui parlent même couramment. Comment font-ils ? Y a-t-il peut-être d’autres grammaires, d’autres méthodes plus modernes, des auteurs plus optimistes, plus « normaux » ? Car j’ai tout de même observé une chose, c’est qu’alors qu’il semble politiquement correct de dénoncer la souffrance des élèves, il n’en est pas de même pour le martyre des auteurs ! Je vous laisse tirer vos propres conclusions : « Puissé-je, en récompense d’une vie entièrement consacrée à l’instruction de la jeunesse, obtenir les suffrages dont l’espoir m’a encouragé et m’a soutenu dans mes longs travaux ! » « Une pratique longue et assidue devait ici me servir de flambeau… ». « Mes principes de prononciation, ma théorie des conjugaisons, mon nouveau classement des adverbes… “la faveur qu’ont rencontrée mes améliorations, des connaissances plus précises qu’avec n’importe quel autre ouvrage…”. » « Pour la première fois dans l’histoire de l’enseignement de l’anglais dans notre pays, une grammaire à caractère scientifique… »
Évidemment, de tels emportements n’ont rien d’étonnant pour une psy. Tous nos patients désirent être reconnus comme des êtres singuliers, et les auteurs des grammaires anglaises ne sont pas plus gravement atteints que d’autres. La seule différence, c’est que là où d’autres ont moins de chances d’aboutir, leur métier ne favorisant pas cet épanouissement, les auteurs des grammaires anglaises eurent la possibilité, génération après génération, d’être la bête noire de quelques milliers d’élèves.
Mais je ne veux pas complètement noircir le tableau, car j’ai tout de même trouvé réconfort dans une remarque qui date de 1900 mais qui décrit une génération qui pourrait être la mienne. C’est le professeur Aigre qui écrit : « On est en général assez surpris de voir que nos élèves, après avoir étudié l’anglais pendant plusieurs années, sont, le plus souvent, incapables de le parler. Ils ont appris un certain nombre de mots, connaissent les règles principales de la grammaire, et peuvent traduire assez correctement, avec l’aide d’un dictionnaire, […] mais lorqu’ils se trouvent en présence d’un Anglais, ils sont fort embarrassés pour les comprendre ou se faire comprendre par eux. » Et à peu près en même temps, le professeur Meadmore constate que « la Grammaire et les Exercices ne constituent pas une méthode pour l’enseignement de l’anglais », et dans la liste de ses ouvrages on trouve « Jeux anglais pour les écoles » et combien d’autres ouvrages imaginatifs à l’attention de nos aînés ingrats.
La faute n’est donc pas uniquement du côté des auteurs et des profs…
Car il y a aussi l’administration ! Parmi les documents que j’avais demandés ce jour-là se trouvait la brochure du ministère de l’Éducation des années 80, qui m’intéressait particulièrement parce que c’était mon époque à moi. Je l’ouvre, et à propos de l’enseignement de l’anglais pour les classes de seconde, première et terminale, je lis le charabia suivant : « Il ne s’agit pas enfin de se limiter à la jubilation de la découverte préméditée, à la mise en lumière d’un modèle abstrait satisfaisant pour l’esprit : le minimum d’initiation technique ici préconisé n’est justifié que s’il aboutit pour l’élève à l’exercice immédiat ou différé de sa “compétence de communication”… »
Heureusement, je pense que ma prof de terminale, celle qui nous faisait lire les romans juteux de Margaret Drabble, ne l’avait pas lu… ou ne l’avait pas compris.
Il ne restait plus qu’un livre sur la pile et il fallait tout de même que je commence à lire mes journaux psys. J’ai regardé rapidement la quatrième de couverture – c’était un ouvrage moderne, vraisemblablement pour adultes, s’agissant, disait l’éditeur, d’une méthode « infaillible et tordante pour parvenir à vous faire comprendre outre-Manche. […] L’auteur tente de répondre… aux vraies questions sur nos excellents amis britanniques : les Anglais ont-ils une âme ? Comment parviennent-ils à se reproduire ?… »
Une association d’idées assez curieuse, me dis-je. Pourquoi est-ce l’anglais qui est visé plus que d’autres langues qu’on étudie à l’école, plus que d’autres matières d’ailleurs, comme les maths par exemple, que beaucoup d’entre nous détestaient encore plus, mais pas de cette manière… quasi charnelle ? À cette question je n’avais pas de réponse, je me suis donc contentée de tirer vers moi mes revues, en pensant que je n’avais touché là que la pointe de l’iceberg et que la grammaire anglaise, du moins son étude, avait encore des secrets à me révéler.
7. Choses qui sont de peu de bénéfice pour l’économie domestique : une poule sans œufs et sans poussins ; une truie stérile ; un chat qui dort ; des enfants entêtés ; une bourse sans argent.
8. On ne prête pas volontiers ces trois choses : sa femme, son cheval, ses armes.
Premiers pas
Mais il fallait aussi penser aux choses pratiques. Pour l’instant, à part ma mère, la seule personne à qui j’avais parlé du colloque était ma collègue Gabrièle. Elle avait suivi un cours d’anglais quelques années auparavant et me conseillait de faire de même. J’allais donc lundi voir ma directrice pour demander une formation en anglais. Évidemment, je ne pouvais pas lui dire que j’étais invitée à un colloque à New York – comme les médecins, les psys sont souvent particulièrement sensibles à l’endroit du corps ou de l’âme qui, consciemment ou non, les fait souffrir, et je ne voulais pas provoquer chez elle quelque crise d’envie ou de jalousie. Car il était peu probable que Mme Coing, avec ses vingt ans dans le même établissement, zéro publications et peu d’ouverture en général, ait jamais reçu ou soit jamais susceptible de recevoir à l’avenir une invitation de la sorte. Était-ce l’âge, la routine, le désintéressement progressif ou la désillusion, elle supportait mal les jeunes dont nous avions la charge ; les vols, casses et autres comportements antisociaux qui étaient leur mode prioritaire d’expression ne faisaient que l’irriter, sans qu’elle cherche, malgré son prétendu intérêt à ce qui se faisait, à en approfondir les causes. Cela peut surprendre de la part d’une psy, mais le désir de questionner est probablement un don au même titre que la musique, la peinture ou la poésie, variant en intensité et en durée de vie selon les personnes, mais dont l’absence totale dans un métier comme le nôtre est désastreuse, car avec comme unique bagage les études et la prétention de les avoir « faites », on est plutôt incompétent. Ce fut donc pour éviter de rappeler à Mme Coing l’avis de la majorité du personnel à son égard que je lui dis que j’avais besoin de rafraîchir mon anglais pour lire plus facilement les publications.
–Les publications ?
Elle me regarda d’un air supérieur. Debout derrière son bureau, elle se préparait à partir – manteau trois-quarts avec écharpe en soie, gants, sac rectangulaire noir et rigide.
–Vous n’arrivez pas à lire les publications ? Pourtant, le vocabulaire scientifique, c’est sensiblement le même qu’en français.
–Oui, mais il n’y pas que…
–Moi je n’ai pas de mal à lire… ce qui me dérangerait plutôt, ce serait de parler, mais bon, parler anglais, je n’en ai pas besoin.
Elle détourna les yeux et fit semblant de ranger son bureau. J’attendis un moment avant de réagir.
–On comprend peut-être l’idée générale, lui dis-je, souriant, la rejoignant sur son premier constat. Mais on n’est pas toujours sûr du détail, moi en tout cas… la grammaire anglaise, il y a tant d’exceptions (sans doute la gêne d’avoir à lui demander quelque chose me faisait répéter bêtement ce que tout le monde disait), sans parler des faux-amis qui changent complètement le sens.
–C’est pas grave, ça, reprit-elle, confiante, son titre de directrice lui autorisant des imprécisions. L’idée générale suffit pour savoir ce qui se fait. S’il fallait tout lire et tout comprendre !
Elle fit un geste en l’air et cette moue désespérée que je connaissais bien, pour avoir essayé en vain d’engager son empathie pour quelques cas difficiles. Avec tous ses défauts, pensais-je, ma mère a quand même du respect pour la grammaire. La main enfin retombée sur son sac, elle me dit avec sécheresse :
–De toute façon, on n’a pas de budget pour l’anglais.
Il était évident que cette remarque visait à me signaler qu’il s’agissait d’une considération hors de ma portée et qu’elle entendait ainsi clore la conversation. D’ailleurs elle regarda à nouveau son sac et fut sur le point de le reprendre. Je poursuivis tout de même :
–Il n’y a pas de budget qu’on pourrait basculer sur l’anglais ?
Avec ce verbe affectionné par les administrateurs, j’espérais lui montrer que moi aussi, je m’accordais un certain pouvoir.
–En principe j’ai droit à trente heures de formation par an.
Visiblement, elle avait hâte de partir, et, tout en pendant son sac dans le creux de son bras, me le fit sentir en recommençant le jeu de rangement. Mais comme je ne bougeais pas, elle finit par hausser les épaules en me regardant dans les yeux, l’air de dire qu’elle ne voyait pas l’intérêt de ma demande, mais que j’étais libre de me renseigner.
–Écoutez, si c’est vraiment ça que vous voulez, allez voir ce qu’ils proposent à l’Institut Welcome. Ils m’ont envoyé une brochure il y a quelque temps, mais je ne pense pas l’avoir gardée. Ils sont très connus, ils ont même une école pas loin d’ici il me semble. Si ça ne coûte pas trop cher, on pourra peut-être trouver de l’argent quelque part.
–Welcome ?
Je la regardai d’un air douteux.
–Ceux qui font la pub dans le métro ?
–Ceux-là ou d’autres, si vous voulez, il y en a partout aujourd’hui, des cours d’anglais. Reste à savoir si on y apprend quelque chose, mais tout le monde s’y met, vous pouvez toujours aller voir si ça vous plaît, puis on verra ce qu’on peut faire.
À vrai dire, je passais quotidiennement devant la pub de Welcome et mon inconscient devait l’enregistrer, mais je n’aurais jamais eu l’idée de m’adresser à une de ces usines à langues qui brassent des centaines de clients par jour, et sa remarque me coupa momentanément le souffle. C’était tout autre chose que je voyais dans mes fantasmes – la petite salle intime, et moi, face à celle qui ressemblerait pour moitié à la Margaret Drabble de mes rêves de lycéenne et pour l’autre à ma prof d’anglais – une femme jeune, blonde, habillée de couleurs pastel, douce et encourageante. Dans une boîte comme Welcome, avec les complexes que j’avais, me remettre à l’anglais en compagnie de tous ces jeunes professionnels au sourire hollywoodien qu’on voit sur les affiches ne m’enchantait guère. Mais comme j’étais d’humeur plutôt positive et que ça ne me coûtait rien d’aller voir, je remerciai ma directrice, lui dis que je tâcherais d’y passer le lendemain et surtout, que c’était une très bonne idée. Je ne sais pas si elle m’entendit (mais d’habitude ce genre de personnes enregistre le moindre compliment), car déjà elle me tournait le dos et ses pensées étaient sans doute ailleurs, mais pour ma part j’étais contente, j’avançais.
Qu’on le veuille ou non, quand on vit seul avec son enfant, on finit par lui faire part, au fil des conversations, de sa propre vulnérabilité, de ses propres appréhensions et angoisses, et dans certains cas, ce dernier comprend qu’il est dans son intérêt de vous raisonner, exactement comme vous faites pour lui, comme s’il était momentanément devenu votre parent. Entre David et moi, cette réciprocité fonctionnait parfaitement, et ce soir-là, à peine lui avais-je dit, en lui passant la salade, que ça m’angoissait mais que j’avais l’intention de prendre des cours d’anglais, qu’il me rappela gentiment que si j’avais fait des années d’études pour comprendre les névroses des autres et que je n’arrivais pas à surmonter les miennes, ça voudrait dire que « tout ça » n’avait servi à rien. C’est un des avantages de vivre avec un adolescent, car de cette manière-là ou d’une autre, ça vous oblige, vous aussi, à grandir.
Le lendemain matin je n’avais donc pas d’autre choix que de pousser la porte de l’Institut Welcome, où je fus tout de suite accueillie par un grand sourire de bienvenue, le premier d’une panoplie de grimaces, les unes plus acrobatiques que les autres, que j’en viendrais à reconnaître comme étant destinées à assurer au client – peu importe l’évidence du contraire – qu’il était en train de faire des progrès fulgurants en anglais.
–Que puis-je faire pour vous ? me demande la femme au sourire, sa jeune et jolie tête brune gracieusement penchée de côté, feignant d’ignorer l’état de panique de cette nouvelle cliente qui, comme tous, devrait parler couramment anglais dans un mois ou deux.
Elle m’indique le fauteuil en face d’elle et je m’assieds.
–J’aimerais savoir ce que vous proposez comme cours d’anglais…
–Vous êtes un particulier ? une entreprise ?
–C’est pour moi, je travaille dans un établissement hospitalier.
Je perçois une légère diminution dans l’intensité de son sourire. Je ne vais peut-être pas lui faire rentrer beaucoup d’argent.
–Vous êtes infirmière ?
–Non, je suis psychologue. Je m’occupe d’enfants et d’adolescents.
–Ah, me fait-elle, en me regardant dans les yeux avec un soupçon de familiarité, voilà un métier intéressant. Vous avez besoin de votre anglais dans votre travail ?
Elle a une voix chantante, et à part ce votre anglais dévorant, comme si elle regardait dans ma bouche et voyait que mon anglais était nul, elle ne me fait pas peur. Je suis même sous le charme. Elle continue :
–C’est pour lire ? Pour parler ? Vous participez à des réunions en anglais ?
Elle penche la tête, consolide son sourire, m’accueille. Elle est sympathique, je peux me confier.
–Les deux. J’ai besoin de parler, mais j’ai surtout besoin de revoir les bases de la grammaire. J’ai tout oublié. Je n’ai pas fait d’anglais depuis… oh là là, ça fait quinze ans… plus même !
Devant elle, j’ai honte de mon âge, de ne pas savoir parler à 40 ans passés, même s’il s’agit de parler anglais. C’est ridicule, mais c’est comme ça. Pour nous, parler, ça a une signification. Ne pas pouvoir parler…
–Et vous avez à peu près quel niveau ?
–Quel niveau ?
La question me pénètre comme un coup de poignard mais j’essaie de répondre calmement.
–Je ne sais pas… j’ai fait de l’anglais jusqu’au bac et je comprends à peu près tout quand je lis, mais…
–Vous avez du mal à vous exprimer, c’est ça ?
Ses jolis yeux noirs me regardent avidement, et je comprends qu’elle a l’habitude des gens comme moi, qu’elle ne fait que me donner la réplique, les réponses sont toujours les mêmes.
–Oui c’est ça, je ne suis pas du tout sûre de moi pour parler et d’ici six mois je dois participer à une conférence à New York.
Voilà, j’avais tout avoué, je me sens débarrassée d’un poids, mais en même temps sans défense, complètement vulnérable, dépendante de maman. Elle peut faire de moi ce qu’elle veut.
–Pour le niveau, je peux vous faire passer un petit test, si vous voulez.
Mon cœur se met à battre de plus en plus fort, j’ai les mains gelées.
–Un test ?… maintenant ?
–C’est vite fait, vous savez, un petit test pour évaluer votre niveau d’écrit, puis un petit entretien en anglais avec un de nos professeurs. Pas plus d’une petite heure en tout. C’est gratuit, sans aucune obligation.
Elle se penche en avant, m’enveloppe dans son sourire.
Le petit test, le petit entretien, le niveau, j’ai un trac épouvantable, comme s’il s’agissait de me faire une radio et qu’à la sortie on me dise que j’ai une maladie rare et incurable. Mais je suis coincée, dans six mois il faut que je parle couramment, que je réponde aux questions que l’on me posera, alors je regarde ma montre, qui m’assure que dans la vraie vie je ne suis pas un bébé qui ne sait pas encore parler mais une grande personne avec un bureau et des rendez-vous. Je lui dis que je suis d’accord, pourvu que ça ne dure pas plus d’une heure. Et là-dessus elle fait un premier petit sourire confidentiel pour se féliciter elle-même, ensuite, la main sur le téléphone, un deuxième pour moi – un sourire d’infirmière à la petite fille que l’on va opérer des amygdales.
–Allô, Cedric ?
Elle prononce le nom à l’anglaise, avec un long « e ».
–Tu es libre ? J’ai quelqu’un pour un test. Tu peux venir à l’accueil ? Oui ? OK, à tout de suite.
Puis elle s’adresse à moi :
–Cedric va vous faire passer un petit test à l’ordi, et il discutera un petit moment avec vous, d’accord ? Puis selon votre niveau et vos besoins on vous conseillera. Encore une fois, sans aucune obligation, bien sûr.
Là-dessus un jeune homme mince et de taille moyenne, aux cheveux châtains bouclés et en costume gris descend l’escalier et s’approche du bureau de Véronique (je savais son nom, ayant remarqué une petite statuette avec un bandeau avec « Hello, my name is Véronique »).
–Cedric, je te présente… ah, ça alors, je suis désolée Madame, j’ai oublié de vous demander votre nom !
–Anselme, Laure Anselme.
Je souris. Cedric aussi.
–C’est le petit test d’entrée général, Cedric. Tu le trouveras dans le dossier « tests ». Il faut le faire en 30 minutes, puis tu enchaînes avec l’entretien, tu sais, comme je t’ai expliqué hier.
–OK, dit Cedric, qui ne me semble pas tout à fait à l’aise.
Il est très jeune, 25 ans maximum, peut-être nouveau dans l’école. Curieusement, cela me rassure. Il se tourne vers moi.
–Hello Laure, me dit-il, avec un joli « o » dans son hello, qui me semble plus anglais qu’américain, glad to meet you. Come with me !
Je comprends par son geste que je dois le suivre et me lève, mais je suis tellement impressionnée que je n’arrive même pas à sortir un « yes, thank you ». Est-ce qu’il va me parler toujours comme ça, en anglais ? Pourtant il avait l’air de comprendre Véronique quand elle lui parlait français. Il se tourne vers moi et me dit :
–We can take the lift if you prefer.
–Yes, je réponds enfin, faiblement.





























