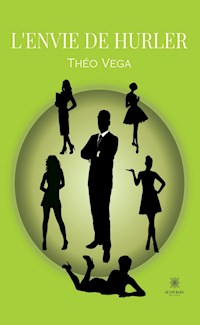
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Mélange de dérision (parfois comique), d’humour, de tendresse et d’amertume, ce roman est l’expression du ressenti de l’auteur sur son parcours de vie (à cheval sur deux siècles). Cette envie de hurler, c’est celle que nous ressentons à un moment de notre vie, un besoin d’expulser quelque chose que nous portons depuis longtemps et qui devient trop oppressant. Elle surgit quand vient cette nécessité du retour en arrière pour comprendre pourquoi nous en sommes là.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Théo Véga aime les mots, leurs sens, leur force, leur résonnance. Il aime les agencer en donnant à chacun d'eux une place essentielle. L’envie de hurler est un exutoire pour l’auteur mais aussi l’expression de sa fascination permanente pour la féminité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Théo Véga
L’envie de hurler
Roman
© Lys Bleu Éditions – Théo Véga
ISBN : 979-10-377-4505-7
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
J’ai longtemps été persuadé me souvenir de mes premiers pas…
Je me revois lâcher cette table basse contre laquelle je m’étais appuyé, prendre cette tasse à café et avancer dans un équilibre chaotique vers la cuisine. J’entends ma tante murmurer à ma mère de ne pas bouger.
C’était ma première victoire, celle de ma volonté, de la confiance, elle aurait pu en déclencher d’autres. Seulement, personne ne m’ayant cru, malgré la précision de mon souvenir, je me suis résigné…
J’avais pensé construire une histoire, donner une cohérence à cette ébullition qui monte comme une sève mais, fidèle à mon impulsion, j’ai démarré avec la vision floue de ce que je veux, pressé par le besoin de faire jaillir tout ça, vite, violemment peut-être… Cette fois, je dois aller au bout.
Dans le profond du silence, à ce moment où je suis sorti du sommeil, les mots sont venus, fluides, ils se sont assemblés dans l’improvisation de la nuit. Je n’avais qu’à les écrire mais, comme à chaque fois, la paresse m’a retenu, sournoisement, et plus encore, la certitude trompeuse qu’à mon réveil, ils seraient là, inchangés. Alors, j’ai replié mon corps et je me suis rendormi avec cette assurance du travail qui se poursuivrait pendant mon sommeil.
Ce matin, tout s’est effacé et il ne me reste que l’envie, trop forte pour que je renonce, et qui me rive à mon clavier. C’est maintenant, je le sais, il n’y aura pas d’autres tentatives.
Quand on cherche à comprendre pourquoi on en est arrivé là, justifier ce qui s’est passé, c’est spontanément sur son enfance que l’on se retourne. Je ne sais pas si c’est la meilleure façon de procéder pour moi qui ai tant d’impatience, mais il faut sans doute ce détour.
Que me reste-t-il de ce temps-là ?
Je suis parti plus vite que les autres, mais j’ai gâché cette avance. Si certains prétendent avoir avalé des couleuvres, moi, le bébé précoce et indépendant, échappant à la surveillance de ma mère, confortablement assis en barboteuse bleu clair dans la boue du Limousin, seul sous ce ciel humide de campagne, j’ai goûté aux limaces bien grasses de cette région spongieuse, probablement parce que leur fluo transparent me rappelaient les roudoudous de l’époque.
L’image qui me vient ensuite, c’est celle de ce gros petit bonhomme avec son pull à boutons en lainage gris dont les cuisses font craquer les coutures de sa culotte courte, les oreilles bien dégagées, avec ces yeux bleu-gris, dont le regard déjà ne se fixe pas. Totalement inadapté aux travaux manuels, avec ces doigts que je ne parviens pas à délier, empêtré dans ma maladresse, gauche jusqu’à la stupidité, je suis la risée de tous ces dégourdis plus âgés qui se poussent du coude devant mon incapacité à tresser ce panier en osier qui restera inachevé et tordu et que la maîtresse finira par jeter avec un haussement d’épaules.
C’est mon premier handicap, avant les autres…
Seule fierté dans ce ridicule, ce monde à moi, un nuage derrière lequel je me suis lové et cette facilité à raisonner qui les étonne, puisque je suis et resterai longtemps le plus jeune, ma mère ayant réussi à m’expédier en maternelle avant l’âge de quatre ans.
Encombré de mon corps, je rate ce premier contact avec les autres, celui qui aurait pu être déterminant.
De cette image du gros bébé bien sympathique comme me qualifie cette maîtresse sur les genoux de laquelle j’ai parfois besoin de m’asseoir pour un câlin, je comprends qu’à la manière de Benjamin Button, j’ai fait les choses à l’envers, recherchant le monde des adultes, pendant que ceux de mon âge pensent avant tout à se bagarrer. Ce n’est qu’à l’âge adulte que, poursuivant ce déphasage, j’aurai les désirs et le comportement d’un enfant.
Enfant, je suis autre et cet atypisme que je revendique puisqu’il me différencie, m’enferme dans une solitude aussi consciente qu’inévitable. Et puis, vrai sujet d’isolement, gamin boulimique, j’appartiens au monde des gros. On peut en rire autant qu’on veut, ceux qui ne l’ont pas connu ne soupçonnent pas l’humiliation et la souffrance que l’on y ressent. On y apprend à fuir le regard des autres, à ne plus écouter leurs vannes éculées en cours de gym, chaque fois qu’arrive son tour, le dernier à passer bien sûr, et que l’on reste suspendu, le cul désespérément vissé sur le gros nœud de la corde ou qu’au saut en hauteur, le corps s’affale sur le fil tendu dans lequel il se prend les pieds. On y apprend aussi à éviter le reflet accusateur de la glace, celui qui vous renvoie sans concession l’image accablante de votre profil.
Alors, face à cette hostilité, je me réfugie dans mon imaginaire, je me cloître, j’absorbe des romans et je crée mon double, ce second moi toujours disponible, toujours à mon écoute. Il me détourne des grandes amitiés, celles de l’enfance. Je suis à côté, spectateur des autres, je n’en mesure pas encore les conséquences.
Au fur et à mesure des années apparaît ma première faille, mon paradoxe : la maturité d’une personnalité trop décalée, confrontée à mon immaturité à vivre dans la vraie vie, à en comprendre les règles.
Côté fantasmes, j’assume dès l’enfance mon originalité en me concentrant, à la rubrique sous-vêtements du magazine la Redoute, sur le découpage impatient et approximatif de photos noir et blanc de femmes généreuses en soutien-gorge et corsets avec porte-jarretelles. Je les trimballe partout, même en promenade, la menotte dans la main de ma mère qui évite de remarquer cette perversité précoce, préférant penser que j’aime bien faire du découpage, ce qu’elle trouve, au vu de mon handicap manuel, plutôt rassurant…
Je connais très tôt mon premier orgasme (émotionnel…), en caressant le long cou hérissé de grains de chair de poule de l’une de mes cousines, sur l’air langoureux des enfants du Pirée, la chanson du film de Jules Dassin,avec sur la pochette du vinyle la silhouette lascive de l’envoutante Mélina Mercouri. La sensualité épanouie de cette adolescente m’a à cette époque beaucoup troublé, tout autant que celle plus délurée de sa sœur cadette, qui venait me garder certains jeudis et s’allongeait tendrement contre moi pour me proposer des petites siestes réparatrices.
Je découvre avant dix ans mon premier sexe féminin encore imberbe, en déculottant par étapes une autre cousine un peu plus âgée que moi, à l’issue d’un scénario bien orchestré par elle. C’est la curiosité bien sûr qui m’avait guidé dans ce baissé de culotte auquel elle avait d’abord fait mine de s’opposer, en poussant un petit soupir très encourageant, ménageant une pudeur de convenance, avant (bien entendu) de me laisser glisser par étapes la culotte jusqu’à ses pieds. En posant ma bouche sur ce petit renflement, juste à l’endroit de la fente, j’ai ressenti un peu de déception à son goût musqué et un peu amer, ce n’était que ça un zizi de fille…
Je n’ai pas d’univers à moi, puisque l’appartement trop petit de mes parents me prive de chambre et que je dors dans la salle à manger, séparée du salon par des contrevents coulissant sur des rails, que l’on ferme la nuit. Néanmoins, la lumière se glisse dans les interstices et il suffit d’ôter la clé dans la serrure pour devenir voyeur.
C’est la contrepartie de cette enfance sans décor.
Alors, à cette époque où la puberté vous démange, lorsque des tantes, des grandes cousines ou des amies de province de mes parents, de passage à Paris, viennent dormir à la maison dans le canapé lit du salon, je m’oblige à rester éveillé, tapi dans mon lit, jusqu’au moment où je n’entends plus les bruits de conversations, celui où les adultes vont se coucher, où le canapé se déplie et où elles se retrouvent seules dans le salon. Je me lève fiévreusement, les narines dilatées d’envie, comprimant mon sexe qui se dresse d’un coup, dur, lourd et douloureux, tâchant de contrôler ma respiration qui s’accélère et je me colle à la serrure en espérant que cet angle de vue me permettra de les voir se déshabiller.
À chaque fois, de tout mon désir exaspéré, je me persuade qu’elles ne choisiront pas pour ce strip-tease involontaire un coin inaccessible du salon ou pire… la salle de bains. Triste fantasme ! La plupart m’échapperont, comme si elles m’avaient deviné derrière ce rideau ridicule et je n’apercevrai que des descentes ultra rapides de fermetures Éclair laissant furtivement apparaître le dos d’un soutien-gorge qui se détachera sournoisement, hors de vue, au mieux, le demi-profil dansant d’un sein dont le téton si convoité restera dissimulé. Combien d’amères déceptions derrière cette attente arrachée à mon sommeil, lorsque je verrai ces castratrices disparaître de la pièce, pour réapparaître quelques minutes plus tard, revêtues d’une chemise de nuit même pas transparente ou, plus navrant, d’un pyjama à motifs totalement opaque, avant d’éteindre la lumière et de tirer brutalement le rideau sur mes envies. Alors, je sentirai dans ma main mon sexe dégonflé se replier comme un escargot s’enroulant dans sa coquille et, glacé de la tête au pied, je regagnerai mon lit pour noyer ma frustration dans le puits de mes rêves.
Quelques années plus tard, c’est Laurence, cette jeune ado un peu plus âgée que moi, au visage plus original que joli, en bleu marine obligé, que je guette chaque jour à la même intersection, avec une discrétion de babouin et que je suis fidèlement jusqu’à son école, voisine de la mienne, en respectant toujours la même distance. Si je fredonne, pour oublier mon ridicule, c’est mon seul point commun avec la chanson de Sardou En chantant. Car je ne verrai jamais se déshabiller cette « première fille de ma vie » et je n’aurai pas à jouer « le vieil habitué », mais c’est vrai qu’à cette époque d’érotisme seulement suggéré, les filles ne se déshabillent pas.
Je ne rencontrerai jamais Laurence, toujours accompagnée de la même copine boulotte, et qui, à demi retournée, me jettera des regards exaspérés par mon petit manège. Je ne trouverai pas les mots pour m’adresser à Laurence, ces mots idiots que n’importe quel ado décomplexé aurait débités sans hésiter. La peur de rougir, d’un ridicule qui ne tue que ceux qui n’osent pas, la peur surtout de me décevoir, me paralysera à chaque tentative pour l’aborder. Le premier pas de la chanson, celui que j’aurai tant désiré, Laurence ne le fera pas bien sûr, insensible à mon impuissance, car, si les filles ne se déshabillent pas en ce temps-là, elles ne font pas non plus le premier pas. Ma seule audace se limitera à cette lettre stupide déposée précipitamment sur son trajet, à même le trottoir, mais qui, mal « arrimée », s’envolera avant qu’elle ne l’aperçoive.
Je ne retrouverai Laurence que bien plus tard, sur les bancs de la fac, quelques rangs derrière moi. Dans le petit choc émotif de ce retour inattendu, je lui adresserai un regard brillant et implorant auquel elle répondra avec une indifférence étonnée, n’ayant bien sûr aucun souvenir du lourdaud de l’époque, trop occupée à rigoler avec ses copains.
Malgré cette aisance trompeuse, cette assurance prétentieuse que j’affiche, je prends du retard sur ce monde qui avance tandis que je reste à quai, que je me déphase. C’est le début de cette colère contre moi, sourde, rampante, encore contenue, qui anticipe ces rendez-vous manqués, ce qui n’arrivera pas, ce que je ne vivrai pas. Mes parents, dans leur égoïsme autiste, ne s’étonnent pas de voir ce gros ado vautré, passant des journées à plat ventre sur les tapis, pour calmer ses douleurs d’estomac à la suite de razzias dans le frigidaire pour se gaver de hachis parmentier glacé, et qui, replié sur lui-même, oscille entre lecture, rêves vaporeux et sommeil comateux.
Je m’ennuie, je m’enferme et pourtant je m’imagine, je me sais différent, je veux croire que cette différence est le signe d’un talent dont je me grise et dont la seule perspective certains soirs me donne la chair de poule et des frissons d’orgueil. Je dors dans ce lit encastré dans la boiserie de la salle à manger, que l’on déplie le soir et que l’on replie le matin, je n’ai pas d’univers physique à moi, je dois tout m’inventer… Est-ce l’explication de ce que je suis devenu ?
Enfant, les craquements de cette boiserie en toc me faisaient sursauter la nuit, dans le silence de ce petit appartement, soudain trop grand, chaque fois que je ne parvenais pas à m’endormir avant les autres. Ils me révélaient la présence de cet inconnu qui s’approchait progressivement, si près de moi, jusqu’à effleurer mon visage, dont je sentais le souffle sur ma joue, mais qui se volatilisait lorsque, couvert de sueur et n’en pouvant plus d’angoisse, je rallumais brusquement la lumière. C’est dans ce lit improvisé, que la sublime et majestueuse Maléfice, drapée dans sa longue cape sombre, le visage anguleux et blême, est venue me hanter de son sourire glacé, avant que ne lui succède Belphégor avec son masque de cuir, se dirigeant sur moi dans la raideur de sa démarche d’automate, au rythme de ses gestes saccadés.
On n’a pas assez conscience des paniques que provoquel’imagination des enfants lorsque, la nuit venue, elle libère sa folie créatrice.
J’ai manqué ce rendez-vous avec Laurence, dont j’aimais le nez en trompette, la découpe des narines et sa mâchoire inférieure avançant légèrement qu’elle masquait de sa main dans un geste très féminin. J’aimais aussi ce plissement de ses yeux dû à une légère myopie, mais qui faisait son charme. J’ai loupé Laurence en toute conscience, j’ai une seconde chance avec les séjours linguistiques. Ce n’est pas à nous les petites Anglaises, mais à moi les petites Allemandes, plus simple, peut-être…
Pour une fois, la chance me sourit, au lieu du fils d’un commissaire de police initialement prévu, ma famille d’accueil a comme atout cœur : une jeune blonde de 16 ans (je n’en ai encore que quatorze), grande, classique aux yeux bleus, bien foutue, très bandante. Joseph, mon père, cet antihéros, qui, en bon médecin, s’est dispensé de toute éducation sexuelle, va à nouveau me prouver qu’il est à la hauteur de la situation. La veille de mon départ pour Berlin, anticipant sans doute l’excitation dans laquelle il m’imagine, il me « convoque » à un tête-à-têteinsolite.
Je vais enfin apprendre tout ce que j’ai voulu savoir sans avoir jamais osé le demander. Il s’est composé une gueule de circonstance, en s’efforçant de sourire pour me (se ?) décontracter. Il voudrait la jouer complice, mais ça ne vient pas, il hésite, et puis, au bout du mal à l’aise, il débite d’un coup ce qui le tracasse. Écoute, me dit-il, les Allemandes, je les ai connues là-bas, à la fin de la Seconde Guerre, quand je m’étais engagé dans la première armée de Lyautey, elles sont, c’est… alors fais gaffe et surtout ne me fais pas un petit Schleu. Voilà, fin du tête à tête, je suis sidéré, je pourrais lui répondre qu’il serait plus simple de me donner le mode d’emploi, mais c’est juste inutile, ce fossé entre nous n’a aucune chance de se combler, alors je me contente de hocher la tête.
Est-ce aussi ce malentendu qui explique la suite ?
Je vais tourner autour d’Antje (prénom de cette jeune Allemande) tout en sourire et bon élève, comme devant un joli paquet cadeau dont on se demande si on peut l’ouvrir. Évidemment, elle m’intimide un peu et puis elle a un copain, Olaf, un Viking moustachu de 18 ans qui conduit une Volkswagen rouge clinquant dans laquelle il l’emmène certains soirs avec un sourire vainqueur, me renvoyant brutalement à mes culottes courtes. Je suis déjà prêt à jeter l’éponge avant même d’avoir engagé la partie et à me résigner à ne regarder Antje que comme une grande sœur.
Mais, ce soir, l’école est finie et dans un élan de gaieté elle me propose de l’accompagner dans une fête foraine. Je suis juste derrière elle devant cette glace déformante, nos corps se touchent ; mes mains se posent d’elles-mêmes sur ses hanches, glissent sur son ventre juste à l’endroit où il s’arrondit, je pince sa peau, elle rit, je m’étonne de ces tendres petits bourrelets que je presse à pleines mains, mais plus encore du fait qu’elle se laisse faire. Mes lèvres effleurent ses cheveux, je respire sa blondeur, je n’y crois pas, je tente un baiser sur sa joue, elle rougit légèrement avec un petit sourire. Je juge plus prudent de ne pas aller plus loin pour l’instant, je n’ai encore jamais franchi autant d’étapes… Nous rentrons, dans le U-Bahn, j’ai pris sa main, elle me l’a laissée, elle s’amuse de mon ignorance, elle joue… curieuse de savoir jusqu’où ira ma maladresse. Arrivés devant la porte de la maison, je multiplie les petits baisers, comme autant de petits picotements sur ses joues, je ris bêtement, ma braguette me trahit stupidement.
Toute la famille dort, je l’ai prise par les épaules dans cette complicité du début de la nuit, nous montons doucement l’escalier jusqu’à ma chambre. Je m’assois sur le lit, je prends son bras et l’attire sur mes genoux, elle ne résiste pas, elle a toujours ce sourire amusé, ironique et bienveillant pour cet apprentissage qu’elle contrôle. Mes mains n’hésitent plus dans leurs caresses, mais se limitent encore à son visage. Je n’arrête pas de parler à voix basse pour me donner du courage, je suis si près de ses lèvres.
Ça bascule d’un coup… À ce moment que je ne choisis pas, mon corps échappe enfin à mon cerveau et je l’embrasse avec un naturel et un savoir-faire qui me coupe le souffle… Doigt d’honneur à Olaf, ce connard de Viking arrogant.
Je l’enlace rageusement, mais en plein triomphe, la réalité me rattrape brusquement, j’ai oublié quelque chose… Ah oui ! … de lui caresser les seins. Trop tard… mon geste a perdu toute spontanéité, ma main se pose, empruntée et maladroite sur son sein gauche, je n’en éprouve même pas de plaisir, le balconnet de son soutien-gorge est trop rigide et je ne sens rien de la tendre rondeur de ce sein. Elle se dégage gentiment, mais fermement, je ne trouve pas les mots pour la retenir, je me sens con, petit, lâche… Elle quitte la chambre avec un sourire que je préfère ne pas interpréter, je crois comprendre qu’elle va revenir, je ne suis pas sûr d’en avoir envie, je suis battu d’avance.
La revoilà, elle se glisse rapidement dans la chambre, les cheveux dénoués, en peignoir éponge blanc, une petite lueur moqueuse dans le bleu des yeux. Elle chuchote quelque chose que je ne saisis pas bien, mais dans lequel il y a, j’en ai peur, les mots nuit et avec toi. Je perds les pédales et Joseph apparaît drapé en statue de commandeur… J’ai la bouche pâteuse, plus de salive… Comment lui dire que je ne suis pas ce héros, que non, stop… je m’arrête là, que je ne suis pas prêt pour ce saut. Cette soirée, c’était déjà au-delà de ce que je pouvais imaginer, j’aurais seulement voulu la caresser encore un peu, cette victoire-là me suffisait, je viens de si loin, si elle savait… Je la serre contre moi, je pose sa tête sur mon épaule, mes mains cherchent à nouveau le contact de ses seins derrière l’étoffe du peignoir, enfin libérés du sous-tif castrateur. Elles les enveloppent d’un coup ; aucune déception, ils sont aussi fermes et ronds que je les avais fantasmés.
Je lui murmure des mots apaisants, protecteurs, non… raisonnablement cons. Je crois avoir repris l’ascendant. Mais, cette fois, elle me repousse fermement, coucher avec moi, c’est dans l’ordre des choses, c’est de son âge, mais se faire peloter comme une débutante, par un benêt pubère, ignorant et maladroit qui tâte ses premiers nichons comme dans un cours d’anatomie du soir, ça c’est carrément humiliant… Elle me toise avec indulgence, elle a retrouvé sa bienveillance, elle a compris qu’elle ne me hisserait pas au niveau de son Olaf, la marche était trop haute… c’est au tour de ce con de Viking de me montrer son doigt d’honneur… Je n’ai même pas envie de me défendre, ce serait trop long, trop compliqué de lui expliquer, de lui raconter, tout… depuis le souvenir manqué de mes premiers pas, le panier en osier difforme, le cul sur la corde à nœuds, le rire de ces petits salauds.
Elle sort de la chambre en murmurant un bonne nuit très maternelle, elle m’a jaugé en évitant de me juger, je me pétrifie dans ce fiasco, le pénis en deuil, recroquevillé lui aussi, incapable du moindre geste pour la retenir et éviter la frustration. Elle ne me redonnera plus ma chance et je ne la lui redemanderai pas, elle subira encore quelques baisers trop courts et bien comptés, avec une froideur et une passivité non dissimulées, simplement pour la bonne entente de cet été-là, puisque nous sommes dans un face à face obligé, mais m’interdira fermement l’accès à ses seins auxquels je finirai par renoncer. Antje ne sera bientôt que ce souvenir un peu amer que je chercherais à évacuer à cause de mon impuissance à en faire l’étape qui aurait pu m’éviter l’histoire linéaire qui se profile, avec cette colère sous ma peau.
Je voudrais accélérer cette adolescence à en crever d’ennui, sans horizon, dans ce Neuilly crottes de chiens avec ses mémères traînant leurs chiwawas à nœuds dans les squares, avec ses vieux en cire, vides d’expression, figés sur leur banc du dimanche, le long de ces boulevards résidentiels bordés de leurs beaux immeubles immuables que je parcours au pas de charge, juste pour respirer, parce que j’en peux plus de ce chauffage central à fond les manettes qui vous abrutit de torpeur et vous dilate les pores de la peau, les veines et le cerveau surtout… J’étouffe de ces déjeuners du dimanche sur la table à rallonge de la salle à manger que l’on surélève pour l’occasion. J’en peux plus de la béarnaise qui dégueule sur les tranches de rôti de bœuf rouge vif, plissées comme les cuisses gercées des bébés ou de la sauce marchand de vin, épaisse et violette, qui submerge l’entrecôte bordelaise noyée dans le gras et les nerfs, et plus encore, pour achever cet indigeste, des glaces sans arôme et sans âme de chez Besançon, l’incontournable glacier au crâne lisse comme du parquet ciré chez qui le tout Neuilly traditionnel se presse.
Je promène mon cul de plomb de gros petit bourgeois complexé, trop et mal nourri, ne sachant rien faire d’autre pour tuer son temps que lire et rêvasser. Alors, la nuit, ramassé en chien de fusil dans mon lit, au rythme monocorde des grincements de la boiserie, je m’invente des histoires à pioncer sur les toits, dans lesquelles je m’interview… moi le célèbre sportif auréolé de ses victoires, moi l’acteur au top, au sourire énigmatique et insolent, moi le romancier plein d’assurance, déjà revenu de tous ses succès.
Comment échapper à ce ronron qui ronronne toujours pareil ?
L’évasion, c’est peut-être ce manège de chevaux, près de chez moi, rueChauveau, ça ne s’invente pas, une rue étroite qui n’en finit plus et au milieu de laquelle il surgit. Là, en plein cœur de l’urbain, comme une parenthèse enchantée dans la ville, s’ouvre ce petit monde, tout en boxes et carrières, découverte et souterraine, avec ses allées bosselées et sa grande rampe en pierre qui descend raide et lisse sur le manège d’en bas et sur laquelle les sabots des chevaux dérapent les jours de gel, tandis que leurs longs hennissements stridents vous explosent les tympans. Je m’engouffre avec délice dans cet univers olfactif, à pleines narines… Car ce que je hume à bouche, naseaux et poumons grands ouverts, c’est ce mélange unique et incomparable de sciure, de paille humide, de cuir tanné, de transpiration et… decaca des chevaux. Ça ne se raconte pas, ça se ressent, je m’en imprègne.
J’ai eu dans mon adolescence, dans le domaine des senteurs, deux grandes émotions, deux vertigesrétro nasals : le caca des chevaux et celui des vaches, les belles limousines, grasses et tendres, ces grosses perles de lait… On ne peut pas les comparer ; l’odeur des bouses de vaches, l’effluve de ces grandes galettes largement étalées dans les prés gorgés de flotte, chauffées à vif par le soleil de midi qui en fait monter tout le suc à vos narines, n’a rien à voir avec celle de ces grosses boules compactes de crottes de chevaux qui garnissent la paille et la sciure.
Je monte comme je peux, sans talent mais sans trouille, les chevaux que les palefreniers veulent bien me donner, au gré de leur mauvaise humeur, sensibles ou insensibles au mors, selon que les cavaliers précédents leur ont ou non massacré la bouche. J’encaisse avec une indifférence résignée les hurlantes des maîtres de manège aigris qui défoulent sur nous leurs frustrations pleines de fiel et de rancune. Mais j’aime surtout venir m’accouder en fin de journée ou le soir, à la tribune de pierre du manège souterrain, glaciale en hiver, pour assister aux meilleures reprises.
C’est là qu’un jour je l’ai aperçue. Ce n’est pas que cet ange blond soit vraiment joli, elle est trop anguleuse, son nez un peu long, un peu pointu, mais, sur un cheval, elle a cette grâce et cette légèreté naturelles qui accélèrent brutalement letic-tac de mon horloge biologique. Il y a dans les reflets de ses cheveux d’or qui volent et retombent sur ces épaules, au rythme de ces galops cadencés, ce quelque chose qui me trouble, cette pointe au creux de l’estomac qui me remue délicieusement. Qu’est-ce qu’elle a, qu’est-ce qu’elle fait pour que les chevaux lui obéissent si docilement ? J’écarquille les yeux pour observer ses mains, ses jambes, mais je ne remarque rien, la seule explication, c’est qu’elle a… ce que d’autres cherchent et ne trouvent jamais, mais que le cheval ressent.
Un don, un feeling ? Elleemportetout dans cette séduction.
Elle est au cœur de l’adolescence, la femme à peine esquissée, sa sensualité encore en éveil. Elle appartient à ce décor : le manège, les chevaux, ces senteurs qui se fondent dans la magie de ce creuset. Alors, même si elle est trop jeune pour mes fantasmes et si je n’ai pas de désir charnel, c’est elle que je choisis. Comment pourrait-elle comprendre, dans ces banalités que nous échangeons, qu’elle est le prétexte au défi que je vais me lancer ?
C’est l’été, l’année du bac, j’ai en perspective ce cliché des plus belles vacances… Si je veux changer de peau, c’est maintenant, je peux encore me donner l’illusion de quitter ce premier monde réducteur, celui de mes échecs, pour cet autre où je veux croire que le jeu est ouvert. Pour elle ou à cause d’elle, je me déclare la guerre. Je vais enfin châtier ce corps qui m’a trop longtemps humilié, il va payer cette souffrance par une autre souffrance. Je vais l’atteindre là où il se croyait le plus fort, là où il m’a pris en otage, je vais l’affamer, comme si j’en faisais le siège. D’un côté, la révolte de ma volonté, exaspérée par ses défaites, de l’autre, l’inertie et le confort tranquille de ces kilos bien protégés par des années de capitulation.
C’est dans les landes du sud-ouest que le combat s’engage, là où j’ai mes souvenirs de vacances et, sur ces grandes plages, tous mes complexes de maillot. J’ai dans ma tête la silhouette fluide de ma cavalière. Porté par cette image, je mets d’entrée la barre très haut… Le matin : un fruit, au déjeuner, grillade de viande blanche exclusivement et crudités sans condiment et puis… plusrien, pas un légume, ni pain, ni sucre, ni fromage, pas même un laitage et le soir rebelotte. Je compte sur la violence de cette attaque, l’effet de surprise qu’elle crée dans ce corps capricieux, habitué à ce que je cède à toutes ses envies. Mais je l’ai sous-estimé, il est plus sournois que je ne l’aurais cru, et au début, à part quelques tiraillements discrets de mon estomac, il fait comme s’il ne se passait rien, il n’y croit pas, comme mes parents qui observent avec une indifférence amusée ce changement de comportement et haussent légèrement les épaules chaque fois que je laisse passer les plats.
Convaincu que je reviendrai à sa raison, mon corps fait le dos rond, il ne réagit pas, il campe sur ses bourrelets, comme pour mieux annihiler mes efforts. Sûr de lui et de la force que lui donne sa passivité, il ne lâche pas un gramme. Il pense que, de guerre lasse, je vais me décourager et lâcher cette affaire, mais, cette fois, il se plante, s’il y a un vaincu, ce sera lui. Son inertie n’est qu’un défi de plus, un autre challenge qui durcit ma détermination. Il n’a pas saisi l’enjeu, mais lorsque, dans le resto gastronomique du coin, je commande sans hésiter le potage du jour, au lieu de l’incontournable foie gras de canard dont les autres se goinfrent, il se met clairement en alerte, l’affaire devient sérieuse. Alors, d’agressé il devient agresseur et il frappe à la tête. Ça tourne et je ressens en milieu de journée les premiers vertiges, cette impression étrange et désagréable de ne pas être là, d’être sorti de mon corps, en un mot de marcher à côté de mes espadrilles.
Mais, même si j’hallucine un peu, mon orgueil est là, borné jusqu’à la stupidité, il s’arc-boute, il ne veut rien lâcher. Je pense à l’histoire qu’on m’a racontée de ce type qui, s’étant affamé pour maigrir, s’accroupit au milieu d’un pré pour chier tranquillement et entend alors un bruit répété, semblable à celui d’une ventouse. Après avoir vainement cherché autour de lui, il ose enfin regarder sous lui et découvre avec stupeur que ce bruit n’est autre que celui de son cul broutant l’herbe avec ardeur…
Mon anus va-t-il se transformer en pompe aspirante ?
Cela fait maintenant trois semaines que la lutte a commencé, mon corps affaibli par la non-bouffe, commence à comprendre que je ne vais pas desserrer l’étreinte, que, malgré les vapeurs de mon cerveau, je m’acharne à l’étrangler et qu’il ne peut plus se borner à jouer la montre. Il consulte le magasinier, les réserves sont là, accumulées depuis toutes ces années, il tente de se rassurer, il peut encore tenir un bon moment, alors il décide un premier prélèvement sur le stock. La balance le dénonce aussitôt, ce matin l’aiguille vient d’amorcer un premier mouvement vers la gauche. Je sais ce que signifie ce signe, ce qu’il laisse présager, mais je ne montre rien, ça vient seulement de commencer… S’il espérait un peu d’indulgence, mon corps se trompe, il n’y aura pas de trêve. Je sais trop bien quel en serait le prix. Je ne change donc rien au dispositif en place. J’accentue ma pression en crevant physiquement (natation, tennis, course…) cet organisme aux abois sous la chaleur plombante de cet été quis’étiiiiiresi lentement. Les chutes de tension et les étourdissements se multiplient, je plane comme si j’étais shooté, mais plus je me sens vulnérable, plus je suis fort.
Je me dissocie de ce corps étranger dont j’observe les réactions avec curiosité et cynisme. J’attends froidement sa défaite, ce n’est qu’une question de temps, je n’ai plus d’impatience. Le premier mois est dépassé, le combat devient trop inégal, mon corps le sent, il prend peur, pas la peine cette fois de convoquer le magasinier pour évaluer les réserves, il déstocke largement… La balance enregistre mécaniquement, l’aiguille bascule sensiblement vers la gauche, je peux enfin lâchermonsourire… Ma peau s’étire comme un parchemin qui se déplie, emportant dans cet étirement une partie des bourrelets, les traits de mon visage s’affirment en s’affinant et, dans cette première métamorphose, j’entre enfin dans la glace, sans appréhension et sans recul, je me laisse regarder.
Je me trouve beau, en vrai, je ne suis pas si mal dans ce nouvel être. Mon Joseph de père, toujours soucieux d’intervenir à temps, tente de me convaincre que le moment est venu de calmer le jeu. Mais je ne l’écoute pas, ce n’est pas maintenant que je vais lâcher ma proie, je veux aller au bout de sa défaite. Au terme du deuxième mois, mon corps démoralisé lâche prise, il largue par-dessus bord, c’est le grand déboulement… les dernières poches de graisse sont aspirées, je sors de ma peau.
Je pourrais accepter un armistice face à cette capitulation sans condition. Je crois naïvement que la situation est under control, que mon cerveau dirige la manœuvre, mais je suis allé un cran trop loin, mon corps ne m’écoute plus, il dérape, il déboule… La balance témoigne de ce sabordage, j’ai perdu près de 15 kilos et l’avalanche se poursuit. À la fin du troisième mois, le changement est spectaculaire, mes joues se creusent, je n’ai jamais été aussi grand… la menace se profile… Cette fois, Joseph beugle un grand coup et déclenche l’alarme : stop la connerie ! Il agite l’épouvantail de l’hôpital, pointe mon inconscience et, en apôtre Pilate, se dédouane totalement.
Pour ne pas faire dans la demi-mesure, ma mère y va de son couplet en précisant qu’elle n’avait pas besoin de ce souci supplémentaire, tout en évitant de préciser à quels autres il s’ajoute, dans sa petite vie mouvementée où coiffure rime avec couture et manucure, sans oublier les contraintes du pot au feu, de l’osso buco et de sa grande spécialité la tarte aux pommes meringuée. Je leur oppose une calme indifférence, mais ce n’est qu’en apparence. Les commandes ne répondent plus et je dévisse toujours, bien qu’ayant discrètement recommencé à m’alimenter normalement. Rien n’y fait, je vais passer le cap des vingt kilos et je paniquegrave, même si l’expression est encore inconnue. Je n’ose plus regarder le fléau de la balance qui, refusant de revenir à ma raison, s’obstine à pencher désespérément à gauche.
Je flotte, sensation d’apesanteur, je n’habite plus dans mes vêtements… Après un rapide conciliabule avec moi-même, face à cette débâcle, sous le regard noir et consterné de Joseph le procureur, je décrète l’état d’urgence et je réintroduis le sucre, dernière mesure sans doute avant pimpon les pompiers… Est-ce l’efficacité soudaine de cettesolutionde dernière extrémité ou mon corps me prend-il enfinen pitié ? Je ne le saurai jamais, mais je constate ce matin en montant sur la balance, alors qu’un filet de sueur coule sournoisement le long de ma colonne, qu’après une petite hésitation sur sa gauche, l’aiguille s’est enfin stabilisée. Ouf… ça devenait chaud devant, le bruit des sirènes s’éloigne, mais le plus long est à venir, il va falloir gérer ma victoire pour préserver cet acquis si chèrement payé. C’est l’autre galère qui se profile dans un horizon que je sais sans fin…
Je suis rentré à Neuilly crottes de chiens, il me reste encore quelques jours, avant de faire mon entrée à la fac de droit de Nanterre et tester l’effet de ma nouvelle silhouette. Sur le chemin du manège, je croise mon ange blond, c’est le choc… Je lis dans ses yeux qui s’agrandissent de stupeur, son incrédulité devant ma métamorphose. Elle me dévisage sans retenue, ce qu’elle n’avait jamais fait. Elle est sciée la cavalière ! Elle en perd toute discrétion. Je fais bien sûr comme si de rien et j’écourte la conversation d’un petit signe de la main accompagné d’un sourire facile, avec la fausse assurance du gars qui n’a rien remarqué. Ça a marché… je suis un autre, sans savoir si cet autre est aussi séduisant que je l’ai voulu. Je n’ai rien lu dans ses yeux effarés par sa découverte du nouveaumoi.
Nanterre de cet octobre-là, le premier jour, je découvre cet amphi blindé, en forme de coque de navire renversé avec ses trois travées plongeantes sur les bancs desquelles les blancs culs de Neuilly Auteuil Passy et du beau 78 côtoient la minorité revancharde des Jets et des Sharks, au cœur de ce campus à l’américaine, bien isolé de la ville, afin qu’on puisse s’y affronter tranquillement. Deux mondes se toisent, dans un mélange d’étonnement, d’indifférence et de mépris, qui d’instinct les sépare et les braque. Ça a pété dans ce passé soixante huitard qu’on a déjà oublié et ça répétera à répétitions dans les années qui suivront mon arrivée dans cette petite poudrière, puisque le détonateur est en permanence enclenché et n’attend que le prétexte.
Travée de gauche (une fois n’est pas coutume) et travée de droite, lesbien nés et parmi eux, à la droite de la droite, le gratin du 16e et puis, travée du milieu, les oubliés du gâteau, ceux pour qui étudier c’est contester et qui revendiquent l’accès à tout, comme un acquis social élémentaire, dans cette démocratie idéale où l’égalité n’a rien à foutre du mérite. Étonnante confrontation dans ce petit monde, entre, d’un côté, ceux que l’argent et le pedigree, les relations de papa/maman, tonton ou tata, protègent des aléas sociaux et qui s’inquiètent raisonnablement de leur avenir et, de l’autre, ceux qui ont tout le chemin à parcourir et croient, ou font semblant de croire, qu’à grands coups de gueules, de grèves sans fin et de main tendue à ces travailleurs qui les méprisent, ils abattront ce mur étanche, waterproof, érigé par ces privilégiés qui actionnent les leviers, indifférents au changement de gouvernants. Pour ces exclus des privilèges, cette fac sur ce site improbable n’est qu’une grande récré où tous les pétards sont permis, à l’abri temporaire de ce jour où, sans état d’âme, la société les placardisera à la place qu’elle leur assignera ou, pire, les recrachera.
Mais cette première année-là, je me fous bien de ces réflexions sociales, je regrette seulement que, noyé dans cet anonymat compact qui nous désindividualise, toutes ces filles auxquelles je voudrais plaire ne me voient même pas. Je les dévisage pourtant de tous mes yeux, zoomant sur chaque travée, regrettant que les blondes, mais les brunes surtout et les auburn sur lesquelles je règle mon viseur soient déjà encadrées par des même pas beaux.
En bas de l’amphi, la petite porte à gauche sur l’estrade vient de s’ouvrir timidement sur madame Than, une miniature asiatique, violemment décolorée en blonde diaphane, les pommettes rebondies en peau de fesse et la lippe bulbeuse s’ouvrant sur des dents mal rangées. Elle nous observe un peu méfiante avec un sourire crispé, ses cils papillonnant précipitamment sur ses deux petites billes de poisson chat. Un silence de pure curiosité salue son arrivée, elle hésite à s’asseoir à ce bureau trop grand et tout nu, planté sur ce perchoir, seul élément du décor. Elle rosit d’un coup derrière la tronche du micro qui la dissimule. Elle se décideà l’empoigner fébrilement et à lui tordre le cou pour se le ramener sous le menton, comme pour se le poser dessus. Elle se cale sur son siège dans un petit dandinement de la croupe. Sa bouche s’entrouvre à regret pour laisser sortir les premiers mots, ceux qui seront déterminants. C’est le moment de vérité qui, entre elle et nous, va décider de tout. On voudrait lui donner sa chance, on est même prêt à faire semblant : allez vas-y, le chiwawa, lance-toi… Mais elle s’étale dans unbredouillement de présentation inaudible qui fait brutalement retomber l’audimat. Sourire cramoisi, petite toux de détresse, c’est fini, les pouces sont baissés… Elle va se la jouer toute seule la pèse peu, son introduction générale au droit civil dans le consensus du refus d’écoute, les plus déterminés venant agiter ostensiblement leur gros cul juste sous son nez.
Moi, l’ancien bon élève de Sainte Croix de Neuilly sur Seinepriez pour nous, je comprends vite que cet amphiBabel n’est pas un lieu d’études, mais de petites rencontres entre amis. Je me désole donc de voir ces jolis petits châssis remonter les travées, si mal accompagnés par de grosgars qui ne donnent pas envie et quitter l’amphi avec eux dans un sourire complice. C’est mon premier atterrissage, j’avais naïvement imaginé que le nouveau moi attirerait les regards, mais ce sont les regards qui m’attirent, sans pour autant se poser sur moi, malgré l’insistance idiote avec laquelle je dévisage tous ces visages. Ça manque de pile dans mon sex trap.
Faute du savoir entreprendre, il va falloir me contenter de ce qui vient s’échouer du côté de chez moi. La première qui m’arrive est une relation d’un vieux copain d’enfance, embarqué comme moi dans cette première année. C’est une brune très piquante, aux cheveux courts aussi épais que le crin d’une jument, genre grassouillette, un peu bouffie, avec une corbeille généreuse, mais lourde et sans doute molle au toucher. La chute de reins dans ce même registre, bien masquée la première fois par une jupe en velours moutarde, m’apparaît dans sa réalité cata la fois suivante, pas contenue dans un pantalon rouge qui souligne ses débordements et les marques d’une toute petite culotte qui n’a pas pris la mesure de ses grasses fesses. Tant pis pour cette disgrâce, je me persuade qu’elle a du chien, puisqu’elle la joue sans complexe et que son assurance me plaît. Sa personnalité vaut bien la rondeur de son cul.
Je constate ce que je savais déjà, ce ne sont pas les belles ou les bien faites qui m’attirent, mais celles qui ont un truc qui m’accroche. C’est ce truc qui, enfant, m’a fait ressentir mon premier émoi pour Gislaine, une mocheté de gamine noiraude, à gros sourcils, mais dont la mâchoire en galoche donnait un genre à son sourire. J’avais un coup de cœur pour ses dents blanches bien alignées. Alors, en luge au sport d’hiver, je me ridiculisais pour que sa bouche s’ouvre béante sur sa jolie dentition dans le roucoulement d’un rire dont la sensualité naissante me troublait. Elle le voyait bien la Gislaine et elle en jouait avec l’expertise de la séductrice que plus tard elle n’a peut-être jamais été. Pourtant, la maturité venant, son menton en avant lui a peut-être redonné son peps d’enfant. Je suis fasciné par l’attrait qu’exerce la laideur de certaines femmes mûres.
En attendant, je vais tester l’intérêt que Myriam, prénom de ce plantureux pain au chocolat, ressent pour moi. Ce n’est pas un challenge, juste un échauffement avant des étapes plus ambitieuses, je vais donc y aller direct, sans préliminaires, convaincu que son sourire en réponse au mien est bien la preuve que nous sommes d’accord. Alors, en ce début d’après- midi, assis à sa droite, je colle avec une indiscrétion provocante ma cuisse contre la sienne et frotte langoureusement ma jambe contre sa jambe. Je ne me donne même pas la peine de la regarder, persuadé du succès attendu. Le résultat, comme je le pensais, ne se fait pas attendre. Elle se tourne lentement vers moi avec un gentil sourire de grande sœur, elle marque un temps et elle me chuchote tout simplement : non…
Non ?
Ce n’est juste pas possible… L’humiliation de ce non me la coupe net, j’en perds la respiration. Tu t’es seulement regardée avant de me dire non ? Je pose les yeux sur toi alors que j’ai beaucoup mieux à chasser, et toi, avec ta croupe à triple étage en flan de pâtissier, tu oses me repousser ? C’est une erreur que tu vas forcément regretter, allez pince moi que je sorte de ce mauvais rêve. Est-ce que tu comprends que c’est pas le scénario ? À cet instant, je voudrais me volatiliser… un petit coup de baguette Samantha ! Dans ma logique d’enfant, je croyais qu’en fermant les yeux, je disparaissais, puisque, ne voyant plus les autres, j’étais sûr qu’eux aussi ne me voyaient plus. J’ai l’impression que tous les regards ont d’un coup plongé sur moi, mais je ne peux pas m’échapper, sans être encore plus ridicule. J’essaye de me composer une attitude, seulement il y a ce feu stupide sur mes joues, cette grosse poche de sang qui s’y est concentrée et que je ne peux pas effacer d’un revers de main. Mais pourquoi ? Mon physique n’est pas en cause, je suis grand, brun, définitivement mince, j’ai des yeux d’un bleu à tomber, je sais causer et faire rire. Qu’est-ce qui ne fonctionne pas ? C’est vrai, je suis mal fringué, je n’en ai pas conscience, on radine clairement là-dessus chez les Neuilléens, mais cette époque-là n’y attache pas beaucoup d’importance.
Pour oublier mes échecs, je croise quelques extravagantes, des pas terribles… Parmi elles il y a Stéphanie la rousse avec son grand mouvement de cheveux en avant, ses yeux vert d’eau, son déhanché sympa et son labello rose décoloré dont elle se pommade sans cesse les lèvres. Ça pue un peu, mais ce n’est pas franchement désagréable. Évidemment Stéphanie, elle ressemble à une jument avec sa grande taille, elle a aussi des petits trous dans la peau. Elle fume une petite pipe, elle m’étourdit, je joue à l’étudiant. Mais ça manque d’envie, même si Stéphanie est pleine de vie. Alors, je décide de rejoindre la travée du centre, celle du marais que ceux des beaux quartiers préfèrent éviter.
C’est souvent quand on n’attend rien que quelque chose arrive. Cet après-midi-là, alors que je comate dans le ronronnement de cette Histoire du droit qui se déroule sans moi, je me retourne machinalement, juste pour décontracter ma nuque. Et dans ce mouvement, je découvre, quelques rangées derrière moi, ce visage lumineux avec ses traits et son sourire de petite fille, encadré par des cheveux dont les multiples reflets blonds descendent sur ses épaules comme une pluie étincelante qui m’éblouit. Je prends un grand splashde fraîcheur dans la tronche. Elle me sourit avec un étonnement très naturel et sans aucune gêne, alors que, dans la surprise de ma découverte, je l’ai braquée. Je me suis figé sur elle, les compteurs sont bloqués… Voyant que je n’arrive pas à atterrir, elle est sur le point d’éclater de rire, sa bouche s’ouvre sur ses dents blanches de Perrette au pot au lait qui me ramènent brutalement au ridicule de mon voyeurisme. Mon cou pivote d’un coup pour se remettre en place. Mais je crève d’envie d’y retourner…
Ce joli flash me renvoie à un souvenir d’enfance, celui de l’effet grands magasins. J’ai toujours eu du mal à le situer dans le temps, il flotte entre enfance et préadolescence, plus proche probablement de la première. Boulevard Haussmann, au cœur du mois de décembre, je viens de sortir des grands magasins avec ma mère, et elle surgit en face de moi cette petite rousse avec ses minuscules tâches claires sur le visage, comme autant de touches d’un pinceau d’impressionniste et ses yeux de jade dont la douce transparence me fait frissonner. Ses jolis cheveux fauves descendent en petites tresses serrées jusqu’à la naissance des épaules. L’ovale de son visage a la perfection fragile des femmes de Vermeer, le grain de sa peau leur délicatesse et leur teint de lait. Son regard pénètre le mien, je vibre jusqu’au bout des orteils, une onde délicieuse parcourt mon corps, je suis pétrifié… C’est un instant d’extase comme je n’en ai pas encore connu. Mais, le plus merveilleux dans le choc émotionnel de cette rencontre inattendue, c’est la sensation intuitive, mais certaine, que ce ressenti est partagé, car elle aussi s’est immobilisée en me voyant. Nous sommes dans le même étonnement, quelque chose que nous ne comprenons pas nous attire l’un vers l’autre et nous enveloppe dans la magie de sa promesse. C’est la RENCONTRE, celle que le destin vous offre une seule fois, sans préavis et sans explication. À prendre et à ne pas laisser passer…
Oui, peut-être, mais je ne suis pas dans le bon tempo, car même si je ne demande qu’à croire à la princesse charmante, je suis encore prépubère, difficile dans cet état inachevé d’engager toute une vie, sans hésitation et sans retour, même sous le coup de la foudre. On ne pourrait pas refaire la scène dans dix ans, même en prenant le risque qu’elle ait perdu ses adorables taches de rousseur ? Et puis, je ne peux pas planter maman comme ça, au sortir d’un grand magasin, même pour un conte de Noël… En plus, j’ai laissé mon destrier blanc à l’écurie et je ne sais pas où se trouve son château, ni si je m’y plairais. Alors, laissez-moi m’abandonner à cet instant hors du temps, sans avoir besoin de décider. Mais elle aussi est accompagnée de sa mère qui, n’ayant conscience de rien, la rappelle sans précaution à la réalité. Le timbre de sa voix fait éclater la bulle, mon inconnue détourne brusquement son regard, elle est ramenée vers cette main qui se tend et elle disparaît dans le flot des passants. Il n’y a eu entre nous, ni murmure, ni geste, pas même l’esquisse d’un sourire, juste ces regards qui se sont noyés… Mais l’intensité de cette rencontre éclair donnera à la magie de son souvenir cette force étrange et troublante qui me fascine encore. Reste, comme pour mes premiers pas, le doute insidieuxque mon imagination frustrée n’ait encore tout inventé.
Pourtant, en me retournant tout à l’heure sur cette jeune blonde, même si la rencontre de nos regards était différente, j’ai ressenti la délicieuse surprise de l’effet grands magasins… Mais c’était tellement indiscret que je n’ose plus y revenir. Comment faire pour me retourner de manière naturelle ? Il faudrait un peu de temps, mais c’est long le temps, quand l’envie est trop forte pour donner du temps au temps. Tant pis, j’y reviens et si elle éclate de rire, je rirai aussi, c’est la seule défense possible. Son sourire creuse deux petites fossettes symétriques au cœur de chacune de ses joues et j’en aperçois une troisième qui se dessine au milieu du menton. Il y a aussi cette frange en épi qui cache son front et que je n’avais pas remarquée. Sa frimousse est ronde et potelée, son nez, petit et fin, sa lèvre inférieure, un peu épaisse. À la détailler, elle ne tient pas les promesses de son sourire, mais je les préfère avec des défauts qui les personnalisent. Ça ne va pas être simple de l’aborder, sans qu’elle me voie arriver avecmes sabots dondaine… Je calme mon impatience un jour ou deux jusqu’à cet intercours où je la vois discuter au milieu d’un petit groupe dans lequel je repère un gars que je connais vaguement, un corse tout frisé au tarin bien incurvé avec de grosses lunettes noires. C’est le fil rouge pour aller jusqu’à elle.
C’est la première fois que je la vois debout, elle a remonté ses cheveux dans un chignon un peu lâche qui laisse s’échapper de grandes mèches épaisses qu’on voudrait prendre à pleines mains et découvre l’ourlet de son oreille trop charnu à mon goût. Elle n’est pas grande, elle a un petit ventre rebondi, c’est le stade d’avant celui des premiers bourrelets, des seins proportionnés à sa silhouette, en forme de poire, comme je les imagine sous son soutien-gorge. Elle porte un col roulé multicolore et un pantalon en velours marron très petit bateau, rien d’excitant, des petites bottines dans le même ton et je devine que, même au printemps, il y a peu de chances que je voie ses jambes.
Sa voix chantonne et mon oreille sensible perçoit le chuintement d’un adorable s’feu, dont je ne veux pas croire qu’il soit la séquelle, dans la prime enfance, de quelques pipis au lit… Il y a une gaieté naïve dans le timbre de sa voix, de petits scintillements dans ses yeux noisette, une bienveillance dans son regard. Elle est si mignonne cette petite poupée qu’on a spontanément envie de la dorloter. Je me glisse derrière le Corse, en me planquant derrière son tarin. J’essaye de me mêler à la conversation où il est question de Bretagne et de Bretons. Sylvie (c’est son prénom) est bretonne. Mais je suis sec sur la Bretagne et plus encore sur les Bretons, alors je vais de l’un à l’autre en souriant bêtement, je ris mécaniquement à des allusions que je ne comprends pas. J’essaye de m’introduire dans ce cercle, mais je bute à sa porte…
J’ai souvent eu cette impression de ne pas savoir entrer dedans. Est-ce une inaptitude aux autres ? Une forme d’autisme ? Ou le besoin de rester spectateur pour mieux les observer ? Je regarde Sylvie, j’aime la résonance de ce prénom très répandu, ce qu’il m’évoque, la forêt, la magie des fées, c’est aussi à l’époque mon côté Sylvie Vartan, dont la sensualité langoureuse, la voix traînante et cajoleuse allumaient mes fantasmes. Elle rit sans retenue Sylvie, ça sonne clair. Je cherche à attirer son regard, elle pose furtivement les yeux sur moi, je n’y lis qu’un peu de curiosité, rien de moqueur, elle semble avoir oublié mon indiscrétion. Mais je n’arrive pas à participer à la conversation qui roule sans moi. Je suis là en figurant, con et emprunté. Fin de la scène, j’ai raté mon entrée.
Le lendemain, alors que je descends l’amphi, je l’aperçois au moment où elle s’assoit dans la travée du milieu, juste au centre, il n’y a encore personne à côté d’elle, j’ai un peu de chance pour une fois, welcome… Je me positionne à l’entrée pour empêcher quiconque de me précéder. Je joue l’hésitant, je me retourne comme si j’attendais la bande de copains que je n’ai jamais eue, je regarde ma montre, je pousse un petit soupir impatient et agacé. Je n’y tiens plus, je me faufile dans la rangée. Bien sûr, je fais l’étonné de la voir à cette place en lâchant un bonjour aussi distrait que possible. Ses yeux de petite fille me sourient avec malice, j’évite de vérifier dans son regard si elle est dupe. Elle est trop gentille pour se foutre ouvertement de moi. Son parfum laisse planer une discrète senteur de citronnelle, rien de recherché. Je suis bien, assis sagement à côté d’elle. Elle a de petites mains, presque des menottes, ses ongles sont courts et soignés sous un vernis transparent. Ses traits expriment une bonne humeur naturelle, une douceur tranquille. Elle écoute calmement le cours, prend des notes d’une écriture ronde et régulière. Je m’efforce de ne la zieuter que du coin de l’œil. Elle semble indifférente à cette attention oculaire. À l’intercours, elle tourne enfin la tête vers moi, elle sourit et elle attend, d’un air de dire : allez vas-y, je t’écoute, ça fait un moment que tu en as envie et je vois bien que tu ne sais pas comment t’y prendre…
Face à cette perche, je ne peux plus hésiter, avant que le silence ne devienne gênant, je me lance… Je parle trop vite, c’est impulsif et chaotique, je suis conscient que je la gave un peu, mais j’ai peur du blanc… Je voudrais me mettre en valeur tout en cherchant le sujet qui capte son attention, l’équation du dragueur… Comme elle semble m’écouter, je me chauffe et le moteur s’emballe, j’en arrive par je ne sais plus quel fil passant dans je ne sais plus quelle aiguille à lui parler de… De Gaulle ! Le Gaullisme, tout ce qu’on peut y fourrer, à vrai dire je m’en fous, ça ne déclenche rien chez moi, mais l’homme des mots me fascine, et plus encore, sa manière de les utiliser, de leur donner un rythme, un souffle, une intensité théâtrale au service de son histoirepour se propulser dansla grande… Comme d’autres, je connais par cœur ses grands discours, je les déclame en imitant le timbre de sa voix dans ses différentes variations, au fur et à mesure de son évolution. Le destin de ceux qui ont fait marcher l’histoire, c’est mon dada, moi qui suis à quai… Quelle prémonition les a guidés ? Quelle porte ont-ils ouverte pour passer de l’autre côté ? Ils se sont lancés à partir d’un événement, d’une intuition et surtout à cause de ce besoin irrésistible de crever l’écran de leur vie, en acceptant de le payer cash.
Ça y est, c’est parti, je suis en scène… J’ai tellement envie de faire partager mon enthousiasme que je me crois brillant, convaincant, mais j’oublie que, derrière mon projecteur, je suis le seul spectateur. À chaque fois, cette prise de conscience me fait brutalement redescendre de l’estrade au milieu du numéro. Dégrisé, j’attends le verdict.
Elle n’a pas dit un mot, elle fixe sur moi un regard étonné, sa bouche s’entrouvre légèrement sur ses dents de lait, visiblement, elle ne s’attendait pas à cela. Un silence… Je m’excuse de mon emballement, de ne pas lui avoir laissé en placer une. Elle a en retour un sourire indulgent et m’assure d’une petite voix acidulée qu’elle a trouvé ça… intéressant.
Intéressant ? Mais je vois bien que son intérêt se limite à une curiosité amusée pour ce gars d’un genre inhabituel, spécimen jusque-là inconnu d’elle, sur lequel on s’arrête un instant, sous l’effet de la surprise et qu’on archive ensuite… Elle s’est déjà détachée… Le cours a recommencé, chacun de nous reprend sa pause et l’indifférence ses droits. Je ne partage plus avec elle que cette senteur de citronnelle qui flotte discrètement autour de moi. Je ne m’en veux même pas, à quoi bon… Je comprends que De Gaulle pour séduire Caroline à la plage





























