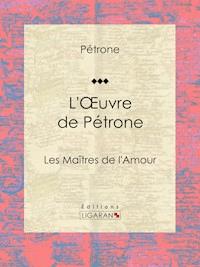
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Il y a déjà bien longtemps que je vous promets le récit de mes aventures. Le moment est venu de tenir parole aujourd'hui qu'une heureuse occasion nous réunit, car nous ne sommes pas ici exclusivement pour fixer des points de science, mais pour causer aussi et pour rire un peu en nous racontant de bonnes histoires."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335087727
©Ligaran 2015
(Édition allemande 1773.)
Parmi tant de chefs-d’œuvre que nous a laissés l’antiquité classique, il y en a de plus célèbres, mais il y en a peu d’aussi lus que le Satyricon de Pétrone. De ce que ce roman a toujours été populaire et l’est resté même à notre époque, ce serait pourtant une erreur de conclure qu’il soit d’un abord très facile. Nul ouvrage, peut-être, n’a plus besoin de commentaire.
Sans doute, à première lecture, le charme du récit, la vive peinture des mœurs et des caractères, l’esprit et l’entrain de l’auteur font que l’on passe volontiers et presque sans les apercevoir sur des difficultés aussi nombreuses que graves, mais il n’y a rien d’exagéré à dire que plus on vit dans la familiarité de Pétrone, plus on approfondit son œuvre, plus on voit se multiplier les points d’interrogation.
Une notice donnant à l’avance la solution de toutes ces obscurités apparaît donc comme le complément presque indispensable d’une édition de Pétrone.
Malheureusement, malgré de très nombreux et très savants travaux, c’est une tâche impossible actuellement de résoudre seulement les plus essentielles des innombrables questions que soulève le Satyricon.
Ajoutons-le pour la consolation du lecteur, il est peu probable – à moins qu’on ne découvre de nouveaux manuscrits – que les érudits de l’avenir arrivent à des conclusions beaucoup plus satisfaisantes et beaucoup plus sûres que celles dont nous sommes obligés de nous contenter.
Pétrone est, en effet, d’une lecture difficile non seulement pour un homme cultivé, mais pour un latiniste, mais même pour les spécialistes, philologues et historiens, qui ont consacré toute une vie de labeur acharné à l’étude de la décadence latine. Nombreux sont les points sur lesquels leurs travaux n’ont fait qu’accentuer la divergence de leurs vues, et ce n’est pas sans motif qu’un traducteur de Pétrone, J.N.M. de Guerle a intitulé le commentaire qu’il lui consacre : Recherches sceptiques sur le « Satyricon » et sur son auteur.
Pour ne pas nous engager dans des discussions sans fin, nous nous bornerons ici à indiquer les problèmes posés par la critique et les principales solutions entre lesquelles elle hésite, sans nous interdire cependant de laisser deviner nos opinions personnelles.
Il ne nous est parvenu qu’une partie du Satyricon ; les morceaux qui nous ont été conservés présentent bien des lacunes, bien des obscurités, bien des fautes. Non seulement l’époque où vivait Pétrone, non seulement le temps et le lieu où se passe le roman sont discutés, mais on n’est d’accord ni sur l’identité de l’auteur, ni sur le but de son œuvre, ni sur l’authenticité d’une notable partie des fragments qui nous sont parvenus. Nous allons examiner brièvement ces diverses questions.
I. L’auteur du « Satyricon ». – Les manuscrits portent, sans autre indication, le nom de Titus Petronius Arbiter.
L’histoire a conservé la trace de nombreux dignitaires du nom de Pétrone qui se sont distingués à divers titres sous l’Empire dans l’administration ou dans la guerre, y compris un empereur, Pétrone-Maxime, assassin de Valentinien III et lui-même assassiné trois mois après. Les lettres gardent la mémoire de onze auteurs ayant porté ce nom, dont un pieux évêque canonisé par l’Église. Il était naturel de chercher parmi ces personnages l’auteur du Satyricon, et les érudits n’y ont point manqué.
Au XVIe siècle, Pithou, aussi estimé comme philologue que comme jurisconsulte, a cru pouvoir l’identifier avec le plus célèbre de tous, avec le Pétrone, favori, puis victime de Néron, immortalisé par une belle page de Tacite au XVIe livre des Annales, paragraphes 18 et 19.
« … Il consacrait, dit le grand historien, le jour au sommeil, la nuit aux devoirs et aux agréments de la vie. Si d’autres vont à la renommée par le travail, il y alla par la mollesse. Et il n’avait pas la réputation d’un homme abîmé dans la débauche, comme la plupart des dissipateurs, mais celle d’un voluptueux qui se connaît en plaisirs. L’insouciance même et l’abandon qui paraissaient dans ses actions et dans ses paroles leur donnaient un air de simplicité d’où elles tiraient une grâce nouvelle.
On le vit, cependant, proconsul en Bithynie et ensuite consul, faire preuve de vigueur et de capacité. Puis retourné aux vices, ou à l’imitation calculée des vices, il fut admis à la cour parmi les favoris de prédilection. Là, il était l’arbitre du bon goût : rien d’agréable, rien de délicat, pour un prince embarrassé du choix, que ce qui lui était recommandé par le suffrage de Pétrone. Tigellin fut jaloux de cette faveur : il crut avoir un rival plus habile que lui dans la science des voluptés. Il s’adressa donc à la cruauté du prince, contre laquelle ne tenaient jamais les autres passions, et signala Pétrone comme ami de Scévinus ; un délateur avait été acheté parmi ses esclaves, la plus grande partie des autres jetés dans les fers, et la défense interdite à l’accusé.
L’empereur se trouvait alors en Campanie, et Pétrone l’avait suivi jusqu’à Cumes, où il eut ordre de rester. Il ne soutint pas l’idée de languir entre la crainte et l’espérance, et toutefois il ne voulut pas rejeter brusquement la vie. Il s’ouvrit les veines, puis les referma ; puis les ouvrit de nouveau, parlant à ses amis et les écoutant à leur tour ; mais, dans ses propos, rien de sérieux, nulle ostentation de courage, et de leur côté, point de réflexions sur l’immortalité de l’âme et les maximes des philosophes ; il ne voulait entendre que des vers badins et des poésies légères. Il récompensa quelques esclaves, en fit châtier d’autres, il sortit même ; il se livra au sommeil, afin que sa mort, quoique forcée, parût naturelle. Il ne chercha point, comme la plupart de ceux qui périssaient, à flatter par son codicille ou Néron, ou Tigellin ou quelque autre des puissants du jour. Mais, sous les noms de jeunes impudiques et de femmes perdues, il traça le récit des débauches du prince, avec leurs plus monstrueuses recherches, et lui envoya cet écrit cacheté, puis il brisa son anneau, de peur qu’il ne servît plus tard à faire des victimes. »
Tacite appelle le courtisan de Néron : arbiter elegantiarum, l’arbitre des élégances ; il en fait un voluptueux raffiné et lui attribue une satire contre Néron. Or le nom de notre auteur est Titus Petronius Arbiter, il se donne pour un adepte de la philosophie d’Épicure ; et il est bien tentant d’admettre que le Satyricon n’est autre chose que cet écrit ridiculisant et flétrissant les mœurs de Néron, de l’infâme Tigellin et des autres favoris du prince. Le récit de Tacite est du reste confirmé par Pline l’Ancien et par Plutarque, qui ajoutent qu’avant de mourir Pétrone fit briser une coupe précieuse, « une coupe de cassidoine valant 300 grands sesterces », pour la dérober à l’avidité de Néron.
Enfin Terentianus Maurus, qu’on fait vivre sous Domitien, cite Pétrone comme se servant volontiers du vers iambique. Il faut donc que l’auteur du Satyricon soit antérieur à Domitien ; et comme entre le règne de ce dernier et celui de Néron nous ne connaissons aucun Pétrone dont le signalement réponde à celui du romancier, on est amené logiquement à l’identifier avec le favori de Néron.
Malheureusement ce dernier s’appelait Caius Petronius Turpillianus, tandis que notre auteur se nomme Titus Petronius Arbiter : on n’explique pas par quel miracle l’épithète arbiter elegantiarum s’est transformée si bien en un nom propre que, dans la suite, l’auteur du Satyricon est appelé indifféremment Petronius et Arbiter. En outre, les prénoms sont différents.
Le pamphlet que Pétrone composa quelques heures avant sa mort était nécessairement court : le roman satirique, dont nous ne possédons du reste qu’une faible partie, a deux ou trois cents pages et contient deux longs poèmes. Quelque prodigieuse-que fut sa facilité, le favori de Néron n’a pas eu le temps matériel de dicter avant d’expirer une œuvre d’aussi longue haleine.
N’ayant plus rien à ménager, on ne voit pas pourquoi il se serait servi de noms supposés, pourquoi il aurait eu recours au roman pour flétrir ses ennemis ; il aurait bien mal atteint son but, puisque pour certains commentateurs c’est Néron qu’il a voulu peindre sous les traits de Trimalcion, tandis que pour d’autres ce parvenu vieux et ridicule peut tout au plus être identifié à Tigellin. On ne comprend pas davantage comment il a pu perdre un temps précieux sur des hors-d’œuvre inutiles à sa vengeance, comme, par exemple, la matrone d’Éphèse.
Avant de la cacheter, il aurait dû prendre le temps de faire copier sa diatribe, car il est difficile d’admettre que Néron ait poussé l’amour des belles-lettres jusqu’à livrer bénévolement à la publicité un écrit destiné à le tourner en ridicule.
Enfin, l’identification des deux Pétrone ne date que du XVIe siècle, et Pithou, qui en est l’auteur, ne la donne que pour une simple conjecture. Comment se fait-il que l’œuvre d’un personnage illustre, illustré en outre par Tacite et traitant par surcroît d’un Néron, ne soit mentionnée ni par Suétone ni par Pline, ni par Martial, ni par Juvénal, et que Quintilien même, si bien informé de tout ce qui s’était écrit avant lui, ait négligé d’en parler. On a allégué, il est vrai, le témoignage de Terentianus Maurus, mais pour le placer sous Domitien il faut l’identifier avec le Terentianus, fonctionnaire en Afrique, mentionné par Martial, ce qu’on fait sans l’ombre d’une preuve. Bien plus, Lac-tance-Placide accuse T. Pétrone d’avoir pris dans la Thébaïde de Stace, qui mourut sous Trajan, l’hémistiche fameux :
ce qui repousse assez bas dans l’histoire des lettres latines et Pétrone et, par suite, Terentianius Maurus qui le mentionne.
Nous n’aurions pas discuté aussi longuement cette hypothèse si elle avait pour seule conséquence d’attribuer à l’auteur de Satyricon une biographie de fantaisie. Mais elle fixe, ce qui est beaucoup plus grave, la date de l’œuvre et par suite, si elle est erronée, elle en fausse radicalement l’interprétation : si T. Pétrone a été contemporain de Néron, ses jérémiades sur la décadence de la poésie et surtout de la peinture ne peuvent passer que pour les déclamations prophétiques peut-être, mais très exagérées, d’un esprit chagrin quoique clairvoyant. N’est-il pas plus beau et aussi plus vraisemblable de voir en notre auteur un dernier adorateur et un dernier représentant de l’idéal classique égaré en pleine décadence et sentant déjà la barbarie proche ?
Si T. Pétrone est mort en 66, c’est-à-dire deux ans avant Néron, il a entendu situer son roman sous Auguste ou Tibère, et les mœurs qui s’y trouvent décrites sont celles de ses contemporains. Si cette date est erronée, l’historien qui l’adopte risque de se figurer la Rome des Césars comme déjà rendue à un degré de décadence, de décomposition morale qui, en réalité, n’a été atteint qu’un ou deux siècles plus tard.
Enfin, le critique qui fait de T. Pétrone presque un contemporain d’Auguste sera porté à se dissimuler les défauts de sa langue, ceux de son style, ceux de sa poétique. Et cela est si vrai que le suprême argument qu’allèguent les partisans de l’hypothèse que nous combattons en ce moment, c’est la pureté de la langue, la pureté du style, l’élégance classique des vers chez Pétrone. Il nous semble, au contraire, que ses rares qualités ne doivent pas servir à nous dissimuler des défauts assez visibles et même assez gros. N’est-il pas dangereux d’admettre trop facilement au nombre des modèles classiques un écrivain qui, à plus d’un titre, ne le mérite pas complètement, et une erreur de date qui engendrerait un tel aveuglement serait-elle sans conséquence et pour le goût littéraire et pour l’esprit critique lui-même ? N’est-il pas plus intéressant, pour peu que l’hypothèse soit vraisemblable, de se représenter en Pétrone un dévot de la littérature et de l’art antiques se débattant en pleine décadence, subissant cependant, malgré lui, les modes littéraires de son époque et victime parfois à son tour de cette corruption du goût contre laquelle il s’élève.
L’opinion vers laquelle nous inclinons a du reste pour elle des autorités anciennes : Henri Valois place Pétrone sous le règne de Marc Aurèle, son frère Adrien sous Gallien, Stabilius, Bourdelot et Jean Leclerc sous Constantin. Enfin Lydio Giraldi le fait vivre sous Julien, ce qui est aller un peu loin : comment, en effet, en pleine bataille religieuse, Pétrone eût-il pu ignorer si parfaitement le christianisme ? On l’a même confondu avec l’évêque de Bologne canonisé dont nous parlions au début de cette étude et qui vivait au Ve siècle. Ce n’est donc point chose facile de lui assigner une date. Mais il ne saurait en aucun cas, à notre avis, être ni le favori de Néron, ni même un de ses contemporains. Comme, d’autre part, il est mentionné par quelques écrivains du IIIe siècle, il n’est guère possible de le faire descendre plus bas que Dioclétien, mais, étant donné surtout ce qu’il dit de la décadence totale de la peinture à son époque, nous inclinons à le placer fort peu avant ce prince. On ne manquera pas de nous objecter la pureté, du reste relative, de sa langue et de son style. Mais les exemples ne manquent pas d’écrivains qui, en pleine décadence, ont su maintenir l’idéal classique.
On n’est pas plus fixé sur le lieu que sur la date de naissance de notre auteur. Mentionnons cependant la tradition qui fait de Pétrone un Gaulois. Elle est basée sur un texte de Sidoine-Apollinaire, du reste insuffisamment clair, qui semble le faire naître ou au moins le faire vivre à Marseille, et sur une conjecture assez plausible de Bouche, dans son Histoire de la Provence, qui fait sortir l’auteur du Satyricon du village de Petruis, aux environs de Sisteron, parce qu’une inscription découverte en 1560 a révélé que cette localité portait dans l’antiquité le nom de Vicus Petronii. Ce ne serait donc pas tout à fait par hasard que par la légèreté de son style, par les agréments de son esprit et surtout par son talent de conteur, Pétrone se trouve être l’ancêtre de Rabelais, de La Fontaine, de Le Sage et de Voltaire. Mais est-il besoin de le dire, cette hypothèse, du reste assez plausible, est plus agréable à notre amour-propre de Français que solidement établie.
II. Le texte du « Satyricon ». – I. Le texte que nous possédons se compose de trois parties : la première et la dernière racontent les aventures d’Encolpe et de ses amis, la seconde, qui est un hors-d’œuvre, décrit un banquet donné par l’affranchi Trimalcion.
Comme nous l’avons déjà dit, nous ne possédons qu’une faible partie du roman de Pétrone, un douzième, suivant Douza, un sixième, suivant l’estimation plus modérée et sans doute plus exacte de M. Collignon. Le Codex Tragurensis (actuellement Parisinus 7989) porte, en effet, en sous-titre : Fragments des livres XV et XVI. D’autre part, une interpolation de Fulgence (Ms. Paris 7975) attribue au livre XIV la scène racontée au chapitre 20. Bien que ces deux indications ne soient qu’à peu près concordantes, il est permis d’en conclure que la première partie des fragments que nous possédons (chap. 1 à 26), contenant l’entretien d’Encolpe et d’Agamemnon sur la décadence de l’art oratoire, la fuite d’Ascylte, l’histoire du manteau volé et celle de Quartilla faisait partie du livre XIV. Le Banquet de Trimalcion, qui vient couper les aventures d’Encolpe et constitue, avons-nous dit, un épisode bien distinct et fort long, formait très probablement à lui seul un livre complet, le XVe, et, en conséquence, la suite des aventures d’Encolpe à partir de sa rencontre avec Eumolpe (à la fin du chapitre 140) se trouvait très vraisemblablement dans le livre XVI. La déconfiture d’Eumolpe devait clore ce livre, mais non pas, probablement, l’ouvrage tout entier, puisque le sort des deux principaux personnages n’est pas encore fixé au moment où nos fragments s’arrêtent. Donc, en considérant l’épisode de Trimalcion comme un livre complet ne présentant ni lacunes ni abréviations, en supposant tous les livres à peu près d’égale longueur, en admettant enfin que l’ouvrage s’arrêtât à la fin du livre XVI ou peu après, hypothèse encore plus douteuse que les deux précédentes, il faudrait multiplier par seize la longueur du Banquet, qui compte environ cinquante paragraphes, pour avoir approximativement celle de l’ouvrage ! Quelle que soit la valeur de cette méthode de calcul, ce qui est certain, c’est que le roman formait un énorme manuscrit dont le dessus et sans doute aussi le dessous se sont perdus et dont le milieu seul a été conservé.
Dans la partie qui subsiste on trouve du reste tant d’allusions à des évènements qui n’y sont pas mentionnés qu’il est impossible à première vue de ne pas s’apercevoir que le texte qui nous est parvenu n’est qu’une suite. Enfin, les écrivains du Moyen Âge citent divers passages de Pétrone, que nous n’avons plus.
Le fragment même que nous possédons n’est pas complet : il présente des lacunes dont il est difficile d’apprécier l’importance. Certaines incohérences, certaines transitions défectueuses, certaines faiblesses de style révèlent le travail plus ou moins adroit d’un abréviateur qui a copié fidèlement divers morceaux, qui en a sauté d’autres, qui en a enfin résumé. Il paraît du reste n’avoir pas opéré au hasard. « Il semble, dit M. Lecoultre, que l’abréviateur, s’il a été guidé par un principe quelconque, a eu soin de nous conserver des discussions sur la décadence de l’art oratoire, qui étaient si fréquentes au premier siècle, les discours ridicules d’un parvenu qui cite des auteurs à tort et à travers et les élucubrations d’un poète de l’école classique qui proteste contre les innovations de Lucain. » Ces préoccupations littéraires semblent indiquer que le remaniement que nous constatons est dû à un écrivain ou à un professeur qui, poursuivant un but très spécial et très précis, a pu altérer profondément le texte pour ne garder que ce qui était à sa convenance.
Cet abrégé, à son tour, a subi les injures du temps et présente de nombreuses lacunes. Il a été d’autant plus massacré par les copistes que ceux-ci ont dû s’ingénier à combler les lacunes, à rétablir le texte là où il était devenu illisible, à le corriger quand il renfermait des mots grecs, ou des termes techniques, ou des expressions populaires, ou des allusions à des usages qu’ils ne comprenaient plus, toutes occasions d’altérer davantage un texte déjà abîmé, que le Satyricon leur offrait en abondance.
Enfin, le texte que nous possédons ne nous est parvenu que par fragments successifs.
1° Un premier fragment découvert en 1476 a été imprimé à Milan, en 1482, et est resté le seul texte connu de Pétrone jusqu’en 1565. Il correspond aux deux meilleurs manuscrits de la Bibliothèque nationale et contient la majeure partie de ce qui nous est parvenu des aventures d’Encolpe, ainsi que le début du Banquet de Trimalcion. C’est la partie la plus sûrement authentique.
2° Le Codex Sambucus, publié à Vienne (1564) et à Anvers (1565), qui a servi à l’établissement des éditions publiées de 1564 à 1664, et le fragment trouvé par Corvin, dans un couvent de Bude, en 1587, ou Codex Pithœius (de Pithou), donnent un texte moins bon, mais généralement considéré comme authentique et complétant sur plusieurs points les manuscrits précédents, dans lesquels ils s’emboîtent en quelque sorte.
3° Parmi les lacunes que laissait subsister la combinaison des différents manuscrits que nous venons de mentionner, il y en avait une particulièrement importante. Il nous manquait encore la dernière et majeure partie du banquet de Trimalcion. Elle fut découverte par Pierre Petit dans la bibliothèque du couvent de Trau et publiée pour la première fois à Padoue en 1664. Le nouveau manuscrit s’emboîtait également dans les précédents : il contenait en effet tout le Banquet, dont les premiers chapitres étaient déjà connus, et se raccordait ainsi au début avec la première partie des aventures d’Eumolpe. Il se raccordait aussi, à la fin, avec la deuxième partie de ces aventures : le fragment de Trau rétablissait donc la continuité entre les deux fragments déjà connus. C’était, en outre, un document du plus haut intérêt pour l’étude des mœurs et de la langue de la ville impériale.
Pourtant, son authenticité fut immédiatement contestée par les deux frères A. et Ch. Valois. Pierre Petit, sous le pseudonyme de Marinus Stabilius, défendit sa découverte et envoya le manuscrit à Grimani, ambassadeur de Venise à Rome, pour le faire étudier par les savants : il fut établi qu’il datait au moins de deux cents ans. Un nouvel examen eut lieu en France, chez le grand Condé, et conduisit aux mêmes conclusions. Depuis lors, il fut communément admis, mais sans preuves décisives, que le Banquet était du même auteur que les Aventures d’Encolpe.
Nous aurons à revenir sur cette mémorable discussion. Bornons-nous pour l’instant à en souligner l’importance. Ce n’est pas pour le plaisir d’être pédant que nous avons ennuyé le lecteur de cette aride histoire de manuscrits : si par hasard la solution qui a prévalu était erronée, si le Banquet était d’un autre auteur que les Aventures d’Encolpe et d’un auteur bien postérieur, toute la critique, toute l’interprétation de l’œuvre attribuée à Pétrone se trouverait faussée depuis 1664. Tout ce qu’on a écrit sur le style, sur le talent de l’auteur, sur la grammaire du Satyricon, sur les mœurs qui y sont décrites, sur le but même de l’ouvrage serait nul et non avenu, puisqu’on aurait parlé à la fois de deux auteurs très différents, écrivant à des époques peut-être très éloignées.
4° Il existait encore de nombreuses lacunes dans le texte du Satyricon qui en rendaient le sens obscur et la lecture difficile. Elles se trouvèrent comblées d’une manière assez heureuse par le manuscrit découvert par Dupuis à Belgrade, traduit par Nodot et édité par Leers de Rotterdam.
L’inauthenticité en fut presque aussitôt péremptoirement établie, et par la seule étude de la-langue le faussaire, mauvais latiniste, mais écrivain assez ingénieux, s’était servi des allusions contenues dans les fragments déjà connus à des évènements qui n’y sont pas racontés pour en reconstituer le récit et avait exécuté ce travail avec assez d’adresse pour faire du Satyricon un ouvrage suivi, se suffisant à lui-même et ne présentant plus que de rares incohérences.
Nous n’avons pas exclu de cette traduction les fragments de Nodot, parce que, suivant la remarque de Basnage, ils donnent de la liaison à un ouvrage qui n’en avait pas et en rendent la lecture facile et agréable. Nous nous sommes borné à mettre entre une apostrophe renversée (‘) et une apostrophe (’) toutes les parties du texte dont l’inauthenticité n’est plus discutée aujourd’hui.
5° Les fragments découverts plus tard par Marchena à Saint-Gall ont également été reconnus inauthentiques et n’ont pas même le mérite de rendre l’ouvrage plus lisible. Nous avons donc jugé inutile de les traduire.
Arrivé au terme de cet ennuyeux mais indispensable paragraphe, il nous faudrait conclure, ne fût-ce que pour être clair, et nous ne trouvons à apporter au lecteur qu’une impression personnelle : nous croyons pour notre part, et plus fermement encore depuis que nous avons traduit l’un et l’autre, que le Banquet est d’une autre main et d’une autre époque que les Aventures d’Encolpe. De ces deux morceaux, le premier nous a paru beaucoup plus difficile à comprendre parce qu’il est écrit suivant une syntaxe plus incertaine, dans une langue plus corrompue, plus faisandée ; le second nous a semblé plus difficile à traduire parce que sa langue est plus latine et plus élégante, son style plus fin et plus serré. Le premier nous paraît l’œuvre d’un romancier naturaliste qui peint avec une exactitude scrupuleuse les mœurs et les usages de son temps, mais qui se révèle assez inhabile dans l’analyse des caractères ; le second est au contraire l’œuvre d’un psychologue enjoué et profond et d’un moraliste sceptique, nourri des maximes d’Épicure et tout spécialement préoccupé des rapports qu’il entrevoit entre la décadence des mœurs et celle des arts et des lettres. Son Encolpe est un aventurier lettré qui ne connaît ni scrupules, ni remords, ni foi, ni pitié, mais c’est un jeune homme, et quand il lui arrive d’avoir à souffrir des agissements de ses pareils, il pleure, il déclame, il s’indigne et devient pour un moment moraliste : son caractère est peint avec une finesse, une naïveté et une grâce inimitables. Dans le Banquet, ce n’est plus qu’un provincial un peu naïf à qui le luxe de Trimalcion en impose malgré tout, et plus qu’il ne convient à un homme de goût : on ne sait pas assez s’il est dupe ou s’il se moque.
Le caractère de Trimalcion lui-même nous paraît également d’un dessin peu net. Le personnage nous semble avoir été étudié fidèlement de l’extérieur à la manière des romanciers réalistes plutôt que pénétré, compris, et surtout expliqué : tantôt il ment par ostentation, tantôt il étale de la meilleure grâce du monde ses humbles origines. Sans doute, toutes les contradictions se rencontrent dans la nature humaine et il ne faut voir là que celles d’un caractère scrupuleusement noté sur nature, mais, en art, le vrai a besoin d’être rendu vraisemblable.
L’auteur des aventures d’Encolpe et d’Ascylte pénètre plus profondément dans l’âme de ses personnages : son Eumolpe aussi se dément lui-même : après nous avoir conté une aventure crapuleuse où il a trahi la confiance de son hôte en s’habillant hypocritement du manteau de la vertu, il s’élève un instant après sans effort aux plus hautes considérations morales et nous prouve en un admirable langage que c’est l’abaissement du caractère et la faillite des mœurs qui sont l’unique cause de la décadence des arts. Il n’a d’autre souci que la poésie, il est volontiers généreux avec ses amis, il sait pardonner une offense, mais pourtant il recourt sans hésiter aux plus bas mensonges et à la plus honteuse duplicité pour gagner sa vie et faire sa fortune. Les contrastes de son caractère, hardiment mais habilement accusés, ne nous étonnent pas : l’auteur sait nous les rendre vraisemblables, tout comme la gentillesse avisée, le cœur excellent et l’esprit droit du petit Giton, jolie nature trop tôt corrompue par le milieu. C’est que nous avons affaire ici à un psychologue doublé d’un conteur et d’un écrivain, tandis que l’auteur du Banquet n’est qu’un observateur curieux, consciencieux et érudit du milieu qui l’entoure.
Il est même un peu lourd. Le Banquet est surchargé de descriptions minutieuses fort intéressantes pour l’historien, et dont la parfaite exactitude s’est trouvée déjà bien des fois vérifiée par les découvertes de la science, mais fort peu intéressantes pour l’humble lecteur qui ne demande à un roman que de le divertir : tous ces services compliqués, et d’une baroque ingéniosité, qui se succèdent sur la table de Trimalcion ne sont pas l’œuvre de l’imagination de l’auteur ; ils ont réellement, la science moderne est parvenue à l’établir, paru un jour dans quelque somptueux banquet, mais il y en a vraiment trop, ils sont trop minutieusement décrits, et après s’y être intéressé quelque temps on finit, comme les convives, par en avoir une indigestion. L’auteur de ce morceau était certainement un érudit possédant une collection fort curieuse des plus beaux menus de l’antiquité, mais ce n’était certes pas un artiste que son sens de la mesure et du beau avertit à temps que l’excès en tout est un défaut : il manque un peu de goût.
Il n’en manque pas qu’en littérature. Il a voulu nous donner un manuel de l’élégance : tout ce que fait Trimalcion est à éviter, tout ce qu’il dit est à ne pas dire. Mais il n’a pas, comme l’auteur des Aventures d’Encolpe, le sens de ce qu’est la véritable distinction. On sent que c’est chez lui leçon apprise, qu’il professe à son tour ce qu’on lui a enseigné, qu’il a étudié les règles du bon ton, laborieusement, mais que ce n’est là que connaissance acquise ; aussi ne s’élève-t-il guère au-dessus du niveau des manuels de civilité puérile et honnête. Chez l’auteur des Aventures d’Encolpe, la distinction serait plutôt poussée jusqu’à la recherche.
Les propos des amis de Trimalcion, par leur naïveté amusante, leur banalité implacable et leur savoureuse vulgarité, sont sans doute d’un comique de bon aloi, mais semblent sortis d’une tout autre veine que les traits vifs, spirituels, cyniques, la verve railleuse, la fantaisie légère, l’irrévérence désinvolte, l’élégance aisée et détachée qui, chez Pétrone, s’allient au plus solide bon sens. L’auteur du Banquet nous parait l’ancêtre authentique de notre Rabelais, celui des Aventures d’Encolpe annonce plutôt Voltaire.
Tels sont, à côté d’autres motifs d’ordre plus technique et qu’il serait trop long d’exposer ici, les raisons qui nous font soupçonner que les fragments que nous possédons pourraient bien être de deux auteurs différents.
Oserons-nous aller jusqu’au bout de notre pensée et avancer qu’il y en a eu sans doute trois ou davantage ? Dans les Aventures d’Encolpe nous croyons distinguer, en effet, des morceaux d’inspiration et de valeur bien différentes. Il nous semble que les chapitres relatifs au culte de Priape, l’histoire de Quartilla, et peut-être celle de la prêtresse Œnothea sont au moins en partie d’un auteur relativement récent.
Leur mérite littéraire est mince. Ils sont lugubrement tristes, platement pornographiques ; les terreurs de la superstition s’y marient au matérialisme le plus bas, au sensualisme le plus grossier. On n’y retrouve rien de la bonne humeur, du bel équilibre intellectuel, de la bonne santé morale qui caractérisent l’auteur des meilleurs morceaux du Satyricon. On se sent, au contraire, en pleine décadence.
Eumolpe date encore de l’époque où Rome, déjà corrompue mais encore vigoureuse et brillante, lutte non sans courage contre sa propre décadence. L’auteur du Banquet, comme celui des priapées, n’en est plus à pressentir la faillite intellectuelle et morale de Rome : il la constate avec une netteté de procès-verbal.
Un morceau célèbre, et qui mérite de l’être, la Matrone d’Éphèse, n’est peut-être même qu’une Milésienne récente qui se serait glissée tardivement dans le recueil.
Résumons-nous : tout ce qui trahit une décadence trop complète soit de la littérature, soit des mœurs, nous paraît indigne de l’auteur primitif du Satyricon. Il aurait écrit la meilleure partie de l’œuvre, celle qu’on ne se lassera jamais de relire. Il aurait créé un type, celui de l’élégant coquin, lettré, déluré et sans aucun scrupule, un style, celui du récit familier, un cadre, celui du roman à tiroir.
Son succès lui fit des émules, des continuateurs, qui l’imitèrent sans l’égaler ; il était tentant d’attribuer à Ascylte ou à Encolpe toutes les bonnes histoires de brigands qui couraient Rome : c’était leur assurer le meilleur des patronages ; il était tentant de les insérer dans une œuvre déjà célèbre qui leur ferait faire leur chemin dans le monde ; il était facile d’adopter le ton, la manière de l’auteur qui est déjà celle de nos meilleurs conteurs français. Et c’est ainsi que le livre, démesurément grossi, devint un recueil énorme, quelque chose comme l’épopée de la crapule durant la décadence romaine.
L’œuvre primitive était, à en juger par les fragments qui en restent, quelque chose de plus élevé, de plus délicat, et, ajouterons-nous, de plus moral : il s’agissait de la décadence des lettres envisagée comme conséquence de la décadence des mœurs.
III. Les personnages et le cadre du roman. – Les lacunes et l’incertitude du texte, l’ignorance où nous restons sur la date même approximative de la composition des différents fragments rendent parfois l’œuvre assez difficile à comprendre.
Un des hommes qui ont le plus consciencieusement étudié le Satyricon, un de ceux aussi qui, à notre sens, ont le mieux compris Pétrone, le chevalier La Porte du Theil, a, dans des pages encore inédites, tenté de restituer la physionomie des principaux personnages du roman, en se basant exclusivement sur les Aventures d’Encolpe, qui seules lui semblent d’une authenticité certaine. Nous ne saurions choisir un meilleur guide :
« Peut-être, dit-il, aucun des nombreux interprètes qui ont tant travaillé sur cette production singulière ne s’est-il assez occupé du soin de rassembler et de présenter sous un seul point de vue tout ce qui se trouve, dans le cours de la narration d’Encolpe, de particularités éparses, d’après lesquelles on peut deviner bien des faits qui nécessairement devaient avoir précédé ceux que nous trouvons ici plus ou moins clairement exposés, plus ou moins défigurés par de très nombreuses lacunes dont on ne saurait calculer la grandeur respective. Ce soin, qui eût été léger, n’eût pas laissé fréquemment d’ajouter aux lumières que tant d’habiles gens se sont efforcés, mais non pas toujours avec un égal succès, de jeter sur une multitude de passages qui nous arrêtent encore par leur obscurité. Voici, à ce qu’il m’a semblé, tout ce que le narré d’Encolpe suppose avoir été précédemment raconté quelque part : de ce rapprochement résultera une idée nette, telle que l’on peut se la faire, avec quelque fondement, du caractère de cœur et d’esprit que Pétrone devait avoir voulu donner à ce principal personnage de ce drame narratif et satirique ; personnage qui, à plus d’un égard, semble avoir servi de modèle aux modernes Gil Blas et Figaro.
Encolpe, soit Grec, soit plutôt Romain d’origine, aurait appartenu à une famille honnête. On est fondé à penser que Pétrone l’avait représenté comme né dans la classe des hommes libres. Si on peut induire aussi de certains passages qu’Encolpe avait dû être quelque temps en service, il est permis de supposer que cet esclavage avait été accidentel, et peut-être uniquement le fruit ou la suite d’un dérangement de conduite bien prématuré. En tout cas, je ne sais si ce que l’auteur lui attribue de connaissances et d’acquis ne nous met pas en droit de conjecturer qu’il lui avait donné des parents d’un état qui aurait permis à leur enfant de fréquenter les meilleures, même les plus hautes sociétés, lesquelles néanmoins ne l’attirèrent jamais, ou ne le captivèrent pas longtemps.
Encolpe, en naissant, devait avoir reçu de la nature toutes les grâces du corps, tous les talents de l’esprit ; mais, du côté du cœur et de l’âme, il s’en fallait bien que son partage eût été aussi bon.
Sans doute, une éducation très soignée avait contribué à développer en lui le germe de tous ses avantages, mais n’avait certainement point étouffé celui de tous ses vices.
Quant au physique, de très bonne heure il s’était trouvé en état de ressentir comme d’inspirer avec violence la passion de l’amour. Éminemment pourvu de ces moyens, de ces forces extraordinaires qui distinguent presque privativement certains individus et les rendent d’une aptitude prodigieuse à goûter eux-mêmes ainsi qu’à donner aux autres les jouissances les plus vives et les plus répétées, il semble avoir tour à tour enflammé et aimé tout ce que les grandes villes, théâtre du libertinage le plus raffiné ou le plus crapuleux, pouvaient compter, chez l’un et l’autre sexe, de personnes, n’importe à quel âge, plongées, soit dans la volupté la plus tendre, soit dans la débauche la plus sale.
Quels étaient au juste les sentiments que Pétrone lui avait prêtés relativement aux femmes ? Encolpe avait-il été, au total, représenté de manière que, chez lui, un goût dépravé n’eût jamais pris effectivement la supériorité décidée sur le penchant le plus naturel, et que les femmes, ne pouvant s’empêcher de l’aimer, eussent simplement à regretter de n’être pas seules à l’intéresser ? Ou peut-on penser que partout, dans ce qui est perdu comme dans ce qui nous reste du roman, ce qu’il disait de ses sentiments pour elles tendait uniquement à masquer le tort réel de leur donner une trop faible place dans son cœur ? C’est sur quoi on ne doit peut-être pas se prononcer. Mais ce qui est certain est que, dans ce que nous lisons aujourd’hui, on croit reconnaître évidemment que, s’il lui eût fallu déterminément choisir et renoncer à aimer l’un des deux sexes, celui pour qui nous sommes faits n’eût pas obtenu de lui la préférence. Disons plus : le rôle que, dans nos fragments, nous le voyons jouer vis-à-vis des femmes en général, ne répondant nullement aux moyens dont la nature l’avait si libéralement pourvu, semble annoncer que Pétrone l’avait voulu représenter comme assez peu porté à les contenter. Je ne parle point ici simplement de la triste manière dont on le verra, dans le morceau dont je donne la traduction, se comporter avec une belle et charmante femme de dix-huit à vingt ans : mais je rapproche encore ce qui, de son propre aveu, avait pu, sans réclamation de son côté, lui être reproché par un camarade de débauche, lorsque celui-ci l’accusait en propres termes, antérieurement à la fatale époque dont il vient d’être question et au temps de sa plus grande vigueur, de n’avoir pu se tirer galamment d’affaire avec une jeune personne encore neuve en amour (car je reste persuadé que tel est le sens d’un passage sur lequel il est superflu de disserter) ; et tout à l’heure d’autres faits viendront à l’appui de ce que je dis présentement.
Quant aux agréments de l’esprit, il paraît que rien de ce qui sert à rendre la société d’un homme séduisante et sa conversation agréable ne lui était étranger. Dans les lettres, dans les arts, dans les sciences, il ne manque d’aucune de ces connaissances qui permettent de parler avec justesse sur tout objet intéressant et qui dénotent l’homme bien élevé et l’homme instruit, l’homme du bon ton. Particulièrement en fait de littérature, tout annonce chez lui un goût assez épuré, un tact assez fin, malgré l’obscurité et les fréquentes lacunes qui défigurent les passages où il est question de semblables sujets, toutes ses censures, toutes ses plaintes sur le mauvais genre d’éloquence des déclamateurs de son siècle, sur le style et la manière des poètes de cet âge, sur le peu de talent et l’avilissement des artistes ses contemporains, paraissent marquées au meilleur coin. On dira peut-être que, quand il prétend joindre l’exemple au précepte, il est moins heureux et que l’on pourrait à bon droit lui appliquer les vers :
Mais prenons-y garde ; si le style dans lequel tout ce roman est écrit est en effet (comme il me le paraît) plutôt vicieux que correct, soit en prose, soit surtout en vers, c’est le tort de l’auteur. Je ne prétends point ici discuter son mérite ; mais toujours puis-je dire que les maximes avancées par Encolpe, en fait de littérature, sont les plus sûres, les plus propres à maintenir le goût dans sa justesse et dans sa pureté.
À l’égard des principes qui fondent la morale et assurent la conduite de l’homme, supposé qu’Encolpe les eût jamais adoptés, il ne les avait pas longtemps suivis. S’il semble avoir connu et même avoir foncièrement aimé la vertu, s’il va quelquefois jusqu’à tonner fortement contre le vice, on est presque autorisé à croire qu’il ne faut pas s’y méprendre ; que c’est uniquement dans la vue d’excuser ses excès et avec l’intention de prouver combien un franc libertin peut encore être préférable, pour ce qu’on appelle le fond du cœur, au sectateur hypocrite d’une rigide mais fausse vertu. Ce que je pourrais ajouter sur ce point tiendrait à la morale générale du roman considéré dans son ensemble. De célèbres littérateurs en ont peut-être suffisamment parlé. Je pourrai rappeler ailleurs ce qu’ils en ont dit ; ici, je me borne à rassembler les traits qui caractérisent en particulier le personnage d’Encolpe ; traits qu’on a besoin de connaître préalablement pour n’être point arrêté dans la lecture de ce qui nous reste du récit de ses aventures.
Encolpe, soit que, dès son bas âge, par quelque accident ordinaire il eût perdu ses parents, soit que simplement, dans les premiers jours de l’adolescence, emporté par la fougue des passions, il se fût, sans tarder, soustrait à la domination ordinairement si douce, presque toujours si utile, mais parfois importune, d’un père et d’une mère, Encolpe, dis-je, paraît avoir été représenté par Pétrone comme ayant été de très bonne heure livré à lui-même et maître de ses actions. À quelque époque de sa vie qu’on place l’occasion qui, dans le plan général du roman, était supposée lui avoir fait entamer sa narration, certainement, dans ce qui nous reste de cette narration, on ne trouve la mention ni l’indication d’aucun fait, d’aucun évènement qui ne concerne un jeune homme de vingt à vingt-cinq ans, plutôt qu’un homme fait et d’un âge mûr ; et on voit qu’antérieurement au point où le prennent les fragments aujourd’hui subsistants, Encolpe avait fait déjà plus d’un métier. On ne saurait douter que, dans ce qui précédait, comme dans les lacunes courantes qui se reconnaissent maintenant, il devait être question d’une multitude de faits, d’un grand nombre d’intrigues amoureuses, de maint et maint tour d’escroquerie du genre, je l’ai déjà dit, de ce que présente le tableau de la vie de Gil Blas, de Figaro, mais avec des nuances adaptées à nos mœurs.
Une fois livré au monde et au tourbillon du plaisir, Encolpe, sans doute, n’avait point tardé à tomber dans tous les embarras où nous précipite bientôt le dérangement de la fortune, compagnon inséparable du dérèglement des mœurs et des actions. À des mots échappés qu’on rencontre çà et là dans nos fragments, on reconnaît que, dès l’entrée de sa carrière, il avait subi un esclavage dans lequel il avait été soumis à tout ce que la passion ou le libertinage d’un maître amoureux ou vicieux avait pu exiger de lui.
Le désordre dans sa conduite n’avait été que la moindre de ses fautes ; Encolpe s’était porté jusqu’au crime. Il se peut que, dans la portion non existante du roman, des circonstances, qui l’auraient seules rendu coupable, le disculpassent en partie ; mais ce que nous lisons aujourd’hui nous apprend clairement que, dans un voyage, il avait tué son hôte et que s’il avait ensuite échappé à la justice, ç’avait été uniquement par un bonheur inespéré ou par une prompte fuite.
Dans les différentes et nombreuses courses que vraisemblablement sa vie agitée et licencieuse lui avait occasionnées, non seulement sur terre il avait couru maint et maint danger (comme quand il avait failli être écrasé sous des ruines, ou englouti dans quelque bouleversement général, évènement dont il ne nous parle que par hasard et sans détail) ; mais sur mer, dans quelque traversée, il avait été près de périr ; et le naufrage qu’on trouvera décrit dans le morceau dont je donne la traduction semble n’avoir pas été le seul ni le premier que Pétrone le supposait ailleurs avoir essuyé.
On reconnaît encore, ou du moins on croit reconnaître qu’Encolpe devait avoir fait le métier de gladiateur ; que, engagé à un chef de ces tristes victimes du goût barbare des anciens pour des jeux sanguinaires, il n’avait point été fidèle aux conditions du marché, par lequel, comme on sait, le gladiateur d’un certain genre, et en certaines occasions, se dévouait à la mort, au gré des spectateurs, qui rarement épargnaient le vaincu dans l’arène. Encolpe parle positivement, quoique avec plus de clarté, d’un danger de cette espèce auquel il avait été exposé, mais dont il s’était sauvé par une audace et une adresse assez peu communes pour qu’il pût s’en glorifier comme d’un chef-d’œuvre en fait de coquinerie.
Cependant, tout en lui attribuant de tels exploits, il s’en faut beaucoup que Pétrone lui eût donné du courage ; il ne lui fait pas même vanter une prétendue valeur. Au contraire, dans le cours du récit qu’il met dans sa bouche ; il lui fait avouer franchement, même pour ainsi dire, il le montre se targuant de la poltronnerie dont sa conscience habituellement l’accusait. En plus d’un endroit, Encolpe donne à entendre qu’il n’était point brave et que ses menaces, quand il en faisait, étaient uniquement de la forfanterie ; ailleurs il récite naïvement les reproches que son compagnon de débauche et de friponnerie lui faisait de sa lâcheté réelle ; on verra que lui-même en badine.
Après bien des aventures, qui ne sont que très obscurément (même inintelligiblement) indiquées, Encolpe s’était violemment épris d’un jeune adolescent, que partout il nomme Giton. Celui-ci devait être un enfant, né aussi de parents libres. Je dis de parents libres, mais que l’on doit supposer pauvres et fort peu délicats (puisqu’ils l’avaient eux-mêmes livré à un esclavage dont il n’avait pu briser la chaîne qu’aux dépens de sa pudeur et en abandonnant sa personne à un maître libertin). Le passage d’où je tire cette induction peut prêter à une autre interprétation, je le sais ; mais la différence que cette interprétation apporterait dans les notions qui concernent Giton ne mérite pas qu’on en fasse l’objet de la moindre discussion. Il est certain qu’Encolpe lui-même nous le représente comme avouant aisément toute sa turpitude, se reconnaissant digne du sort le plus malheureux, puisqu’il avait donné dans le jeu dès qu’il avait pu raisonner, et que s’il était devenu libre ce n’avait été que par l’infamie ; il convenait d’avoir été vendu, comme fille, à un acheteur, lequel ne s’y trompait point, et en feignant de se laisser abuser par une mère avide ou nécessiteuse qui sacrifiait son enfant, s’estimait heureux de pouvoir s’assurer ainsi, sans paraître les avoir préalablement cherchées, des jouissances, précieuses à son goût dépravé, mais dont un désir trop hautement annoncé l’eût fait rougir en public. Du reste, Giton ne manque ni d’un fonds de bonté dans le cœur, ni d’une sorte de justesse dans l’esprit. Ses désordres, ses coupables complaisances paraissent venir plutôt de la faiblesse de son âme et d’un défaut total de principes que de l’emportement des passions et de la force du vice. Également attrayant pour les deux sexes, il se prête, sans préférence marquée, aux plaisirs de l’un et de l’autre. Partout on le voit céder et jamais attaquer. Enfin, il montre de la douceur, de la raison, de la gentillesse, surtout une certaine grâce enfantine qui, pour ainsi dire, fait parfois oublier à quel point s’avilit sa personne.
« Tel est l’objet d’une passion qui, selon le plan général du roman, devait avoir régné, sinon exclusivement, du moins avec plus d’empire que tout autre sentiment accidentel et passager, dans le cœur d’Encolpe, durant un temps considérable : il en est constamment et violemment occupé pendant la période qu’embrassent nos fragments. Sur quel pied, je veux dire en quelle condition Encolpe, intrinsèquement, était-il censé tenir Giton avec lui ? c’est ce qu’il n’est pas aisé de déterminer. En certains endroits et d’après la mention de quelques services, tenant de la pure domesticité, auxquels Giton paraît non seulement résigné sans réclamation, mais comme parfaitement accoutumé, on serait tenté de prononcer que, en tout, il doit être censé avoir été mis en scène comme domestique : et véritablement, s’il faut décidément admettre l’authenticité du fragment trouvé à Trau, il faudra aussi convenir que Giton avait été mené chez Trimalcion comme devant servir les deux amis, Ascylte et Encolpe. Mais habituellement on rencontre tant de motifs frappants de penser différemment, qu’on ne saurait adopter cette idée ; l’union d’Encolpe avec Giton est trop étroite. Il le traite toujours de frère, et vit en effet avec lui, comme avec la sœur, comme avec la maîtresse, comme avec l’épouse la plus hautement avouée. Même logis, même table, même lit, mêmes compagnies ; tout à ces deux amants est commun. Ni les plaisirs, ni les voyages, ni les arrangements de société ne les séparent ; il semble que foncièrement un contrat indissoluble les lie et qu’à peine un pareil ménage puisse, comme l’engagement légal entre des époux des deux sexes, devenir, en certaines circonstances, sujet au divorce.
(Sauvé, inv.)
À ce couple vivant d’une si étrange manière, se trouve uni un tiers parfaitement assorti. Celui-ci porte le nom d’Ascylte. Pétrone a-t-il ici, comme ailleurs, prétendu présenter un nom purement appellatif ? et ce nom d’Ascylte doit-il, ou avec tous les autres généralement, ou seul en particulier, être censé significatif ? Je l’ignore. En tous les cas, si nous suivions l’analogie de la langue grecque, ce terme ne peut guère signifier autre chose que l’Infatigable : sans doute, une telle dénomination conviendrait assez bien au rôle que Pétrone fait jouer à ce personnage ; mais comme, après tout, ce terme n’est pas trop décidément connu dans la langue grecque, si on veut maintenir l’opinion que notre auteur connaissait parfaitement cette langue, il faudra plutôt croire que, dans son idée, le nom d’Ascylte ne signifiait rien.
Quoi qu’il en soit, Ascylte, bien digne de figurer ici, est un des plus francs vauriens, si je puis m’exprimer ainsi. Né dans un pays étranger, vraisemblablement dans la Grèce, par les suites de quelque exploit, pareil à ceux dont nous avons vu Encolpe réduit à se vanter, il avait été forcé de s’expatrier ; et, pour lui, le lieu, quel qu’il fût, où dans le roman, il était supposé avoir formé sa liaison avec notre héros n’était qu’un lieu d’exil. Pour le libertinage, il était peut-être encore supérieur à Encolpe, qui se croyait fondé à lui reprocher ses infamies et jusqu’à l’impureté même de son souffle.
Ascylte ne laisse pas d’être instruit : le roman le suppose assez lettré pour pouvoir tirer une ressource de ses connaissances et gagner sa vie, en donnant quelques leçons à des jeunes gens. C’était en partie le désir de se perfectionner dans cet exercice qui l’avait poussé et déterminé à se lier si étroitement avec Encolpe, plus avancé que lui dans ce genre d’étude, mais tout au plus son égal en fait de débauche, de malice et de friponnerie. Toutefois, il n’avait point gratuitement obtenu de participer à des instructions qui devaient lui devenir profitables, et, au milieu d’un verger (c’est lui-même qui, dans la chaleur d’un violent débat, en fait le reproche à son maître), Ascylte avait été forcé de se soumettre aux mêmes complaisances qu’Encolpe exigeait habituellement du tendre Giton : c’est ainsi qu’il était devenu pour lui un second frère.
Dans une pareille association, l’argent devait souvent manquer ; aussi, les trois amis (comme on peut s’exprimer, en parlant ici une langue assortie) faisaient-ils flèche de tout bois. Pour être admis à de bons repas, il ne leur répugnait point de faire habituellement le métier de flatteurs et de parasites. Et comme dans une très grande ville, telle que celle où évidemment doit être le lieu de la scène, pour toutes les aventures détaillées dans la portion qui nous reste du roman, il ne manque jamais d’y avoir de ces riches vaniteux, qui se piquent d’aimer les lettres, qui se mêlent de les cultiver plutôt par air que par goût réel, qui même se croient de bonne foi du talent, et rassemblent volontiers des auditeurs disposés à louer leurs compositions, Encolpe et, sans doute à son exemple, ses deux camarades n’épargnaient point les applaudissements à tout amateur dont la prétention au mérite littéraire était appuyée d’une table bien garnie.





























