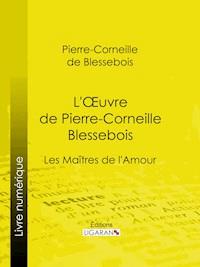
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"""L'Oeuvre de Pierre-Corneille Blessebois"" est un livre captivant qui nous plonge dans l'univers fascinant de l'auteur éponyme, Pierre-Corneille de Blessebois. Ce recueil regroupe une sélection de ses œuvres les plus marquantes, offrant ainsi aux lecteurs une immersion totale dans son talent littéraire.
Pierre-Corneille de Blessebois, écrivain du XVIIe siècle, est connu pour sa plume raffinée et sa maîtrise de la langue française. À travers ses écrits, il explore avec finesse et profondeur les thèmes de l'amour, de la passion, de la tragédie et de la condition humaine. Son style poétique et élégant transporte le lecteur dans des mondes imaginaires, où se mêlent émotions intenses et réflexions philosophiques.
Ce livre offre une sélection variée d'œuvres de Pierre-Corneille de Blessebois, allant des tragédies classiques aux poèmes lyriques en passant par des récits empreints de mystère. Chaque texte est une véritable invitation à la réflexion, à la découverte de l'âme humaine et à l'exploration des passions qui l'animent.
""L'Oeuvre de Pierre-Corneille Blessebois"" est un véritable trésor littéraire, permettant aux lecteurs de redécouvrir un auteur injustement méconnu. À travers ces pages, Pierre-Corneille de Blessebois nous offre un voyage captivant dans son univers artistique, où se mêlent beauté des mots, profondeur des émotions et réflexions intemporelles.
Que vous soyez passionné de littérature classique, amateur de poésie ou simplement curieux de découvrir de nouveaux horizons littéraires, ce livre saura vous séduire par la richesse de son contenu et la qualité de son écriture. Plongez-vous dans ""L'Oeuvre de Pierre-Corneille Blessebois"" et laissez-vous emporter par la magie des mots de cet auteur talentueux.
Extrait : ""L'Aurore commençait à gratter aux portes de l'Orient quand Céladon, qui était depuis quelques jours prisonnier à Alençon, vit entrer dans sa chambre une jeune demoiselle dont les yeux, quoique petits, jetaient une lumière d'autant, plus vive que le lieu était un peu obscur."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le poète et romancier Pierre-Corneille Blessebois naquit vers 1646, non à Alençon, comme on a prétendu, mais à Verneuil ou dans les environs.
Cet écrivain singulier, qui se qualifiait lui-même de poète errant, était d’une bonne famille protestante. Destiné à l’état militaire, il vint à Alençon, et, dès ce moment, les aventures, les scandales emplissent une vie dont tous les détails ne sont pas encore bien connus. On sait qu’il changea plusieurs fois de religion, que peu scrupuleux, mais né amant, il séduisait les femmes et leur coûtait cher. C’est à Alençon qu’il connut Mlle Marthe de Sçay, qui venait le visiter dans la prison où il avait été enfermé pour crime d’incendie. Sorti de prison, il continua ses intrigues galantes et scandaleuses et, après un duel, ayant enlevé Mlle de Sçay, qui portait aussi le nom de Marthe Le Hayer, il dut se réfugier en Hollande. Cette fille de bonne maison, de laquelle il avait été follement amoureux, devint alors l’objet d’une haine violente qu’il manifesta dans ses écrits. C’est en Hollande qu’il publia la plupart de ses ouvrages. Il y prit du service dans la marine. Il revint ensuite en France et était à Paris en 1678. Vers 1696 il se trouvait à la Guadeloupe, où son service d’officier de marine sur les galères françaises l’avait mené. Aux Antilles, il fut encore le héros d’aventures galantes. Il y fit imprimer le Zombi du Grand-Pérou et mourut après 1697, époque où l’on perd complètement la trace du vieux favori des belles.
M. Cléder a mis en tête de son édition du Zombi (Paris, 1862) une savante préface, où il juge ainsi le talent et les ouvrages de Blessebois :
« Disons maintenant quelques mots sur le talent littéraire de Corneille Blessebois. Ses œuvres peuvent être divisées en deux parties bien distinctes : les écrits sérieux et les écrits facétieux. Dans la première partie figurent les tragédies des Soupirs de Sifroi, d’Eugénie, de Sainte Reine et la comédie de La Corneille. Il faut placer dans la seconde ses romans et nouvelles, ainsi que ses poésies gaillardes et burlesques. Il est aisé de voir au premier coup d’œil que la poésie burlesque était plus dans le genre de son talent ; il s’y sentait plus à l’aise, et la franchise de ses allures amenait parfois dans ses écrits des éclairs d’une gaieté vive et spirituelle. Cependant son style, presque toujours maniéré, se ressent d’une certaine affectation par l’emploi de mots nouveaux et d’expressions bizarres qui servent à exprimer une pensée plus bizarre encore. Aussi ces défauts graves se font-ils remarquer davantage lorsqu’il veut exercer sa verve sur des sujets plus relevés, et qu’il monte sa lyre au ton de l’épopée tragique. Alors cette disparate choquante se fait sentir plus que partout ailleurs, et on le voit à chaque instant, au milieu des situations les plus intéressantes et les plus dramatiques, tomber dans le trivial et le bouffon, par la puérilité de certains détails, l’extravagance de certaines pensées et le style burlesque dont elles sont affublées. Du reste, je ne sais si nous devons nous montrer bien sévères vis-à-vis de cet écrivain, car, si ce n’étaient les quatre vers suivants qui lui sont échappés à une époque où il n’avait pas encore lu l’Art poétique de Boileau, que le législateur du Parnasse venait de livrer au public :
nous ne voyons nulle part, dans ses écrits, qu’il ait tiré vanité de ses compositions. Sa prose n’est pas plus soignée que ses vers, et les négligences dont elle fourmille, et qu’il eût été facile de faire disparaître, sont la meilleure preuve qu’il n’écrivait que pour occuper ses loisirs et pour se venger des femmes qui l’avaient dédaigné ou trompé.
Il voulut à la fois servir Mars, Vénus et les Muses ; mais nous aimons à penser, pour la gloire comme pour le plaisir de notre héros, que les deux premières divinités lui furent plus favorables.
Nous ne terminerons pas cette notice, malheureusement très incomplète, sans disculper, jusqu’à un certain point, bien entendu, Corneille Blessebois des reproches exagérés qui ont été formulés contre lui par deux célèbres bibliophiles, MM. Charles Nodier et Paul Lacroix.
Le premier, dans les Mélanges tirés d’une petite bibliothèque (page 367), dit, en parlant du Zombi du Grand-Pérou : – Jamais pamphlet n’a été plus grossièrement approprié aux sales orgies d’un cercle d’hommes oisifs et dépravés ; – et le second, dans une note du tome II du Catalogue Soleinne (n° 1465), porte ce jugement : – Ce passage n’est pas le seul qui rappelle le ton de certaines descriptions des livres du marquis de Sade. – Cette rigueur et cette sévérité nous paraissent pour le moins exagérées. Certes, nous ne voulons pas nous faire l’apologiste de Corneille Blessebois, proclamer ses mœurs comme des exemples à suivre, et ses écrits comme des modèles de goût et de décence ; mais le Zombi reste bien au-dessous des Dames galantes de Brantôme et de l’Histoire amoureuse des Gaules de Bussi-Rabutin, que Charles Nodier n’a jamais songé à frapper ainsi de son courroux, et dont il parle quelquefois avec complaisance.
Quant au reproche qui lui est adressé par M. Paul Lacroix, nous le trouvons pour le moins aussi injuste. Nous avons vainement cherché dans les œuvres de Blessebois, même les plus hardies, et nous n’y avons rien trouvé qui puisse entrer en parallèle avec les tableaux cyniques et les maximes infâmes dont pullulent à chaque page la majeure partie des ouvrages du marquis de Sade. Corneille Blessebois est un poète licencieux, c’est un fait incontestable ; mais ses écrits ne sont pas plus libres que ceux qui composent le Parnasse satyrique, le Cabinet satyrique, le Cabinet des Muses gaillardes, l’Espadon satyrique, les Sottisters, etc., et l’auteur peut être placé à la suite de ses contemporains Régnier, Sigogne, Maynard, Théophile, Berthelot, Motin et autres, qui se sont illustrés dans ce genre de poésie, et dont les ouvrages, recherchés par les curieux et les savants, n’ont jamais été l’objet d’un blâme aussi rigoureux.
Charles Nodier lui-même, qui se laisse parfois aller à des condamnations irréfléchies ou à des éloges exagérés, selon la nature de ses impressions, avait accordé à ce genre d’écrits une large place dans sa bibliothèque, parce qu’il comprenait mieux que personne que ces sortes d’ouvrages, outre le mérite de la rareté, qui n’est pas toujours le moindre aux yeux de quelques bibliophiles, présentent encore un certain intérêt à tous ceux qui s’occupent d’une manière plus ou moins directe de l’histoire de l’esprit humain. »
Il faut ajouter à ces lignes pleines de sens que l’un des mérites de Blessebois, ou du moins ce qui le signale tout particulièrement à l’attention des lettrés, c’est qu’en écrivant le Zombi du Grand-Pérou il dota la France de son premier roman colonial. À cette époque l’exotisme et surtout l’exotisme américain n’avaient encore rien fourni à la littérature française, sinon dans les relations de voyage et dans les recueils géographiques.
Avec le Zombi, les îles apparaissent dans les lettres avec un grand nombre de mots du vocabulaire créole. Et à cet égard le Zombi est un monument linguistique qui vaudrait la peine qu’on l’étudiât de très près. Au demeurant, ce libelle, extrêmement rare, resta longtemps tout ce que la littérature française devait à l’exotisme. Le Zombi marque une date littéraire extrêmement importante, et celui qui tenterait d’écrire l’histoire du roman colonial en France serait obligé de mentionner avant tout le nom de Pierre-Corneille Blessebois, auteur bien singulier et duquel on ne sait pas grand-chose, puisque l’on demeure incertain aussi bien sur le lieu et la date de sa naissance que sur l’endroit et le temps où il mourut.
G.A.
touchant les Œuvres de Pierre-Corneille Blessebois.
Les soupirs de Sifroi, ou l’Innocence reconnue, tragédie par M. de Corneille Blessebois, Châtillon-sur-Seine, Pierre Laymeré, 1675.
In-8° de 44 pp. et 1 f. non chiff. pour le privilège. Le sujet de cette tragédie en 3 actes et en vers est l’histoire de Geneviève de Brabant et elle est imitée en grande partie du roman du Père Cériziers : l’Innocence reconnue. Il y a dans cette pièce des personnages singuliers tels qu’un fantôme, deux loups, un ange.
Marthe le Hayer, ou Mademoiselle de Sçay, petite comédie. Imprimée pour l’auteur, 1676.
Petit in-12 de 24 pp. (Hollande, Elzévier), en trois actes et en vers.
Marthe le Hayer, ou Mademoiselle de Sçay, 1682.
Pet. in-12 de 24 pp.
Marthe le Hayer, ou Mademoiselle de Sçay, 1698.
Pet. in-12.
Le Bretteur, comédie nouvelle et galante en trois actes. Imprimée pour l’année 1758.
Pet. in-12 de 24 pp. C’est la même pièce que la précédente dont on a seulement changé le titre. Elle a été imprimée en cachette par un ouvrier inhabile et elle a été fort mal typographiée.
Les souteneurs et les soutenues, comédie en vers et en trois actes (1738).
M. Cléder a eu sous les yeux un manuscrit dans lequel la pièce Marthe le Hayer porte le titre que voilà. C’est une version qui présente quelques différences sans importance avec le texte imprimé.
Filon réduit à mettre cinq contre un, amusement pour la jeunesse, par Pierre-Corneille de Blessebois.
Pet. in-12 de 26 pp., s. l. n. d. (Hollande, Elzévier, 1676.) Pièce en vers entre Filon et Mirène, Lisette, Catin, Marote, Alise, Jeanneton et Isabelle. Très rare.
Filon réduit à mettre cinq contre un, amusement pour la jeunesse, par P.-Corneille de Blessebois. Leyde, 1676.
Pet. in-12 de 11 ff., y compris le titre.
L’Eugénie, tragédie dédié [ sic ] à S.A. le prince d’Orange, par P.-Corneille Blessebois, s. l. n. d.
Pet. in-12 de 42 pp., y compris 5 ff. préliminaires, plus 3 ff. n. chif. à la fin. (Leyde, Elzévier, 1676.) En trois actes et en vers.
Voici le sujet de cette pièce : Eugénie, fille du gouverneur d’Égypte, est déguisée en homme et sous cette apparence inspire une violente passion à Mélance, jeune dame romaine. Celle-ci, irritée d’une froideur qu’elle attribue au mépris de ses charmes, accuse Eugénie d’avoir tenté de lui ravir son honneur. Eugénie, en révélant son véritable sexe, déjoue l’imposture. Dans un sonnet au lecteur, placé en tête de cette tragédie, dédiée à S.A.R. le prince d’Orange, Corneille Blessebois dépeint la triste situation où il se trouvait à son arrivée en Hollande. Voici le sonnet :
L’Eugénie de Pierre-Corneille Blessebois, tragédie, à Leyde, chez Félix Lopez, 1676.
Pet. in-12 de 52 pp., plus 3 ff. n. chif.
Le Rut ou la Pudeur éteinte, Leyde, 1676.
3 parties in-12. 1repartie : 3 ff. n. chif. pour le titre et 72 pp., y compris la dédicace à Mlle de Sçay ; 2epartie : 3 ff. n. chif. pour le titre et la dédicace et 71 pp., plus 1 p. n. chif. ; 3epartie : 3 ff. n. chif. pour le titre et la dédicace à Mlle de Sçay et 87 pp.
Le Lion d’Angélie, histoire amoureuse et tragique. Cologne, chez Simon l’Afriquain.
Pet. in-12 de 168 pp., y compris 1 front, gravé, 1 titre imprimé, 1 dédicace, etc. (Hollande, Elzévier.) Ce volume est ainsi dédié : À M. Elzévier, capitaine ordinaire de mer pour le service de la République de Hollande, montant aujourd’hui un vaisseau de soixante-dix pièces, appelé LE CHÈNE :
« N’ai-je pas eu l’honneur, monsieur, de vous suivre sur l’Ostzée ? Et dans les deux batailles que nous avons données avec réussite, et en sept jours, contre les Suédois, n’ai-je pas vu moi-même des preuves convaincantes de ce que la Hollande publie à votre avantage ? » La dédicace est signée du nom de Corneille Blessebois.
Pour être complet, le livre doit être suivi de l’opuscule suivant :
Le temple de Marsias. À Cologne, chez Simon l’Afriquain, 1676.
Pet. in-12 de 43 pp., nouvelle mêlée de prose et de vers dédiée à très discrète, très pudique et très vertueuse demoiselle Émerentie van Swanevelt, épouse de M. Elzévier… Ces deux ouvrages ont une pagination séparée, mais une seule série de signatures. On trouve rarement les deux parties ensemble.
La Corneille de Mademoiselle de Sçay, comédie pour l’hostel de Bourgogne, 1678.
In-12 de 3 ff. et 65 pp. en lettres rondes, s. l. (Paris). En un acte et en vers. Une gravure sur bois reproduite plusieurs fois dans le courant de l’ouvrage représente Blessebois, en habit d’officier, prenant le menton de Mlle de Sçay vêtue en bergère.
La victoire spirituelle de la glorieuse Sainte Reine sur le tiran Olibre, tragédie nouvellement composée par M. de Corneille Blessebois. Autun, Pierre Laymeré, 1686.
In-4° de 49 pp., plus un f. n. chif., 4 fig. sur bois, dont la dernière est gravée par Ambroise.
Le Zombi du Grand-Pérou ou la Comtesse de Cocagne. Nouvellement imprimé, le quinze février 1697.
Pet. in-12 de 2 ff. pour le faux titre et le titre, 6 pp. pour le portrait en vers de la comtesse de Cocagne et 145 pp. On n’en connaît que quelques exemplaires. Zombi en créole signifie esprit, fantôme, sorcier. L’auteur (qui signe Effe-géache) d’Une nuit d’orgie à Saint-Pierre-Martinique (1892) l’emploie encore avec le sens de revenant. Le Zombi a été imprimé aux Antilles.
Lupanie. Histoire amoureuse de ce temps. À la Sphère, 1668.
Pet. in-12 de 94 p. (Hollande, Elzévier.)
Lupanie. Histoire amoureuse de ce temps. À Paris [ sic ] chez Jean-Pierre de Marteau, 1669.
Pet. in-12 de 118 pp., dont les 8 prem. n. chiff. pour le titre et l’Épître dédicatoire.
Lupanie. Histoire amoureuse de ce temps. Imprimée cette année.
S.l. n. d. (Hollande, vers 1676.) In-12 de 120 pp.
Lupanie. Histoire amoureuse de ce temps. Avec lesmaximes d’amour. À la Tendresse chez les amants, 1700.
Petit in-12.
Saint-Germain, ou les Amours de M. D.M. T.P., avec quelques autres galanteries.
S.l. n. d. (Hollande, Elzévier.) Petit in-12 de 130 pp. Dans cette réimpression de Lupanie on a changé le titre et remplacé l’épître dédicatoire par plusieurs pièces de vers. On pense que les majuscules M. D.M. T.P. désignant Mme de Montespan ont été mises par un éditeur soucieux de rajeunir un ouvrage oublié.
Ce roman satirique est réimprimé en tête du recueil intitulé Amours des Dames illustres de notre siècle. Cologne, Jean Leblanc, 1680, pet. in-12, sous le titre : Alosie ou les Amours de Mmede M. T.P.
Œuvres satyriques de P. Corneille de Blessebois. Leyde, 1677.
Pet. in-12 très rare qui, pour être complet, doit se composer ainsi : un frontispice gravé par Smelztzing ; un titre imprimé ; deux feuillets pour la préface ; L’Almanac des belles (pour l’année 1676, en vers), 34 pages, y compris le titre et l’épître à Mlle de Jearny en 2 feuillets, plus 1 feuillet blanc ; L’Eugénie. 52 pages dont les 10 premières non chiffrées pour le titre et les préliminaires ; à la fin, 3 feuillets non chiffrés qui contiennent 7 portraits en vers, plus 1 feuillet bleu ; Le Rut ou la Pudeur éteinte, en trois parties, 1re partie, 1 f. n. chif. pour le titre et 72 pages ; 2e partie, 4 ff. n. chif. pour le faux titre, le titre et la dédicace et 73 pages ; 3e partie, 4 ff. n. chif. et 87 pages ; Marthe le Hayer, ou Mademoiselle de Sçay. Imprimée pour l’auteur en 1676, 24 pages ; Filon réduit à mettre cinq contre un, amusement pour la jeunesse, par P. Corneille de Blessebois, 26 pp. On trouve séparément les parties de ce recueil et nous les avons décrites à leurs titres respectifs.
La pièce Marthe le Hayer, ainsi que Filon et quelques autres morceaux satiriques de Corneille Blessebois ont été réimprimés dans les différentes éditions de la Bibliothèque d’Arétin, recueil qui a encore paru sous le titre Le Cabinet d’amour et de Vénus.
On attribue parfois à Blessebois une Relation d’un voyage de Copenhague à Brème, en vers burlesques, qui a eu plusieurs éditions sous des titres différents, et la Comtesse d’Olonne, comédie que l’on attribue généralement à Bussy-Rabutin.
M. de la Sicotière possédait le manuscrit d’un libelle de Corneille Blessebois intitulé Aventures du parc d’Alençon et composé vers 1670, où l’on trouve la description du parc, en vers, que voici :
Différentes œuvres de Corneille Blessebois ont été réimprimées au cours du XIXe siècle soit par l’éditeur Poulet-Malassis, qui était d’Alençon, et c’est la ville où Blessebois trouva ses premières aventures, soit par l’éditeur Gay, soit par M. Cléder, soit par Mme Marc de Montifaud, soit par d’autres.
Leyde, 1676.
LECTEUR,
Tu trouveras de quoi te divertir dans ce livre, ou tu n’es pas facile à contenter. Ne t’en rapporte pas toutefois à mon sentiment ; les pères sont fous de leurs enfants, et les auteurs de leurs ouvrages. Mais la dépense n’est pas grande, et deux escalins qu’il t’en coûtera, pour cette bigarrure, ne valent pas le papier. D’ailleurs, que sais-tu, cher lecteur, si Mlle de Scay, à qui tu feras la cour par ce moyen, ne deviendra point amoureuse de toi ? Elle a encore quelque monnaie qui ne t’incommoderait pas, et que tu ne lui trouverais plus, si j’avais voulu continuer d’être comme à toi,
Lecteur,
Très humble serviteur,
P.C.B.
MADEMOISELLE,
L’ingratitude est le plus noir de tous les crimes, et j’estime avoir lu quelque part que les dieux descendirent un jour sur la terre pour en prendre vengeance. Ainsi trouvez bon, je vous prie, que je me tire de pair de ceux qui nourrissent ce serpent dans les sombres replis de leurs âmes, et que, pour reconnaissance du diamant que vous me donnâtes, de la plus obligeante manière du monde, lorsqu’à la faveur de votre masque vous sûtes venir dans la prison d’Alençon vous soumettre à ce malheureux priape que vous avez encore dû, depuis, courir deux ans sans l’attraper, je vous offre cette petite veille de ma muse qui se souviendra éternellement de ce jour-là. Ne pensez pas, mademoiselle, que je puisse me flatter de m’être acquitté, par ce léger présent, d’un bien que je publie sans cesse, et dont j’ai donné des mémoires à la courrière de tout l’univers. Non, non, ma gratitude étend plus loin son empire, et je vous proteste avec vérité qu’il n’y a point de genre de vers dont je n’aie exalté cette admirable franchise. Je composai encore dernièrement une petite comédie dont je vous fis la principale héroïne, et qui s’intitule : le Bordel de Mademoiselle de Sçay, ou Marthe Le Hayer ; et de peur qu’on ignorât que vous en êtes le lubrique sujet, j’ajoutai : « cousine germaine de l’auteur des Palmes du Juste, premier fripon de notre siècle, et issue de germain du procureur du roi d’Alençon, surnommé, par excellence, le pou de la ville. » Mais comme je vous y ai tracée avec toute cette effronterie qui vous est naturelle et qui fait lever les épaules aux honnêtes personnes de votre sexe, s’il s’en trouve, quelques-uns de mes amis m’ont détourné de lui faire courir le hasard de l’impression et m’ont mis devant les yeux la rougeur que je causerais à votre modestie qui paya le tribut à la Parque entre les mains du marquis de Courcelles, il y a plus de dix ans, s’il arrivait que le destin le conduisît un jour dans votre cabinet. J’espère toutefois franchir le pas et vous donner enfin de plus sincères marques du zèle qui m’anime et qui me fait porter inviolablement la qualité,
Mademoiselle,
De votre très humble et très obéissant serviteur,
P.-C.B.
Le Rut
L’Aurore commençait à gratter aux portes de l’Orient quand Céladon, qui était depuis quelques jours prisonnier à Alençon, vit entrer dans sa chambre une jeune demoiselle dont les yeux, quoique petits, jetaient une lumière d’autant plus vive que le lieu était un peu obscur. Son teint effaçait les lis et le jasmin ; les roses n’avaient rien de comparable au vermeil de sa divine bouche ; ses dents étaient blanches, si bien rangées et tellement égales, que cette seule partie avait de quoi produire de l’amour dans une âme moins sensible que la sienne ; ses cheveux d’un blond châtain étaient répandus par boucles sur ses joues, et sa coiffure à la turque était artistement ordonnée et ne laissait rien à souhaiter de plus. Sa gorge était d’albâtre, et son sein négligemment ouvert offrait à la vue des charmes tout à fait puissants ; sa taille était médiocre, non moins engageante que dégagée, et si majestueuse, qu’encore que sa beauté n’eût pas été relevée par la propreté d’une simarre de satin blanc enrichi d’un passement d’or, dont elle avait ce jour-là sacrifié aux Grâces, Céladon n’aurait pu se défendre de la recevoir à bras ouverts. Il se disposait à lui témoigner sa surprise, lorsque cette adorable divinité visible le prévint en ces termes : « Je sais bien, lui dit-elle d’un air tout galant, que ma visite a de quoi vous étonner, et cette liberté que je me donne de vous venir voir sans avoir le bien de vous connaître que par le bruit qui se répand partout de vos rares attributs n’est pas sans doute si petite qu’elle n’ait pu suspendre quelque temps l’intention que j’en avais formée ; mais enfin, cher Céladon, je n’ai pu résister davantage au désir que j’ai de vous voir et de vous aimer. » Un peu de modestie qui n’eut pas long règne l’interrompit en cet endroit, et cependant Céladon prit ainsi la parole : « Je ne me plaindrai plus de ma mauvaise destinée, puisque sa barbarie reçoit une heureuse intermission par le bien imprévu de votre charmante vue, et que votre bonté me vient de donner à connaître que je suis maintenant le plus fortuné de tous les hommes. Oui, miraculeuse beauté, votre présence est un soleil efficace, qui dissipe les nuages qui voilaient mes plaisirs, et je recouvre par votre secours mille fois plus de biens que je n’en perdis sous les ruines de ma liberté. Veuillent les justes dieux que mes chaînes durent éternellement, si la continuation des délices que je goûte ne m’est pas déniée, et s’il m’est permis d’espérer que ce ne sera pas ici la dernière fois que vous apporterez le jour dans ce temple de la plus obscure de toutes les nuits. »
« Je voudrais, reprit Dorimène, qu’il me fût libre de vous tenir compagnie dans un lieu où ma conversation vous pourrait épargner les fâcheuses réflexions de votre esclavage ; mais j’ai des parents qui ne me pardonneraient jamais cette hardiesse, et leur vertu est si délicate que j’en aurais sans doute beaucoup à souffrir si les pas que je viens de faire ne leur étaient ignorés. Mais comme mon cœur ne se règle que par les puissances dont il est entraîné et que ces puissances ne sont autre chose que les insignes attraits dont vous épuisâtes la nature, je veux bien, Céladon, si toutefois la chose est digne de vous être offerte, consentir à ne l’éloigner jamais de vous, et vous faire un innocent sacrifice de ses premières ardeurs et de ses vœux tout passionnés et tout tendres. » En achevant ce discours, elle poussa un soupir qui persuada entièrement Céladon qu’il en était idolâtré, et comme elle était un but où les plus fiers auraient été glorieux de donner, il se sut bon gré de l’avoir assujettie. Et s’étant relevé de terre, où il s’était agenouillé à son abord pour lui présenter un siège : « Non seulement, s’écria-t-il, j’accepte avec chaleur cette offrande sublime, mais aussi j’ose vous conjurer, par la grandeur de votre mérite et par les miracles de vos perfections, de m’en donner quelques témoignages, afin que je cesse de douter d’une possession où les dieux seulement ont droit d’aspirer. Je suis difficile à persuader, et je courbe tellement sous le faix de mes disgrâces que je n’ose me figurer que mon sort me veuille laisser jouir des félicités dont vous me voulez être prodigue. Apparemment, digne et vénérable objet vers qui mon inclination se tourne entièrement, que la déité qui vous a conduite dans ces ténèbres n’a pas oublié de vous apprendre que le silence en est le seigneur, et la discrétion l’inséparable compagne. Ici les bienfaits sont ensevelis dans l’oubli aussitôt qu’ils ont reçu l’être, ou s’ils poussent des germes d’immortalité et de reconnaissance, ce n’est que dans l’esprit de l’heureux favori sur qui on les répand. Ici l’on ignore l’usage de la langue, et le secret est si fort attaché au salut de l’homme qu’on ne le saurait divulguer sans s’enfoncer le poignard dans le sein. Ainsi vous n’avez point d’obstacle légitime à opposer au contentement dont je demande que vous souteniez ma vie contre qui tant de traverses ont déployé leur insolence, et qui se rendra infailliblement à leur opiniâtreté, si vous n’en rétablissez la trame dans la douceur de vos vivifiantes caresses. »
Après qu’ils se furent ainsi témoigné leur mutuelle affection, Dorimène, qui se trouvait bonne marchande de la réception de Céladon, lui en témoigna sa gratitude le plus tendrement qu’il lui fut possible. Mais pour ne pas le laisser dans la pensée qu’il avait pu concevoir que sa facilité venait de la perte qu’elle avait déjà faite de sa pudeur aux approches d’un autre amant, elle jugea à propos de lui protester de nouveau qu’elle avait été vaincue par la force de ses charmes contre lesquels il n’était pas aisé de se raidir. Mais à peine avait-elle ouvert la bouche pour en entamer le discours qu’elle fut interrompue par l’abord de deux inconnues qui entrèrent dans la chambre de Céladon sans ôter le masque, combien qu’elles eussent levé la palle de leur effronterie, et qui s’assirent sur son lit, sans autre forme de cérémonie. Cette nouvelle compagnie la chassa, de sorte que Céladon ne sut rien de l’histoire de cette jeune fleur qu’il venait de cueillir, sinon qu’en la reconduisant jusques au guichet, elle eut, le temps de lui dire qu’elle était l’une des filles de M. Le Sage ; que naturellement on l’appelait Martichon, mais qu’elle avait abandonné cette qualité rampante pour celle de Dorimène, qui lui semblait plus belle, et dont la douceur convenait mieux à celle de ses grâces. Nos deux amants prirent ainsi congé l’un de l’autre,
Dans un autre temps, Céladon aurait monté les degrés de sa chambre quatre à quatre, dans l’impatience d’aller trouver les deux inconnues qu’il avait laissées ; mais Dorimène avait un peu modéré l’excès de sa vigueur, et tout jeune et vaillant qu’il était au doux exercice de Cyprine, il s’était emporté dans ses caresses jusqu’à perdre baleine, et ne regagna sa chambre qu’à pas de vieillard. À peine y fut-il entré que celle des deux masques qui semblait avoir de l’empire sur l’autre lui fit signe de la main de venir s’asseoir auprès d’elle, et dès qu’il lui eut obéi avec une grâce qui lui était naturelle, elle prit ainsi la parole : « Si je ne lève pas le masque, lui dit-elle, ce n’est pas que je ne sache de l’air dont on vit dans le monde, ni que j’ignore qu’il n’y a point de rang qui puisse affranchir celle qui l’occupe des civilités qu’on doit à la plus parfaite image que nous ayons sur la terre du dieu qui captiva autrefois Climène et qui fut cause, par sa poursuite, que Daphné fut convertie en laurier. Mais, Céladon, la hardiesse où je m’échappe contre les lois de la retenue qui m’a acquis quelque bruit parmi le sexe m’a suggéré cet unique moyen de vous venir assurer de mes services et de plaindre avec vous la dureté de vos injustes parents qui ne rendent pas à ce qu’ils ont de plus précieux et de mieux formé, tant pour les excellentes parties du corps que celles de l’esprit, tout le secours que le sang seulement, sans autre raison, en devrait tirer. Lorsque le bruit de vos rares qualités m’eut ouvert le cœur à une compassion dont je ne me repentirai jamais, je me déterminai à vous venir offrir ma bourse, dans un équipage qui vous pût dérober ma connaissance, et si vous ne dédaignez pas l’encens que je vous viens brûler, et que vous puissiez vous contenter de ma possession sans me connaître, je vous proteste, Céladon, de vous rendre tous les jours une visite et d’essayer à vous démêler des caprices de votre injurieux destin. Cette fidèle personne, ajouta-t-elle, en lui montrant sa compagne, est une marchande de cette ville, dont toute la boutique est à votre disposition, et qui, brûlant de posséder le bien de votre vue, m’a conjurée, sachant le dessein que j’avais, de l’amener avec moi. »
Amarante, c’est le nom de cette généreuse galante, de même que Marcelle est celui de la jeune marchande, Amarante, dis-je, attendait la réponse de Céladon, et voyant qu’il restait muet : « Serait-il possible, lui dit-elle, que vous fussiez insensible aux propositions que je viens de vous ouvrir ? Auriez-vous bien si peu de considération pour votre repos que d’en négliger les soins que j’y veux apporter ? Ah ! Céladon, que je serais malheureuse s’il en était ainsi, et que votre réputation serait fourbe si vous rejetiez le service des dames et le dessein que j’ai de me ranger sous vos fers ! Combien que, pour les raisons que je vous ai déjà dites, mon visage soit assez bien voilé pour vous dérober les traits qui le composent, peut-être ne sont-ils pas toutefois si faibles qu’ils ne pussent faire quelque impression sur votre âme si la vue en était permise.
– Ah ! que vous êtes injuste, répartit promptement Céladon, que le silence fatiguait déjà, si vous avez cru que j’ai une âme capable de résister aux charmes dont vous l’avez complétée ! Non, non, adorable beauté, je vous aime sans vous connaître, et pour vous dire plus, je vous adore, et je vous confesse que si vous n’êtes pas une divinité immortelle, au moins en avez-vous toutes les adorables parties. Mon silence n’est pas si condamnable que vous feignez de le croire, et ce n’est pas une petite merveille que j’aie pu si promptement recouvrer la parole, puisque la surprise et l’admiration où m’ont plongé les augustes appas dont vous êtes revêtue m’en devrait avoir interdit l’usage pour jamais. J’accepte vos bontés, quoique je m’en reconnaisse indigne, et je mériterais sans doute la continuation de ma mauvaise fortune si je refusais les largesses d’une divinité, qui, je pense, est venue exprès du ciel pour allonger la quenouille des Parques qui filent mes jours, maintenant dignes d’envie. Je ne vous demanderai pas ce qui vous peut avoir inspiré cette charité ; je sais bien que vos yeux, dont la puissance n’a pas de limites, n’auront pu découvrir les ennuis que ces sombres endroits versent, continuellement sur moi, sans en corriger la malignité au sucre de votre divine présence. Et vous, continua-t-il, en se tournant vers Marcelle, et vous, son obligeante compagne, que ne dois-je point à vos bontés et à l’envie que vous avez eue de voir un prisonnier qui n’aurait point de parallèle en misère sans l’honneur qu’il reçoit de votre visite ? »
Marcelle le regarda d’une façon si tendre et si passionnée qu’elle lui fit juger qu’elle brûlait d’un autre désir que de celui d’une simple visite ; et comme elle se disposait à répartir à sa civilité, son masque, qu’elle tenait avec les dents, lui tomba de la bouche et fit briller aux yeux de Céladon l’éclat d’une beauté qui surpassait incomparablement celle non seulement de Dorimène, mais aussi de toutes les bergères d’Alençon.
Ce nouveau spectacle n’eut pas moins de quoi charmer notre prisonnier qu’il sut vivement troubler Amarante.
Elle crut avec justice que de semblables attraits seraient funestes aux inclinations que l’ignorance où était Céladon des siens qui commençaient à sortir de la carrière de leur printemps aurait pu former en lui, et si son déplaisir n’opéra pas ses dangereux effets sur-le-champ, il est constant que sa cruauté n’en fut que plus tyrannique.
Cependant Marcelle revint du silence que cet accident imprévu, à ce qu’elle disait, mais exprès selon mon sens, lui avait causé, et s’expliqua à Céladon en des termes si éloquemment amoureux
Les choses se passaient ainsi dans son âme, lorsque le concierge le vint avertir que Le Hayer, procureur du roi du lieu, fameux fripon et grand scélérat, demandait à parler à lui.
De sorte qu’il se fallut séparer sans en venir au doux moment ; mais Amarante, qui aurait plutôt consenti à perdre la vie qu’à laisser écouler la journée sans se faire appliquer la marque de Céladon, lui promit de revenir dans peu de temps ; et Marcelle lui dit à l’oreille, sans être aperçue d’Amarante : « Cher Céladon, vous m’aurez à dîner. »
Céladon n’eut pas plutôt entretenu Le Hayer sur quelques affaires qui le regardaient, qu’ils se séparèrent aussi bons amis que l’incompatibilité de la vertu du prisonnier avec les mauvaises qualités de l’autre le permit. Et comme Céladon remontait en sa chambre, une jeune créature lui présenta ce billet, avec une bourse tissue des plus beaux cheveux de l’univers ; et l’ayant ouverte, il y trouva ces mots :
Billet de Dorimène à Céladon.





























