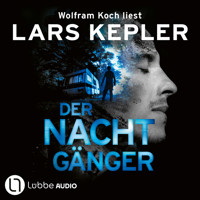Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Sébastien Vernière accomplit enfin son rêve en quittant la banlieue parisienne pour s’établir près de sa tante, Ernestine, au cœur du piémont pyrénéen. À peine installé, il apprend avec stupeur le décès brutal de celle-ci et hérite de la demeure où il passa ses étés d’enfance. Dès sa première nuit sur ces terres familiales, un événement étrange survient lorsqu’une dame blanche provoque un accident mortel avant de disparaître dans la forêt, sans laisser de trace. Les apparitions se multiplient, et Sébastien se retrouve plongé au centre d’une enquête énigmatique. Quelle est l’origine de cette mystérieuse entité et quel sombre secret se cache derrière ces phénomènes qui secouent la région et attirent l’attention des médias nationaux ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Après une vie professionnelle intense en région parisienne, Serge Gaichies choisit de poser ses valises dans les paysages grandioses des Baronnies, au cœur des Hautes-Pyrénées. Là, entre silence des cimes et murmure des hommes, l’évidence s’impose : écrire. Il signe ici son deuxième roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Serge Gaichies
L’ombre blanche
Roman
© Lys Bleu Éditions – Serge Gaichies
ISBN : 979-10-422-7341-5
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Playlist
Les chansons qui ont accompagné l’écriture de mes pages :
Chapitre 1
Sébastien Vernière
Il faisait un temps à ne pas mettre unpied dehors. Le morceau de gouttière qui s’était décroché quelques jours plus tôt en bordure du toit cognait par intermittence sur la façade de l’immeuble, juste au-dessus de la fenêtre de la chambre. Il faisait une nuit noire sans lune, avec un vent à décorner les bœufs, un vrai temps de chien. La pluie dense et intense frappait les persiennes en rafales. La tempête brouillait de temps à autre les images de la télévision familiale, et Sébastien avait décidé d’aller se réfugier sous sa couette bien qu’il ne soit que vingt et une heures.
Il avait abandonné ses parents devant la traditionnelle émission de divertissement du samedi soir. À douze ans, les journées d’école bien remplies, avec en plus le cours de gym hebdomadaire, la course du matin et celle du soir pour attraper le bus, les quinze minutes de marche avec un cartable chargé de livres et de cahiers, finissaient par l’épuiser en fin de semaine.
Dans sa chambre et sous sa couette, il était bien au chaud, c’était en quelque sorte sa tanière. Il était protégé de l’orage par la douceur de ses draps. Seul le radiateur de chauffage central gargouillait un peu et claquait de temps en temps.
Tandis que le mauvais temps et la tempête étaient partout au-dehors, il tenait un livre récupéré le matin même à la médiathèque entre ses mains. Mais pas n’importe quel livre : L’ombre blanche, d’Adrien Quercampois. Un ouvrage un peu ancien, mais très complet sur la question de ces fantômes féminins, tous vêtus de blanc, qui déambulaient la nuit au bord des routes de campagne. La couverture usée et défraîchie arrivait encore à relier les pages de papier jaunies par le temps. Ce livre allait changer le cours de son existence, tout avait commencé avec sa lecture. Il se plongea et s’immergea dans cette histoire sans retenue aucune.
Il lut jusqu’à ce que le sommeil le gagne. Il y apprit que la légende de la « Dame Blanche » trouvait son origine au XVIe siècle, dans le château de Puymartin en Périgord. C’était dans ce château que Thérèse de Saint-Clar fut surprise par son époux, de retour prématuré de guerre, dans les bras de son amant. Le mari jaloux tua l’amant sur-le-champ. L’épouse infidèle fut ensuite emprisonnée dans la tour du château pendant de nombreuses années. À sa mort, et en guise de sépulture, elle fut emmurée dans une des caves du château. Depuis, elle serait apparue plusieurs fois sur les chemins de ronde et dans les coursives du manoir. Certains habitants du château et visiteurs de passage affirmaient l’avoir aperçue plusieurs fois. Xavier de Montbron, propriétaire de la demeure et descendant de l’époux trahi, l’affirmait souvent : la Dame Blanche existevraiment !
La légende s’était ensuite étendue à d’autres territoires du pays de France : à partir du XIXe siècle, et à chaque fois, ce sont des femmes qui revenaient de l’au-delà, généralement des châtelaines qui réapparaissaient dans leur demeure après leur mort. Le voile blanc dont elles étaient vêtues rappelait à la fois le suaire dans lequel on enveloppait traditionnellement les défunts, mais également l’innocence de ces victimes, souvent mortes dans des circonstances tragiques et injustes.
Ce paradoxe ajoutait au mystère. Du point de vue de la culture chrétienne, qui était celle de Sébastien, ces femmes n’avaient pas reçu l’extrême-onction avant leur décès, le dernier des sacrements. Raison pour laquelle elles revenaient errer sans fin dans le monde des vivants et apparaissaient à leurs descendants avant leur disparition, pour les préparer à la mort.
Mais il n’y avait pas qu’en Périgord où cette légende était bien présente : une ancienne châtelaine de Saint-Just-près-Brioude, en Haute-Loire, morte sans avoir eu le temps de confesser ses fautes, fut condamnée à revenir sur terre indéfiniment. On racontait que la Dame Blanche marchait plusieurs nuits de suite autour du château, puis pénétrait dans la grande chambre, où elle réveillait ceux qui dormaient en les giflant, puis elle disparaissait en ne laissait jamais aucune trace.
Elle avait été aperçue à un descendant de la dame du château pour la dernière fois le 31 décembre 1880, à la mort d’une femme mariée. Ensuite, un peu plus tard, était apparue une autre légende…
Dans les années 1930, aux États-Unis, la Dame Blanche revint alors sous l’allure d’une auto-stoppeuse. Elle était toujours drapée de blanc et apparaissait aux automobilistes pour les sauver ou les plonger dans la mort.
En France, dans les années 1960, les récits de ce genre étaient nombreux. Sébastien apprit que c’était de cette façon, le 20 mai 1981, que la légende de la Dame Blanche passionna et enflamma l’Hexagone : trois adolescents de Palavas-les-Flots dirent avoir pris une femme en stop en pleine nuit. Très silencieuse à l’arrière de la R5, la passagère cria soudainement au conducteur de faire attention au prochain virage, qu’il passa dès lors en ralentissant. Immédiatement après, la mystérieuse femme habillée de blanc s’évapora à tout jamais et disparut sans que le véhicule se soit arrêté.
On apprit encore en lisant la suite de l’article que, quand elle portait des gants noirs, elle annonçait de mauvaises nouvelles, et que, quand elle était vêtue de gants blancs, elle en apportait de bonnes.
Sébastien, tout à coup, frissonna à cette idée. Il posa son livre, écouta encore quelques instants le sifflement incessant du vent dans les branches du grand chêne qui touchaient presque la fenêtre de sa chambre. Il remonta sa couette en duvet sur ses épaules, serra fort le drap contre son torse, recala son oreiller sous sa joue et finit par se laisser emporter par un sommeil profond et réparateur.
Il était né en février 1980 à Magny-les-Hameaux, une agglomération de la proche banlieue sud de Paris. Ses parents étaient, l’un comme l’autre, de petits fonctionnaires sans grade d’une communauté de communes voisine.
Il se nommait Sébastien Vernière.
De son école primaire de quartier, il avait reçu une éducation standard, comme tout Français moyen de son époque. Il avait effectué ensuite un parcours tout à fait classique du collège au lycée. Par la suite et jusqu’à ce jour, tout dans sa vie avait été relativement moyen : il était de taille moyenne, nourrissait une ambition de réussite très moyenne, et son parcours scolaire sera lui-même très moyen. Il allait même jusqu’à revendiquer parfois cette « moyenneté » d’ensemble, qui finalement l’arrangeait et lui permettait à chaque fois de passer presque inaperçu ! La seule chose un peu exceptionnelle dans sa vie, sa seule source d’évasion, de rêve, d’imaginaire, c’était sa passion pour les Dames Blanches.
Il avait vécu et avait grandi dans le logement familial. Ses parents de par leur statut et leur profession, avaient obtenu la possibilité d’y habiter : c’était un appartement de fonction au deuxième et dernier étage d’une petite résidence des années quatre-vingt à loyer modéré. La façade était en pierre, mais on ne pouvait vraiment dire si c’était de la vraie ou de la fausse pierre. L’ensemble était toujours bien entretenu, coquet et en bon état. Leurs proches et seuls voisins de palier étaient une famille de quatre personnes originaires des îles. De la Martinique, sans doute ? En plusieurs décennies de proximité, il ne saurait absolument rien d’eux, si ce n’est qu’ils étaient de bons chrétiens et allaient à la messe chaque dimanche matin. Ils se disaient bonjour ou bonsoir à chaque fois qu’ils se croisaient, mais jamais rien de plus. En fait, il ne connaissait que leur nombre, leur visage et leur nom affiché sur leur boîte aux lettres, rien d’autre.
Le reste de l’immeuble était occupé au rez-de-chaussée par une femme, mère célibataire, avec son petit garçon, un couple de retraités et un vieux monsieur vivant seul dans son appartement. Les communs, la cage d’escalier et le hall d’entrée étaient tenus propres et parfaitement aseptisés par une femme de ménage d’origine africaine. Consciencieuse et discrète, elle passait une fois par semaine en pestant et râlant à chaque fois. Ses paroles résonnaient dans le hall d’entrée quand elle arrivait, on savait à chaque fois qu’elle était là ! Sébastien se souvenait que tous les vendredis, ça sentait le produit désinfectant dans tout l’escalier et que ça lui piquait un peu les yeux à son passage.
Dans leur appartement, à droite après le petit hall d’entrée, on trouvait un salon d’une trentaine de mètres carrés, avec un joli balcon qui laissait apercevoir à l’extérieur une grande pelouse que bordait une forêt parsemée d’imposants et magnifiques chênes.
Ses parents y avaient une chambre, et lui l’autre. Il était fils unique et passait pas mal de temps à lire et à contempler les arbres. Cette petite enfance passée à s’ennuyer souvent et à observer la nature constituerait par la suite une de ses grandes passions. Il aimerait les forêts, la nature, les arbres, les oiseaux et les rivières, tellement plus que la ville.
La vie qu’il menait depuis son jeune âge était sans surprise, mais sans souffrance non plus, sans imprévu, mais sans stress, sans grandes joies, mais sans peines. Il la trouvait assez banale et ordinaire, il s’ennuyait souvent et avait l’esprit ailleurs tout le temps, il rêvait dans les livres et par les livres, surtout avec ceux sur les Dames Blanches.
Il en connaissait à présent un rayon sur le sujet, et il avait lu durant son adolescence tout ce qui pouvait lui passer sous la main à ce propos : l’histoire de la première « Dame Blanche », les différentes apparitions recensées, les régions les plus concernées, les heures du jour et de la nuit les plus propices au phénomène. Il avait même fait un exposé sur la question à l’école primaire, qui lui avait valu un dix-huit sur vingt. Il trouvait le sujet autant poétique qu’inquiétant, il y croyait sans y croire, mais ça le fascinait. Ça le faisait rêver, il s’évadait par l’esprit et semblait se perdre dans la lumière pâle et translucide des draps blancs des fantômes. Tous ses livres étaient soigneusement classés et bien rangés sur l’étagère au-dessus de son bureau et toujours à portée de main.
L’unique but de sa vie : fuir de toute urgence la région parisienne quand il serait grand ! Ici, il détestait tout ou presque : le RER, le béton, les sirènes stridentes des ambulances et des voitures de police, les travaux et ses trottoirs boueux, les halls d’immeubles qui sentaient les poubelles, les nécessaires zigzags entre les crachats et les crottes de chien sur son chemin, les embouteillages du matin et du soir quand il rentrait, l’agressivité et la tristesse des gens dans les transports en commun. Il n’aimait définitivement pas du tout la banlieue où il s’était déjà fait voler son vélo à deux reprises, dépouillé de sa montre sur le quai de la gare de Versailles en plein jour, et même sévèrement agressé une fois sans raison aucune.
Chaque année, pour les vacances d’été, et depuis l’âge de dix ans, ses parents l’emmenaient deux semaines au mois de juillet à Boulogne-sur-Mer, sur la Côte d’Opale. Une reconduction quasi systématique d’une habitude, un rituel qu’ils avaient pris depuis qu’ils s’étaient connus là-bas étant jeunes : sa mère était de Boulogne ville, et son père d’Amiens. Adolescents, ils y passaient des vacances ensemble en famille avec leurs propres parents. Ils s’y étaient rencontrés, s’y étaient fréquentés, et puis mariés. Par la suite, ils avaient déménagé en région parisienne pour raison professionnelle. En fait, c’était la principale motivation qui faisait qu’on arrivait ici en banlieue : personne ne venait y vivre par plaisir, personne. Ce n’était jamais un choix en tant que tel, mais plutôt une certaine forme de contrainte, d’obligation, de passage forcé pour tous les provinciaux qui voulaient débuter dans de bonnes conditions leur vie active et accélérer rapidement le cours de leur carrière. On y vivait, on y survivait, et on en partait dès que l’on pouvait, mais parfois on pouvait y rester longtemps et même jusqu’à la fin de sa vie pour certains.
Sébastien n’aimait pas plus Boulogne-sur-Mer que Magny. Il trouvait la mer grise et plate, pour lui ce n’était pas vraiment la mer. Les gens étaient tristes, souvent moches, le paysage morne, l’air trop frais et trop humide, même en été. La seule chose qu’il appréciait à Boulogne, c’étaient les dames blanches du glacier de la plage. Le nom lui rappelait à chaque fois ses lectures. Toujours soucieux d’approfondir ses connaissances sur le sujet, il apportait avec lui, chaque été, un ou deux ouvrages, qu’il parcourait avec délectation durant tout son séjour, dans son lit le soir, une fois couché.
Pas trop loin de la maison, le petit bar glacier de la plage était tenu par une femme gironde très gentille aux joues rouges et pommelées. Il ne savait pas comment elle s’appelait, mais il remarquait qu’elle rendait la monnaie en disant toujours « s’il vous plaît », comme à chaque fois dans le nord de la France. Ça l’étonnait toujours, c’était une expression qu’on n’utilisait pas ou très peu à Paris. Elle disait « septante et non pas soixante-dix », « nonante et pas quatre-vingt-dix ». Elle était toujours vêtue d’un tablier de cuisine en nylon imprimé qui encerclait comme il le pouvait sa taille opulente et avait les pires difficultés à contenir sa volumineuse poitrine. Quand Sébastien la regardait, elle lui faisait toujours penser à un personnage sympathique de vache laitière d’un petit livre que sa mère lui lisait pour l’endormir le soir. Comme elle, elle portait des mi-chaussettes qui remontaient au-dessus de ses ballerines vernies noires et recouvraient en les comprimant un peu ses chevilles solides et droites.
La dame blanche : il aimait depuis toujours ce mélange de vanille et de chocolat. Il trouvait jolie et élégante la crème chantilly du dessus. Mais il l’avalait sans conviction, il ne l’aimait pas plus que ça, il aurait pu s’en passer. Par contre, il dégustait à la petite cuillère, et en faisant durer le plaisir, le mélange de crème glacée à la vanille et de chocolat noir fondu.
Il se demandait chaque fois pourquoi ce dessert avait été nommé « Dame Blanche » et s’il y avait un rapport direct avec les histoires de fantômes du même nom, à part la couleur de la crème glacée peut-être. Un jour, lorsqu’il était encore tout petit, son père lui avait tout de même expliqué que c’était à cause d’une espèce de fantôme, une femme drapée d’un drap blanc qui traînait au bord des routes et des étangs la nuit. Il lui avait dit que le matin de bonne heure ou à la nuit tombée, elle faisait des apparitions intermittentes et furtives. C’était de cette façon qu’avait commencé sa passion pour le sujet et que, quelque temps après, il avait lu son premier livre. En fait, tout était parti de là…
Mais il préférait de beaucoup le mois d’août au mois de juillet, et plus spécialement encore la semaine qu’il passait tous les ans depuis l’âge de dix ans en Baronnies. C’était ainsi que l’on nommait ce petit coin du sud de la France, calé tout contre le milieu de la chaîne des Pyrénées et réparti entre les communes de Lannemezan et Bagnères-de-Bigorre. Dans les Baronnies, au pied du Pic du Midi et du Montaigu, on trouvait une trentaine de petits villages, tous plus jolis et plus paisibles les uns que les autres. Tout le contraire de la banlieue Parisienne, il s’en était très vite rendu compte.
Sébastien y passait une semaine tous les étés depuis ses douze ans, âge auquel on l’avait laissé voyager seul en train pour la première fois. Il rejoignait là-bas sa tante Ernestine, la sœur de son père, qui vivait dans le village d’Esparros. Elle y était arrivée il y a fort longtemps. Son union avec Henri, son défunt mari, l’avait amenée dans la région. C’était un enfant du pays, et lors de son service militaire dans le nord de la France, il avait connu Ernestine. Elle l’avait ensuite suivi, ils s’étaient installés en Baronnies vers le début des années soixante-dix, et elle y était restée vivre seule après son décès.
Ernestine logeait dans une petite maison de village située sur la principale et unique rue du village, et éloignée d’une centaine de mètres environ du centre du bourg. La bâtisse ancienne, construite en galets de l’Arros comme la plupart des autres maisons, était entourée d’un grand jardin clos de mur en pierres sèches. Son toit était en ardoise de pays. Elle y cultivait un grand potager qui jouxtait la maison et possédait six à sept poules et quelques lapins. Au rez-de-chaussée, constitué d’une seule grande pièce, se trouvaient, d’un côté, une vieille banquette en velours marron et deux fauteuils club en cuir usé de la même couleur, de l’autre, une cheminée avec un évier en pierre et un garde-manger juste en dessous, logé dans l’épaisseur du mur comme l’évier. Tout proche, posé sur le parquet de chêne, un imposant buffet en bois sombre faisait office de vaisselier et de placard de rangement.
En son milieu, il comprenait deux grands tiroirs. C’était dans l’un d’eux qu’Ernestine rangeait ses lunettes et son journal, tous les matins après l’avoir lu. C’était là aussi qu’elle conservait les deux ou trois derniers numéros de son magazine préféré : Modes & Travaux. Quand il y en avait trop et qu’elle ne pouvait plus arriver à fermer le tiroir, elle faisait le tri, et ils finissaient en allume-feu ; ici, rien ne se perdait.
Écologiste de la première heure sans le savoir, Ernestine usait jusqu’à la corde, recyclait, réparait, réutilisait et ne jetait presque rien de ce qu’elle achetait.
Elle cuisinait depuis toujours, la plupart du temps soit dans le poêle à bois qui jouxtait l’évier, soit directement dans la grande cheminée située juste en face du grand buffet. Sébastien adorait ce qu’elle lui préparait : sa garbure maison au fumet délicat, son gratin de macaronis au fond de veau, son civet de lapin parfumé au laurier et au thym, son ragoût d’agneau aux carottes d’Asté, ses tourtes des Pyrénées, ses beignets aux pommes et tout le reste aussi sans aucune exception. Rien à voir avec ce qu’il mangeait en région parisienne, ici tout était succulent et à son goût.
À l’étage, il y avait deux petites chambres, la sienne et celle de Sébastien, qui n’était bien sûr occupée que quand il était là, c’est-à-dire une semaine tous les ans. Les murs étaient parsemés de cadres avec quelques photos jaunies d’ancêtres, torses bombés, toujours sévères, regards fiers et noirs.
Dans la troisième pièce, la plus petite, entre les deux chambres, Ernestine avait aménagé une salle de bain juste avant le décès de son époux. C’était la seule concession qui avait pu être faite ici au confort moderne. Tout le reste était totalement d’époque et dans son jus. Sébastien y était tellement heureux depuis qu’il y venait qu’il n’avait jamais été surpris le moins du monde par le décalage avec l’aménagement de l’appartement où il vivait à Magny-les-Hameaux. Ici, tout était à sa place, il y avait juste ce qu’il fallait, et il découvrait le luxe véritable des choses simples. Il le savait, sa vie était ici.
Comme pouvaient en témoigner les photos grand format où elle prenait la pose dans les deux cadres sur le mur de l’escalier, Ernestine était très jolie étant jeune. Son visage fin et bien dessiné, son regard doux et profond, ses cheveux clairs bien rangés et tirés en chignon sur l’arrière de sa tête laissaient deviner la très belle jeune femme qu’elle était déjà à vingt ans. Elle avait su conserver toutes ses expressions, et on la reconnaissait bien, même si c’était maintenant une personne d’un grand âge. Heureusement pour elle, elle était totalement autonome, et avait toute sa tête. Elle se caractérisait par une vitalité débordante. Son existence était des plus saine, et sa santé toujours excellente, été comme hiver. Elle vivait de la pension de réversion de son époux, touchait l’aide au logement, et faisait quelques ménages dans le village de temps en temps. Afin de compléter encore ses modestes revenus, elle se rendait chaque semaine au marché de Lannemezan pour y vendre un peu de sa production de légumes, quelques cèpes, girolles et pieds de moutons récupérés dans les bois à la saison des champignons, noix et châtaignes ramassées dans la forêt voisine, et aussi de l’ail des ours au tout début du printemps, de la salade de pissenlits sauvages, et de temps en temps, une poule et un ou deux lapins. Avec l’argent gagné, elle passait ensuite en fin de matinée chez le boucher avant la fermeture de son magasin pour acheter un morceau de bœuf, et parfois à la mercerie pour y récupérer du matériel de couture.
Ernestine cousait pour elle-même, mais aussi pour le compte de quelques voisins moyennant rétribution, encore une de ses multiples petites sources de revenus. Huit euros pour un ourlet, dix pour raccourcir une robe ou les manches d’une veste, vingt pour refaire une doublure, ses tarifs compétitifs étaient adaptés au pouvoir d’achat local. Elle ne roulait pas sur l’or, ne se plaignait pas de son sort, mais donnait pour autant l’impression de ne jamais manquer de rien. La seule chose qui l’énervait, et elle le répétait bien assez à Sébastien, c’était ce qu’elle entendait tous les jours à la télévision de la bouche des gens de la ville, comme elle disait. Il lui semblait être d’une autre époque : on y parlait « mobilités » et plus « moyens de transport », on vivait désormais dans les « territoires » et plus « en province », on disait « sororité » et plus « solidarité entre femmes », on se « sexualisait » et on ne « se maquillait plus », on évoquait la « ruralité » et plus la « campagne », on était « non binaire » et plus du tout « asexué », on buvait du « vin nature » et plus de la « piquette », même le bulletin météo de dix-neuf heures cinquante, qu’elle écoutait avec attention chaque soir, se nommait à présent « météo climat »… ! Elle se demandait parfois dans quelle langue l’on parlait. À chaque fois qu’il l’entendait pester et râler, ça faisait rire Sébastien. Elle n’était pas contre la modernité, mais quand elle la trouvait inutile et qu’elle n’y voyait aucun intérêt, elle ne se privait pas de le dire avec force à qui voulait l’entendre, et peu importait si l’on n’était pas d’accord avec elle. Elle disait qu’à son âge, si on ne disait pas ce que l’on pensait, on ne le ferait jamais !
Elle était amie avec les trois quarts du pays, mais elle était très proche d’une veuve de son âge, une femme d’exploitant agricole, Marguerite Estrade. Leur couple traversait depuis des années de grandes difficultés avec leur exploitation déficitaire, et Ernestine allait souvent les aider pour les foins et dans quelques autres occasions. Même si cela se perdait de plus en plus, la solidarité était pendant très longtemps la meilleure des mutuelles par ici, et parfois le seul moyen permettant de traverser et de surmonter les difficultés de la vie. Elle lui parlait souvent de Sébastien, comme si c’était son propre fils. Elle lui avait raconté sa passion pour les Dames Blanches.