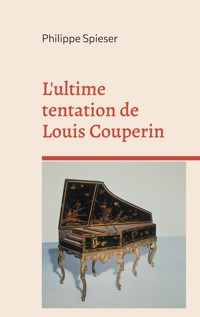
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le livre est une biographie romancée de Louis Couperin (1626-1661), oncle de François Couperin dit le Grand et l'un des plus illustres représentants de cette grande famille de musiciens français. Il se présente sous forme d'une lettre écrite par un de ses élèves imaginaire évoquant les hésitations intellectuelles, spirituelles et personnelles de celui qui fut l'organiste de Saint Gervais-Saint Protais, une importante paroisse de Paris, proche du Louvre. S'appuyant sur les rares informations dont on dispose, l'auteur imagine l'artiste confronté aux questions scientifiques et théologiques de son temps.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
REMERCIEMENTS
À Alain Dulot.
À Xavier C.
À Pascal Bertry, honnête homme qui se dit organiste, claveciniste et épinettiste amateur (un jugement de goût, non de niveau), a écrit une biographie de Louis Couperin, musicien, à partir de rares informations fiables.
Elle constitue la matière première de ce qui reste un roman et n’existerait pas sans elle. Qu’il soit ici profondément remercié.
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
1
Paris, 31 août 1661
Cher Maître, cher Louis,
Tout est accompli. Ou presque tout. C’est le début de la fin. La fin ? Le début d’autre chose, en tout cas. On va procéder dans l’heure à l’ensevelissement de votre enveloppe terrestre dans un caveau de l’Église Saint-Gervais et Saint-Protais. Votre humble cercueil attend déjà, drapé de noir. Des hautes bougies qui atteignent à mi-hauteur de l’étroite nef s’élèvent d’épaisses fumées charbonneuses dans le tremblement de leurs flammes incertaines. L’assistance est une assemblée d’ombres murmurantes qui ne manqueront pas de se taire lorsque l’office funèbre débutera. Quelques éventails de dentelle sont agités par des mains gantées, luttant contre une chaleur que la nef de l’église atténue à peine. Auriez-vous été inspiré, dans une de vos œuvres, par ce colloque de spectres si vous en aviez été le spectateur ? J’en doute, votre musique, intellectuelle et sensible, ne s’est jamais attachée à décrire des paysages ou des situations précises, elle n’en avait pas besoin. Vous reposerez, pour l’éternité, au pied de l’orgue que vous avez tenu plus de huit ans, exactement depuis le 9 avril 1653, vous n’aviez que vingt-sept ans. C’était une journée d’un printemps triomphant pour la nature, le soleil était déjà inhabituellement chaud, et pour vous-même, rayonnant de la joie ressentie devant une ambition pleinement satisfaite. J’en fus le témoin attendri. Votre contrat vous chargeait de tenir l’imposant instrument durant douze ans. La Mort, ignominieuse à considérer ce que vous pouviez encore composer et interpréter, en a décidé autrement. Quoi qu’il en soit, que valent traités, arrangements ou promesses pour elle ? Les notaires et les hommes d’Église ne sont pas barrages bien solides contre cette invincible boue qu’est la Mort. Elle a interrompu cruellement votre accord avec le sévère chapitre de la paroisse la plus noble, la plus recherchée et la plus aristocratique de Paris. Proche du Louvre, elle jouxte la résidence et la personne du Roi, en reçoit la première ses commandements et ses bontés. Feu Louis XIII y consacra même solennellement le royaume à la Vierge. Il est donc impératif de s’y presser, de s’y montrer, on n’ose dire d’aller s’y faire voir.
Je ne vous ai pas revu depuis de longues semaines, à l’époque où votre maladie s’était déchainée après vous avoir assiégé avec sournoiserie, sans bruit, ce qui explique son triomphe. Je n’ai pu vous dire adieu avant votre passage sur l’autre rive. De toutes façons, vous ne teniez pas à des retrouvailles en des circonstances qui eussent été pénibles pour nous deux. Votre pudeur vous interdisait de vous présenter rabougri, diminué, menu, tremblant (sans délicatesse, on a évoqué devant moi votre état pitoyable), sauf à des gens pour qui vous n’étiez qu’un corps pantelant source de possibles revenus – artisan, médecin ou prêtre. Je n’ai écouté que quelques mots d’une description qui me parut indécente. De votre côté, vous saviez que je passais des auditions destinées à assurer mon avenir d’organiste ou de musicien de cour au service d’un prince ou mieux, d’un mécène, puisqu’ils sont notoirement moins avares. Elles me tenaient éloigné de vous et même de Paris, vous ne vouliez en aucun cas constituer un détour perturbant sur mon chemin déjà passablement semé d’embûches.
Je l’avoue, et ne voyez là aucun égoïsme ou manque de charité, je ne suis pas mécontent de ce rendez-vous manqué. Je n’aurais pas supporté le spectacle de votre effondrement physique, j’en avais chassé par avance les images dégradantes. Je me suis seulement demandé douloureusement ce qu’étaient devenus sous les coups de boutoir du mal votre visage austère, au dessin si régulier, osseux et dur, semblable à celui du défunt Louis XIII, votre face toujours concentrée que n’ont pas déparée un maigre collier de barbe et une moustache à peine esquissée sous un nez discret, vos yeux légèrement voilés par des paupières un brin affaissées qui laissaient cependant passer la lumière questionneuse de l’intelligence, vos fins cheveux noirs cascadant sur d’étroites épaules légèrement tombantes. Et votre corps, a-t-il gonflé ou est-il au contraire amaigri, conséquence des dysenteries et des humeurs méphitiques fréquentes de nos jours dans des villes embarrassées de bêtes, de gens sales et galeux parce que misérables, d’ordures ? La capitale de notre malheureux pays n’est pas le moindre de ces effrayants cloaques.
Je ne sais pas quelle a été la cause réelle de votre grand départ, si brusque qu’il a intrigué bien des gens. Le diagnostic n’a plus d’importance, il est toujours question d’humeurs, de fluides mauvais, de bubons. Il vous appartient ainsi qu’à votre médecin, s’il a été capable d’en porter un qui ait été pertinent. Dieu merci, la maladie vous a épargné son meilleur ennemi, le chirurgien barbier, qui, lui, a le droit de hacher, trancher, cautériser parfois et faire souffrir sans guérir avant de contribuer grandement à faire mourir. Hypothèse absurde : sceptique à l’égard de la Faculté et surtout de ses plus sanglants bras armés, vous l’auriez sans doute chassé avant qu’il ne prépare ses instruments.
La déréliction de votre état physique a été à l’image des rudesses du temps. La crise de l’avènement, cette période ainsi baptisée parce qu’elle débuta par la prise de pouvoir de Louis majeur, encore inexpérimenté et émancipé de sa mère brutalement congédiée de son Conseil et durant laquelle il a endossé avec une vigueur inattendue ses habits de prince oint par Dieu, a été terrible. Elle a été accompagnée d’un cortège sinistre de malheurs, de disettes, de fièvres fatales, d’embolies de toute sorte, ainsi, pour faire bonne mesure, que des pluies incessantes qui ont détruit les récoltes, ruiné les paysans avant de les tuer, augmenté la cherté de la vie et la colère du peuple. Les rongeurs furent affamés, partant, agressifs et impavides. Ils ne craignaient plus ni les hommes ni surtout les chats.
Je ne compte pas pour rien dans ce chaos la fronde des Parlements et des princes de sang contre le jeune souverain rendu responsable de tout, chiens mordant la main nourricière. Les conséquences du dérèglement des saisons sur nos vies quotidiennes - cherté et rareté des biens et de la nourriture ou manque de paysans - deviennent inévitablement des enjeux dans les joutes politiques lorsque ces dernières s’aiguisent au point d’apporter un climat de guerre civile. Commencer son règne tel un pharaon novice combattant les sept plaies d’Egypte laissait augurer des jours tourmentés. Bien des esprits crédules ont vu dans ces catastrophes un mauvais présage et ces funestes événements fragilisaient dangereusement le trône adolescent, dans les cœurs et les têtes.
Le jeune Louis Le Quatorzième s’en est opportunément ému, compatissant aux peines de ses sujets meurtris « avec une désolation difficile à exprimer » comme il l’a écrit lui-même dans une adresse largement diffusée dans les paroisses. Il a montré alors une sincérité et une compassion que personne n’a pu contester mais qui n’étaient dues qu’à son jeune âge. Le pouvoir endurcit vite, aujourd’hui, je gage qu’il enverrait sans doute plutôt ses troupes que ses condoléances. Depuis le peu de temps où il règne sans partage, il a déjà prouvé son goût pour la guerre… Vous avez vécu ces tristes moments avec stoïcisme, jusqu’à faire preuve d’une grande générosité, vous vous êtes dépris de beaucoup de choses. J’en ai reçu plusieurs témoignages émouvants, notamment de ceux qui sont allés vous rendre visite et sont repartis, qui avec une partition, qui avec un peu de nourriture, qui avec un vêtement, tout ce que vous avez jugé superflu ou inutile à moyen terme. Sont-ils venus par pure sympathie à votre endroit, craignant de manquer de vous revoir avant qu’il soit trop tard ? N’était-ce pas également une assurance que certains s’offraient à peu de frais ? Ils ont ainsi payé une sorte de tribut à Dieu dans l’espoir conscient ou inconscient qu’Il les épargnera encore un peu, en remerciement de leur dernière visite si charitable à l’une de ses pauvres créatures. De leur part, un acte de miséricorde, de bonté et évidemment de prudent calcul.
2
J’écris aujourd’hui une missive posthume qui ne vous est donc pas destinée. Vous l’auriez reçue, vous l’auriez laissée probablement sans réponse : Dieu, maintenant, ne vous autoriserait pas à réagir, même si vous le souhaitiez. Mon affirmation est purement gratuite : des permissions de sortie, Il n’en a jamais donné jusqu’ici à quiconque. Autrement cela se saurait, on ne resterait pas dans cet inconnaissable sur lequel tant de têtes pensantes se sont cognées et se cognent encore. Dieu serait-il lui-même une hypothèse inutile ? J’ose écrire cette question, certain de n’être lu que par ceux qui se pencheront sur mon legs après ma mort si je n’ai pas décidé entretemps de détruire tout ce que j’aurais commis, lettres, documents, missives - en dehors de ma musique, bien sûr.
Laissez-moi donc partager avec vous un monologue épistolaire dont vous aurez connaissance, quelque part, ailleurs, qui sait ? Il faut avoir la foi, dit-on, accepter le saut dans l’inconnu qui constitue ce pari hasardeux proposé par Blaise Pascal. J’évoque ici un philosophe que vous avez lu et relu, avec passion et à qui vous avez rendu des visites au sujet desquelles vous êtes resté étrangement assez peu disert, sauf lors de rares confidences copieuses et véhémentes que vous me fîtes il y a peu. J’en suis donc réduit à des conjectures - un mot qu’il aimait bien. Justement, vous vous êtes contenté d’évoquer ses travaux en probabilités, en arithmétique et en géométrie, en soutenant que, pour le peu que vous en avez compris, vous y aviez trouvé une parenté esthétique et intellectuelle avec la musique. Contemplant un instant la voûte de l’église qui va vous abriter, avec ses ogives multiples qui s’entrecroisent comme si de gigantesques compas les avaient creusés et modelés dans la pierre blonde, je me dis à votre suite que l’architecture, elle aussi, s’écrit en courbes calculables.
Puisque vous nous avez quittés, sauf indication relative au lieu où vous vous tiendrez, cette lettre m’est adressée, à l’exclusion de tout autre destinataire. Alors, qu’est-ce qui justifie la peine de l’écrire ? D’abord, elle vaut simplement examen de conscience qu’un pécheur ferait sans l’intermédiaire d’un prêtre et soumettrait à son propre jugement, en attendant celui de Dieu. Mettre ses idées en ordre, faire le bilan de la journée, toujours chercher à savoir si on a commis le mal ou fait un peu de bien, comprendre le pourquoi des choses avant de s’en remettre au Créateur dont on finit toujours par invoquer le nom, qui servira de réponse commode après quelques « pourquoi ? », n’est-ce pas ce que les bons pères nous ont enseigné ? Les hommes devraient systématiquement s’adonner à ce nettoyage de l’âme et de l’esprit s’ils veulent encore mériter la présomption d’être d’essence divine. Ensuite, j’ai cependant une idée s’agissant de l’avenir du texte présent : il est des pays proches où l’édition de livres, y compris de pamphlets et de suppliques, ne subit pas la lourde police de notre beau pays.
Alors, pourquoi perdre du temps à rédiger cette missive posthume qui n’aura jamais de lecteur ? Le chapitre de l’église Saint-Gervais et Saint-Protais m’a sollicité par lettre, en janvier dernier, afin de vérifier bien « des détails de votre passé, mineurs ou non, il nous appartiendra d’en décider », et qui ne seraient pas parvenus à sa connaissance. Si la Parque n’avait coupé le fil ténu de votre existence, vous auriez été en état de les confirmer ou de les infirmer devant lui de vive voix. Physiquement, il adopte d’ailleurs, en ces occasions, une gênante configuration de tribunal, l’impétrant ou le suspect d’un côté, les juges de l’autre. Vous auriez été à même de le faire par écrit, avec votre plume si précise quoique vous préfériez les notes aux lettres. C’est trop tard. Dès cette époque, les membres du conseil étaient convaincus que vous vous trouviez sur cette crête vertigineuse nommée le plus souvent d’une expression latine, in articulo mortis. Elle est rarement traduite et pour cause : nous sommes superstitieux et la mort ne peut se dire en termes francs et clairs sans que l’on ait le sentiment effrayant de la convoquer.
Le chapitre a eu raison de surseoir à toute injonction à comparaître devant lui. Ce fut beaucoup moins un geste de bonté ou de mansuétude à votre endroit qu’une question d’emploi du temps pour ces hommes très occupés. En tout cas, l’échéance ultime s’est rapprochée plus rapidement que ce qu’il attendait et que ce que je craignais. J’ai trouvé surprenante et pour tout dire très inamicale cette demande émanant des religieux en responsabilité de notre illustre paroisse, des chrétiens normalement prompts à pardonner, réfractaires par construction à la rancune et aux calomnies. Je n’en connais toujours pas la véritable raison de fond. Ils ont simplement laissé filtrer le reproche de votre discrétion excessive à leurs yeux inquisiteurs : « On ne sait rien de lui, de sa vie personnelle, de ses pensées de toute nature, de sa loyauté à tout ce qui nous fonde, de sa foi profonde, de son attachement à la Sainte Église », ce qui est effectivement un grief qui vaut péché mortel aux yeux de personnes qui prétendent s’occuper par le menu de nos âmes et de leur salut. Quel projet, s’agissant de vos restes spirituels, ont-ils en tête ? Souhaitent-ils vous accuser et si oui, de quoi ? Est-ce pour instruire à votre endroit je ne sais quel procès en béatification ou en sorcellerie, deux inculpations plus proches qu’on ne croit ? Que veulent-ils faire des informations que je pourrais leur fournir ? Ont-ils l’intention de vous élever une statue ou, au contraire, effacer jusqu’à votre mémoire ? Mystère.
Inquiet, je me suis alors proposé avec tant de fermeté de mener à bien cette investigation, montrant un désir si insistant d’en contrôler les moyens et les conclusions que j’ai finalement été choisi puis confirmé comme seul enquêteur par ces dignes ecclésiastiques. Je n’avais, il est vrai, pas beaucoup de concurrents pour ce pensum. Au fond de moi, ces juges de nos consciences, je les crois retors, sinon fourbes. Ils me semblent être de ces hommes qui posent des questions captieuses, en en connaissant in petto les réponses ou, au besoin, en les inventant avec tant de précision qu’elles paraissent vraisemblables. Ils finissent par se convaincre eux-mêmes de leurs mensonges et des produits de leur imagination. Ils savent faire l’âne pour avoir le foin des soupçons, des actes d’accusation, des procédures à suivre et des condamnations à appliquer. Si j’ai donc revendiqué haut et fort ce mandat délicat, c’est parce que j’ai considéré sans modestie que moi, Eustache Devernois, j’étais votre meilleur et plus fidèle élève en la discipline où vous, Louis Couperin, avez excellé, la musique et l’habileté à maîtriser un clavier. Je me suis aussi prévalu, sans vanité, d’avoir bénéficié de votre amitié suffisamment forte pour que j’aie pu vous connaître un peu et suffisamment distante pour qu’elle ne nuise pas au jugement que je pouvais porter sur vous. La tâche d’enquêter m’incombait donc naturellement, ai-je argumenté, car je l’accomplirais avec la rigueur et l’honnêteté que, de notoriété publique, j’ai mises à vous servir.





























