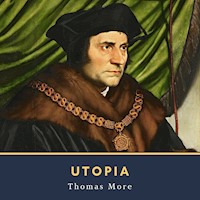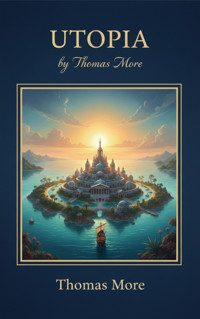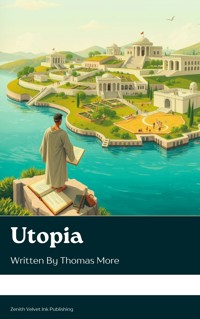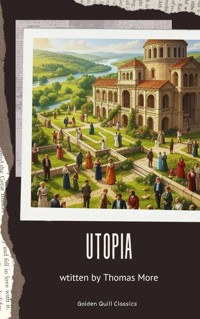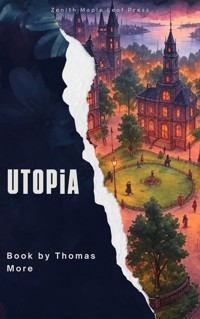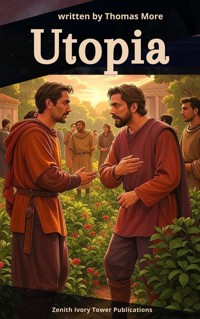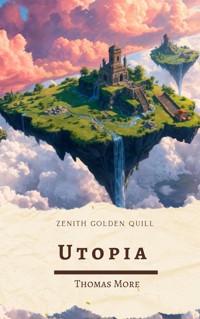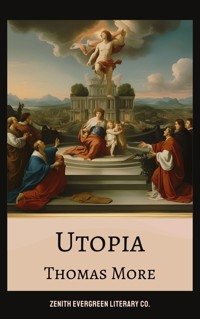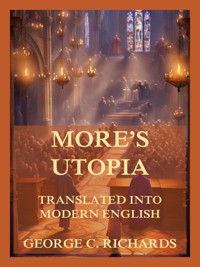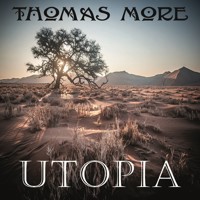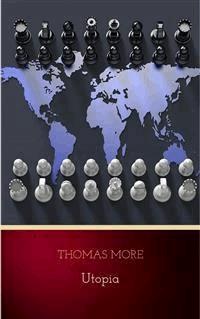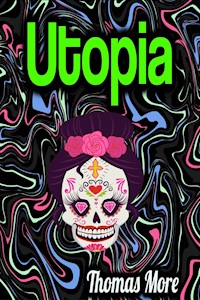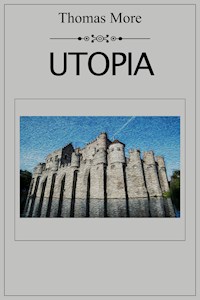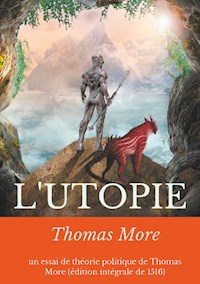
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "L'Utopie" de Thomas More est une oeuvre fondatrice de la littérature politique, publiée en 1516, qui propose une réflexion profonde sur la société idéale. Le livre se présente sous la forme d'un dialogue entre More et un voyageur fictif, Raphaël Hythloday, qui décrit une île imaginaire où les habitants vivent selon des principes de justice, d'égalité et de rationalité. Ce texte explore des thèmes tels que la propriété collective, l'abolition des classes sociales et l'importance de l'éducation. More critique les travers de la société européenne de son temps, marquée par les inégalités et les abus de pouvoir. L'île d'Utopie devient ainsi un miroir critique permettant d'évaluer les possibilités de réforme sociale et politique. L'ouvrage, à la fois sérieux et satirique, interroge la nature humaine et la capacité à instaurer un ordre juste. Sa structure en deux livres, le premier établissant un diagnostic des maux de l'Europe, et le second décrivant l'organisation utopienne, invite le lecteur à une réflexion sur les valeurs fondamentales de la société. "L'Utopie" reste un texte incontournable pour comprendre les débats sur la justice sociale et les idéaux politiques. L'AUTEUR : Thomas More, né en 1478 à Londres, est une figure emblématique de la Renaissance anglaise. Humaniste, avocat, théologien et homme d'État, il est surtout connu pour son oeuvre "L'Utopie". More étudie à Oxford avant de se lancer dans une carrière juridique et politique. Il devient l'un des conseillers les plus proches du roi Henri VIII, occupant le poste de Lord Chancelier. Cependant, sa carrière prend une tournure dramatique lorsqu'il s'oppose à la rupture du roi avec l'Église catholique. Refusant de prêter serment à l'Acte de Suprématie, qui déclarait Henri VIII chef de l'Église d'Angleterre, More est emprisonné à la Tour de Londres. En 1535, il est exécuté pour trahison. More est canonisé en 1935 par l'Église catholique. Son oeuvre littéraire et sa vie témoignent d'un engagement profond envers ses principes moraux et religieux. "L'Utopie" reflète ses préoccupations humanistes et sa quête d'une société plus juste. Aujourd'hui, Thomas More est souvent célébré pour sa contribution à la pensée politique et pour son intégrité face aux pressions politiques de son époque.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Préface du Traité de la meilleure forme de gouvernement : lettre de Thomas More à Pierre Gilles
Livre premier
Livre second
Des villes d’utopie et particulièrement de la ville d’Amaurote
Des magistrats
Des arts et métiers
Des rapports mutuels entre les citoyens
Des voyages des Utopiens
Des esclaves
De la guerre
Des religions de l’Utopie
Préface du Traité de la meilleure forme de gouvernement : lettre de Thomas More à Pierre Gilles
Thomas More à Pierre Gilles, salut !
Ce n’est pas sans quelque honte, très cher Pierre Gilles, que je vous envoie ce petit livre sur la république d’Utopie après vous l’avoir fait attendre près d’une année, alors que certainement vous comptiez le recevoir dans les six semaines. Vous saviez en effet que, pour le rédiger, j’étais dispensé de tout effort d’invention et de composition, n’ayant qu’à répéter ce qu’en votre compagnie j’avais entendu exposer par Raphaël. Je n’avais pas davantage à soigner la forme, car ce discours ne pouvait avoir été travaillé, ayant été improvisé au dépourvu par un homme qui, au surplus, vous le savez également, connaît le latin moins bien que le grec. Plus ma rédaction se rapprocherait de sa familière simplicité, plus elle se rapprocherait aussi de l’exactitude, qui doit être et qui est mon seul souci en cette affaire.
Toutes les circonstances, je le reconnais, mon cher Pierre, m’ont donc facilité le travail au point qu’il ne m’en est guère resté. Assurément, s’il m’avait fallu inventer ce qui suit ou le mettre en forme, un homme, même intelligent, même instruit, aurait eu besoin de temps et d’étude. Qu’on m’eût demandé une relation non seulement exacte mais encore élégante, jamais je n’y aurais suffi, quelque temps, quelque zèle que j’y eusse mis.
Mais, libéré des scrupules qui m’auraient coûté tant de travail, j’avais simplement à consigner par écrit ce que j’avais entendu, ce qui n’était plus rien. Cependant, pour terminer ce rien, mes occupations me laissent, en fait de loisir, moins que rien. J’ai à plaider, à entendre des plaideurs, à prononcer des arbitrages et des jugements, à recevoir les uns pour mon métier, les autres pour mes affaires. Je passe presque toute la journée dehors, occupé des autres. Je donne aux miens le reste de mon temps. Ce que j’en garde pour moi, c’est-à-dire pour les lettres, n’est rien.
Rentré chez moi en effet, j’ai à causer avec ma femme, à bavarder avec les enfants, à m’entendre avec les domestiques. Je compte ces choses comme des occupations puisqu’elles doivent être faites (et elles le doivent si l’on ne veut pas être un étranger dans sa propre maison) et qu’il faut avoir les rapports les plus agréables possible avec les compagnons de vie que la nature ou le hasard nous ont donnés, ou bien que nous avons choisis nous-mêmes, sans aller toutefois jusqu’à les gâter par trop de familiarité et à se faire des maîtres de ses serviteurs. Tout cela mange le jour, le mois, l’année. Quand arriver à écrire ? Et je n’ai pas parlé du sommeil, ni des repas, auxquels bien des gens accordent autant d’heures qu’au sommeil lui-même, lequel dévore près de la moitié de la vie. Le peu de temps que j’arrive à me réserver, je le dérobe au sommeil et aux repas. Comme c’est peu de chose, j’avance lentement. Comme c’est quelque chose malgré tout, j’ai terminé L’Utopie et je vous l’envoie, cher Pierre, afin que vous la lisiez et que, si j’ai oublié quelque chose, vous m’en fassiez souvenir. Ce n’est pas sous ce rapport que j’ai le plus à me défier de moi-même (je voudrais pouvoir compter sur mon esprit et sur mon savoir autant que jusqu’à présent je compte sur ma mémoire) ; je n’en suis pas néanmoins à me croire incapable de rien oublier.
Me voici en effet plongé dans une grande perplexité par mon jeune compagnon John Clement qui nous accompagnait, vous le savez, car je ne le tiens jamais à l’écart d’un entretien dont il peut retirer quelque fruit, tant j’espère voir un jour cette jeune plante, nourrie du suc des lettres latines et grecques, donner des fruits excellents. Si je me rappelle bien, Hythlodée nous a dit que le pont d’Amaurote, qui franchit le fleuve Anydre, a cinq cents pas de long. Notre John prétend qu’il faut en rabattre deux cents, que la largeur du fleuve ne dépasse pas trois cents pas à cet endroit. Faites, je vous prie, un effort de mémoire. Si vous êtes d’accord avec lui, je me rangerai à votre avis et je me déclarerai dans l’erreur. Si vous n’en savez plus rien, je m’en tiendrai à ce que je crois me rappeler. Car mon principal souci est qu’il n’y ait dans ce livre aucune imposture. S’il subsiste un doute, je préférerai une erreur à un mensonge, tenant moins à être exact qu’à être loyal.
Vous pourrez aisément me tirer d’embarras en interrogeant Raphaël lui-même ou en lui écrivant. Et vous allez être obligé de le faire à cause d’un autre doute qui nous vient. Est-ce par ma faute, par la vôtre, par celle de Raphaël lui-même ? Je ne saurais le dire. Nous avons en effet négligé de lui demander, et il n’a pas pensé à nous dire, dans quelle partie du nouveau monde Utopie est située. Je donnerais beaucoup pour racheter cet oubli, car j’ai quelque honte à ignorer dans quelle mer se trouve l’île au sujet de laquelle j’ai tant à dire. D’autre part, un homme pieux de chez nous, théologien de profession, brûle, et il n’est pas le seul, d’un vif désir d’aller en Utopie. Ce qui l’y pousse n’est pas une vaine curiosité de voir du nouveau ; il souhaiterait encourager les progrès de notre religion qui se trouve là-bas heureusement implantée. Comme il désire le faire selon les règles, il a décidé de s’y faire envoyer par le Souverain Pontife et même à titre d’évêque des Utopiens, sans se laisser arrêter par le scrupule d’avoir à implorer cette prélature. Il estime en effet qu’une ambition est louable si elle est dictée, non par un désir de prestige ou de profit, mais par l’intérêt de la religion.
C’est pourquoi je vous requiers, mon cher Pierre, de presser Hythlodée, oralement si vous le pouvez aisément, sinon par lettres, afin d’obtenir de lui qu’il ne laisse subsister dans mon œuvre rien qui soit inexact, qu’il n’y laisse manquer rien qui soit véritable. Je me demande s’il ne vaudrait pas mieux lui faire lire l’ouvrage. S’il s’agit d’y corriger une erreur, nul en effet ne le pourra mieux que lui ; et il ne saurait s’en acquitter s’il n’a lu ce que j’ai écrit. De plus ce sera pour vous un moyen de savoir s’il voit d’un bon œil que j’aie composé cet écrit ou s’il en est mécontent. Car s’il a décidé de raconter lui-même ses voyages, il préfère peut-être que je m’abstienne. Et je ne voudrais certes pas, en faisant connaître l’État utopien, enlever à son récit la fleur et le prix de la nouveauté.
A vrai dire, je ne suis pas encore tout à fait décidé à entreprendre cette publication. Les hommes ont des goûts si différents ; leur humeur est parfois si fâcheuse, leur caractère si difficile, leurs jugements si faux qu’il est plus sage de s’en accommoder pour en rire que de se ronger de soucis à seule fin de publier un écrit capable de servir ou de plaire, alors qu’il sera mal reçu et lu avec ennui. La plupart des gens ignorent les lettres ; beaucoup les méprisent. Un barbare rejette comme abrupt tout ce qui n’est pas franchement barbare. Les demi-savants méprisent comme vulgaire tout ce qui n’abonde pas en termes oubliés. Il en est qui n’aiment que l’ancien. Les plus nombreux ne se plaisent qu’à leurs propres ouvrages. L’un est si austère qu’il n’admet aucune plaisanterie ; un autre a si peu d’esprit qu’il ne supporte aucun badinage. Il en est de si fermés à toute ironie qu’un persiflage les fait fuir, comme un homme mordu par un chien enragé quand il voit de l’eau. D’autres sont capricieux au point que, debout, ils cessent de louer ce qu’assis ils ont approuvé. D’autres tiennent leurs assises dans les cabarets et, entre deux pots, décident du talent des auteurs, prononçant péremptoirement condamnation au gré de leur humeur, ébouriffant les écrits d’un auteur comme pour lui arracher les cheveux un à un, tandis qu’eux-mêmes sont bien tranquillement à l’abri des flèches, les bons apôtres, tondus et rasés comme des lutteurs pour ne pas laisser un poil en prise à l’adversaire. Il en est encore de si malgracieux qu’ils trouvent un grand plaisir à lire une œuvre sans en savoir plus de gré à l’auteur, semblables à ces invités sans éducation qui, généreusement traités à une table abondante, s’en retournent rassasiés sans un mot de remerciement pour l’hôte. Et va maintenant préparer à tes frais un banquet pour des hommes au palais si exigeant, aux goûts si différents, doués d’autant de mémoire et de reconnaissance !
Entendez-vous avec Hythlodée, mon cher Pierre, au sujet de ma requête, après quoi je pourrai reprendre la question depuis le début. S’il donne son assentiment, puisque je n’ai vu clair qu’après avoir terminé ma rédaction, je suivrai en ce qui me concerne l’avis de mes amis et le vôtre en premier lieu.
Portez-vous bien, votre chère femme et vous, et gardez-moi votre amitié. La mienne pour vous ne fait que grandir.
Livre premier
L’invincible roi d’Angleterre, Henri, huitième du nom, prince d’un génie rare et supérieur, eut, il n’y a pas longtemps, un démêlé de certaine importance avec le sérénissime Charles, prince de Castille. Je fus alors député orateur en Flandre, avec mission de traiter et arranger cette affaire.
J’avais pour compagnon et collègue l’incomparable Cuthbert Tunstall, qui a été élevé depuis à la dignité de maître des Archives royales aux applaudissements de tous. Je ne dirai rien ici à sa louange. Ce n’est pas crainte qu’on accuse mon amitié de flatterie ; mais sa science et sa vertu sont au-dessus de mes éloges, et sa réputation est si brillante que vanter son mérite serait, comme dit le proverbe, faire voir le soleil une lanterne à la main.
Nous trouvâmes à Bruges, lieu fixé pour la conférence, les envoyés du prince Charles, tous personnages fort distingués. Le gouverneur de Bruges était le chef et la tête de cette députation, et George de Thamasia, prévôt de Mont-Cassel, en était la bouche et le cœur. Cet homme, qui doit son éloquence moins encore à l’art qu’à la nature, passait pour un des plus savants jurisconsultes en matière d’État ; et sa capacité personnelle, jointe à une longue pratique des affaires, en faisaient un très habile diplomate.
Déjà le congrès avait tenu deux séances, et ne pouvait convenir sur plusieurs articles. Les envoyés d’Espagne prirent alors congé de nous pour aller à Bruxelles, consulter les volontés du prince. Moi, je profitai de ce loisir, et j’allai à Anvers.
Pendant mon séjour dans cette ville, je reçus beaucoup de monde ; mais aucune liaison ne me fut plus agréable que celle de Pierre Gilles, Anversois d’une grande probité. Ce jeune homme, qui jouit d’une position honorable parmi ses concitoyens, en mérite une des plus élevées, par ses connaissances et sa moralité, car son érudition égale la bonté de son caractère. Son âme est ouverte à tous ; mais il a pour ses amis tant de bienveillance, d’amour, de fidélité et de dévouement, qu’on pourrait le nommer, à juste titre, le parfait modèle de l’amitié. Modeste et sans fard, simple et prudent, il sait parler avec esprit, et sa plaisanterie n’est jamais blessante. Enfin, l’intimité qui s’établit entre nous fut si pleine d’agrément et de charme, qu’elle adoucit en moi le regret de ma patrie, de ma maison, de ma femme, de mes enfants, et calma les inquiétudes d’une absence de plus de quatre mois.
Un jour, j’étais allé à Notre Dame, église très vénérée du peuple, et l’un de nos plus beaux chefs-d’œuvre d’architecture ; et après avoir assisté à l’office divin, je me disposais à rentrer à l’hôtel, quand tout à coup je me trouve en face de Pierre Gilles, qui causait avec un étranger, déjà sur le déclin de l’âge. Le teint basané de l’inconnu, sa longue barbe, sa casaque tombant négligemment à demi, son air et son maintien annonçaient un patron de navire.
A peine Pierre m’aperçoit-il qu’il s’approche, me tire un peu à l’écart alors que j’allais lui répondre et me dit en désignant son compagnon :
— Vous voyez cet homme ; eh bien ! j’allais le mener droit chez vous.
— Mon ami, répondis-je, il eût été le bienvenu à cause de vous.
— Et même à cause de lui, répliqua Pierre, si vous le connaissiez. Il n’y a pas sur terre un seul vivant qui puisse vous donner des détails aussi complets et aussi intéressants sur les hommes et sur les pays inconnus. Or, je sais que vous êtes excessivement curieux de ces sortes de nouvelles.
— Je n’avais pas trop mal deviné, dis-je alors, car, au premier abord, j’ai pris cet homme pour un patron de navire.
— Vous vous trompiez étrangement ; il a navigué, c’est vrai ; mais ce n’a pas été comme Palinure. Il a navigué comme Ulysse, voire comme Platon. Écoutez son histoire :
Raphaël Hythloday (le premier de ces noms est celui de sa famille) connaît assez bien le latin, et possède le grec en perfection. L’étude de la philosophie, à laquelle il s’est exclusivement voué, lui a fait cultiver la langue d’Athènes, de préférence à celle de Rome. Il n’ignorait pas qu’en cette matière les latins n’ont rien laissé d’important sauf quelques passages de Sénèque et de Cicéron. Le Portugal est son pays. Jeune encore, il abandonna son patrimoine à ses frères ; et, dévoré de la passion de courir le monde, il s’attacha à la personne et à la fortune d’Améric Vespuce. Il n’a pas quitté d’un instant ce grand navigateur, pendant les trois derniers des quatre voyages dont on lit partout aujourd’hui la relation. Mais il ne revint pas en Europe avec lui. Améric, cédant à ses vives instances, lui accorda de faire partie des vingt-quatre hommes qui restèrent lors du dernier voyage à Castel, le point le plus éloigné qu’atteignit l’expédition. Il fut donc laissé sur ce rivage, suivant son désir ; car notre homme ne craint pas la mort sur la terre étrangère ; il tient peu à l’honneur de pourrir dans un tombeau ; et souvent il répète cet apophtegme : Le cadavre sans sépulture a le ciel pour linceul ; partout il y a un chemin pour aller à Dieu. Ce caractère aventureux pouvait lui devenir fatal, si la Providence divine ne l’eût protégé. Quoi qu’il en soit, après le départ de Vespuce, il parcourut avec cinq de ses compagnons du Castel une foule de contrées, débarqua à Taprobane comme par miracle, et de là parvint à Calicut, où il trouva des vaisseaux portugais qui le ramenèrent dans son pays, contre toute espérance.
Dès que Pierre eut achevé ce récit, je lui rendis grâces de son obligeance et de son empressement à me faire jouir de l’entretien d’un homme extraordinaire ; puis j’abordais Raphaël, et après les saluts et compliments d’usage à une première entrevue, je le conduisis chez-moi avec Pierre Gilles. Là, nous nous assîmes dans le jardin, sur un banc de gazon, et la conversation commença.
Raphaël me dit d’abord comment, après le départ de Vespuce, lui et ses compagnons, par leur douceur et leurs bons offices, s’attirèrent l’amitié des indigènes, et comment ils vécurent avec eux en paix et dans la meilleure intelligence. Il y eut même un prince, dont le pays et le nom m’échappent, qui leur accorda la protection la plus affectueuse. Sa libéralité leur fournissait barques et chariots, et tout ce qu’il fallait pour continuer leur voyage. Un guide fidèle avait ordre de les accompagner et de les présenter aux autres princes avec d’excellentes recommandations.
Après plusieurs jours de marche, ils découvrirent des bourgs, des villes assez bien administrées, des nations nombreuses, de puissants États.
Sous l’équateur, ajoutait Hythloday, et de part et d’autre, dans l’espace compris par l’orbite du soleil, ils ne virent que des vastes solitudes éternellement dévorées par un ciel de feu. Là, tout les frappait d’horreur et d’épouvante. La terre en friche n’avait d’autres habitants que les bêtes les plus féroces, les reptiles les plus affreux ou des hommes plus sauvages que ces animaux. En s’éloignant de l’équateur, la nature s’adoucit peu à peu ; la chaleur est moins brûlante, la terre se pare d’une riante verdure, les animaux sont moins farouches. Plus loin encore, l’on découvre des peuples, des villes, des bourgs, où un commerce actif se fait par terre et par mer, non seulement dans l’intérieur et avec les frontières, mais entre des nations à grande distance.
Ces découvertes enflammaient l’ardeur de Raphaël et de ses compagnons. Et ce qui entretenait leur passion des voyages, c’est qu’ils étaient admis sans difficulté sur le premier navire en partance, quelle que fût sa destination.
Les premiers vaisseaux qu’ils aperçurent étaient plats, les voiles formées d’osiers entrelacés ou de feuilles de papyrus, et quelques-unes en cuir. Ensuite, ils trouvèrent des vaisseaux terminés en pointe, les voiles faites de chanvre ; enfin des vaisseaux entièrement semblables aux nôtres, et d’habiles nautoniers connaissant assez bien le ciel et la mer, mais sans aucune idée de la boussole.
Ces bonnes gens furent ravis d’admiration et pénétrés de la plus vive reconnaissance, quand nos compagnons du Castel leur montrèrent une aiguille aimantée. Avant, ils ne se livraient à la mer qu’en tremblant, et encore n’osaient-ils naviguer que pendant l’été. Aujourd’hui, la boussole en main, ils bravent les vents et l’hiver avec plus de confiance que de sûreté ; car, s’ils n’y prennent garde, cette belle invention, qui semblait devoir leur procurer tous les biens, pourrait devenir, par leur imprudence, une source de maux.
Je serais trop long si je rapportais ici tout ce que Raphaël a vu dans ses voyages. D’ailleurs, ce n’est pas le but de cet ouvrage. Peut-être compléterai-je son récit dans un autre livre, où je détaillerai principalement les mœurs, les coutumes et les sages institutions des peuples civilisés qu’il a visités.
Sur ces graves matières nous le pressions d’une foule de questions, et lui prenait plaisir à satisfaire notre curiosité. Nous ne lui demandions rien de ces monstres fameux qui ont déjà perdu le mérite de la nouveauté. Des Scylles, des Célènes, des Lestrigons mangeurs de peuples, et autres harpies de même espèce, on en trouve presque partout. Ce qui est rare, c’est une société sainement et sagement organisée.
A vrai dire, Raphaël remarqua chez ces nouveaux peuples des institutions aussi mauvaises que les nôtres ; mais il y a observé aussi un grand nombre de lois capables d’éclairer, de régénérer les villes, nations et royaumes de la vieille Europe.
Toutes ces choses, je le répète, feront le sujet d’un autre ouvrage. Dans celui-ci, je rapporterai seulement ce que Raphaël nous raconta des mœurs et des institutions du peuple utopien. Auparavant, je veux apprendre au lecteur de quelle manière la conversation fut amenée sur ce terrain.
Raphaël accompagnait son récit des réflexions les plus profondes. Examinant chaque forme de gouvernement, il analysait avec une sagacité merveilleuse ce qu’il y a de bon et de vrai dans l’une, de mauvais et de faux dans l’autre. A l’entendre discuter si savamment les institutions et les mœurs des différents peuples, il semblait qu’il eût vécu toute sa vie dans les lieux où il n’avait fait que passer. Pierre ne put contenir son admiration.
— En vérité, dit-il, mon cher Raphaël, je m’étonne que vous ne vous attachiez pas au service de quelque roi. Certes, il n’en est pas un qui ne trouvât en vous utilité et agrément. Vous charmeriez ses loisirs par votre connaissance universelle des lieux et des hommes, et une foule d’exemples que vous pourriez citer lui procurerait un enseignement solide et des conseils précieux. En même temps, vous feriez une brillante fortune pour vous et les vôtres.
— Je m’inquiète peu du sort des miens, reprit Hythloday. Je crois avoir passablement rempli mon devoir envers eux. Les autres hommes n’abandonnent leurs biens que vieux et à l’agonie, et encore lâchent-ils en pleurant ce que leur main défaillante ne peut plus retenir. Moi, plein de santé et de jeunesse, j’ai tout donné à mes parents et à mes amis. Ils ne se plaindront pas, j’espère, de mon égoïsme ; ils n’exigeront pas que, pour les gorger d’or, je me fasse esclave d’un roi.
— Entendons-nous, dit Pierre, je ne voulais pas dire que vous deviez vous asservir aux rois, mais leur rendre service.
— Les princes, mon ami, y mettent peu de différence ; et, entre ces deux mots latins servire et inservire, ils ne voient qu’une syllabe de plus ou de moins.
— Appelez la chose comme il vous plaira, répondit Pierre ; c’est le meilleur moyen d’être utile au public, aux individus, et de rendre votre condition plus heureuse.
— Plus heureuse, dites-vous ! et comment ce qui répugne à mon sentiment, à mon caractère ferait-il mon bonheur ? Maintenant, je suis libre, je vis comme je veux, et je doute que beaucoup de ceux qui revêtent la pourpre puissent en dire autant. Assez de gens ambitionnent les faveurs du trône ; les rois ne s’apercevront pas du vide, si moi et deux ou trois de ma trempe manquons parmi les courtisans.
Alors, je pris ainsi la parole :
— Il est évident, Raphaël, que vous ne cherchez ni la fortune, ni le pouvoir, et, quant à moi, je n’ai pas moins d’admiration et d’estime pour un homme tel que vous que pour celui qui est à la tête d’un empire. Cependant, il me semble qu’il serait digne d’un esprit aussi généreux, aussi philosophe que le vôtre, d’appliquer tous ses talents à la direction des affaires publiques, dussiez-vous compromettre votre bien-être personnel ; or, le moyen de le faire avec le plus de fruit, c’est d’entrer dans le conseil de quelque grand prince ; car je suis sûr que votre bouche ne s’ouvrira jamais que pour l’honneur et pour la vérité. Vous le savez, le prince est la source d’où le bien et le mal se répandent comme un torrent sur le peuple ; et vous possédez tant de science et de talents que, n’eussiez-vous pas l’habitude des affaires, vous seriez encore un excellent ministre sous le roi le plus ignorant.
— Vous tombez dans une double erreur, cher Morus, répliqua Raphaël ; erreur de fait et de personne. Je suis loin d’avoir la capacité que vous m’attribuez ; et quand j’en aurais cent fois davantage, le sacrifice de mon repos serait inutile à la chose publique.
D’abord, les princes ne songent qu’à la guerre (art qui m’est inconnu et que je n’ai aucune envie de connaître). Ils négligent les arts bienfaisants de la paix. S’agit-il de conquérir de nouveaux royaumes, tout moyen leur est bon ; le sacré et le profane, le crime et le sang ne les arrêtent pas. En revanche, ils s’occupent fort peu de bien administrer les États soumis à leur domination.
Quant aux conseils des rois, voici à peu près leur composition :
Les uns se taisent par ineptie, ils auraient eux-mêmes grand besoin d’être conseillés. D’autres sont capables, et le savent ; mais ils partagent toujours l’avis du préopinant qui est le plus en faveur, et applaudissent avec transport aux plates sottises qu’il lui plait de débiter ; ces vils parasites n’ont qu’un seul but, c’est de gagner par une basse et criminelle flatterie, la protection du premier favori. Les autres sont les esclaves de leur amour-propre, et n’écoutent que leur avis ; ce qui n’est pas étonnant ; car la nature inspire à chacun de caresser avec amour les produits de son invention. C’est ainsi que le corbeau sourit à sa couvée, et le singe à ses petits.
Qu’arrive-t-il donc au sein de ces conseils, où règnent l’envie, la vanité et l’intérêt ? Quelqu’un cherche-t-il à appuyer une opinion raisonnable sur l’histoire des temps passés, ou les usages des autres pays ? Tous les auditeurs en sont comme étourdis et renversés ; leur amour-propre s’alarme, comme s’ils allaient perdre leur réputation de sagesse, et passer pour des imbéciles. Ils se creusent la cervelle, jusqu’à ce qu’ils aient trouvé un argument contradictoire, et si leur mémoire et leur logique sont en défaut, ils se retranchent dans ce lieu commun : « Nos pères ont pensé et fait ainsi ; eh ! plût à Dieu que nous égalions la sagesse de nos pères ! » Puis ils s’assoient en se rengorgeant, comme s’ils venaient de prononcer un oracle. On dirait, à les entendre, que la société va périr, s’il se rencontre un homme plus sage que ses ancêtres. Cependant, nous restons froids, en laissant subsister les bonnes institutions qu’ils nous ont transmises ; et quand surgit une amélioration nouvelle, nous nous cramponnons à l’antiquité, pour ne pas suivre le progrès. J’ai vu presque partout de ces jugeurs moroses, absurdes et fiers. Cela m’arriva une fois en Angleterre…
— Pardon, dis-je alors à Raphaël, vous auriez été en Angleterre ?
— Oui, j’y ai séjourné quelques mois, peu après la guerre civile des Anglais occidentaux contre le roi, guerre qui se termina par un affreux massacre des insurgés. Pendant ce temps, je contractai de grandes obligations envers le très révérend père Jean Morton, cardinal-archevêque de Canterbury, et chancelier d’Angleterre.