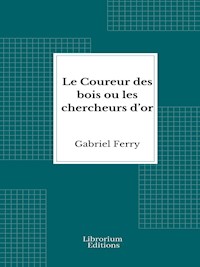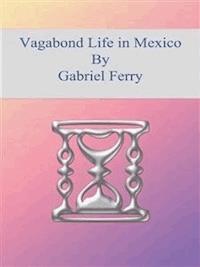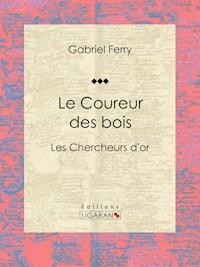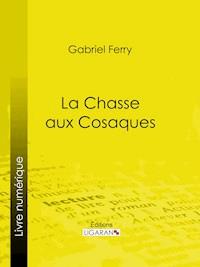
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le romancier aurait mauvaise grâce à afficher les allures de l'historien ; toutefois il est certains faits peu connus d'une époque, il est quelques types que l'histoire a relégués dans l'ombre, et que le conteur peut ramasser, comme fait le glaneur des épis que le moissonneur a dédaignés. Dans le crépuscule du soir d'une société qui finit, dans le crépuscule matinal d'une société qui commence..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
(Le Chant du Cosaque. – BÉRANGER.)
Le romancier aurait mauvaise grâce à afficher les allures de l’historien ; toutefois il est certains faits peu connus d’une époque, il est quelques types que l’histoire a relégués dans l’ombre, et que le conteur peut ramasser, comme fait le glaneur des épis que le moissonneur a dédaignés. Dans le crépuscule du soir d’une société qui finit, dans le crépuscule matinal d’une société qui commence ; au milieu des débris vivaces encore du passé, et des aspirations nouvelles vers l’avenir ; au milieu des ténèbres qui couvrent encore le monde depuis soixante ans, réunir ces faits, éclairer ces types d’un jour éclatant et véritable, est encore une assez belle tâche que l’histoire laisse au romancier.
Moscou fumait encore ; la retraite était commencée ; la grande armée, ainsi qu’un vaisseau battu par le vent et la lame qui le brise pièce à pièce et jonche la mer de ses épaves, la Grande-Armée, décimée par le froid et la faim, semait chaque jour de ses débris la merde neige qu’elle traversait. Officiers et soldats se répandaient dans toutes les directions à la recherche de quelques vivres ou de provisions de bois. Mais de tous ces innombrables maraudeurs, le plus petit nombre parvenait seul, après des fatigues inouïes, à rejoindre le gros de l’armée ; la plupart, dans ces excursions entreprises au hasard, trouvaient la mort sous la lance des Cosaques ou succombaient sous les cruelles atteintes d’un hiver exceptionnel.
C’était dans les premiers jours de décembre 1812. Une des plaines qui s’étendait en deçà de la Bérézina, présentait un affreux aspect de misère et de désolation. La neige tombait à flocons pressés ; un vent d’ouest soulevait et agitait comme un linceul la nappe blanche étendue sur la terre durcie. Des débris informes jonchaient le sol de tous côtés ; et dans ces débris, à peine reconnaissait-on, sous la neige qui s’amoncelait d’instant en instant, des cadavres d’hommes et de chevaux, des canons sans affût et des ferrements de caissons.
La plaine n’était cependant pas encore déserte ; au milieu des rafales neigeuses, erraient des soldats qui n’avaient plus forme humaine. C’était comme une procession de fantômes, marchant à la suite les uns des autres, à travers la brume opaque de l’atmosphère.
Parmi ces pâles vivants qui cherchaient un asile et du pain, deux personnages se remarquaient par l’impassibilité ou l’abattement qu’ils montraient devant la souffrance. La nuit commençait à obscurcir l’horizon. Étendus tous les deux sur la terre, à l’abri d’un mur à moitié écroulé, au pied duquel s’élevait un sapin, et à quelques pas des ruines noircies d’une masure, ils semblaient ne pas se préoccuper du surcroît de dangers qu’allaient leur apporter les ténèbres, en amenant des bandes de loups dans la plaine.
Les branches du sapin ployaient sous le poids de la neige qui retombait en cascade sur les deux hommes immobiles, sans qu’ils parussent s’en apercevoir. Des lambeaux d’uniforme laissaient deviner qu’ils appartenaient à une arme différente, mais ne permettaient pas de préciser le corps dont ils faisaient partie. Le seul point de ressemblance qui leur fût commun consistait, malgré la différence de leur taille et de leur âge, dans un air de famille qui trahissait en eux deux hommes issus d’un même sang. C’étaient en effet deux frères : l’aîné, âgé d’environ trente-cinq ans, était taillé en Hercule ; le second, plus jeune de dix ans, offrait dans sa stature la même disproportion que dans son âge.
Le premier, disons-le tout d’abord, servait dans les grenadiers à cheval de la garde impériale ; c’était un de ces soldats éprouvés qui semblent se rire de la fureur des hommes et de l’intempérie des climats ; le second faisait, dans les vélites de la jeune garde, le rude apprentissage de la carrière militaire. Par-dessus les lambeaux de leurs uniformes, les deux frères étaient couverts de peaux de mouton noires, provenant du harnachement de chevaux de hussards.
La figure bronzée par le soleil d’Égypte et d’Italie du grenadier de la garde conservait encore sous le givre et les glaçons dont sa longue moustache et sa barbe épaisse étaient hérissées, la fierté de ces rudes conquérants qui avaient fait le tour de l’Europe et campé dans toutes ses capitales. Le jeune vélite, les yeux hagards et la figure amaigrie, paraissait prêt à succomber à l’asphyxie par le froid.
L’état de fatigue et d’épuisement des deux infortunés frères était tel, que ni l’un ni l’autre ne s’apercevaient que peu à peu la neige les enveloppait comme un suaire.
L’aîné des deux frères, toujours maître de sa volonté, feignait une immobilité voisine de la mort, pour ne pas attirer sur lui l’attention de ces soldats-fantômes errant encore dans le voisinage et qui n’étaient pas moins à craindre parfois que les Russes eux-mêmes, car il avait un trésor à dérober à tous les regards.
Quant au vélite de la jeune garde, il dormait en réalité, et cette nuit-là, précisément, il rêvait du foyer maternel.
Les derniers des rôdeurs attardés regardaient, en passant, les deux frères immobiles. Le désir de s’emparer des chaudes chabraques dont ils étaient recouverts brillait dans leurs yeux ; mais l’un d’eux s’écria, d’une voix rauque :
– C’est le colonel de Vauvrecy qui a retrouvé son frère ! passons : ce géant, s’il est vivant encore, nous tuerait si nous osions toucher à l’enfant.
Tous passèrent, et quand le dernier de ces spectres eut disparu dans l’ombre du crépuscule, le colonel se dressa lentement comme un gigantesque trépassé qui se lèverait de sa couche froide. Après s’être assuré qu’il était bien seul, il secoua la neige amoncelée sur lui, puis, avant que la nuit n’amenât ses ténèbres, il se hâta de jeter un regard sur son frère pour s’assurer s’il ne dormait pas de ce sommeil léthargique, précurseur de la mort, quand on s’y abandonne sur la neige. Aux yeux fermés du jeune homme, à sa respiration lente et pénible, le colonel comprit qu’il était réellement endormi du sommeil qu’il redoutait pour lui.
Un regard, empreint d’un indicible sentiment de tendresse paternelle jaillit de ses yeux. Un lourd silence régnait dans ces solitudes où la bise glaciale modulait seule des notes lugubres à travers le branchage des sapins. Les lèvres du grenadier laissèrent échapper des mots entrecoupés :
– Cinq jours, cinq longs jours, murmurait-il, sans feu, presque sans vêtements !… verrons-nous le sixième se lever ? Oh ! ma mère, si votre pauvre André n’était pas avec moi… je voudrais mourir ici. André, répéta-t-il, en secouant son frère, nous sommes seuls, nous allons pouvoir enfin manger et nous chauffer.
André ne répondit pas ; alors le colonel le prit dans ses bras, et l’adossa contre le tronc de l’arbre ; mais la vie semblait avoir abandonné le jeune vélite. Cependant, une rafale de neige vint frapper son visage de ses pointes aiguës, et André entrouvrit enfin les yeux.
– Ah ! dit-il à son frère, pourquoi m’avoir éveillé ? Je rêvais de ma mère.
– C’est justement pour que tu puisses encore dormir sous son toit que je t’arrache maintenant aux dangers du sommeil…
Le vélite suivit d’un air troublé les mouvements de son frère : il devinait plutôt qu’il ne distinguait ce que faisait le grenadier. Il le vit écarter la couche de neige qui couvrait le sol, en retirer quelques débris de planches arrachées aux ruines de la cabane voisine, ainsi qu’un peu de paille humide ; puis il entendit le grincement d’un briquet contre la pierre à feu et aperçut une gerbe d’étincelles.
Pendant ces préparatifs, la nuit était close, sombre et lugubre ; le vent d’ouest faisait rage ; les sapins craquaient et semblaient hurler comme une bande de loups. Les deux fugitifs prirent, quelques secondes, ces bruits étranges pour l’harmonie nocturne de ces déserts.
– Sont-ce les loups qui hurlent ainsi ? dit enfin à voix basse André, qui retrouva devant le danger sa présence d’esprit.
– Non, répondit le colonel, pour ne point effrayer son frère, et tout en portant sa main à un poignard caché dans sa ceinture, ce sont les modulations du vent d’orage qui font cet horrible vacarme.
– C’est étrange !… Je crois que tu te trompes !…
C’étaient, en effet, les loups qui faisaient sur les champs de neige une large curée des cadavres qui s’y trouvaient à moitié ensevelis. Bientôt le doute ne fut plus possible aux fugitifs ; ils entendirent les griffes des voraces animaux grattant le manteau blanc et dur dont la terre était couverte, et ils aperçurent leurs prunelles ardentes luire dans les ténèbres.
– J’aime mieux les loups que les Cosaques, s’écria le colonel, renonçant à tromper plus longtemps son frère. Ceux-là, du moins, n’en veulent qu’aux morts.
En disant ces mots, il continua à faire jaillir des gerbes d’étincelles à l’aide de son briquet ; mais l’amadou, dont un heureux hasard l’avait rendu possesseur, imprégné d’humidité, subissait sans s’allumer le contact du feu.
– Le pauvre diable de soldat du train, dont je me suis trouvé légataire universel, m’a fait dans ce briquet et ces ustensiles un triste cadeau, – continua-t-il avec une gaîté feinte et bien éloignée de son cœur ; – j’aurais dû n’accepter cette succession que sous bénéfice d’inventaire.
André essaya de sourire ; mais outre le froid qui le torturait, il avait pour le moment un terrible sujet d’appréhension. Malgré l’obscurité du ciel, le tapis de neige renvoyait une terne clarté qui lui avait permis d’apercevoir une demi-douzaine de loups s’avancer près du sapin contre lequel il était adossé.
Vauvrecy, tout absorbé par ses efforts pour enflammer l’amadou qu’il tenait en main, ne prêtait nulle attention à ce qui se passait autour de lui.
Cependant un loup d’une taille démesurée, qui précédait les autres, s’approcha assez pour qu’on pût distinguer le feu sinistre de ses yeux, et entendre le souffle de ses naseaux qui flairaient la neige. De tous les points de la plaine des hurlements plaintifs arrivaient par bouffées sur les ailes du vent.
– C’est comme à Eylau, murmura le colonel, toute la nuit les loups ont hurlé sur le champ de bataille.
– Ils sont là, dit André d’une voix étouffée. Regarde.
Le colonel cessa de battre le briquet, et n’eut pas besoin de chercher longtemps des yeux pour voir l’animal, dont la formidable stature se détachait sur la blancheur de la neige.
– Diable, dit Pierre à voix basse, celui-ci préfère peut-être les vivants aux morts. – Tâche d’être plus heureux que moi, continua-t-il en remettant entre les mains d’André le briquet et l’amadou, pendant ce temps je vais faire la garde. Aie soin de te tourner du côté de cette bête féroce pour l’effrayer, s’il est possible, par la lueur des étincelles.
Le grenadier tira de dessous sa peau de mouton noire un poignard affilé suspendu à une corde.
– Ce poignard, qui ne me quitte jamais, dit-il à son frère, est ce que nos ancêtres appelaient le poignard de merci. L’un de nos aïeux le portait à la bataille de Poitiers.
Le colonel, entourant son bras gauche de la chabraque, s’avança de quelques pas vers l’animal ; le loup ne bougea pas, et fit entendre un grognement de colère, suivi du bruit de ses mâchoires qu’il faisait retentir l’une contre l’autre.
André, lui, essayait de battre le briquet mais ses mains engourdies par le froid, lui refusaient presque service. Néanmoins quelques rares étincelles jaillirent dans les ténèbres. Le loup était toujours à la même place, roulant ses prunelles flamboyantes, de droite et de gauche, et André entendit Pierre murmurer :
– Il faut en finir avec cette bête qui sert probablement d’éclaireur à une bande. Un quart d’heure de plus passé sans feu, et peut-être sera-t-il trop tard pour sauver André !…
– Pierre ! cria le vélite, je t’en conjure, reviens, je ferai la garde pour nous deux…
Mais Pierre n’écouta pas la voix de son frère, il n’écouta que son désir de réchauffer au plus vite le corps glacé du pauvre enfant et il continua d’avancer vers le monstrueux animal. Celui-ci reculait à mesure que le grenadier gagnait du terrain ; mais tout en reculant, il ne fuyait pas.
André perdit presque de vue la haute taille de son frère, qui marchait le poignard à la main droite et le bras gauche en avant.
Au moment où il lui criait de nouveau de revenir, un long hurlement couvrit sa voix. Pierre se courba presque jusqu’à terre et se releva portant le terrible animal cramponné à son bras gauche.
Un instant après, un hurlement de douleur se mêla aux sifflements du vent, et une masse noire retomba sur le tapis de neige ; presqu’aussitôt des cris lointains retentirent, tandis que l’animal agonisant se tordait sur le sol blanchi. C’était la voix des loups fuyant épouvantés de la mort de celui qui les guidait.
Pierre ne tarda pas à rejoindre son frère ; d’une main il tenait son poignard rougi de sang, et de l’autre l’animal qu’il venait d’achever.
– Pierre, Pierre, es-tu blessé ? s’écrie André.
– Pas le moins du monde ; les crocs de l’animal se sont enfoncés dans l’épaisse toison qui couvrait mon bras gauche, dont ils ont à peine entamé la chair. Voici, grâce à Dieu, dans ma chasse de quoi remplacer avantageusement le quartier de cheval gelé que j’ai enterré sous la neige. Tiens, mon pauvre André, réchauffe-toi un peu au contact de ce qui reste de chaleur à la bête que voici.
Le colonel, tout en parlant ainsi, étendit comme un édredon, sur les pieds endoloris de son frère, le corps de l’animal encore chaud, et André, sans penser que le colonel soutirait autant que lui, goûta seul un léger soulagement que son généreux frère eût pu payer de sa vie.
Cependant, après des efforts inouïs pour combattre l’humidité de l’amadou d’abord et de la paille ensuite, le colonel finit par allumer le feu qu’il désirait si fort.
Dans cet intervalle, le froid avait gagné des pieds du vélite jusqu’à son cœur ; sa vue se troublait, et, au moment où une légère clarté du soir brilla au milieu de l’obscurité, il se sentit défaillir.
– Pierre, dit-il d’une voix presque inintelligible, cette fois… tout est fini… je me meurs !…
Le grenadier trembla de tous ses membres aux paroles d’André ; alors il le saisit comme une mère prend son enfant, et l’exposa peu à peu au voisinage du foyer, tout en massant vigoureusement de la paume de sa main ses membres inertes.
Le jeune homme poussa un soupir de satisfaction et de bien-être, mais le colonel ne put se refuser à une terrible évidence : c’est que le froid, la fatigue et les privations avaient brisé presque sans retour le corps si frêle et si délicat de son frère.
Le grenadier le considéra pendant quelques secondes avec l’expression d’un navrant désespoir, puis tout à coup prenant son parti, et obéissant à une pensée de dévouement sublime, quand les liens du sang et de l’amitié étaient brisés entre tous les malheureux qui disputaient leurs jours aux neiges de la Russie, le colonel se dépouilla de la peau de mouton qui l’abritait, l’ajouta à celle qui déjà couvrait son frère, et resta frémissant sous la bise glaciale qui secouait les lambeaux de sa chemise et ouvrait dans sa peau nue de saignantes crevasses. Sa mâle et rude figure se leva résignée vers le ciel qui s’assombrissait de plus en plus : il pria pour André.
Pendant que des deux frères, l’un invoquait la bonté divine et l’autre mourait lentement, une vapeur sombre et glacée paraissait joindre le ciel et la terre. L’immense nappe neigeuse était déserte, et les rafales impétueuses du vent sifflaient lugubrement dans les sapins. Après avoir prié en silence, le colonel jeta un morne coup d’œil sur cet océan aux vagues éblouissantes ; quant à André, une espèce de vertige lui montait au cerveau et le sauvait des tortures de l’agonie.
Le grenadier avait enseveli sous la neige un lambeau de chair de cheval, et c’était pour conserver ce précieux trésor qu’il avait feint de dormir pendant que ses compagnons, hâves et décharnés, erraient autour de lui. Le loup qu’il venait de tuer remplaçait alors avec avantage sa hideuse réserve. À l’aide de son poignard, il détacha un quartier de l’animal, dont le froid commençait à roidir le corps, et en jeta sur les charbons un morceau tout saignant.
Quand la chair eut pétillé quelque temps au contact du feu, et qu’elle offrit enfin l’aspect d’une cuisson imparfaite, le colonel, avant d’en porter à ses lèvres un seul morceau, songea de nouveau à son frère.
– Allons, André lui dit-il, voici, grâce à Dieu, de quoi nous refaire pour cette nuit ; prends et mange, tes forces ne tarderont pas à revenir.
Le jeune vélite fit un mouvement pour obéir, mais sa tête retomba contre le tronc de sapin.
– Je n’ai plus besoin de rien, murmura-t-il ; je n’irai pas plus loin, je veux mourir ici.
– Corbleu ! je veux mourir ici ! c’est bientôt dit, reprit le grenadier d’un, ton d’affectueux reproche. Un soldat n’a pas le droit de disposer ainsi de lui, il appartient à son drapeau.
Allons ! du courage, voici une grillade de loup comme peu en auront mangé dans leur vie, et qui nous donnera des forces pour rejoindre l’armée.
Le grenadier, donnant l’exemple à son frère, avala un morceau de chair calcinée ; puis il essaya d’en introduire dans la bouche d’André.
Le jeune vélite écarta sa main.
– Je n’ai qu’envie de dormir, dit-il d’un ton douloureux. Ah ! comme je m’étendrais bien sur cette neige !
– Pour ne plus te relever, malheureux ! Cette faiblesse équivaudrait à une désertion et te déshonorerait !…
André fit un geste de dédain.
– Mais ton drapeau c’est la vie, s’écria énergiquement le grenadier ; sous son ombre nous retrouverons le feu du bivouac, des vivres, de la gloire ! Tiens, vois-tu, André, j’ai visité en vainqueur Rome, Berlin, Vienne et Moscou ; je ne crois pas que Moscou soit la dernière de mes triomphantes étapes ! n’y a-t-il pas encore Londres qui nous reste à voir ?
Mais l’enthousiasme du soldat vainqueur de l’Europe ne suffit pas pour rappeler chez son frère la vie qui s’éteignait. Un faible sourire, pâle comme le soleil de ces affreux climats, et un frisson d’angoisse furent son unique réponse.
La neige tombait toujours à flocons pressés, et le vent dont le souffle dispersait une armée naguère si puissante, rasait avec des sifflements tantôt sourds, tantôt aigus, la plaine déserte et glacée.
Le grenadier approcha de nouveau son frère du triste foyer qui ne projetait déjà plus qu’une lueur mourante.
Pour rendre aux membres du jeune vélite la circulation du sang que le froid figeait dans ses veines, il frappa du fourreau de cuir de son sabre, doucement d’abord, puis bientôt plus rudement, ses jambes, sa poitrine et ses bras. Cet exercice, tout en entretenant la chaleur qui commençait à s’épuiser aussi dans le corps presque nu du colonel, rendit quelque vigueur au jeune soldat que la mort envahissait graduellement. Alors le grenadier lui présenta de nouveau un lambeau de la chair du loup. Le vélite essaya d’obéir à la volonté de son frère, mais ses muscles roidis se refusèrent à le servir.
– André, André, tu ne reverras plus ta mère, si tu ne manges pas, dit le colonel d’une voix lente. Que lui répondrai-je quand elle me demandera : Pierre, qu’avez-vous fait de votre frère, que vous aviez promis de ramener ? Pourquoi êtes-vous revenu sans lui ?
– Ma mère ! murmura André avec émotion. Pauvre mère !… Eh bien ! tu lui diras que j’ai voulu mourir ici !… Oh ! je t’en conjure, laisse-moi dormir !… c’est une si bonne chose que le sommeil !
– André, reprit le colonel, ta mère n’aura plus de fils, car je ne compte pas à ses yeux. Depuis quinze ans n’a-t-elle pas fait son deuil de l’aîné de ses enfants ? Elle sait bien qu’un jour ou l’autre, il doit tomber sur un champ de bataille ! André, n’entends-tu pas la voix de ta mère qui t’appelle !
– Je n’entends que les rugissements du vent qui me tue, répondit le jeune soldat.
– Tu veux mourir ! reprit le colonel. Eh bien ! soit ; mourons ensemble !…
Le colonel, après avoir dit ces mots, s’étendit sur la neige, à côté d’André, et resta immobile comme un cadavre.
Ce spectacle rendit au jeune vélite une fugitive énergie : il essaya de se lever, et tendant à son frère sa main glacée :
– Marchons, lui dit-il.
– Bien, André, reprit le grenadier, – il y a souvent plus de courage à fuir la mort qu’à l’attendre. Je savais bien que tu n’étais pas un lâche. Mais pour reprendre les forces nécessaires, il faut manger. Si tu le voulais nous pourrions faire bien du chemin d’ici au jour.
Tandis que ranimé par les paroles de son frère, André prenait un peu de nourriture et que le colonel battait de ses bras sa robuste poitrine pour rappeler la chaleur qui le fuyait, les nuages en s’écartant laissèrent tomber quelques rayons de la lune sur la plaine blanchie.
Tout à coup des ombres noires et lointaines se dessinèrent sur la nappe éblouissante de neige qui s’étendait en longues ondulations.
– Les Cosaques ! dit le colonel d’une voix sourde et en se jetant précipitamment sur le brasier à moitié consumé qu’il acheva d’éteindre sous le poids de son corps.
En effet, à la vitesse désordonnée avec laquelle trois cavaliers, coiffés de bonnets pointus et montés sur de petits chevaux, se mouvaient sur la surface de la plaine, aux éclairs que la lune laissait tomber sur le fer de leurs lances, il était impossible de ne pas reconnaître en eux des maraudeurs Cosaques, plus redoutables que les loups.
Couchés à plat-ventre derrière le tronc du sapin, le grenadier et le vélite observaient avec une anxiété croissante les mouvements de ces impitoyables ennemis. Ils les virent fouiller de la pointe de leurs lances les monceaux de neige qui leur paraissaient suspects ; descendre plusieurs fois de leur selle, s’accroupir, comme les loups, sur les cadavres pour les dépouiller ; s’éloigner, revenir sur leurs pas, puis enfin disparaître derrière un pli de terrain. Quelque temps encore le vent apporta aux oreilles des fugitifs le bruit de leurs voix et les hennissements de leurs chevaux.
Le peu de force qu’avait reconquis le jeune homme s’était dissipé pendant les mortels instants qu’avait duré cette scène, lorsque, tout à coup, les trois cavaliers surgirent de nouveau au sommet d’une éminence. Cette fois, ils semblaient se diriger du côté de Pierre et d’André.
Cette nouvelle émotion acheva de briser le vélite, qui retomba dans l’état d’hallucination dont son frère avait eu tant de peine à le retirer. Toutefois, le pauvre enfant conservait le sentiment du danger qu’il courait.
– André, m’entends-tu ? dit le grenadier.
André fit un signe d’affirmation.
– Jette tes bras autour de mon cou, reprit Pierre en s’agenouillant.
Le vélite obéit machinalement. Alors le colonel passa ses bras sous les jambes de son frère, et l’enlevant de terre il s’éloigna du bivouac le plus rapidement qu’il lui fut possible ; il espérait, à la faveur des troncs espacés des sapins, parvenir à s’éloigner sans être aperçu. La lune qui de nouveau s’était voilée, laissait une chance de succès à cette tentative.
Le colonel, après avoir marché pendant quelques minutes, tourna la tête ; il ne vit rien dans l’allure des trois cavaliers qui fût de nature à lui faire craindre d’avoir été découvert ; ils semblaient poursuivre insoucieusement leur marche. Un instant rassuré, le grenadier redoubla de vitesse et d’efforts. Le poids même dont il était chargé, en réchauffant ses membres roidis, leur donnait une vigueur nouvelle.
André de son côté, ranimé par les secousses que le pas saccadé de son frère communiquait à tout son corps, retrouva la parole ; seulement, il était évident, aux mots entrecoupés qu’il laissait tomber de sa bouche, que la conscience de sa position lui échappait en partie.
Tout à coup, les trois cavaliers s’arrêtèrent et parurent se consulter. Quoique séparés par une assez grande distance des deux fugitifs, ils venaient, grâce à leur vue perçante, de distinguer sur le tapis de neige une masse noire qui se mouvait rapidement. Un des Cosaques se dirigea vers les deux frères !
– Pierre, disait en ce moment le jeune vélite, tu me conduis vers ma mère, n’est-ce pas ? Tu me conduis aussi vers celle que j’aime !…
André comprit confusément qu’il aurait dû retenir les cruelles paroles qui faisaient allusion à des évènements passés ; mais une force irrésistible le poussait. Au nom qu’il ajouta tout bas, il sentit son frère tressaillir sous lui.
– Elle ne m’aimait pas, moi, continua-t-il, car elle n’aimait que la gloire… c’est pour elle que j’ai voulu en acquérir aussi ! Dois-je donc mourir… oublié… inconnu ? Dieu me punirait-il d’avoir voulu supplanter mon frère dans le cœur d’Alexandrine… car elle te préférait… Pierre !… l’œil de la jalousie voit tout.
À cette révélation inattendue, une lueur terrible brilla subitement dans les yeux du colonel. Un instant le puissant colosse chancela. Mais c’était une de ces nobles natures que les sacrifices les plus pénibles trouvent toujours prêtes à les accepter.
– Ne crains rien, André, s’écria-t-il, tu échapperas à cet affreux désastre, tu seras de ceux que les femmes admireront à leur retour, car les vaincus de Moscou reviendront chargés de plus de gloire que jamais n’en acquirent des vainqueurs. Elle t’aimera. Allons, du courage !
Pierre n’acheva pas ; il venait d’apercevoir les Cosaques. La neige durcie craquait derrière eux, l’ennemi s’avançait : André, obéissant à l’hallucination qui le dominait, chantait à voix basse une de ces mélopées plaintives à l’aide desquelles les mères ont l’habitude de bercer leurs nourrissons.
En ce moment les deux frères atteignaient un taillis de jeunes sapins qui s’étendait le long d’un ravin.
Devant eux la nappe blanche de la neige se déroulait à leurs yeux comme un vaste linceul tendu par la main de Dieu pour y ensevelir la grande armée tout entière.
Le grenadier côtoyait alors les bords du précipice, cherchant un endroit pour le franchir, quand tout à coup une voix rude gronda derrière lui, un choc violent le jeta sur la terre, et André lâchant les bras dont il l’entourait, glissa dans le ravin dont la neige se referma sans bruit au-dessus de sa tête.
Le choc violent qui achevait de terrasser le colonel, était produit par le cheval d’un des Cosaques lancé sur lui à toute vitesse.
Avant que Vauvrecy, dont le front heurta la neige durcie, eût pu se reconnaître, trois Cosaques s’étaient précipités sur lui, et quand il se releva il était seul, prisonnier et désarmé. Pierre, au milieu des impitoyables ennemis qui venaient de le surprendre, jeta autour de lui un coup d’œil désespéré. André n’était plus là, il comprit que son frère dormait à jamais dans son cercueil de neige. De grosses larmes roulèrent sur sa figure, et il resta un instant immobile comme s’il eût été atteint par la foudre !
– Marche ! cria brutalement un Cosaque placé derrière lui.
Dans toute autre circonstance, Vauvrecy eût deviné cet ordre, au geste impérieux qui l’accompagna ; mais l’infortuné était en ce moment accablé par la mort de son frère, et il n’avait plus pour ainsi dire la conscience de son être.
Alors, comme si le malheureux devait épuiser à la fois toutes les douleurs, le fouet que tenait à la main l’un des cavaliers cosaques s’abattit en sifflant sur les épaules du colonel, et un sillon sanglant se dessina sur sa chair nue. Un second coup répéta bientôt sur son front le stigmate imprimé à ses épaules.
Le knout d’un vil Cosaque outrager ainsi l’un des guerriers vainqueurs de l’Europe ! l’un de ceux que l’on voyait souvent traiter d’égal à égal avec les rois, s’asseoir même sur leurs trônes ! On eût pu s’attendre à une colère de lui, il n’en fut rien ! le visage du colonel resta impassible ; seulement, ses yeux exprimèrent une haine si implacable, qu’ils eussent fait pâlir ceux qui l’outrageaient s’ils en avaient surpris le regard. Un vague espoir soutenait Vauvrecy. Il comprit qu’il valait mieux obéir que se faire tuer sans espérance de se venger jamais, et il ne se retourna même pas vers le ravin qui avait englouti son frère bien aimé.
Le grenadier marcha comme un esclave devant les chevaux des Cosaques ; il n’avait plus faim, il n’avait plus froid. Le front baissé, les flancs haletants et les pieds déchirés, le soldat continua, pendant une heure à peu près, d’avancer en silence. De temps en temps seulement, il levait vers le ciel son mâle visage. Il enregistrait dans sa mémoire un effroyable serment.
Quelques feux visibles dans l’éloignement indiquèrent la présence d’un groupe de pauvres huttes perdues dans ce désert de neige. Les cavaliers et le fugitif ne tardèrent pas à atteindre cet endroit : les Cosaques mirent pied à terre devant une misérable cabane.
Le colonel exténué de faim, de fatigue et de froid, espéra trouver enfin quelque adoucissement momentané à ses cruelles souffrances : car des chaudières bouillantes placées sur des brasiers ardents laissaient échapper une vapeur aromatique de viandes.
Vain espoir ! À peine les Cosaques furent-ils descendus de cheval qu’ils lièrent fortement les bras de Vauvrecy le long de son corps, puis après l’avoir ainsi garrotté, ils l’attachèrent par l’extrémité de la corde à l’un des poteaux qui s’élevaient devant la cabane. Cette corde était suffisamment longue pour permettre au prisonnier de s’approcher du foyer de l’intérieur.
Mais quand, succombant aux atteintes du froid, il voulut entrer dans la cabane, le sifflement du fouet, placé dans les mains de l’un des cavaliers qui se chauffaient et mangeaient, repoussa impitoyablement le gentilhomme français, comme un chien importun que l’on chasse.
Enfin, lorsqu’une heure plus tard les Cosaques eurent fini leur repas, une consultation parut s’engager entre eux au sujet du prisonnier ; Vauvrecy en jugea, du reste, ainsi, aux gestes par lesquels on le désignait ; après quoi ils sortirent de la cabane pour remonter à cheval.
Avant de se mettre en selle, l’un des Cosaques détacha les liens du colonel, pour qu’il pût reprendre rapidement sa marche.
La tourmente n’avait pas cessé. Le vent d’ouest arrachait aux branches des sapins des avalanches de neige et de lugubres soupirs.
Après environ trois quarts d’heure de route, les cavaliers s’arrêtèrent un instant et tinrent un nouveau conseil. Enfin deux se séparèrent du troisième, qui resta seul avec le colonel ; à leur avis, un homme suffisait et au-delà pour maintenir un soldat français que le fouet avait dégradé.
Ce Cosaque resté gardien du captif était précisément celui qui avait deux fois outragé le colonel. Malheureusement pour lui il ne vit pas, lorsque ses deux compagnons s’éloignèrent, le sourire de joie du captif.
Vauvrecy avait été dépouillé en un clin d’œil, pendant sa chute, de ses plus précieux trésors : son briquet, sa pierre à feu et le poignard de merci qui, jusqu’alors, ne l’avait jamais quitté ; mais il lui restait pour armes offensives son courage surhumain et sa force herculéenne.
Semblable au lien que le dompteur croit avoir soumis, et qui étouffe ses rugissements de colère, le grenadier marcha docilement devant le Cosaque ; le fils de l’Ukraine le suivait en sifflant.
Vauvrecy sentait cependant ses forces s’épuiser. Il prêta plus attentivement l’oreille. Pendant longtemps, les deux Cosaques avaient suivi la même direction que leur camarade, en laissant toutefois s’augmenter, petit à petit, l’espace de terrain qui les séparait de lui. Bientôt, le colonel n’entendit plus le bruit des fers de leurs chevaux frappant la terre durcie.
C’était, ou jamais, le moment d’agir, car les jambes de Vauvrecy commençaient à se dérober sous lui.
L’haleine chaude du cheval de son gardien caressait le cou du captif ; la vapeur que lançaient les naseaux de l’animal tourbillonnaient en flocons condensés autour de lui ; le grenadier retourna lentement la tête, comme pour implorer un instant de repos.
– Marche, chien ! dit brutalement le Cosaque en levant sa cravache plombée.
Vauvrecy étendit la main comme pour faire un nouvel appel à l’humanité du Cosaque. Une troisième fois encore le fouet siffla sur les épaules du grenadier. Ce devait être le dernier outrage que le barbare infligeait au Français vaincu.
Les doigts de fer du colonel s’enfoncèrent dans les naseaux fumants de l’animal qui hennit de douleur et voulut se cabrer. Trop près de son prisonnier pour le percer du ter de sa lance, le Cosaque le frappa violemment du bois de son arme : il était trop tard !
Le grenadier serra dans une étreinte plus violente encore les naseaux endoloris du cheval, puis poussa un hurlement aigu et lâcha prise. Débarrassé de la main de fer qui le dominait en le meurtrissant, effrayé du cri de Vauvrecy, l’animal, hennissant et superbe de douleur et d’effroi, se dressa presque debout sur les jambes de derrière. Le colonel, rappelant ses forces épuisées, se jeta alors sous le ventre du cheval ; de ses épaules d’Hercule il l’enleva du sol, lui fit perdre l’équilibre et le renversa sur le dos.
Le Cosaque, la jambe encore engagée sous la selle, qu’il n’avait pu vider à temps, fit entendre un dernier et inutile cri d’appel ; ses compagnons étaient hors de portée de la voix. Alors Vauvrecy saisit la bride du cheval qui se relevait, de l’autre il maintint le Cosaque sur la neige. La lutte entre les deux adversaires ne fut pas longue. Le cavalier se débattit un instant sous les doigts qui pressaient sa gorge, frissonna une seconde d’une courte agonie, et bientôt ne fut plus qu’une masse inerte et sans vie.
Le Français ramassa la lance échappée au Cosaque, et le cloua contre le sol.
– Et d’un ! dit-il avec une joie terrible. C’était la première victime de son serment.
Puis, contenant par la bride le cheval effrayé, Vauvrecy appuya le pied sur le corps de son vil ennemi, dont le sang fondait et rougissait la neige, et prit le ciel à témoin de son serment qu’il répéta tout haut.
Alors le grenadier sauta en selle, et lâchant la bride à sa monture, qui partit comme un trait, il s’élança au milieu des tourbillons de neige qui couvraient la terre.
C’était une horrible nuit que celle où Vauvrecy galopait ainsi à l’aventure.
Parmi les bruits de la tourmente, le grenadier croyait distinguer parfois la voix de son frère qui l’appelait à l’aide, ou entendre encore résonner à ses oreilles les dernières notes de sa chanson plaintive. Il s’arrêtait involontairement, le cœur palpitant, comme s’il n’eût pas su qu’André dormait pour toujours dans sa couche glacée.
Après une course furieuse et haletante, le cheval de Vauvrecy s’abattit mort entre ses jambes. Le colonel épuisé, malgré sa constitution athlétique, par les fatigues, les souffrances et les émotions de la journée, resta évanoui sur le sol glacé du désert.
Il est certainement fâcheux d’arrêter brusquement la série d’évènements qui se déroulent devant le lecteur pour y mêler des explications rétrospectives. On aime à suivre le cours d’un récit comme on suit le cours d’un fleuve qui, entre deux rives alternativement boisées ou fleuries, escarpées ou en pente douce, roule, sans s’arrêter, ses eaux limpides vers son embouchure. Au milieu du paysage varié qu’il parcourt, qui s’inquiète de sa source ou des pays qu’il a visités ?
L’homme, entre le passé qui ne lui appartient plus, et l’avenir qui ne lui appartient pas encore, n’hésite jamais : c’est l’avenir qu’il interroge de préférence. Nous demandons donc de nouveau pardon au lecteur d’entrer dans un ordre de faits rétrospectifs ; les explications qui vont suivre sont indispensables à la clarté de notre histoire.
En 1812, il y avait au fond des plaines de la Champagne, entre B *** et V ***, deux petites maisons contiguës, ensevelies, pour ainsi dire, au milieu d’un massif de verdure.
Un jardin séparé par un mur mitoyen s’étendait devant chacune d’elles.
Quoique ces deux maisons fussent peu éloignées de la grande route, la grille qui parait leur façade supportait, pendant la belle saison, une végétation si touffue de houblon, de vigne vierge, d’aristoloches et de chèvre feuille, que le rideau formé par ces plantes grimpantes, les dérobait complètement à la vue des passants !
Deux familles habitaient ces fraîches et charmantes demeures : l’une de ces deux familles se composait de la veuve du marquis de Vauvrecy, mort pendant l’émigration, de son fils, âgé de vingt ans à l’époque dont nous parlons, c’est-à-dire en 1812, et de sa fille, plus jeune de trois ans. La veuve d’un autre gentilhomme, également mort à l’étranger, et sa fille occupaient l’autre maison. L’histoire de la comtesse de la Roche Lannoy était, à peu de chose près, celle de la marquise de Vauvrecy, et quand nous aurons raconté, en peu de mots, la première, nous aurons presque dit la seconde.
Il est certaines positions politiques si nettement tranchées, qu’il ne faut pas être doué d’un esprit supérieur pour en deviner le dénouement inévitable.
Tout, en 1789, révélait en France une crise dont l’explosion devait être terrible. Tandis que les écrits des philosophes et des encyclopédistes préparaient les esprits à tous les changements sociaux et religieux, les prodigalités des deux prédécesseurs de Louis XVI avaient creusé le gouffre où devaient s’engloutir la vieille monarchie.
Une guerre ruineuse, un traité de paix non moins ruineux que la guerre ; la théorie de la souveraineté du peuple, dont les publicistes s’étaient faits les champions, des idées de liberté rapportées d’au-delà des mers : tout, en un mot, proclamait hautement l’approche d’une immense catastrophe.
Le marquis de Vauvrecy, gentilhomme dauphinois, à qui ses relations avec la cour de Versailles ne laissaient rien ignorer de ce qui se passait à Paris, n’avait pu fermer les yeux aux clartés sinistres qui jaillissaient de tous côtés. Possesseur d’une grande fortune territoriale, il crut prudent d’en réaliser en argent une forte partie, que le comte de la Roche-Lannoy, son ami, chargé d’une mission en Angleterre, porta à Londres.
Qu’on ne croie pas cependant que le marquis de Vauvrecy fût un homme timide ; il n’était que prudent, et les évènements ne justifièrent que trop ses prévisions.
Le gentilhomme dauphinois, pour l’énergie morale et la vigueur physique, paraissait avoir été taillé dans le granit de ses montagnes natales. Sur lui, l’habit de soie à paillettes semblait un anachronisme choquant : le vieux chevalier était évidemment né pour vivre et mourir sous le harnais de fer.
Loin de n’avoir obéi, dans ses prévisions de l’avenir, qu’à un instinct d’égoïste timidité, le marquis avait suivi l’impulsion d’un héroïque sentiment. C’était pour mettre sa femme et ses trois enfants à l’abri des orages qu’il redoutait ; c’était afin de pouvoir, libre du souci de sa famille, faire le sacrifice de sa vie à la monarchie menacée, qu’il avait pris les mesures de prudence que nous venons de dire.
Faible et délicate comme une fleur, la marquise n’eût pas été de force à supporter sans mourir le vent de l’adversité. Des trois enfants qu’elle avait eus de son mariage, un seul, Pierre, l’aîné, ressemblait par sa vigueur au marquis. Les deux autres, André, plus jeune de dix ans que son frère, et sa sœur Marie avaient hérité de la délicatesse de constitution de leur mère.
Ici nous noterons un des contrastes les plus frappants dans les harmonies de la nature, qui se plaît à marier le fort avec le faible, la vigne souple avec l’ormeau robuste. Pierre, quoique le chef futur de la famille de Vauvrecy, quoique reproduisant la stature herculéenne et le caractère du marquis, était certes celui de ses enfants qu’il aimait le moins. Ces deux caractères si entiers ne sympathisaient nullement entre eux : deux chênes ne s’entrelacent pas l’un avec l’autre. L’indomptable et quelque peu sauvage héritier du nom de Vauvrecy supportait impatiemment la discipline paternelle. Un orage était toujours à la veille d’éclater ; du frottement du fer et du silex doit au moindre choc jaillir l’étincelle qui embrase.
Une divergence profonde d’opinion et de sentiment contribuait encore à creuser l’abîme qui séparait le fils du père.
Le marquis était de cette génération trop dure à entamer pour que les idées nouvelles eussent pu même laisser la plus légère empreinte sur sa surface. Pierre, au contraire, avait accepté avec d’autant plus d’empressement, presque d’enthousiasme, les idées philosophiques de libéralisme alors en vogue, que ces idées enflammaient le sang batailleur qui coulait dans ses veines. Elles lui avaient désappris le respect de la royauté, non pas dans le sens absolu du mot, mais de la royauté bourbonienne. Pierre ne rêvant que luttes et batailles, Pierre amoureux de gloire militaire et regrettant les temps de la féodalité guerrière, ne professait qu’une très médiocre estime pour Louis XV le débauché et pour l’honnête et pacifique Louis XVI. Il avait osé dire une fois, devant le marquis, qu’il se regardait comme peu tenu de respecter ces deux pâles descendants de Robert-le-Fort, qui lui au moins avait su conquérir sa couronne l’épée à la main.
De ce moment le vieux gentilhomme, dévoué de corps et d’âme à ses rois, sentit son cœur se fermer pour l’auteur d’un pareil blasphème.
Les évènements ne tardèrent pas, hélas ! à donner raison aux prévisions du marquis. L’orage qu’il prévoyait éclata, avec plus de violence encore qu’il n’avait osé le craindre. Le gentilhomme s’empressa de faire émigrer en Angleterre sa femme, son fils cadet et sa fille ; puis il resta pour défendre dans la personne de Louis XVI la monarchie menacée. Quant à Pierre, ses instincts guerriers le retinrent avec son père près du monarque que le malheur revêtait désormais à ses yeux de tout le prestige d’une lutte héroïque et sanglante à soutenir.
Le vieux gentilhomme, fidèle à ses sentiments chevaleresques d’abnégation et de loyauté, demeura à son poste près du roi jusqu’à la journée du 10 août 1792, qui fut la dernière de la royauté de Louis XVI.
Désormais inutile défenseur d’une cause perdue, convaincu qu’il n’y avait plus de patrie là où il n’y avait plus de rois, et voyant le pays dans la tente des princes fugitifs – car il ne prévoyait que trop le sort du malheureux captif du Temple, – le marquis céda aux sollicitations pressantes de sa famille, et se résolut de l’aller rejoindre à Londres.
Nous n’avons pas besoin de raconter comment il parvint à gagner la côte de Bretagne, ni comment il se trouva un soir avec son fils sur la grève où un canot les attendait pour les porter à bord d’un navire anglais croisant au large. Le vieux gentilhomme allait mettre le pied dans l’embarcation, lorsque Pierre s’agenouilla devant lui :
– Que faites-vous, Monsieur ? lui demanda le marquis étonné.
– Je m’incline devant mon père, pour qu’au moment de me séparer de lui, il me donne sa bénédiction.
– Nous séparer ! et pourquoi ?
– Permettez-moi de le faire, monsieur.
– Je veux le savoir ! s’écria impérieusement le vieux gentilhomme.
– Je n’irai jamais, reprit Pierre d’une voix ferme quoique respectueuse, que comme ennemi chez les Anglais, et je ne leur demanderai jamais non plus d’autre hospitalité que celle que le vainqueur impose au vaincu.
– Ah ! vraiment !… s’écria le marquis d’une voix ironique et menaçante.
– Ce sol, reprit Pierre, en montrant du doigt la grève, est celui de mon pays ; ce sol est menacé de toutes parts, je ne sais pas fuir au moment du danger.
– Je suis donc un lâche, moi ! dit impétueusement le vieillard.
– Un Vauvrecy ne peut jamais l’être, mais…
Le vieux gentilhomme coupa la parole à son fils :
– Réfléchissez, monsieur, lui dit-il ; jamais je ne donnerai la bénédiction paternelle à un fils traître à son roi et renégat envers son Dieu.
Pierre resta la tête inclinée, immobile, comme les saints de bronze qui prient à l’angle des tombeaux, et le rude gentilhomme, après une hésitation à peine visible, sauta silencieux dans le canot et poussa au large.
Ce fut ainsi que se quittèrent, pour ne plus se revoir, le fils au cœur de silex, le père au cœur d’acier.
Pierre n’avait plus d’autre ressource que de s’engager comme volontaire dans les armées que la République mettait sur pied.
Il fut l’un des premiers dans Paris à s’armer pour courir au secours de Verdun menacé par les Prussiens. Déjà il était en marche quand il apprit la prise de Verdun ; il ne voulut pas abandonner pour cela sa nouvelle carrière.
Le général comte de Custine venait d’être appelé au commandement de l’armée du Rhin. Pierre résolut de servir sous les ordres d’un général, gentilhomme comme lui. Il fit donc sous Custine la campagne du Palatinat, et ne quitta les rangs de l’armée que lorsque son général dut venir à Paris se défendre à la barre de la Convention. Pierre comptait alors à peine seize ans ; sa force et sa stature accusaient au moins la vingtaine.
Le jeune volontaire aimait tendrement sa mère, sa sœur, et surtout son frère André. Il saisit toutes les occasions qu’il put trouver pour leur faire parvenir de ses nouvelles ; ses lettres arrivèrent bien à leur adresse, mais l’inexorable sévérité de son père ne permit pas plus à la marquise d’y répondre, que de lui en lire à lui-même le contenu.
À ses yeux, Pierre n’était qu’un renégat, un traître. – Qui abandonne son roi, avait-il coutume de dire, n’est pas loin de renier son Dieu.
Cependant, Pierre blessé de ce long et injuste silence, renferma au plus profond de son cœur son chagrin et ses secrètes affections, et n’écrivit plus.
Plus tard, la renommée du général Bonaparte vint tout à coup éclairer le monde, ainsi qu’un brillant météore. Pierre pressentit que le Robert-le-Fort qu’il avait rêvé pour s’attacher à sa fortune, apparaissait à l’horizon, et il obtint d’entrer comme lieutenant à l’armée d’Italie, qui allait faire sous le jeune général son immortelle campagne.
Les pressentiments de Pierre ne l’avaient pas trompé. Les prodiges qu’il vit s’accomplir sous ses yeux, et dont il fut l’un des héroïques instruments, le remplirent d’admiration pour le sublime soldat qui enfantait ces miracles. Dès-lors, ses espérances se changèrent en certitude, il ne douta plus que Bonaparte ne fût appelé à être le fondateur d’une dynastie.
Plus tard, il suivit en Égypte celui qui lui avait inspiré un enthousiasme si profond ; il campa, sous son drapeau, dans presque toutes les capitales de l’Europe, et fut l’un des plus ardents à l’aider à ceindre son front de la couronne de Charlemagne.
En 1812, Pierre n’était plus seulement le séide du général Bonaparte, il était devenu l’adorateur idolâtre de l’Empereur Napoléon. Cependant, il faut bien le dire, dans ce temps d’avancement rapide, où des soldats se métamorphosaient si promptement en maréchaux et en rois, Pierre de Vauvrecy n’était encore, en 1812, que colonel.
Malgré la brillante bravoure dont il avait donné tant de preuves, quelques défauts avaient retardé le développement de sa fortune. C’était d’abord son caractère de fer qui, après n’avoir su ployer sous l’autorité paternelle, avait trop souvent méconnu les exigences de la discipline militaire. Puis, ensuite, des duels éclatants qu’il n’avait peut-être pas assez évités et qui avaient produit un retentissement défavorable. Son courage de lion, mais calme et froid ; sa force physique, sa remarquable adresse à tous les exercices du corps, le rendaient vainqueur dans toutes ces tristes rencontres. Napoléon prodigue envers l’ennemi, pendant la guerre, du sang de ses officiers et de ses soldats, en était avare en temps de paix. Il détestait les duels et les duellistes, défendait les uns et punissait sévèrement les autres.
À chaque disgrâce qui l’atteignait, Vauvrecy faisait dire à l’empereur qu’il ne manquerait pas à la première occasion de courir au-devant des balles ennemies, et l’empereur répondait toujours :
– La belle promesse, en vérité ! M. de Vauvrecy en dit-il et n’en fait-il pas toujours autant quand je le récompense !
Pierre, en effet, ne savait que manifester sa reconnaissance et son repentir, en cherchant à se faire casser la tête, mais il n’avait pour la mort qu’une passion malheureuse ; la mort ne voulait pas de celui dont le bras, en paix comme en guerre, était un de ses plus terribles pourvoyeurs.
Le dévouement du marquis de Vauvrecy à la royauté déchue, quelque ardent qu’il fût, était bien pâle à côté de celui qu’éprouvait son fils pour l’empereur et roi !
Voyons maintenant ce qu’était devenu le marquis de Vauvrecy. La mort de Louis XVI avait été pour le gentilhomme dauphinois un évènement douloureux et terrible ; il ressentit, s’il est permis de s’exprimer ainsi, le contrecoup de la hache régicide. Le chêne languit et finit par mourir quand la cognée du bûcheron a entamé son tronc rugueux. La sève et la vie du vieux chêne s’écoulaient par cette blessure.
L’oisiveté forcée à laquelle il était condamné et le chagrin de n’avoir pu offrir à la défense de la monarchie le bras de son fils, étaient des causes qui empoisonnaient encore l’existence du marquis.
André atteignait sa treizième année quand son père arriva au terme fatal. André avait été élevé dans les principes paternels ; à ses yeux la patrie n’existait qu’à côté de ses rois ; mais en comparaison de son frère, le jeune homme ressemblait à l’humble sumac comparé à l’arbre à bois de fer. Cependant comme les coalitions contre la France se succédaient sans cesse, le marquis fit promettre en mourant à son jeune fils qu’il y prendrait part un jour. André le jura, et quelque peu soulagé par ce serment, le vieux gentilhomme, que son royalisme égarait, rendait à Dieu son âme d’incorruptible et de loyal chevalier.
La France était pacifiée à l’intérieur, le marquis était mort, les émigrés revenaient en foule et parvenaient souvent à rentrer, pour une faible somme, dans leurs biens confisqués. Le comte de la Roche Lannoy, qui avait émigré avec son ami, était mort quelques années avant lui, et n’avait évité la misère que grâce aux largesses du marquis. La marquise et la comtesse résolurent de rentrer en France. Ce projet fut exécuté ; Mme de Vauvrecy racheta presque tous ses biens, et se trouva riche comme avant le terrible orage ; mais au lieu d’habiter le Dauphine, elle fit l’acquisition, pour elle et pour son amie, des deux maisons dont nous avons parlé au commencement de ce chapitre. Ceci se passait en 1808.
Quoique le marquis de Vauvrecy eût coutume de dire qu’il n’avait plus que deux enfants, et qu’il eût défendu de prononcer devant lui le nom de Pierre, ce n’était jamais sans un tressaillement d’orgueil et de tendresse que Mme de Vauvrecy lisait le nom de son fils aîné dans les bulletins qui parvenaient jusqu’à elle. Par suite de ce même sentiment qui faisait préférer au marquis la faiblesse d’André, la marquise se complaisait dans la force de Pierre.
Tout en s’accoutumant à voir la place de ce dernier vide au foyer domestique, elle n’avait pas passé un seul jour sans donner une pensée et un soupir de tendresse à l’absent.
Elle s’était empressée, à la mort de son mari, d’écrire à son fils pour lui faire part de l’évènement qui, bien que le droit d’aînesse n’existât plus, faisait de lui le chef de la famille. Mais dans sa course errante à travers l’Europe, il n’était pas facile de joindre le soldat conquérant. Cette lettre ne lui parvint donc pas.
De son côté, le capitaine de Vauvrecy, – c’était son grade en 1808, – mûri par l’âge et revenu aux sentiments du plus profond respect paternel, n’avait jamais murmuré contre la sévérité qui le privait de toutes nouvelles de sa famille, et il avait conservé pour sa mère et son jeune frère surtout, un véritable culte.
De même que le marquis regrettait toujours de ne pouvoir offrir son fils aîné au service de ses rois, de même Pierre, de son côté, se désolait aussi de ne pouvoir faire faire à son frère, sous ses ordres, l’apprentissage de la carrière militaire. Ce fut donc avec une joie profonde, au milieu des regrets que le temps avait adoucis sans les éteindre, que le capitaine reçut enfin une lettre de sa mère, qui lui apprenait la nouvelle de la mort du marquis de Vauvrecy.
Quoique les liens du sang, il faut l’avouer, ne soient pas toujours suffisants à former ceux de la tendresse, Pierre ne put s’empêcher, malgré les dissentiments qui avaient existé entre le marquis et lui, de courber tristement la tête, en pensant que son père était mort, non seulement sans daigner lui pardonner, mais même sans paraître daigner se rappeler qu’il eût un fils !
La nouvelle de la rentrée en France de ce qui lui restait de sa famille compensa heureusement, dans le cœur du capitaine, les regrets causés par l’inflexibilité de son père mort. Cette lettre, que Pierre reçut à Erfurt, lui désignait le lieu de la retraite de sa mère, et il obtint un congé pour aller passer quelque temps auprès d’elle. Nous le précéderons à l’habitation riante où sa famille attendait son retour.
En dépit de la délicatesse de sa constitution, et quoiqu’elle eût dépassé déjà la cinquantaine, la marquise de Vauvrecy, grâces aux précautions prises par son mari pour la soustraire aux privations si dures de l’émigration, avait conservé quelques-uns des avantages de la jeunesse ; les années semblaient, pour elle, n’avoir eu que la moitié de leur durée.
André de Vauvrecy, arrivé à l’âge de vingt-deux ans, n’était pas précisément le frêle jeune homme annoncé par sa délicate enfance, mais il ne rappelait en rien la force et la stature herculéenne de son père et de son frère.
Marie de Vauvrecy était plus distinguée peut-être que réellement jolie ; mais, au demeurant, la fraîcheur de son teint, rehaussé encore par d’admirables yeux noirs, l’expression attrayante de sa physionomie et la souplesse de sa taille lui donnaient des droits incontestables à la beauté.
La comtesse de La Roche-Lannoy, voisine de la marquise de Vauvrecy, mérite peu les honneurs de l’analyse au point de vue de la psychologie : c’était une excellente femme, d’une portée d’esprit fort ordinaire et dont le principal mérite avait toujours été la douceur et l’enjouement de son humeur et son tendre dévouement envers ceux qu’elle aimait. Habituée à la tendresse de sa vieille amie, la marquise de Vauvrecy avait trouvé un délicat et ingénieux prétexte pour lui faire accepter en don la petite maison contiguë à la sienne. Cette maison devait servir à augmenter la dot de Mlle Alexandrine de La Roche-Lannoy.
Mlle de la Roche-Lannoy, âgée, en 1808, de quatorze ans, était née à Londres, pendant l’émigration, et voyait la France pour la première fois.
Le climat brumeux du pays où elle avait pris naissance paraissait avoir influé sur elle. La blancheur de son teint, ses yeux bleus et ses cheveux blonds rappelaient les filles de Fingal.
Ses traits avaient encore un peu de cette bouffissure enfantine qui, contrastant avec la sveltesse de sa taille élancée, devenait un charme de plus ; mais à l’expression de ses yeux, dont les prunelles de saphir se couvraient à la moindre émotion d’un voile humide, aux lignes déjà si pures de son front et de son visage on pouvait pressentir la femme irréprochablement belle. C’était la fleur encore enveloppée de sa bourre d’hiver, mais qui promet pour l’été tous les développements de ses parfums et de sa beauté.
Tels étaient les hôtes des deux maisons contiguës où, chaque jour, on parlait de l’arrivée du capitaine de Vauvrecy, ce grand évènement en perspective.
La comtesse de Vauvrecy ressentait une joie pure et profonde à l’idée qu’elle allait enfin presser dans ses bras, après seize ans d’absence, le fils qui, le premier, avait fait tressaillir ses flancs maternels, et qui lui revenait une auréole de gloire au front.
André se rappelait les jours de son enfance, l’amitié presque paternelle et les tendres sollicitudes de son robuste frère.
Quant à Marie, Pierre, pour elle, était un inconnu. Elle était simplement heureuse du bonheur que se promettaient sa mère et son frère, mais il se mêlait quelque appréhension à sa joie. Ce qu’elle avait entendu dire de Pierre en particulier, et des officiers de l’Ogre-de-Corse en général, lui faisait redouter de voir apparaître un géant à la voix rude et au cœur dur comme la voix ; en un mot, un pourfendeur brutal.
Mme de la Roche-Lannoy n’avait pas d’opinion tranchée à cet égard ; elle se contentait de se réjouir du bonheur des autres, sans en discuter ou en analyser les causes.
Alexandrine sa fille partageait jusqu’à un certain point les appréhensions de Mlle de Vauvrecy, son amie. Cependant un vif sentiment de curiosité l’emportait en elle sur la crainte ; elle brûlait du désir de voir de près l’un de ces soldats conquérants qui promenaient d’un bout de l’Europe à l’autre leur épée toujours victorieuse, et dont elle avait si souvent entendu vanter les exploits.
L’esprit chevaleresque de ses ancêtres revivait en elle. Sa crainte était mêlée d’admiration ; puis, toute jeune qu’elle fût, elle sentait que dans les guerres qui, depuis seize ans, déchiraient l’Europe, la place de tout homme en état de porter une épée était sur les champs de batailles. Pour peu que le capitaine ne réalisât pas le portrait tracé par son amie, elle était donc toute disposée à admirer en lui un héros.
Un matin de printemps qu’elle jouait dans le jardin qui précédait la maison, un cavalier à longues moustaches arrêta son cheval à la grille, au moment où elle y accourait elle-même. Un simple soldat accompagnait le cavalier.
– Mon enfant, lui demanda ce dernier d’une voix sonore mais harmonieuse, n’est-ce point ici que demeure la marquise de Vauvrecy ?
Au son de cette voix qui retentissait soudainement à ses oreilles, la jeune fille écarta les boucles blondes qui se détachaient sur ses joues empourprées par l’exercice comme une gerbe d’épis sur une touffe de coquelicots, et fixa ses grands yeux bleus hardis et timides à la fois sur le cavalier.
Celui-ci, immobile sur sa selle, comme si son cheval fougueux, qui grattait de son sabot la terre et jetait des flocons d’écume autour de lui, eût été de bronze ou de marbre, laissait voir sur son mâle visage son admiration pour cette beauté enfantine.
– La maison de la marquise de Vauvrecy ?… répéta la charmante enfant, qui, saisie tout à coup d’une terreur subite, n’acheva pas sa phrase et s’enfuit comme une biche effrayée.
Le cavalier la suivait, en souriant, du regard, quand du perron qui donnait sur le jardin, une femme s’avança vers la grille. Le son mordant de la voix du cavalier était arrivé jusqu’à elle.
– La maison de la marquise de Vauvrecy est celle-ci, dit-elle en la désignant de la main.
– Merci, madame, répondit le cavalier, qui salua et mit pied à terre à la porte qu’on venait de lui indiquer.
Une minute après la marquise, enlevée dans les bras du robuste cavalier, poussait un cri de joie et de bonheur.
C’était son fils aîné, Pierre de Vauvrecy, qui l’étreignait ainsi contre son cœur ! André accourut bientôt prendre sa part des caresses fraternelles, tandis que Marie, attendant son tour, sentait ses appréhensions se dissiper comme la vapeur matinale devant le soleil, à la vue de grosses larmes qui roulaient sur le visage du capitaine et des lignes fières et hardies de sa figure, que le bonheur adoucissait jusqu’à la tendresse.