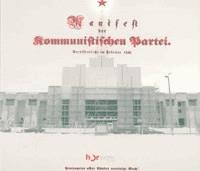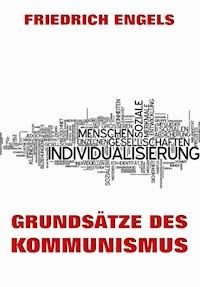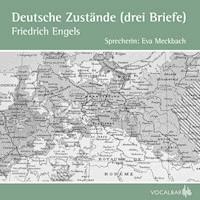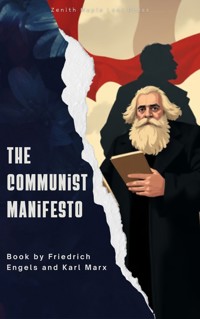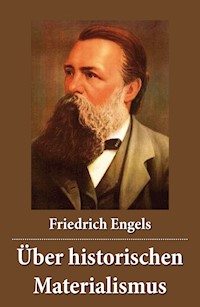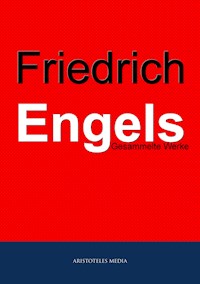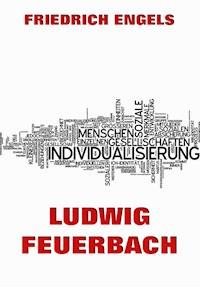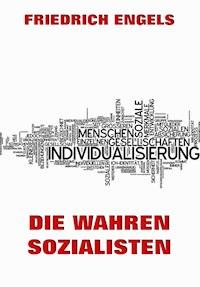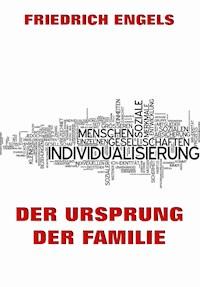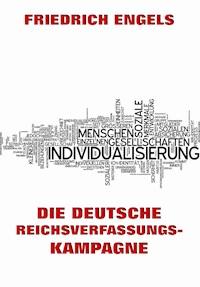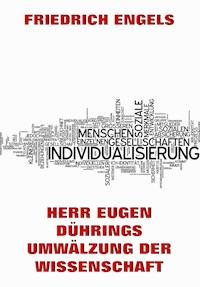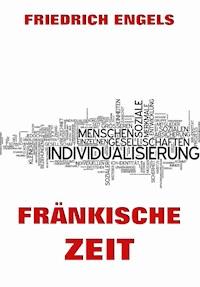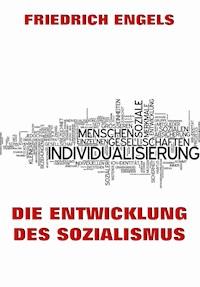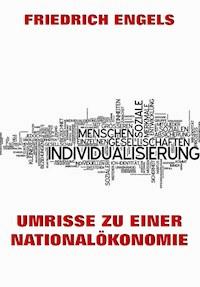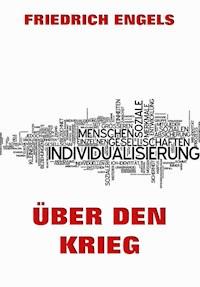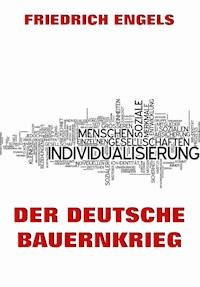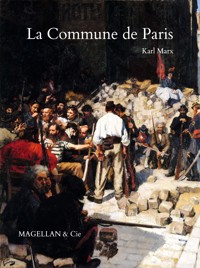
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Tout le monde connaît Karl Marx (1818-1883), le théoricien de la lutte des classes. Mais peu s’intéresse à l’homme, au philosophe et au journaliste engagé, le condamnant d’avance pour ce que ses successeurs ont fait de ses travaux et de ses idéaux. Son texte remarquable sur la Commune de Paris, présenté ici, n’a guère suscité de polémique. Les historiens contemporains s’accordent à lui reconnaître justesse et justification. Pour la rédaction de ce volume « coup de poing », il a réuni et compilé tout ce qu’il trouvait dans les journaux anglais, français et allemand sur la progression de la guerre civile opposant les communards aux forces versaillaises. Ayant vécu à Paris plusieurs années, impressionné par ce mouvement populaire dans lequel il perçoit un « modèle », il veut s’en faire le héraut et s’adresser à la classe ouvrière mondiale. Son portrait des forces en présence est sans concession, pour ceux qu’il soutient comme pour les tyrans qu’il combat : Adolphe Thiers est le chef d’un « gouvernement de défection nationale » et la dénonciation des manœuvres du chancelier Bismarck lui permet de régler quelques comptes personnels. Il faut en effet rappeler que la Commune est directement issue du conflit franco-prussien de 1870, générant une opposition frontale entre ceux qui refusent la défaite et ceux qui s’en accommodent.
À PROPOS DES AUTEURS
Friedrich Engels, né le 28 novembre 1820 à Barmen (Prusse) et mort le 5 août 1895 à Londres, est un philosophe, sociologue, anthropologue et un théoricien socialiste et communiste allemand, grand ami de Karl Marx. Après la mort de ce dernier, il assure, à partir des brouillons laissés par son ami, la rédaction définitive et la publication des livres II et III du "Capital".
Engels a été militant de la Ligue des communistes, de l'Association internationale des travailleurs (Première Internationale) et de l'Internationale ouvrière (Deuxième Internationale).
Karl Marx, né le 5 mai 1818 à Trèves dans le grand-duché du Bas-Rhin et mort le 14 mars 1883 à Londres, est un philosophe, économiste, historien, sociologue, journaliste, théoricien de la révolution[4], socialiste et communiste prussien. Il est connu pour sa conception matérialiste de l'histoire, son analyse des rouages du capitalisme et de la lutte des classes, et pour son activité révolutionnaire au sein du mouvement ouvrier. Il a notamment été un des membres dirigeants de l'Association internationale des travailleurs (Première Internationale). Des courants de pensée se revendiquant principalement des travaux de Marx sont désignés sous le nom de marxisme. Marx a eu une grande influence sur le développement ultérieur des sciences humaines et sociales. Ses travaux ont marqué de façon considérable le XXe siècle, au cours duquel de nombreux mouvements révolutionnaires et intellectuels se sont réclamés de sa pensée.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Commune de Paris
La Commune de Paris
Karl Marx
MAGELLAN & Cie
Proclamation de la Commune de Paris sur la place de l’Hôtel-de-Ville.
Table des matières
AVANT-PROPOS7
Introduction13
PREMIÈRE ADRESSE SUR LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE37
seconde ADRESSE SUR LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE47
aDRESSE SUR LA GUERRE civile en france65
KARL MARX157
Avant-propos
7
AVANT-PROPOS
par Marc Wiltz
Chacun connaît Karl Marx, surtout de nom, avec tout ce qui s’attache à son œuvre de philosophe, au Capital, et à tous les développements du communisme, et ses dévoiements. L’homme décédé à Londres en 1883, après une vie entière passée à réfléchir, à écrire et à agir sur la condition du travail, peut-il être considéré comme responsable de ce que ses successeurs ont fait de ses travaux, de ses principes ou de ses idéaux ?
Son texte remarquable sur la Commune de Paris, présenté ici, n’a guère suscité de polémique. Les historiens contemporains s’accordent à lui reconnaître justesse et justification, même s’il se présente sous la forme d’un pamphlet. The Civil War in France, son titre original en anglais, a été écrit au nom du Conseil général de l’Association internationale des travailleurs, appellation officielle de la « Première Internationale », fondée à Londres en 1864 et dont l’objectif premier était de coordonner le développement du mouvement ouvrier naissant dans les pays européens récemment industrialisés.
Karl Marx en 1874 à Londres, photographie.
8
La Commune de Paris
La première édition du texte est une mince brochure de trente-cinq pages tirée à mille exemplaires, publiée à Londres dès le 13 juin 1871, c’est-à-dire quelques jours à peine après la chute de la Commune. D’autres éditions suivent rapidement soit sous la forme de brochures, soit en parution dans les journaux, avec de nombreuses traductions en français, en allemand, en russe, en italien, en espagnol, en flamand, en croate, en danois, en polonais… pour faire face au succès. La traduction allemande est faite par son ami de longue date Friedrich Engels.
Marx vit à Londres depuis 1849. Pour la rédaction de ce volume « coup de poing », il a réuni et compilé tout ce qu’il trouvait de coupures de journaux anglais, français et allemand racontant la progression de la guerre civile qui oppose les communards aux forces versaillaises. Il s’est également renseigné auprès de plusieurs personnalités de premier plan de la Commune, avec lesquelles il est en contact depuis longtemps. Il a en effet vécu à Paris entre 1843 et 1845, puis entre 1848 et 1849, expulsé les deux fois pour ses prises de position. Très impressionné par ce mouvement populaire dans lequel il perçoit un « modèle », il veut s’en faire le héraut et s’adresser à la classe ouvrière mondiale. Son portrait des forces en présence est sans concession, à la fois pour ceux qu’il soutient et pour les tyrans qu’il combat : côté français, Adolphe Thiers n’est pas épargné par sa verve, le gouvernement étant décrit comme un « gouvernement de défection nationale » et son chef comme un
Avant-propos
parvenu avide et rempli de haine ; côté allemand, la dénonciation des manœuvres du chancelier Bismarck lui permet de régler quelques comptes personnels. Il faut en effet rappeler que la Commune est directement issue du conflit franco-prussien de 1870, générant une opposition frontale entre ceux qui refusent la défaite et ceux qui s’en accommodent. À la chute du Second Empire marqué par le désastre de Sedan (capitulation du 2 septembre 1870), le peuple parisien, malgré la famine et les sacrifices, n’accepte pas le désarmement voulu par Thiers, et choisit délibérément de poursuivre la « guerre civile ». Marx met ici en lumière ces combats pour la liberté de la classe ouvrière et les avancées sociales créées par le mouvement populaire, tuées dans l’œuf. En 1940, il y aura comme une redite de l’histoire…
En 1891, lors du vingtième anniversaire de la Commune de Paris, Engels proposera une nouvelle édition augmentée d’une introduction, elle aussi reproduite ici, soulignant l’importance historique de cette tragédie française qui a causé la mort de vingt mille personnes, et l’exil de beaucoup d’autres.
Double-page ci-dessous : les canons de la Garde nationale sur la butte Montmartre, gravure.
Friedrich Engels avec Karl Marx et ses trois filles Jenny Caroline, Jenny Julia Eleanor et Jenny Laura, vers 1964 à Londres.
Introduction
13
Introduction
par Friedrich Engels
rédigée à Londres, pour le vingtième anniversaire
de la Commune de Paris, le 18 mars 1891
C’est à l’improviste que j’ai été invité à faire une nouvelle édition de l’Adressedu Conseil général de l’Internationale sur La Guerre civile en Franceet à y joindre une introduction. Aussi ne puis-je ici que mentionner brièvement les points les plus essentiels.
Je fais précéder cette étude plus considérable des deux Adressesplus courtes du Conseil général sur la guerre franco-allemande. D’abord, parce que dans La Guerre civileon se réfère à la seconde, qui n’est pas elle-même entièrement intelligible sans la première. Ensuite, parce que ces Adresses, toutes deux rédigées par Marx, sont, tout autant que La Guerre civile, des exemples éminents du don merveilleux dont l’auteur a fait pour la première fois la preuve dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, et qui lui permet de saisir clairement le caractère, la portée et les conséquences nécessaires des
14
La Commune de Paris
grands événements historiques, au moment même où ces événements se produisent encore sous nos yeux ou achèvent à peine de se dérouler. Et, enfin, parce que nous souffrons aujourd’hui encore en Allemagne des suites prédites par Marx, de ces événements.
Est-ce qu’on n’a pas vu se réaliser la prédiction de la première Adresse : si la guerre de défense de l’Allemagne contre Louis Bonaparte dégénère en guerre de conquête contre le peuple français, toutes les misères qui se sont abattues sur l’Allemagne après les guerres dites de libération renaîtront-elles avec une intensité nouvelle1 ? N’avons-nous pas eu encore vingt autres années de domination bismarckienne, et pour remplacer les persécutions contre les « démagogues »2, la loi d’exception et la chasse aux socialistes, avec le même arbitraire policier, avec littéralement la même façon monstrueuse d’interpréter la loi ?
Et ne s’est-elle pas réalisée à la lettre la prédiction que l’annexion de l’Alsace-Lorraine « jetterait la France dans les bras de la Russie3 » et qu’après cette annexion l’Allemagne ou bien deviendrait le valet servile de la Russie, ou bien serait obligée, après un court répit, de s’armer pour une nouvelle guerre et,
1. Allusion aux conflits qui avaient suivi les annexions d’une partie de l’Allemagne par Napoléon 1eren 1813 et 1814. (N.d.É.)
2. Nom malveillant désignant les démocrates dans les années 1820 au sein des États allemands. (N.d.É.)
3. Dans la deuxième Adresseprésentée plus loin, Marx avait prévu que l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine pousserait la France à chercher des alliés pour sa « revanche », auprès de la Russie tsariste en particulier. (N.d.É.)
15
Introduction
à vrai dire, « pour une guerre raciale contre les races latines et slaves coalisées » ? Est-ce que l’annexion des provinces françaises n’a pas poussé la France dans les bras de la Russie ? Bismarck n’a-t-il pas vainement, pendant vingt années entières, brigué les bonnes grâces du tsar, s’abaissant à des services plus vils encore que ceux que la petite Prusse, avant qu’elle ne fût « la première puissance d’Europe », avait coutume de déposer aux pieds de la Sainte-Russie ? Et ne voit-on pas quotidiennement, suspendue au-dessus de notre tête, telle l’épée de Damoclès, la menace d’une guerre, au premier jour de laquelle tous les traités d’alliance des princes s’en iront en fumée ? D’une guerre dont rien n’est sûr que l’absolue incertitude de son issue, d’une guerre raciale qui livrera toute l’Europe aux ravages de quinze à vingt millions d’hommes armés ; et si elle ne fait pas encore rage, c’est uniquement parce que le plus fort des grands États militaires est pris de peur devant l’imprévisibilité totale du résultat final.
Il est d’autant plus nécessaire de mettre à nouveau à la portée des ouvriers allemands ces preuves brillantes et à demi oubliées de la clairvoyance de la politique ouvrière internationale de 1870.
Ce qui est vrai de ces deux Adresses, l’est aussi de celle sur La Guerre civile en France. Le 28 mai 1871, les derniers combattants de la Commune succombaient sous le nombre sur les pentes de Belleville, et deux jours après, le 30, Marx lisait déjà devant le Conseil général ce travail où la signification historique de la Commune
16
La Commune de Paris
de Paris est marquée en quelques traits vigoureux, mais si pénétrants, et surtout si vrais, qu’on en chercherait en vain l’équivalent dans l’ensemble de l’abondante littérature écrite sur ce sujet.
Le développement économique et politique de la France depuis 1789 a fait que, depuis cinquante ans, aucune révolution n’a pu éclater à Paris sans revêtir un caractère prolétarien, de sorte qu’après la victoire, le prolétariat, qui l’avait payée de son sang, entrait en scène avec ses revendications propres. Ces revendications étaient plus ou moins fumeuses, et même confuses, selon le degré de maturité atteint par les ouvriers parisiens mais, en définitive, elles visaient toutes à la suppression de l’antagonisme de classes entre capitalistes et ouvriers. Comment la chose devait se faire, à vrai dire on ne le savait pas. Mais à elle seule, si indéterminée qu’elle fût encore dans sa forme, la revendication contenait un danger pour l’ordre social établi : les ouvriers qui la posaient étaient encore armés ; pour les bourgeois qui se trouvaient au pouvoir, le désarmement des ouvriers était donc le premier devoir. Aussi, après chaque révolution, acquise au prix du sang des ouvriers, éclate une nouvelle lutte qui se termine par la défaite de ceux-ci. C’est en 1848 que la chose arriva pour la première fois. Les bourgeois libéraux de l’opposition parlementaire tinrent des banquets où ils réclamaient la réalisation de la réforme électorale, qui devait assurer la domination de leur parti. De plus en plus contraints dans leur lutte contre le gouvernement à faire appel au peuple, ils
17
Introduction
furent obligés de céder peu à peu le pas aux couches radicales et républicaines de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie. Mais, derrière elles, se tenaient les ouvriers révolutionnaires, et ceux-ci, depuis 1830, avaient acquis beaucoup plus d’indépendance politique que les bourgeois et même que les républicains n’en avaient idée. Quand la crise éclata entre le gouvernement et l’opposition, les ouvriers engagèrent le combat de rues. Louis-Philippe disparut, et avec lui la réforme électorale ; à sa place se dressa la république, la république « sociale», comme les ouvriers victorieux la qualifièrent eux-mêmes. Ce qu’il fallait entendre par république sociale, c’est ce que personne ne savait au juste, pas même les ouvriers. Mais maintenant, ils avaient des armes et ils étaient une force dans l’État. Aussi, dès que les bourgeois républicains qui se trouvaient au pouvoir sentirent le sol se raffermir sous leurs pieds, leur premier objectif fut-il de désarmer les ouvriers. Voici comment cela se fit : en violant délibérément la parole donnée, en méprisant ouvertement les prolétaires, en tentant de bannir les sans-travail dans une province lointaine, on les précipita dans l’insurrection de juin 1848. Et comme on avait pris soin de réunir les forces suffisantes, les ouvriers, après une lutte héroïque de cinq jours, furent écrasés. On fit alors un massacre parmi les prisonniers sans défense, comme on n’en avait pas vu de pareil depuis les jours des guerres civiles qui ont préparé la chute de la République romaine. Pour la première fois, la bourgeoisie montrait jusqu’à quelle folle cruauté dans la vengeance elle peut
18
La Commune de Paris
se hausser sitôt que le prolétariat ose l’affronter, comme classe distincte, ayant ses propres intérêts et ses propres revendications. Et pourtant 1848 ne fut encore qu’un jeu d’enfant comparé à la rage de la bourgeoisie de 1871.
Le châtiment ne se fit pas attendre. Si le prolétariat ne pouvait pas gouverner la France encore, la bourgeoisie ne le pouvait déjà plus. Je veux dire du moins à cette époque où elle était encore en majorité de tendance monarchiste et se scindait en trois partis dynastiques4et en un quatrième républicain. Ce sont ces querelles intérieures qui permirent à l’aventurier Louis Bonaparte de s’emparer de tous les postes-clefs – armée police, appareil administratif – et de faire sauter, le 2 décembre 1851, la dernière forteresse de la bourgeoisie, l’Assemblée nationale. Le Second Empire commença, et avec lui, l’exploitation de la France par une bande de flibustiers de la politique et de la finance ; mais en même temps l’industrie prit aussi un essor tel que jamais le système mesquin et timoré de Louis-Philippe, avec sa domination exclusive d’une petite partie seulement de la grande bourgeoisie, n’aurait pu lui donner. Louis Bonaparte enleva aux capitalistes leur pouvoir politique, sous le prétexte de les protéger, eux, les bourgeois, contre les ouvriers, et de protéger à leur tour les ouvriers contre eux ; mais, par contre, sa domination favorisa la spéculation et l’activité industrielle, bref, l’essor et l’enrichissement de toute la bourgeoisie à un point dont on n’avait pas idée. C’est cependant à
4. Les revendications du pouvoir opposaient vivement les légitimistes, les bonapartistes et les orléanistes. (N.d.É.)
19
Introduction
un degré bien plus élevé encore que se développèrent aussi la corruption et le vol en grand, qu’on les vit fleurir autour de la cour impériale et prélever sur cet enrichissement de copieux pourcentages.
Mais le Second Empire, c’était l’appel au chauvinisme français, c’était la revendication des frontières du Premier Empire, perdues en 1814, ou tout au moins de celles de la première République. Un empire français dans les frontières de l’ancienne monarchie, que dis-je, dans les limites plus étriquées encore de 1815, c’était à la longue un non-sens. De là, la nécessité de guerres périodiques et d’extensions territoriales. Mais il n’était pas de conquête qui fascinât autant l’imagination des chauvins français que celle de la rive gauche allemande du Rhin. Une lieue carrée sur le Rhin leur disait plus que dix dans les Alpes ou n’importe où ailleurs. Une fois le Second Empire devenu un fait acquis, la revendication de la rive gauche du Rhin, en bloc ou par morceaux, n’était qu’une question de temps. Le temps en vint avec la guerre austro-prussienne de 1866 5 ; frustré par Bismarck et par sa propre politique de tergiversations des « compensations territoriales » qu’il attendait, il ne resta plus alors à Bonaparte que la guerre, qui éclata en 1870, et le fit échouer à Sedan et, de là, à Wilhelmshöehe6.
5. Bismarck, grand chancelier de Prusse, provoqua une guerre contre l’Autriche dans l’espoir de réaliser l’unité allemande, promettant des territoires à Napoléon III en échange de sa neutralité. Ces promesses ne furent pas tenues… (N.d.É.)
6. Château situé près de Cassel en Allemagne où Napoléon III a été placé en résidence surveillée entre le 5 septembre 1870 et le 19 mars 1871 après s’être constitué prisonnier lors de la bataille de Sedan. (N.d.É.)
20
La Commune de Paris
La suite nécessaire en fut la révolution parisienne du 4 septembre 1870. L’empire s’écroula comme un château de cartes, la république fut de nouveau proclamée. Mais l’ennemi était aux portes : les armées impériales étaient ou enfermées sans recours dans Metz, ou prisonnières en Allemagne. Dans cette extrémité, le peuple permit aux députés parisiens de l’ancien Corps législatif7de se constituer en « gouvernement de la Défense nationale ». Il le permit d’autant plus volontiers qu’alors, afin d’assurer la défense, tous les Parisiens en état de porter les armes étaient entrés dans la Garde nationale8et s’étaient armés, de sorte que les ouvriers en constituaient maintenant la grande majorité. Mais l’opposition entre le gouvernement composé presque uniquement de bourgeois et le prolétariat armé ne tarda pas à éclater. Le 31 octobre 1870, des bataillons d’ouvriers assaillirent l’hôtel de ville et firent prisonniers une partie des membres du gouvernement ; la trahison, un véritable parjure de la part du gouvernement, et l’intervention de quelques bataillons de petits-bourgeois, leur rendirent la liberté et, pour ne pas déchaîner la guerre civile à l’intérieur d’une ville assiégée par une armée étrangère, on laissa en fonction le même gouvernement.
7. Assemblée législative française instituée par la constitution du 14 janvier 1852. Ses membres étaient élus pour six ans au suffrage universel direct uninominal à deux tours. Les élections ont eu lieu régulièrement en février 1852, en juin 1857, en mai 1863 et en mai 1869. (N.d.É.)
8. Historiquement, nom donné lors de la Révolution française à la milice de citoyens formée dans chaque ville, à l’instar de celle créée à Paris en 1789. Elle a existé jusqu’à sa dissolution en juillet 1871, aux lendemains de la répression de la Commune. (N.d.É.)
21
Introduction
Enfin, le 28 janvier 1871, Paris affamé capitulait. Mais avec des honneurs inconnus jusque-là dans l’histoire de la guerre. Les forts furent abandonnés, les fortifications désarmées, les armes de la ligne et de la garde mobile livrées, leurs soldats considérés comme prisonniers de guerre. Mais la Garde nationale conserva ses armes et ses canons et ne se mit que sur un pied d’armistice avec les vainqueurs. Et ceux-ci même n’osèrent pas faire dans Paris une entrée triomphale. Ils ne se risquèrent à occuper qu’un petit coin de Paris, et encore un coin plein de parcs publics, et cela pour quelques jours seulement ! Et pendant ce temps, ces vainqueurs qui durant cent trente et un jours avaient assiégé Paris, furent assiégés eux-mêmes par les ouvriers parisiens en armes qui veillaient
Napoléon III et Bismarck se rencontrent à Donchéry (Ardennes), le 2 septembre 1870 après la Bataille de Sedan, 1878, peinture de Wilhelm Camphausen (1818-1885).
22
La Commune de Paris
avec soin à ce qu’aucun « Prussien » ne dépassât les étroites limites du coin abandonné à l’envahisseur, tant était grand le respect qu’inspiraient les ouvriers parisiens à l’armée devant laquelle toutes les troupes de l’empire avaient déposé les armes ; et les Junkers9prussiens, qui étaient venus assouvir leur vengeance au foyer de la
9. Le mot désigne à l’origine un jeune seigneur, c’est-à-dire le fils d’un seigneur terrien et, plus tard, les seigneurs terriens eux-mêmes. Au Moyen Âge, un junkerétait le souvent un noble peu fortuné au service d’un seigneur plus influent. Bon nombre d’entre eux ont effectué une carrière de soldats ou de mercenaires s’élevant parfois au rang de commandants influents, et de grands propriétaires. (N.d.É.)
Gouvernement provisoire dirigé par Adolphe Thiers. De droite à gauche : J. Ferry, E. Picard, J. Simon, G Pagès, A. Thiers, J. Favre, C. Pelletan et L. Gambetta, photomontage de Ernest-Eugène Appert, 1870.
23
Introduction
révolution, durent s’arrêter avec déférence devant cette même révolution armée et lui présenter les armes !
Pendant la guerre, les ouvriers parisiens s’étaient bornés à exiger la continuation énergique de la lutte. Mais, maintenant qu’après la capitulation de Paris la paix allait se faire, Thiers, nouveau chef du gouvernement, était forcé de s’en rendre compte : la domination des classes possédantes – grands propriétaires fonciers et capitalistes – se trouverait constamment menacée tant que les ouvriers parisiens resteraient en armes. Son premier geste fut de tenter de les désarmer. Le 18 mars 1871, il envoya des troupes de ligne avec l’ordre de voler l’artillerie appartenant à la Garde nationale et fabriquée pendant le siège de Paris à la suite d’une souscription publique. La tentative échoua ; Paris se dressa comme un seul homme pour se défendre, et la guerre entre Paris et le gouvernement français qui siégeait à Versailles fut déclarée. Le 26 mars, la Commune était élue ; le 28, elle fut proclamée ; le Comité central de la Garde nationale qui, jusqu’alors, avait exercé le pouvoir, le remit entre les mains de la Commune après avoir aboli par décret la scandaleuse « police des mœurs » de Paris. Le 30, la Commune supprima la conscription et l’armée permanente et proclama la Garde nationale, dont tous les citoyens valides devaient faire partie, comme la seule force armée. Elle remit jusqu’en avril tous les loyers d’octobre 1870, portant en compte pour l’échéance à venir les termes déjà payés, et suspendit toute vente
24
La Commune de Paris
d’objets engagés au mont-de-piété