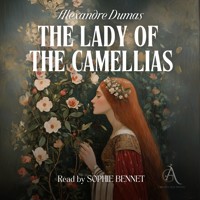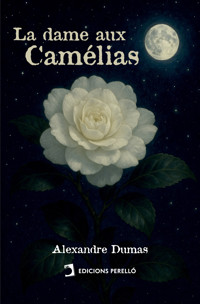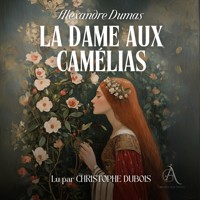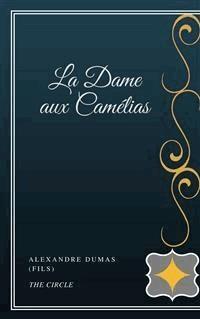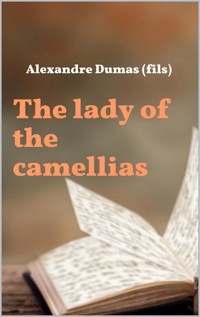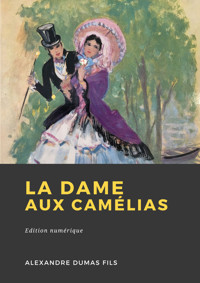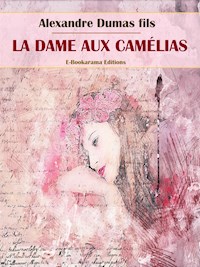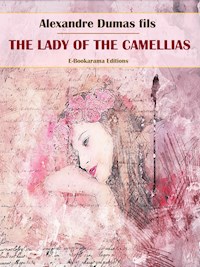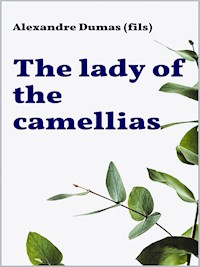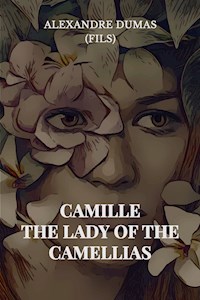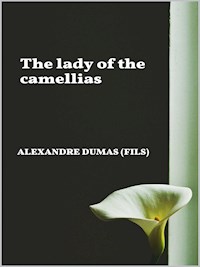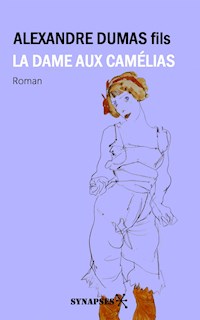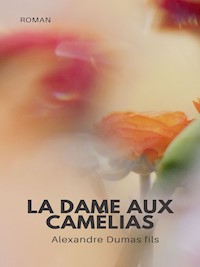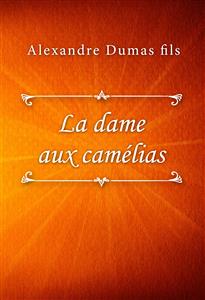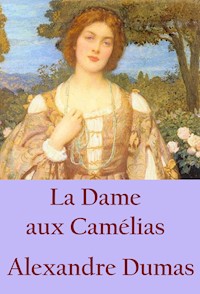Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Dans les premiers jours du mois de décembre 184., je revenais à peine d'un voyage dans le midi de la France, quand je fus incité à dîner chez une dame avec qui j'avais eu l'occasion de me trouver deux ou trois fois avant mon départ, mais dans des circonstances assez confidentielles pour que ces deux ou trois fois eussent établi entre nous une espèce d'intimité."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 668
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dans les premiers jours du mois de décembre 184., je revenais à peine d’un voyage dans le midi de la France, quand je fus invité à dîner chez une dame avec qui j’avais eu l’occasion de me trouver deux ou trois fois avant mon départ, mais dans des circonstances assez confidentielles pour que ces deux ou trois fois eussent établi entre nous une espèce d’intimité. En effet, j’avais été présenté à cette dame par un de mes bons amis, Jacques de Feuil, qui, n’ayant guère de secrets pour moi, m’avait mis au courant de leurs relations réciproques. Le mardi suivant, jour du dîner, à six heures moins quelques minutes, je me faisais annoncer chez madame de Wine.
Jacques était déjà arrivé : c’était son droit et son devoir. Il faisait de la musique dans le salon ; car il est bon de vous dire que Jacques était musicien, et si je vous nommais quelques-unes de ses œuvres, vous seriez tout étonné de retrouver, sous le pseudonyme dont je le couvre, un de ces amis de l’esprit et de l’âme comme le talent s’en crée aux plus grandes distances. Nous nous embrassâmes comme deux bons camarades qui se revoient. Madame de Wine parut quelques instants après.
C’était là une belle personne, dans toute l’acception du mot. Comment n’eût-elle pas été belle avec des détails comme ceux-ci : des yeux noirs admirables, ombragés de longs cils et noyés dans la nacre la plus pure, des cheveux d’Italienne, abondants, soyeux, brillants sur les tempes, et se terminant en un lourd chignon sur un cou rond, ayant, collier naturel, les deux plis circulaires du cou de la Vénus antique ; un nez droit que Minerve eût pu réclamer, une bouche arquée, rose, entre les lèvres de laquelle étincelaient les dents, une taille mince dont la souplesse donne de si jolis reflets à la soie qui la couvre, un bras à la fois ferme et plein d’abandon. Mais ce qui faisait surtout madame de Wine remarquable, un détail pour lequel seulement on eût aimé une femme laide si cette femme l’eût possédé, c’étaient ses pieds. Ces pieds, je l’avoue, étaient une merveilleuse plaisanterie de la nature. Jamais jusqu’alors il n’était venu à l’idée de personne qu’on pût marcher avec des pieds pareils, et cependant elle marchait, et beaucoup, et souvent, pour les faire voir, et j’eusse défié qui que ce fût, un fils déshérité, un négociant au moment de faire faillite, un amoureux courant à son premier rendez-vous, de ne pas se retourner en les voyant passer à côté d’eux.
Madame de Wine pouvait avoir vingt-six ou vingt-sept ans. Il y avait des jours où elle n’en paraissait pas plus de dix-huit, et le mardi où je vins dîner chez elle peut être compté dans ces jours-là. Vêtue d’un corsage blanc et d’une jupe de taffetas rose, elle avait l’air d’une toute jeune fille. Elle me tendit affectueusement la main ; elle semblait s’assurer que j’étais bien son ami, et elle me remercia d’être venu plus que je ne méritais d’être remercié. Nous nous mîmes à causer de mon voyage, d’un voyage qu’elle aussi avait fait à Bagnères pendant le mois de juillet, et elle me dit même : « Grondez monsieur de Feuil ; il n’a jamais voulu venir passer huit jours avec moi à Bagnères ! ce n’eût pourtant pas été une grande fatigue… » Et, à la suite de cette parole, elle jeta sur moi un regard triste dans lequel je lisais couramment la confidence d’un chagrin.
Il paraît que mon ami Jacques n’était pas toujours ce qu’il eût dû être. Cependant j’attachai peu d’importance à ces petits reproches, si fréquents de la part des femmes, et je mis la conversation sur un autre sujet, en attendant les trois derniers convives, qui étaient sa mère, une amie et un monsieur d’une soixantaine d’années, provincial dont madame de Wine avait fait la connaissance à Bagnères, et qui avait eu pour elle toutes les petites prévenances locales si bien appréciées des femmes.
Quant à Jacques, lequel, pendant que nous causions, regardait, un peu en homme qui s’ennuie, les gravures d’un keepsake, c’était un grand garçon de vingt-sept ans. Notre amitié datait du collège. D’ordinaire ces amitiés manquent de solidité : elles tombent sans secousse, comme les premières dents, pour faire place aux amitiés, sinon plus douces, du moins plus fermes, que créent, dans l’âge mûr, les intérêts et les passions du monde. Nos rapports, à nous, n’avaient fait au contraire que se resserrer de plus en plus. Il faut dire aussi que Jacques était une nature exceptionnelle, en dehors même de son talent. Esprit enthousiaste, aussi prompt à la rêverie qu’à la gaieté, souvent profond, toujours original, toujours artiste, cœur généreux, âme indépendante, santé de fer, il avait tout ce qui donne à la vie une allure franche, une raison utile et agréable d’être, et d’être longtemps. Au collège, c’était ce qu’on appelle un beau paresseux, sautant perpétuellement hors du cercle des études classiques pour courir à travers cette fantaisie sans but, sans cause et sans résultat qui indique déjà chez un enfant une organisation d’élite. Il aimait tout ce qui n’était pas ce qu’on lui disait d’aimer : la musique, le dessin, la nature. Aussi passait-il bien des dimanches en retenue. Alors il se mettait dans un coin de la salle et rêvait. Il me semble le voir encore, avec ses cheveux blonds, ses grands yeux bleus et sa figure un peu pâle, qui faisait dire : « Pauvre enfant, il ne vivra pas ! » car, comme il arrive souvent, la santé ne devait lui venir qu’avec l’adolescence.
Tout jeune, il avait perdu son père. Quelques-uns de mes camarades, doués de cette méchante curiosité qu’on ne rencontre que trop chez les enfants, disaient même que ce père n’avait jamais existé. Peu importe. Aujourd’hui, grâce à Dieu, un homme a le droit d’être, du moment qu’il est ; et quand il a le talent et la probité, il a la plus noble et la plus chère famille qu’un homme puisse avoir ; tant pis pour son père s’il ne le connaît pas.
En attendant, une femme, jeune encore à cette époque assez belle, venait deux ou trois fois la semaine voir Jacques. C’était sa mère, toujours seule, vêtue de couleur sombre, et le visage caché sous un voile. Tous deux allaient s’asseoir sous une grande allée réservée aux parents ; ils causaient pendant une demi-heure, et Jacques revenait presque toujours de ces entrevues avec les yeux un peu rouges. Pourquoi ces larmes ? Sa mère l’avait-elle grondé de sa négligence au travail ? Non, cette mère-là ne grondait pas. Je crois plutôt que leurs entretiens roulaient sur des souvenirs tristes pour l’un et pour l’autre ; car bien souvent, quand ils se séparaient, les yeux de la mère étaient aussi humides que ceux de l’enfant. Sans doute il avait été question de ce père mort ou inconnu, et, à coup sûr, le cœur de notre jeune camarade renfermait déjà une douleur ou un de ces premiers secrets de la vie qui font les pâleurs précoces et les mélancolies faciles.
Mais à quoi bon nous arrêter à l’enfance de Jacques ? À l’heure où nous faisons ou plutôt où vous faites sa connaissance, il n’est plus l’écolier paresseux, l’orphelin triste, l’enfant maladif. C’est un beau, grand et brave garçon, plein de cœur et de talent, déjà fils de ses œuvres, aimant toujours sa mère, et aimé d’une des plus belles personnes de Paris. Je ne vois pas que ce soit là une condition bien malheureuse.
Les convives attendus arrivèrent bientôt. La mère de madame de Wine était une assez désagréable personne. Avare égoïste, gourmande, ayant horreur de la jeunesse, qu’elle n’avait plus, et de la beauté, qu’elle n’avait jamais dû avoir, elle portait avec elle une odeur sèche de vieille médisance et de mauvaise humeur. Elle n’eût jamais aimé sa fille, quand même elle eût été capable d’aimer quelqu’un. Elles se voyaient parce qu’il faut qu’une fille et une mère, quand bien même elles ne s’aiment pas, se voient de temps en temps. Le monde dit et veut de ces choses-là, mais il ne les explique pas.
Des cheveux teints, des petits yeux, les joues trop grosses, le nez un peu de travers, le menton maigre, la bouche mince et rentrante ; une robe de soie amarante, un bonnet à rubans de même couleur : voilà cette mère que Jacques alla saluer quand elle se fut assise, mais à laquelle il tourna le dos presque immédiatement. Quant à la seconde dame, c’était autre chose.
Lorsqu’elle parut, je crus voir entrer une petite princesse souffrante, venant, dans le négligé de l’incognito, visiter une amie. En effet, rien de plus simple que sa toilette, mais rien de plus élégant.
Mademoiselle de Norcy, car cette personne n’était pas mariée, pouvait avoir trente ans. C’était l’incarnation du goût et de la distinction. Certes, elle n’était pas, comme beauté, comparable à madame de Wine, et cependant il y avait dans son visage quelque chose qui manquait à l’autre, et qui la faisait aimer tout de suite. La tendresse, la bienveillance, la câlinerie, la propension à tous les sentiments délicats de la femme, les signes de la race, du cœur et de l’esprit, se montraient franchement au milieu de traits fins, tranquilles, harmonieux, dont l’ensemble constituait une charmante et douce figure. À côté de cette femme, madame de Wine perdait beaucoup, et si, moi, j’eusse eu à choisir entre l’opulente beauté de l’une et le charme caressant de l’autre, ma sympathie eût peut-être triomphé de mon amour-propre, et j’eusse, je crois, préféré la moins belle.
Tels étaient nos convives, avec un provincial, brave homme se mouchant encore dans des foulards jaunes à fleurs rouges, et dont l’existence s’écoulait entre la lecture des journaux, la promenade et la partie de whist ; le tout mêlé de conseil municipal, d’influence administrative et d’une dizaine de mille livres de rente. Monsieur Gabert avait bien un peu les défauts de la province : son esprit était quelquefois comme son habit, en retard de deux ou trois ans sur ceux de la capitale, malgré ses rapports fréquents avec les Parisiens qui allaient aux eaux ; il parlait politique au dessert, et disait :
– Moi, voilà ce que je veux.
Comme tous les gens de son âge, il se croyait de l’expérience, et comme toutes les autorités de petite ville, il interrompait les conversations pour y clouer son opinion à voix haute et dans des termes un peu prétentieux ; mais, après tout, c’était là un bonhomme, prêt à être un excellent grand-papa, ce à quoi le destinait sa fille, mariée depuis quelques mois, et qu’il venait visiter à Paris.
Voilà tout.
On nous servit un fort bon dîner, dans une salle bien chaude, bien éclairée, avec des fleurs ; et, peu à peu, des vins francs, l’appétit et la jeunesse firent disparaître je ne sais quelle contrainte qui pesait sur tout le monde au commencement de ce repas, et qui venait d’une inquiétude que, malgré tous ses efforts, dissimulait mal la maîtresse de la maison. Enfin Jacques se montra assez gai, madame de Wine parut joyeuse, et nous gagnâmes ainsi la fin du repas, au milieu d’une causerie générale qu’essayait en vain d’embarrasser l’esprit désagréable de la mère.
Après le dîner, on fit de la musique. Puis dix heures vinrent. Mademoiselle de Norcy se retira, accompagnée de monsieur Gabert, qui lui avait offert son bras. La mère s’accrocha à eux, et nous restâmes seuls, madame de Wine, Jacques et moi. Le cercle de la conversation se resserra donc encore et devint plus intime. On parla de tout un peu, d’art, de vers, d’amour ; mais les bougies diminuaient ; une porte entrouverte, celle de la chambre à coucher, laissait voir une partie des objets de cette chambre noyés dans la pâle clarté d’une lampe de nuit. Je pensai, c’était mon droit de confident, qu’il y avait peut-être encore quelqu’un de trop dans le salon, et je me levai pour me retirer comme minuit sonnait. À mon grand étonnement, Jacques fit ce que je n’eusse certainement pas fait à la suite d’une pareille soirée : il se leva aussi, et après avoir baisé la main de madame de Wine, laquelle me regardait tristement en ayant l’air de dire : « Vous voyez comme il est ! » il me prit le bras et sortit avec moi, presque brusquement et comme s’il eût craint d’être retenu.
Madame de Wine nous accompagna jusqu’à la porte, elle se pencha même sur la rampe pour nous voir descendre ; elle échangea un dernier adieu avec nous, et je me trompe fort, ou deux larmes longtemps contenues vinrent briller à ses grands yeux. Enfin elle rentra chez elle et j’entendis sa porte se refermer lentement, comme pour rappeler Jacques ; mais il n’y songeait guère, et, arrivé dans la rue, il me serra la main et me dit :
– Nous demeurons du côté opposé. Adieu donc ; mais demain j’irai te voir.
Et il ajouta, comme pour repousser à l’avance mes questions :
– J’ai beaucoup de choses à te compter. Demain, à cinq heures, j’irai te prendre ; nous dînerons ensemble.
Et là-dessus il s’éloigna.
Le lendemain matin, vers onze heures à peu près, mon portier monta me dire que la dame chez qui j’avais dîné la veille me faisait demander si elle pouvait monter chez moi. Elle attendait ma réponse dans une voiture. Je répondis que oui, et quelques instants après madame de Wine parut. Elle était dans une grande agitation et très pâle.
– Pardonnez-moi mon indiscrétion, me dit-elle, mais il faut absolument que je vous parle.
Je la fis asseoir, en devinant bien de quoi il allait être question.
– Écoutez, monsieur, me dit-elle, vous êtes l’ami de Jacques, vous savez tout ce qu’il fait. Je vous en supplie, où est-il allé hier en sortant de chez moi ?
– Chez lui, madame.
– Non.
J’étais fort embarrassé ; mais avant tout il fallait tranquilliser cette femme.
– On vous a trompée, madame ; j’ai accompagné Jacques.
Elle m’interrompit.
– Merci, monsieur ; mais, malheureusement, je sais le contraire. J’ai attendu jusqu’à quatre heures du matin devant sa porte.
– Il était rentré, sans doute, avant que vous y fussiez.
– Non, monsieur, non ; je m’étais informée.
Il n’y avait rien à répondre.
– Jacques ne m’aime plus, monsieur !
Et, cette fois, la pauvre femme ne put retenir ses larmes.
– Il me trompe : il aime une autre femme, j’en suis sûre. Si vous saviez comme il est changé pour moi ! Oh ! je suis bien malheureuse ! et c’est mal à lui de me faire tant de peine, car personne ne l’aimera jamais comme je l’aime. Depuis quinze mois que nous nous connaissons, il n’a pas un reproche à me faire. Je ne suis occupée qu’à lui être agréable. Je vais au-devant de ses désirs, je me plie à toutes ses habitudes, à tous ses caprices. Je n’ai de volonté que la sienne. Il n’aime pas ma mère, je la vois le moins possible ; j’ai fermé ma porte à tous mes amis pour l’ouvrir aux siens. Dès que j’ai appris votre retour, sachant le plaisir qu’il aurait à vous voir, je vous ai écrit pour le faire trouver avec vous. Je ne suis un obstacle ni à son travail ni à ses relations. Je sais ce que c’est qu’un artiste, de son âge surtout. Tout ce qu’il me disait de faire, je le faisais. Eh bien ! j’ai l’air de l’ennuyer ; il vient me voir cinq minutes, et à peine est-il assis qu’il se lève pour s’en aller. Il passe toutes ses soirées dehors… Il est injuste pour moi, il me blesse dans toutes mes petites vanités de femme. Si je mets une robe nouvelle, il la trouve de mauvais goût, il critique tout ce que je fais, non seulement entre nous, mais encore devant témoins ; quand je lui demande de m’accompagner quelque part, il me refuse, et savez-vous sous quel prétexte ? il prétend que je suis trop belle, que tout le monde me regarde et que cela l’humilie. Est-ce là une raison à donner à une femme ? N’est-ce pas la conduite d’un homme qui n’aime plus ? Cependant j’oublierais tout si je ne devinais un autre amour. Hier au soir, n’ai-je pas fait tout au monde pour le retenir ? Je n’ai pu résister alors au douloureux désir de me convaincre. Je suis descendue derrière vous, j’ai pris une voiture et me suis rendue chez lui. Oh ! si je l’avais vu rentrer, je me serais dit : « Il revient travailler ; un esprit comme le sien a souvent besoin de solitude… » Je me serais donné toutes les consolations qu’un cœur toujours prêt à pardonner trouve au fond de son amour. Mais il n’est pas revenu. Quelle nuit j’ai passée ! Où était-il ? que faisait-il ? Vous comprenez que je ne puis vivre dans de pareilles agitations. Je suis rentrée brisée, malade de chagrin et de froid ; j’avais la fièvre ; j’ai pleuré tout le reste de la nuit… Ce matin, je me suis arrêtée à la résolution de m’adresser à vous. Rendez-moi un service dont je vous serai reconnaissante toute ma vie. Voyez Jacques, sachez la vérité et dites-la-moi. Je vous jure qu’il ne connaîtra jamais que je l’ai apprise ; mais, quand j’aurai la certitude qu’il ne m’aime plus, qu’il aime une autre femme, alors je m’éloignerai. Ma santé, toujours un peu faible, me donnera un prétexte, et j’irai, dans quelque coin perdu, essayer d’oublier les rêves que j’avais faits : car j’avais franchement lié mon avenir à celui de Jacques, car je faisais des vœux pour son talent, je l’encourageais, je le soutenais, je l’exaltais de toutes mes forces. Je trouve, moi, qu’il est le plus grand homme de la terre, et je voudrais que tout le monde fût de mon avis ; enfin, vous savez ce que c’est qu’une femme qui aime. Maintenant je compte sur vous ; parlez-moi franchement, ne me donnez pas une espérance qu’il me faudrait reperdre, et, quoi que vous me disiez, je vous le répète, croyez à ma reconnaissance.
Que c’était bien là, n’est-ce pas, le langage d’un cœur qui voudrait s’être trompé, et ne demande qu’un mot pour le croire ! J’étais ému par ces paroles touchantes, et je répondis à madame de Wine :
– Jacques vous aime, madame ; j’en suis convaincu. Ces inégalités dont vous vous plaignez ont toujours fait partie de son caractère ; je le sais, moi qui ai été élevé avec lui. En outre, nous autres artistes, nous avons parfois des caprices et des mauvaises humeurs comme les femmes. Peut-être vous exagérez-vous la situation. Je ne serais pas étonné que rien ne fût plus simple que l’emploi de cette nuit dernière, et que Jacques l’eût passée chez quelque ami, ou bien au bal, ou bien au jeu. Je l’ai connu un peu joueur autrefois. Le travail de tête commande souvent des distractions violentes. Puis, son art le met nécessairement en rapport avec des actrices, des danseuses. Il peut avoir été forcé d’aller chez l’une d’elles et de n’avoir pas voulu vous le dire, ce qui serait tout naturel : votre amour eût pu s’alarmer d’une chose qui, pour lui sans importance, pourrait vous paraître un danger. Enfin, madame, je le verrai aujourd’hui, je le questionnerai, et ce qu’il me dira, vous le saurez demain.
La conviction complète que je voulais faire passer dans l’esprit de madame de Wine, j’étais loin de l’avoir ; je comptais la tromper le plus longtemps possible, si malheureusement ses suppositions étaient fondées, mais j’avais l’intention sincère de lui ramener Jacques, en faisant comprendre à celui-ci que son bonheur était de ce côté-là. En effet, madame de Wine, jeune, belle, veuve, riche, libre, et suffisamment femme du monde, était, à mon avis, la plus agréable, la plus convenable liaison qu’il pût avoir. Sans doute il y avait infidélité de la part de Jacques ; mais ce n’était peut-être qu’un caprice pour quelque belle fille de théâtre, caprice sans racine, et qu’un peu de réflexion arracherait bien vite.
Madame de Wine me quitta beaucoup plus calme, et me fit promettre de ne pas parler à Jacques de la visite et de la mission dont elle m’avait chargé. À cinq heures il arriva, souriant, chantant, avec toutes les allures d’un homme heureux. Cette gaieté, en opposition avec la tristesse dont j’avais eu la visite le matin, m’inquiéta pour madame de Wine. Elle me parut d’un mauvais augure à l’endroit de ma négociation.
– Comme tu parais joyeux ! lui dis-je.
– Oui, je suis assez content.
– D’où viens-tu ?
– Je viens de monter à cheval.
– Et ce soir, que vas-tu faire ?
– Je n’en sais rien encore.
– Et cette nuit, où iras-tu ?
– Où j’ai été la nuit dernière.
– Et la nuit dernière où as-tu été ?
– Tu en demandes trop.
– Alors ce que j’ai supposé est vrai.
– Et qu’as-tu supposé ?
– Que tu es en train de tromper madame de Wine.
– Cela se pourrait bien.
– Tu as tort. Elle t’aime.
– Elle le croit, du moins.
– Moi, j’en suis sûr.
– Eh bien, tu verras qu’elle ne mourra pas de notre séparation.
– Tu comptes donc la quitter ?
– Il le faudra bien.
– Pauvre femme !
– Tu la plains ?
– Oui.
– Eh bien, tu as raison ! fit Jacques en devenant tout à coup sérieux, car nul n’était plus prompt que lui à passer d’une sensation à la sensation contraire ; tu as raison, et je la plains aussi ! Mais c’est plus fort que moi, mon cher, et en attendant, j’ai du bonheur à revendre. J’ai le cœur plein, le cerveau toujours prêt, je respire la vie à pleins poumons ; j’aime enfin, j’aime ! Eh bien, je te le jure, cet amour que j’éprouve, j’ai fait tout au monde pour qu’il me vînt de madame de Wine. J’aurais voulu aimer cette femme plus que toute autre. Impossible ! comprends-tu ? Et je n’ai fait que de la mauvaise musique pendant que j’étais avec elle ; aujourd’hui, veux-tu que je te fasse un chef-d’œuvre comme Guillaume Tell ou Don Juan ? Donne-moi une plume et du papier, je vais te le faire.
– Et si tu te trompes ?
– Je ne me trompe pas.
– Et cela dure…
– Depuis six semaines.
– Et depuis ce temps madame de Wine…
– J’invente tous les jours un nouveau prétexte pour ne pas la voir ou pour la voir moins. Je suis injuste envers elle et ne puis être autrement. Quand je pense à toutes les petites infamies que je lui ai faites pour lui voler un jour, une heure de mon temps, c’est honteux et j’en rougis. Mais que faire ? Je ne peux pas lui dire brutalement que je ne l’aime plus, que je ne l’ai même jamais aimée ; et cependant ce serait plus loyal et moins cruel que de la tromper ainsi et de la faire souffrir ; car elle souffre, je le vois bien. Ah ! si cette rupture pouvait venir d’elle ; si elle pouvait tout à coup s’éprendre d’amour pour quelqu’un ; si elle pouvait être heureuse avec un autre, quel bon ami je serais pour l’un et pour l’autre ! Pourquoi faut-il qu’un homme ne puisse pas voir une jolie femme sans lui faire la cour, même lorsqu’il ne l’aime pas ? Quelle sotte et ridicule tradition ! Si j’avais su m’en écarter, j’eusse été pour madame de Wine ce que je suis pour mademoiselle de Norcy, qui m’adore ; il est vrai que mademoiselle de Norcy a cette grande occupation du cœur indispensable aux femmes, un de ces beaux, profonds et fermes amours qui embrassent toute une vie, et qui, au contraire de la foudre, font vivre ceux qu’ils touchent et tuent ceux qu’ils quittent. Madame de Wine n’avait pas cette occupation, et elle a espéré que je la lui donnerais, comme j’ai espéré la trouver en elle. Eh bien, je me suis aperçu tout de suite que nous avions fait fausse route tous les deux. Ça n’a été qu’un mariage de raison, moins le mariage, heureusement. J’aurais peut-être dû la prévenir, et lui montrer le chemin par où elle pût revenir sur ses pas ; mais je suis égoïste comme tous les hommes ; et si je ne l’aimais pas, comme je n’aimais pas autre part, je ne dis rien et j’attendis. Pendant ce temps, elle s’habituait à moi, l’apathie de mon amour contribuait même à augmenter le sien, et aujourd’hui elle m’aime, pas autant qu’elle le croit, mais enfin elle m’aime bien, et ce lui sera une douleur que notre séparation. Mais, je te le répète, il faut que cette séparation ait lieu : je ne me donne même plus la peine de me cacher ; un jour elle apprendra tout, et Dieu sait ce qui arrivera ! Aussi, c’est la Providence qui t’a ramené à Paris, et j’ai compté sur toi pour le dénouement. En ta qualité de romancier, cette besogne te revient de droit. Trouve un moyen nouveau, original, qui me fasse changer ma charge d’amant contre la position d’ami, et tu m’auras rendu un véritable service.
– C’est bien résolu ?
– Certes.
– Sérieusement ?
– Sur l’honneur.
– Alors je puis tout te dire.
– Qu’y a-t-il donc ?
– J’ai eu la visite de madame de Wine.
– Quand ?
– Ce matin.
– Elle m’avait suivi hier, et elle sait tout ?
– Elle ne sait rien.
– Mais elle se doute de quelque chose ?
– Elle n’a pas le moindre soupçon.
– Que voulait-elle, alors ?
– Elle voulait me charger d’une commission pour toi.
– Qui est…
Je regardai attentivement Jacques pour bien voir l’effet de ma réponse.
– Qui est la même que celle dont tu veux me charger pour elle.
– Comment ! elle veut rompre ?
– Oui.
– Elle ne m’aime plus ?
– Non.
– Justement.
– Elle a un amant, peut-être ?
– Ah ! la charmante femme ! s’écria Jacques en me sautant au cou. Elle me tire d’un fier embarras !
À cette nouvelle, rien ne vibra chez Jacques, pas même l’amour-propre ; rien ne le piqua, pas même l’idée qu’il avait pu, en se posant en homme aimé, être ridicule un instant aux yeux de celui qui, depuis le matin, savait le contraire. Rien, enfin, ne troubla sa joie, pas même le soupçon tout naturel que je lui faisais un mensonge, et qu’il était impossible que madame de Wine m’eût brutalement chargé d’un si difficile message.
Décidément, il n’y avait plus d’espoir ; on pouvait jeter le drap sur cet amour ; il était bien mort, si toutefois il avait jamais existé.
Après m’être assez avancé dans l’intérêt de ma protégée (ce que je venais de faire était le seul moyen de me convaincre, non seulement moi, mais encore Jacques, de l’état réel de son cœur) ; après m’être ainsi avancé, dis-je, j’allais nécessairement avoir cette séparation sur les bras. Comment m’y prendrais-je, après l’espoir que j’avais donné le matin à cette femme éplorée, espoir qui, j’en étais sûr, n’avait fait que croître et fleurir ? J’envoyai tous les amoureux au diable ; cependant il me fallait détromper mon ami. Je ne pouvais laisser une minute de plus un pareil mensonge tacher la réputation et l’amour de madame de Wine : j’avouai tout.
– Tant pis pour toi, me dit Jacques, tire-toi de là comme tu pourras.
– Voyons, lui dis-je d’un ton sérieux, c’est assez plaisanter. Ne romps pas ainsi avec cette femme, après une liaison de quinze mois. Cherchons un moyen honorable qui sauve ta délicatesse et ne blesse pas trop son cœur et sa dignité.
– Quant au cœur de madame de Wine, je te l’ai déjà dit, ne te l’exagères pas plus qu’il ne faut. Il y a eu dernièrement entre nous une certaine histoire de bouquet qui m’a prouvé que ce cœur pourrait bien être en chemin, sinon vers un amour, du moins vers une consolation, et qu’il ne souffrirait pas autant que tu le crois.
– Qu’est-ce que c’est que cette histoire ?
– Tu vas encore reconnaître un tour du hasard. Tu sais que je suis l’homme le moins galant de la terre. Une femme à qui je donnerais ma vie sur un mot, il ne me viendrait pas l’idée de lui apporter un bouquet de violettes d’un sou. Je suis complètement ignorant de ces prévenances qui, à ce qu’il paraît, ont un prix énorme aux yeux des femmes, et font même tout le mérite de certains hommes. Il en résulte que, depuis que nous nous connaissions, je n’avais pas envoyé une fleur à madame de Wine, qui, du reste, n’en acceptait de personne. Celles qui entraient dans la maison y entraient, le jour de marché aux fleurs, achetées par elle, et, le soir, en venant, je les trouvais dans le boudoir ou dans le salon. Il y a environ trois semaines, un matin que j’avais, sans qu’elle pût s’en douter, quelque chose à me reprocher vis-à-vis de madame de Wine, je passe devant la boutique d’un fleuriste et j’y vois des violettes de Parme admirables. J’en fais faire un énorme bouquet et je l’envoie à madame de Wine, sans y joindre ma carte, pour avoir, quand je la verrais, le plaisir de me vanter d’une galanterie si nouvelle. J’arrive à cinq heures du soir, j’entre dans le salon, je regarde, pas de bouquet ! je passe dans la salle à manger, pas de bouquet ! j’ouvre le boudoir, pas de bouquet ! rien non plus dans la chambre à coucher ! Restait le cabinet de toilette, vaste chambre très élégante, avec un lit où couche quelquefois la mère quand elle s’attarde chez sa fille. Je me disposais à y continuer mes recherches, que je faisais sans affectation, quand madame de Wine m’arrêta et me demanda où j’allais.
– Ma mère est dans ce cabinet de toilette, elle essaye une robe, n’entrez pas, me dit-elle d’un ton si naturel, qu’il n’y avait pas le moindre doute à élever. D’ailleurs, pourquoi aurais-je soupçonné madame de Wine d’un mensonge ? Je n’entre donc pas ; mais, intrigué de n’avoir pas vu le bouquet, je lui dis :
– Est-ce qu’on ne vous a pas apporté un bouquet aujourd’hui ?
– Non.
– Vous en êtes sûre ?
– Très sûre.
– Demandez donc à votre femme de chambre.
La femme de chambre paraît.
– Marie, n’a-t-on pas apporté un bouquet à madame ?
– Non, monsieur.
Cependant il était impossible que le fleuriste eût gardé ce bouquet. Madame de Wine mentait-elle ? Je poursuivis :
– C’est bien étrange ! J’ai pourtant vu, ce matin, en passant devant votre porte, un homme qui apportait un bouquet dans la maison. Je ne sais quelle curiosité m’a poussé à le suivre ; il a demandé votre nom au concierge, est monté, et quand il est redescendu, il avait les mains vides.
Madame de Wine rougit.
– Ah ! oui, me dit-elle, un bouquet de violettes ; mais il n’était pas pour moi.
– Pour qui donc était-il ?
– Pour ma mère.
– Pour votre mère ? Depuis quand lui envoie-t-on des bouquets, et surtout chez vous ?
– Elle l’a acheté elle-même, et passant la journée avec moi, elle l’a fait apporter ici ; mais moi, personnellement, je n’ai pas reçu de bouquet.
J’espère que le mensonge était flagrant !
– Eh bien ! continuai-je, veuillez demander à votre mère où elle a acheté ce bouquet.
– À quoi bon ?
– Je veux vous envoyer le pareil.
– C’est inutile.
– Votre mère est dans le cabinet de toilette, elle peut vous répondre tout de suite. Voulez-vous que je lui demande moi-même ?
– Non, j’y vais.
Elle sortit une minute, et reparut en me disant avec un aplomb qui prouvait une certaine habitude du mensonge :
– Elle l’a acheté au marché de la Madeleine.
– Eh bien, il m’a paru fort beau, lui dis-je du ton le plus naturel, et je vais vous envoyer le pareil en m’en allant.
Je causai quelques instants encore et je partis. Je voulais avoir le cœur net de cette aventure. J’envoyai chez la mère de madame de Wine. Elle était si peu chez sa fille, qu’elle n’était pas sortie de la journée. Le mensonge, le double mensonge même, était donc flagrant. Maintenant, pourquoi madame de Wine m’avait-elle dit que sa mère était dans son cabinet de toilette ? pour que je n’y entrasse pas. Pourquoi ne voulait-elle pas que j’y entrasse ? parce qu’elle ne voulait pas que je visse ce bouquet. Pourquoi ne voulait-elle pas que je le visse ? évidemment parce qu’elle le croyait venu de la part d’un autre que moi. Donc il y avait un mystère dans la maison, et comme je ne demandais qu’une chose, c’était que madame de Wine eût à mon égard un tort quelconque pour m’autoriser, vis-à-vis de ma conscience, à continuer ce que je faisais, je fus enchanté de cet incident. Je ne lui dis rien, je ne la surveillai même pas ; mais je me gardai cette porte dérobée pour m’échapper le jour où décidément il faudrait en finir. Ce jour est venu ; je te livre le fait, il est authentique ; tires-en le parti que tu voudras. Je n’en déduis pas que madame de Wine ait un autre amant ; cependant, comme tu l’as vu tout à l’heure, cette nouvelle ne m’étonnerait pas ; mais il vient certainement chez elle quelqu’un que je ne connais pas, dont elle accepte des bouquets qu’elle me cache. Ce n’est peut-être qu’un enfantillage ; tant pis, nous en ferons un prétexte. De sa position actuelle à celle de successeur, le dépit aidant, il n’y aura pas loin pour le galant inconnu ; et de là à se consoler, il n’y aura pas loin pour madame de Wine. Du reste, ne t’a-t-elle pas demandé de lui dire toute la vérité ? Cette démarche ne prouve-t-elle pas une âme prête à tout apprendre ?… Elle se retirera dans un coin du monde ! Toutes les femmes en disent autant en pareil cas, mais heureusement peu le font. Cependant elle souffre, je le crois, car c’est encore moi qu’elle aime le mieux ; mais, sois-en bien convaincu, elle se sent déjà un appui d’un autre côté. Elle préférerait peut-être n’en avoir pas besoin ; mais elle jette de temps en temps les yeux dessus. C’est ma conviction. Enfin, mon cher ami, c’est plus fort que moi, je ne puis prendre cette liaison au sérieux, surtout maintenant. Mets-toi donc à l’œuvre dès ce soir, et, en attendant, allons dîner.
Peut-être, à l’heure où Jacques prononçait le nom de madame de Wine pour souhaiter de rompre avec elle, un autre, l’inconnu au bouquet, prononçait-il ce nom avec tous les rêves et toutes les ambitions de l’amour. Ainsi va le monde. Que de femmes il y a dans une femme ! et c’est bien heureux. Buffon a dit : « Le style, c’est l’homme ; » on pourrait dire de la femme ce qu’il a dit du style, car la femme n’est pas ce qu’elle est, mais ce que l’homme la voit.
Je dois dire que le récit de Jacques atténua un peu l’effet produit sur moi par la visite du matin, et madame de Wine m’apparut déjà sous un autre aspect. J’acceptai donc la mission diplomatique dont mon ami me chargeait. C’était plus qu’une mission à remplir ; c’était peut-être une étude à faire, et c’est mon métier que ces sortes d’études.
Il me restait à apprendre comment Jacques avait contracté la nouvelle liaison dont l’aurore servait de couchant à l’autre. Heureusement il n’était pas capable, surtout avec moi, de s’arrêter à moitié chemin de ses confidences, et je me promis de le questionner tout en dînant.
– Où allons-nous dîner ? lui dis-je.
– Chez Lether.
– Rue de Rivoli ?
– Justement : je dîne là tous les jours.
– C’est bien loin de toi cependant.
– Il le faut ; mais allons, je suis déjà en retard.
Cette nécessité de dîner tous les jours au même endroit, cette crainte d’être en retard pour dîner dans un restaurant, se rattachaient bien certainement à l’histoire que je voulais connaître. Nous étions déjà en route.
– Ah çà ! lui dis-je, maintenant tu vas me conter…
– Je te conterai tout, mais pas ce soir… un jour que nous aurons le temps.
– C’est donc bien long ?
– Assez.
– Et ce soir ?
– Je ne pourrai peut-être pas rester plus d’une demi-heure avec toi.
– Que fais-tu donc ?
– Je n’en sais rien encore, mais je vais le savoir. D’ailleurs, tu dois aller chez madame de Wine.
Nous arrivâmes chez Lether.
– Il n’est venu personne pour moi ? dit Jacques au garçon.
– Non, monsieur, pas encore.
La salle était pleine. Ce n’était pas le lieu ni le moment d’insister pour une confidence. Nous causâmes donc de toute autre chose. À peu près vers le milieu du dîner, un homme, qu’il était facile de reconnaître pour le portier d’une grande maison, entra et marcha droit vers nous. Jacques lui tendit la main et prit un petit papier plié, mais non cacheté, et renfermant deux lignes tout au plus.
– C’est bien, dit-il.
L’homme se retira sans dire un mot.
– On t’écrit des lettres qui me paraissent assez mystérieuses, dis-je à Jacques. Pourquoi ne les cachette-t-on pas ?
– Il n’y a pas de danger que le messager les lise.
– Il ne sait pas lire ?
– Si ; mais elles sont illisibles.
Et en même temps il me passait le papier en me disant :
– Essaye.
Il y avait deux lignes écrites au crayon. Il m’eût fallu une demi-heure pour les déchiffrer. Il était évident que Jacques ne lisait pas, mais devinait cette écriture, véritable écriture de femme paresseuse et pressée.
– Eh bien, reprit Jacques, ces deux lignes disent : « Je viendrai vous chercher à sept heures et demie. Je prends votre soirée. »
– Ainsi, à sept heures et demie…
– Je te quitte ; et comme il est sept heures vingt minutes, hâtons-nous.
Cinq minutes après, nous nous promenions sous les arcades, de long en large, comme des gens qui attendent. J’offris à Jacques de le laisser seul.
– Non, me dit-il ; seulement, quand tu verras un petit coupé avec deux chevaux blancs venir de notre côté, tu pourras t’en aller.
– Bien.
Au même moment, le bruit de roues rapides et sonores se fit entendre, deux lanternes brillantes, interceptées périodiquement par les piliers des arcades, roulèrent vers nous, en nous regardant pour ainsi dire. Jacques me donna une poignée de main ; la course de la voiture se ralentit, s’arrêta tout à fait ; la portière s’ouvrit toute seule avant que le valet de pied eût le temps de descendre du siège, et Jacques sauta dans le coupé, qui repartit immédiatement sans qu’on eût besoin de donner un ordre. Il passa à côté de moi ; je vis une petite main gantée qui achevait de le fermer, et, dans le fond, une femme, un voile, une ombre !
Il y avait dans ce bien simple détail un charmant parfum de mystère. La voiture disparut bientôt, et moi, je me rendis chez madame de Wine en me demandant comment j’allais présenter la difficile mission dont j’étais porteur. Heureux homme que ce Jacques, qui négociait ses amours lui-même, et divorçait par ambassadeur !
Deux ou trois fois je m’arrêtai dans l’escalier de madame de Wine, pour mettre de l’ordre dans mon message. Enfin je sonnai, résolu à prendre conseil des circonstances.
– Madame est sortie, me dit la femme de chambre.
– Pour toute la soirée ?
– Oui, monsieur. Elle a dit qu’elle ne rentrerait peut-être que dans la nuit.
– Elle est à la campagne ?
– Je ne sais pas, monsieur.
– Elle n’a rien dit pour monsieur de Feuil, dans le cas où il viendrait ? Je viens de sa part.
– Rien.
Cette sortie de madame de Wine était bien extraordinaire. En effet, elle passait toutes ses soirées chez elle à attendre Jacques, et, ce soir-là, elle avait une seconde raison de ne pas sortir, puisqu’elle devait attendre impatiemment ma réponse. Cependant il ne me restait pas autre chose à faire qu’à m’en aller, ce que je fis. J’entrai dans un théâtre, et sur les dix heures je revins chez moi.
– Voici une lettre qu’on a apportée pour monsieur, me dit mon portier : on attend impatiemment la réponse.
Je regardai l’adresse de la lettre ; je ne connaissais pas l’écriture.
« Dès que vous recevrez ce mot, passez chez moi, je vous prie, monsieur ; j’ai quelque chose de très important à vous dire, un service à vous demander.
E. DE NORCY,
Rue de Provence… »
Qu’est-ce que cela voulait dire ? Bien certainement il s’agissait de madame de Wine. Je courus chez mademoiselle de Norcy. Ce fut elle-même qui vint m’ouvrir. Elle me fit signe de ne pas parler, me prit la main et me conduisit dans la salle à manger.
– Parlons bas, me dit-elle, il ne faut pas qu’on sache que vous êtes ici.
– Qu’arrive-t-il donc ?
– Madame de Wine est dans ma chambre, et dans un état qui vous ferait pitié. Elle sait tout !
– Que sait-elle ?
– La nouvelle liaison de monsieur de Feuil.
– Elle ne fait que s’en douter, je crois.
– Elle en est sûre. Elle m’a nommé la femme.
– Comment sait-elle une chose que je ne sais pas moi-même ?
– Elle a reçu une lettre anonyme.
– Quand ?
– Ce matin, en revenant de chez vous.
– Vous savez donc…
– Oui, je l’ai conduite jusqu’à votre porte. Je ne pouvais la quitter dans l’état où elle était. J’ai passé une partie de la nuit avec elle. À quatre heures du matin, elle est arrivée ici. Elle avait attendu monsieur Jacques, elle ne l’avait pas vu rentrer ; elle était comme une folle. C’est moi qui lui ai conseillé d’aller vous voir ; et je la ramenais de chez vous un peu rassurée, quand, en rentrant, elle a reçu cette lettre anonyme. Il faut être bien lâche pour faire ainsi du mal à une femme ! Cette lettre contenait ces seuls mots : « Jacques vous trompe ; si vous voulez vous en assurer, suivez-le, mais suivez-le en voiture, car ils vont vite. » Elle a fait atteler sa voiture et est allée se poster à quelques maisons plus loin que celle de monsieur de Feuil. À deux heures, il est sorti à cheval ; elle l’a suivi. Il est allé au bois de Boulogne, qu’il a traversé tout droit jusqu’à la porte de Suresne. Arrivé là, il a déposé son cheval chez le garde, et il a attendu sur la porte. Bientôt est arrivé un petit coupé avec des chevaux blancs… Oh ! elle n’a pas perdu un détail ! Jacques y a pris place à côté d’une femme, et ils se sont promenés en dehors du bois pendant une heure à peu près. Puis le coupé a déposé monsieur de Feuil où il l’avait pris ; il est remonté à cheval, et s’est éloigné dans une direction tandis que la voiture en prenait une autre. Cette voiture, que madame de Wine a suivie alors, car elle voulait voir cette femme, cette voiture a pris les Champs Élysées et est entrée dans une maison de la rue de Rivoli. C’était bien évidemment là que demeurait cette dame. Madame de Wine a fait demander son nom, puis elle est venue me conter ce qu’elle savait déjà et s’en est retournée guetter encore monsieur de Feuil. Il a ramené son cheval chez lui, il est ressorti pour aller chez vous. Est-ce vrai ?
– Oui, madame.
– De là, vous avez été dîner ensemble rue de Rivoli, chez Lether.
– C’est encore vrai.
– Après le dîner, le même coupé est venu prendre votre ami et l’a emmené.
– C’est parfaitement exact. Et madame de Wine a encore suivi cette voiture ?
– Oui.
– Et Jacques est maintenant ?
– Au Théâtre-Français, dans l’avant-scène n° 2.
– Avec la dame ?
– Oui.
– Seul avec elle ?
– Seul.
– Et madame de Wine ?
– Oh ! madame de Wine a perdu la tête ! Elle vient me chercher pour que je l’accompagne au Théâtre-Français ; elle veut suivre encore monsieur Jacques après le spectacle, elle veut savoir où il a passé la nuit, car maintenant elle est convaincue qu’il a passé la nuit dernière rue de Rivoli ; mais, toute convaincue qu’elle est, elle veut voir. Alors j’ai pensé à vous. Un homme peut ce qu’une femme ne peut pas. Monsieur Jacques aime sans doute madame de Wine, il tient probablement à lui cacher cette liaison, qui n’existe peut-être pas encore. Vous savez tout l’intérêt que je porte à Charlotte ; je la connais, je sais que le chagrin est un mauvais conseiller ; je voudrais l’empêcher de faire je ne sais quelle folie qu’elle fera certainement si elle est sûre d’être trompée ; enfin voici la situation. Tâchez de prévenir votre ami qu’il est surveillé ; qu’il trouve une raison logique s’il peut à sa conduite d’aujourd’hui, qu’il rentre chez lui ce soir, c’est là le principal, et tout pourra encore être réparé, je l’espère du moins. Je ne vous répète pas toutes les extravagances que madame de Wine m’a dites dans le premier moment ; elle voulait entrer dans la loge du Théâtre-Français, souffleter la femme, faire un scandale public, car cette femme est une femme du monde, à ce qu’il paraît. Je n’ai pas eu grand-peine à la ramener à d’autres idées ; elle a de la dignité ; mais, je vous le répète, que monsieur Jacques prenne des précautions : qu’il se cache ou qu’il rompe avec cette nouvelle liaison, ce qui serait mieux ; sans quoi il arrivera une chose dont, s’il aime encore madame de Wine, il sera le premier à se repentir.
Je répétai à mademoiselle de Norcy la conversation que j’avais eue avec Jacques, l’épreuve que j’avais faite sur lui, le résultat qu’elle avait eu, et je lui fis part de la mission dont il m’avait chargé. Elle réfléchit quelques instants.
– S’il en est ainsi, me dit-elle, entrez dans le salon, dites à Charlotte qu’on vous a dit chez elle qu’elle était probablement ici, et déclarez-lui la vérité avec le plus de précaution possible. Ce sera un coup bien dur, mais mieux vaut qu’elle le reçoive ce soir que demain, car ce soir je suis là pour l’atténuer.
Je m’attendais à une scène de larmes et de récriminations ; en effet, lorsque j’entrai, madame de Wine pleurait silencieusement. En me voyant, elle essuya ses yeux, et aux premiers mots que je lui dis, le sang lui monta aux joues ; cependant elle se contint, et d’une voix qui essayait d’être calme, mais sous laquelle frissonnait la colère de l’orgueil blessé :
– C’est bien, monsieur, me répondit-elle, dites à monsieur de Feuil qu’il est libre.
Sur quoi elle se leva, embrassa mademoiselle de Norcy, me tendit la main et se retira, malgré les efforts que son amie fit pour la retenir.
J’avoue que cette femme était tout autre en ce moment, et que l’émotion donnait à sa beauté un caractère nouveau. Elle était plus que belle ; et Junon, jalouse et courroucée, ne fut jamais si superbe et si grande. Certaines femmes auraient besoin d’être vues sous certains aspects pour être comprises et appréciées. On eût aimé madame de Wine rien que pour sa colère. Sans doute, Jacques ne l’avait jamais vue ainsi.
Nous restâmes naturellement encore quelques instants à causer, mademoiselle de Norcy et moi, de ce qui venait de se passer. La vie calme et la douceur de cette jeune femme étaient d’un contraste frappant avec l’agitation qui venait de sortir. Je racontai à mademoiselle de Norcy l’histoire du bouquet, dont je n’avais pas parlé à madame de Wine.
– Oui, me dit-elle, Charlotte est ainsi faite, et ce que vous me dites ne m’étonne pas. Elle aimait, elle aime encore monsieur de Feuil ; elle eût été incapable de le tromper, comme elle serait incapable de lui pardonner maintenant. Elle a cet amour insuffisant qui va jusqu’à la fidélité, mais qui s’arrête au pardon. Cela vient de sa beauté impérieuse et de l’orgueil que lui en ont fait concevoir les hommages dont elle a été entourée toute sa vie. Elle n’admet pas de rivales et ne comprend pas qu’on la trompe. Tout à l’heure, en lui faisant cet aveu dont cinq minutes auparavant elle doutait encore, c’est moins son amour qui a souffert que son orgueil. Elle compte trop sur sa beauté et demande trop en échange. Monsieur de Feuil, que j’aime beaucoup et qui causait avec moi à cœur ouvert, me l’a dit bien des fois. Il lui est impossible de ne pas faire attention à un homme qui lui dit qu’elle est belle, comme si elle ne le savait pas. Elle se prépare bien des chagrins pour l’époque où on ne pourra plus le lui dire. Jamais monsieur Jacques ne lui faisait un compliment, jamais il ne s’occupait de cette beauté ; il la regardait comme un détail. Madame de Wine allait naïvement jusqu’à lui en faire des reproches.
– Si tous les jours je vous parlais de votre beauté, lui disait-il une fois, et que vous vous cassiez deux dents ce soir, qu’est-ce que je vous dirais demain ?
Ils avaient même à ce sujet de véritables querelles, dont elle sortait blessée ; car monsieur Jacques y mettait toute la franchise de son caractère, et elle tout l’emportement et tout l’orgueil du sien.
– Vous devriez être fier d’être aimé d’une femme comme moi ! lui disait-elle une fois ici même.
– Ma chère enfant, lui répondit-il, car devant moi ils ne se gênaient pas, l’homme qui est fier d’être aimé d’une jolie femme est un sot. J’ai mis ma vanité en moi et non dans les autres. Si l’on me regarde dans la rue, je veux que ce soit pour la musique que je fais et non pour la femme que j’accompagne, et, en tout cas, je préfère qu’on ne me regarde pas du tout. Quand une femme est aussi belle que vous, elle n’a plus qu’une chose à faire, c’est de tâcher de l’oublier elle-même, et, à force d’esprit, de se le faire pardonner par les autres.
Elle sortait donc toujours un peu blessée de ces inutiles discussions ; et les doutes de l’amour méconnu se joignaient aux petites rancunes de la vanité piquée. En somme, elle ne se trompait guère : monsieur Jacques n’avait pas pour elle ce qu’on peut appeler de l’amour. Avec son imagination d’artiste, enthousiaste, pleine de fantaisie et d’inattendu, il tentait quelquefois d’emporter avec lui madame de Wine, et de s’en faire un compagnon sympathique dans les régions supérieures que visitait son talent ; il faisait là des efforts inutiles. Charlotte ne pouvait pas le suivre. Il en est de son esprit comme de son amour : il s’arrête à mi-chemin ; il va jusqu’au tact, il ne va pas jusqu’à l’originalité. Il y a en elle un côté bourgeois qui, tenant à sa naissance, survit à sa position, et qui était incompatible avec l’intelligente sensibilité de monsieur de Feuil. Le père de madame de Wine était un commerçant ; elle a épousé un jeune homme qui avait quelque fortune, à ce qu’il paraît, je ne l’ai jamais connu, et qui se faisait appeler de Wine, d’une petite terre qu’il avait. Cette noblesse-là ne lui a pas ouvert toutes les portes, et, veuve, elle s’est trouvée mal assise entre un monde dont elle ne voulait plus et un monde qui ne voulait pas d’elle. Elle a pensé à utiliser son indépendance pour se créer une société d’artistes, et elle a compté pour cela sur monsieur Jacques, qui s’y est toujours refusé. Son goût, en matière d’art, est fait de traditions et non de sentiments, et les artistes amis de monsieur de Feuil eussent été mal à leur aise chez elle. Enfin, il est résulté de toutes ces petites incompatibilités, mortelles pour l’amour d’un homme supérieur, ce qui devait en résulter naturellement. Madame de Wine, en dehors de monsieur Jacques, a accepté des hommages, très innocents, j’en réponds, mais indispensables à sa nature, et qui ont produit l’histoire du bouquet ; d’un autre côté, monsieur de Feuil, quand il a rencontré une femme comme celle avec qui il est ce soir, dont j’ai entendu parler souvent, qui est une très grande dame, une beauté charmante, une originalité réelle, s’est trouvé entraîné sans pouvoir, sans essayer même de se retenir à une liaison qui n’était plus qu’une habitude. Cependant Charlotte souffre, car elle aimait monsieur Jacques autant qu’il est dans sa nature d’aimer.
Je crains ce qui va arriver : ce n’est pas une de ces femmes à qui le souvenir ou la douleur imposent la dignité ; elle est accessible au dépit, sans compter qu’elle est faible et qu’elle a toujours besoin de s’appuyer sur quelque chose représenté par quelqu’un. Elle va sans doute s’engager trop rapidement dans quelque liaison nouvelle : voilà ce que je voulais empêcher, voilà ce dont monsieur Jacques, comme je vous le disais, se fût repenti s’il eût aimé encore Charlotte. Mais que faire maintenant ? Les conseils de l’amitié sont bien peu de chose devant les conseils de la colère et de la jalousie. Ma vie à moi est toute tranquille, et, renfermée dans un petit cercle d’affections et d’habitudes, n’a que peu de temps à donner à des agitations étrangères, que je blâmerais si je parvenais à les bien comprendre. Je dirai à Charlotte tout ce qu’il est de mon devoir de lui dire, et à la garde de Dieu ! si par hasard Dieu s’occupe de pareilles choses.
Comme vous le voyez, mademoiselle de Norcy était un esprit plein de finesse, d’autant plus appréciable qu’il se tenait dans l’ombre et s’enveloppait de modestie.
Il était minuit quand je me retirai. Pour rentrer chez moi, je devais passer devant la maison de madame de Wine. Je vis de la lumière derrière sa fenêtre. Elle veillait encore. À quoi pensait-elle à cette heure ? Je ne pus m’empêcher de la plaindre encore une fois. C’est une triste nuit que la première nuit que passe une femme après une rupture avec l’homme qu’elle aimait, si peu qu’elle l’aimât, et surtout quand veille à côté d’elle la certitude que celui qui l’abandonne passe cette nuit auprès d’une autre femme, sans regret, sans souvenirs, sans remords ! Ne sont-elles pas alors bien excusables, ces pauvres créatures, de croire aux consolations que leur promet un autre amour ? Avez-vous quelquefois songé à la quantité de femmes qui ont dû souffrir ainsi dans le monde ?
J’écris ces lignes à onze heures du soir, par une belle nuit du mois de juin, transparente et silencieuse. La lune, calme et pleine, se balance comme un globe d’albâtre dans la limpidité de l’air. Une grande forêt épaissit l’horizon de sa masse sombre, et des brises odorantes entrent à chaque minute par ma fenêtre ouverte, si légères qu’elles ne font même pas vaciller la flamme des bougies, auxquelles viennent se brûler de temps en temps les papillons nocturnes. Tandis que j’écris ce récit d’une douleur, peut-être à quelques pas de moi, sous ces allées ombreuses, passent de beaux et jeunes amants, croyant que l’amour vient d’être fait pour eux, se tenant par la main, se souriant et se promettant de longues et belles années ! En effet, c’est bien là une soirée pour de pareils entretiens. Mais que de soirées pareilles a déjà eues le monde ! que de mains se sont ainsi pressées ! que de serments à mi-voix confiés aux ombres amies ! que d’éternités jurées entre deux baisers !
Qu’est devenu le rêve de chacun ? qu’en retrouvons-nous ? Et puisqu’il devait mourir si tôt, pourquoi le faisaient-ils ? À quoi bon alors ? à quoi bon ?… Mot cruel qu’a trouvé la philosophie envieuse des joies de l’âme, et qu’elle jette tout à coup, avec un éclat de rire, au milieu de nos plus chères et de nos plus bienfaisantes folies. Hélas ! ce n’est que trop vrai : jeune fille, d’autres jeunes filles ont passé comme toi, tenant la main d’un amant ou d’un fiancé ; d’autres ont veillé comme tu veilles, avec de subites rougeurs aux joues et de secrètes espérances au cœur ; comme toi, elles ont attendu un jour qu’elles tremblaient de ne jamais voir venir, et ce jour est venu, et d’autres à sa suite ; et voilà qu’à cette heure, insensibles, froides et défigurées, elles dorment là-bas, dans un des plis de l’horizon ! À quoi bon alors ? Elles ont été heureuses !… quelques-unes. Mais la plupart ont souffert, car c’est la loi commune. Et, en tout cas, penchez-vous maintenant sur leur tombeau et parlez-leur de ce bonheur si grand ; rien ne tressaillira en elles… et la destruction continuera sourdement son œuvre… Donc, à quoi bon rêver, puisque le résultat est certain, puisque le but est limité, puisque la mort est là ?
Et cependant, tournez les yeux, et, le long même du cimetière, vous verrez un groupe confiant qui vient demander au voisinage des morts le silence et la solitude dont il a besoin pour aimer à plein cœur. Ici, la mort qui menace la vie ; là, la vie qui raille la mort ! Éternel défi, lutte éternelle où la vie triomphe encore. Eh bien ! croyons, rêvons, aimons, tant que notre cœur bat, que notre esprit pense, que nos yeux voient ! et si la main que nous pressons nous blesse, si la bouche que nous écoutons nous ment, si la mort nous attend au bout de l’allée, il sera toujours temps de nous plaindre, de revenir sur nos pas… et de mourir !
Le lendemain, Jacques m’envoya dire qu’il ne pourrait me voir dans le jour ; mais que, comme il désirait connaître le résultat de ma démarche de la veille, j’allasse le soir au bal de l’Opéra, qu’il y serait.
À peine y étais-je arrivé, qu’un domino me prit le bras sans quitter la main d’un jeune homme que je ne connaissais pas, et nous entraînant tous les deux, lui dit :
– Continue, comte… Monsieur n’est pas de trop ; d’ailleurs, tu n’as besoin de nommer personne.
Il m’était impossible de reconnaître ce domino, qui déguisait bien certainement sa voix. Quant à celui qu’il avait appelé comte, c’était un homme de trente ans à peu près, blond, aux yeux écartés, ce qui donne à la physionomie un air de fausseté mêlée de défiance, car ces sortes d’yeux ont l’air de s’être éloignés ainsi pour voir non plus de face, mais de côté, et en même temps pour échapper aux regards francs et ne pas être vus autrement qu’ils ne voient. Je reconnus à son accent que ce comte était étranger, bien qu’il parlât notre langue aussi vite et aussi correctement que possible. Le comte reprit la conversation, qui, à ce qu’il paraît, n’était qu’à son début quand j’arrivai.