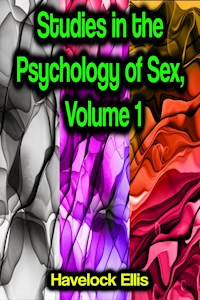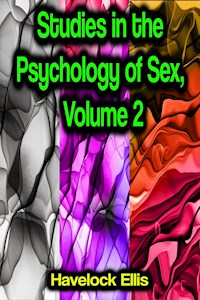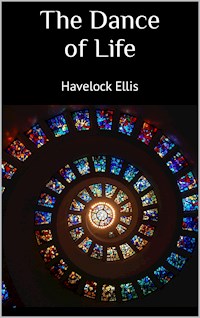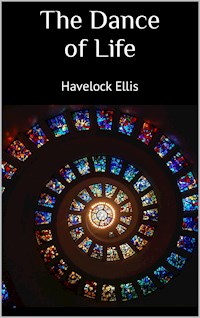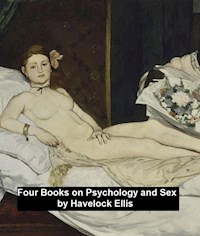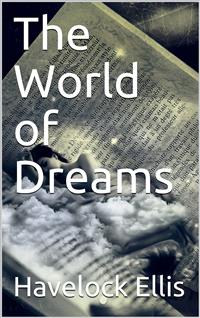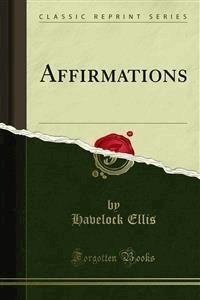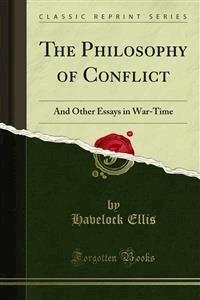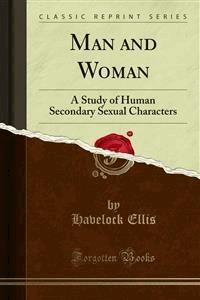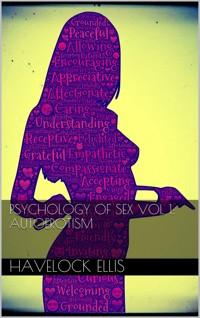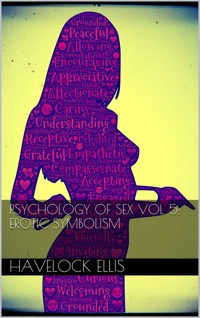3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ALEMAR S.A.S.
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Französisch
- Cette édition est unique;
- La traduction est entièrement originale et a été réalisée pour l'Ale. Mar. SAS;
- Tous droits réservés.
La danse de la vie est le livre le plus vendu de Havelock Ellis, publié pour la première fois en 1923. Il y promeut, dans une série d'essais, une philosophie du développement personnel à travers l'art de la danse, l'art de la pensée, l'art de l'écriture, l'art de la religion et l'art de la moralité. Avec beaucoup de perspectives et d'aperçus uniques sur la littérature et le processus de création.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Table des matières
Préface
Chapitre 1. Introduction
Chapitre 2. L'art de la danse
Chapitre 3. L'art de penser
Chapitre 4. L'art d'écrire
Chapitre 5. L'art de la religion
Chapitre 6. L'art de la morale
Chapitre 7. Conclusion
La danse de la vie
HAVELOCK ELLIS
Traduction et édition 2021 Ale. Mar. sas
Préface
Ce livre a été conçu il y a de nombreuses années. Quant à l'idée qui le traverse, je ne peux pas dire quand elle est apparue. Mon sentiment est qu'elle est née avec moi. À la réflexion, en effet, il semble possible que les graines soient tombées imperceptiblement dans ma jeunesse - de F. A. Lange, peut-être, et d'autres sources - pour germer sans être vues dans un sol agréable. Quoi qu'il en soit, l'idée sous-tend une grande partie de ce que j'ai écrit. Même le présent livre a commencé à être écrit, et à être publié sous une forme préliminaire, il y a plus de quinze ans. Peut-être puis-je être autorisé à chercher une consolation pour ma lenteur, même si c'est en vain, dans la phrase de Rodin selon laquelle "la lenteur est une beauté", et ce sont certainement les danses les plus lentes qui ont été pour moi les plus belles à voir, alors que, dans la danse de la vie, la réussite d'une civilisation en matière de beauté semble être inversement proportionnelle à la rapidité de son rythme.
De plus, le livre reste incomplet, non seulement dans le sens où je souhaiterais encore modifier et ajouter à chaque chapitre, mais même incomplet par l'absence de nombreux chapitres pour lesquels j'avais rassemblé des matériaux et que j'aurais été surpris de trouver manquants il y a vingt ans. Car il existe de nombreux arts, qui ne font pas partie de ceux que nous appelons conventionnellement "beaux-arts", et qui me semblent fondamentaux pour la vie. Mais maintenant, je présente le livre tel qu'il est, délibérément, sans remords, bien content de le faire.
Autrefois, cela n'aurait pas été possible. Un livre doit être achevé tel qu'il avait été prévu à l'origine, terminé, arrondi, poli. En vieillissant, les idéaux d'un homme changent. La rigueur est souvent un idéal admirable. Mais c'est un idéal qui doit être adopté avec discernement, en tenant compte de la nature de l'œuvre en cours. Un artiste, me semble-t-il, n'a pas toujours besoin de terminer son œuvre dans les moindres détails ; en ne le faisant pas, il peut réussir à faire du spectateur son collaborateur, et mettre entre ses mains l'outil nécessaire pour poursuivre l'œuvre qui, telle qu'elle se présente à lui, sous son voile de matière encore partiellement inachevée, s'étend encore à l'infini. Là où il y a le plus de travail, il n'y a pas toujours le plus de vie, et en faisant moins, à condition d'avoir su faire bien, l'artiste peut faire plus.
Il ne parviendra pas, je l'espère, à une cohérence totale. En fait, une partie de la méthode d'un livre comme celui-ci, écrit sur une longue période de temps, consiste à révéler une légère incohérence continuelle. Ce n'est pas un mal, mais plutôt l'évitement d'un mal. Nous ne pouvons pas rester cohérents avec le monde, sauf en devenant incohérents avec notre propre passé. L'homme qui s'accroche constamment - comme il le suppose affectueusement "logiquement" - à une opinion immuable est suspendu à un crochet qui a cessé d'exister. "Je pensais que c'était elle, et elle pensait que c'était moi, et quand nous nous sommes approchés, ce n'était ni l'un ni l'autre" - cette affirmation métaphysique contient, avec une touche d'exagération, une vérité que nous devons toujours garder à l'esprit concernant la relation du sujet et de l'objet. Ni l'un ni l'autre ne peuvent posséder de consistance ; ils ont tous deux changé avant de se rencontrer. Non pas que cette incohérence soit un flux aléatoire ou un opportunisme superficiel. Nous changeons, et le monde change, conformément à l'organisation sous-jacente, et l'incohérence, ainsi conditionnée par la vérité de l'ensemble, devient la cohérence supérieure de la vie. Je suis donc capable de reconnaître et d'accepter le fait que, à maintes reprises dans ce livre, je me suis heurté à ce qui, superficiellement, semblait être le même fait, et que chaque fois j'ai rapporté un rapport légèrement différent, car il avait changé et j'avais changé. Le monde est varié, d'une infinité d'aspects irisés, et tant que je n'aurai pas atteint une variété infinie correspondante d'énoncés, je resterai loin de tout ce qui pourrait être qualifié de "vérité". Nous ne voyons qu'une grande opale qui n'est jamais la même cette fois-ci que la dernière fois que nous l'avons regardée. "Il n'a jamais peint aujourd'hui tout à fait comme il avait peint hier", dit Elie Faure à propos de Renoir, et il me semble naturel et juste qu'il en soit ainsi. Je n'ai jamais vu deux fois le même monde. Cela ne fait que répéter l'adage héraclitéen - imparfait, car il n'est que la moitié de la synthèse plus vaste et plus moderne que j'ai déjà citée - selon lequel aucun homme ne se baigne deux fois dans le même ruisseau. Pourtant - et ce fait opposé est tout aussi significatif - nous devons réellement accepter un courant continu tel qu'il est constitué dans notre esprit ; il coule dans la même direction ; il se concentre dans ce qui est plus ou moins la même forme. On peut dire la même chose du baigneur toujours changeant que le ruisseau reçoit. Ainsi, après tout, il n'y a pas seulement variété, mais aussi unité. La diversité de la multitude est équilibrée par la stabilité de l'unité. C'est pourquoi la vie doit toujours être une danse, car c'est ce qu'est une danse : des mouvements perpétuels légèrement variés, mais toujours fidèles à la forme de l'ensemble.
Nous sommes au seuil de la philosophie. L'ensemble de ce livre est au seuil de la philosophie. Je m'empresse d'ajouter qu'il y reste. Aucun dogme n'est ici énoncé pour prétendre à une quelconque validité générale. Ce n'est pas que même le philosophe technique se soucie toujours de le faire. M. F. H. Bradley, l'un des philosophes anglais modernes les plus influents, qui écrivait au début de sa carrière : "Sur toutes les questions, si vous me poussez assez loin, je finis actuellement par avoir des doutes et des perplexités", dit encore, quarante ans plus tard, que si on lui demande de définir ses principes de façon rigide, "je deviens perplexe". Car même un acarien, imagine-t-on, ne pourrait que difficilement parvenir à une conception métaphysique adéquate du fromage, et combien plus difficile est la tâche de l'Homme, dont l'intelligence quotidienne semble se mouvoir sur un plan si semblable à celui de l'acarien et qui a pourtant un réseau de phénomènes si largement plus complexe à synthétiser.
Il est clair que l'attitude de celui qui, ayant trouvé l'œuvre de sa vie ailleurs que dans le domaine de la philosophie technique, peut incidemment ressentir le besoin, même si ce n'est que par jeu, de spéculer sur sa fonction et sa place dans l'univers. Cette spéculation n'est que l'impulsion instinctive de l'homme ordinaire à rechercher les implications plus larges liées à ses petites activités. Ce n'est de la philosophie que dans le sens simple dans lequel les Grecs comprenaient la philosophie, simplement une philosophie de la vie, de sa propre vie, dans le vaste monde. Le philosophe technique fait quelque chose de tout à fait différent lorsqu'il franchit le seuil et s'enferme dans son bureau...
"Veux-tu découvrir le monde,
Ferme tes yeux, Rosemonde" -
et en ressort avec de grands tomes difficiles à acheter, difficiles à lire et, soyons-en sûrs, difficiles à écrire. Mais de Socrate, comme du philosophe anglais Falstaff, on ne nous dit pas qu'il a écrit quoi que ce soit.
Ainsi, s'il peut sembler à certains que ce livre révèle l'influence expansive de cette grande Renaissance classico-mathématique dans laquelle nous avons le grand privilège de vivre, et qu'ils y trouvent la "relativité" appliquée à la vie, je n'en suis pas si sûr. Il me semble parfois qu'en premier lieu, c'est nous, le troupeau commun, qui façonnons les grands mouvements de notre époque, et qu'en second lieu seulement, ce sont eux qui nous façonnent. Je pense qu'il en a été ainsi même lors de la première grande Renaissance classico-mathématique. Nous l'associons à Descartes. Mais Descartes n'aurait rien pu faire si une foule innombrable dans de nombreux domaines n'avait pas créé l'atmosphère qui lui a permis de respirer le souffle de la vie. Nous pouvons ici nous rappeler avec profit tout ce que Spengler a montré concernant l'unité d'esprit qui sous-tend les éléments les plus divers de la productivité d'une époque. Roger Bacon avait en lui le génie pour créer une telle Renaissance trois siècles plus tôt ; il n'y avait pas d'atmosphère pour lui permettre de vivre et il était étouffé. Mais Malherbe, qui vénérait le Nombre et la Mesure avec autant de dévotion que Descartes, était né un demi-siècle avant lui. Ce Normand silencieux, colossal, féroce, que Tallement des Réaux, à qui nous devons, plutôt qu'à Saint-Simon, le véritable tableau de la France du XVIIe siècle, nous a fait connaître de façon vivante, possédait le génie de la destruction, car il avait l'instinct naturel du Viking, et il a balayé si complètement tout le bel esprit romantique de la vieille France qu'il n'a guère revécu depuis l'époque de Verlaine. Mais il avait l'esprit architectonique normand classico-mathématique - il aurait pu dire, comme Descartes, aussi vrai qu'on puisse le dire en littérature, Omnia apud me mathematica fiunt - et il a introduit dans le monde une nouvelle règle d'ordre. Avec un Malherbe, un Descartes ne pouvait guère manquer de suivre, une Académie française devait naître presque en même temps que le Discours de la Méthode, et Le Nôtre devait déjà dessiner les plans géométriques des jardins de Versailles. Descartes, il faut le rappeler, n'aurait pas pu travailler sans soutien ; c'était un homme de caractère timide et docile, bien qu'il ait été soldat, et non pas de l'humeur héroïque de Roger Bacon. Si l'on avait pu remettre Descartes à la place de Roger Bacon, il aurait pensé beaucoup des pensées de Bacon. Mais nous ne l'aurions jamais su. Il a brûlé nerveusement un de ses ouvrages lorsqu'il a appris la condamnation de Galilée, et il est heureux que l'Église ait été lente à reconnaître qu'un terrible bolcheviste était entré dans le monde spirituel avec cet homme, et qu'elle ne se soit jamais rendu compte que ses livres devaient être mis à l'Index avant qu'il ne soit déjà mort.
Il en est de même aujourd'hui. Nous assistons, nous aussi, à une Renaissance classico-mathématique. Elle nous apporte une nouvelle vision de l'univers, mais aussi une nouvelle vision de la vie humaine. C'est pourquoi il est nécessaire d'insister sur la vie comme une danse. Il ne s'agit pas d'une simple métaphore. La danse est la règle du nombre, du rythme, de la mesure et de l'ordre, de l'influence dominante de la forme, de la subordination des parties au tout. Voilà ce qu'est une danse. Et ces mêmes propriétés constituent également l'esprit classique, non seulement dans la vie, mais, de façon encore plus claire et plus définitive, dans l'univers lui-même. Nous sommes tout à fait corrects lorsque nous considérons non seulement la vie mais aussi l'univers comme une danse. Car l'univers est composé d'un certain nombre d'éléments, moins d'une centaine, et la "loi périodique" de ces éléments est métrique. Ils sont rangés, c'est-à-dire non pas au hasard, non pas en groupes, mais par nombre, et ceux de même qualité apparaissent à intervalles fixes et réguliers. Ainsi, notre monde est, même fondamentalement, une danse, une seule strophe métrique d'un poème qui nous sera à jamais caché, sauf dans la mesure où les philosophes, qui appliquent aujourd'hui même ici les méthodes des mathématiques, peuvent croire qu'ils lui ont conféré le caractère d'une connaissance objective.
J'appelle ce mouvement d'aujourd'hui, comme celui du XVIIe siècle, classico-mathématique. Et je considère la danse (sans préjudice d'une distinction faite plus loin dans ce volume) comme son symbole essentiel. Il ne s'agit pas de déprécier les éléments romantiques du monde, qui sont également de son essence. Mais les vastes énergies exubérantes et les possibilités incommensurables du premier jour peuvent peut-être être mieux estimées lorsque nous avons atteint leur aboutissement final au sixième jour de la création.
Quoi qu'il en soit, l'analogie des deux périodes historiques en question demeure, et je crois que nous pouvons considérer qu'elle tient la route dans la mesure où les éléments strictement mathématiques de la dernière période ne sont pas les premiers à apparaître, mais que nous sommes en présence d'un processus qui est en mouvement subtil dans de nombreux domaines depuis un demi-siècle. S'il est significatif que Descartes soit apparu quelques années après Malherbe, il est tout aussi significatif qu'Einstein ait été immédiatement précédé par le ballet russe. Nous contemplons avec admiration l'artiste assis à l'orgue, mais c'est nous qui soufflons dans le soufflet ; et la musique du grand interprète aurait été inaudible si nous n'avions pas été là.
C'est dans cet esprit que j'ai écrit. Nous sommes tous engagés - et pas seulement une ou deux personnes éminentes ici et là - dans la création du monde spirituel. Je n'ai jamais écrit qu'avec la pensée que le lecteur, même s'il ne le sait pas, est déjà de mon côté. Ce n'est qu'ainsi que j'ai pu écrire avec cette sincérité et cette simplicité sans lesquelles il ne me paraîtrait pas utile d'écrire du tout. C'est ce qui ressort de l'adage que j'ai placé en tête de mon premier livre, "L'esprit nouveau" : celui qui porte le plus loin ses sentiments les plus intimes est simplement le premier de la file d'un grand nombre d'autres hommes, et l'on devient typique en étant au plus haut degré soi-même. J'ai choisi cette phrase après mûre réflexion et avec une conviction totale, car elle est à la base de mon livre. En apparence, elle se référait évidemment aux grandes figures dont je m'occupais et qui représentaient ce que je considérais - et pas du tout dans le sens médiocre de la simple modernité - comme le nouvel esprit dans la vie. Ils étaient tous allés au plus profond de leur âme et, de là, avaient ramené à la surface et exprimé - avec audace ou beauté, de façon piquante ou poignante - des impulsions et des émotions intimes qui, aussi choquantes qu'elles aient pu paraître à l'époque, sont maintenant perçues comme étant celles d'une innombrable compagnie de leurs semblables, hommes et femmes. Mais c'était aussi un livre d'affirmations personnelles. Sous la signification évidente de la devise de la page de titre se cachait la signification plus privée que j'exprimais moi-même des impulsions secrètes qui pourraient un jour se révéler être l'expression des émotions d'autres personnes. Au cours des trente-cinq années qui se sont écoulées depuis, cette phrase m'est souvent revenue à l'esprit, et si j'ai cherché en vain à la faire mienne, je ne trouve aucune justification adéquate à l'œuvre de ma vie.
Et maintenant, comme je l'ai dit au début, je suis même prêt à penser que c'est la fonction de tous les livres qui sont de vrais livres. Il y a d'autres classes de prétendus livres : il y a la classe des livres d'histoire et la classe des livres médico-légaux, c'est-à-dire les livres de faits et les livres d'arguments. Personne ne souhaite déprécier l'une ou l'autre de ces catégories. Mais lorsque nous pensons à un livre proprement dit, dans le sens où une Bible signifie un livre, nous entendons plus que cela. Nous entendons par là la révélation de quelque chose qui était resté latent, inconscient, peut-être même plus ou moins intentionnellement réprimé, dans l'âme même de l'écrivain, qui est, en définitive, l'âme de l'humanité. Ces livres sont susceptibles de repousser ; rien, en effet, n'est plus susceptible de nous choquer au départ que la révélation manifeste de nous-mêmes. Il se peut donc que ces livres doivent frapper sans cesse à la porte fermée de notre cœur. Nous crions négligemment : "Qui est là ?" et nous ne pouvons pas ouvrir la porte ; nous prions l'étranger importun, quel qu'il soit, de s'en aller ; jusqu'à ce que, comme dans l'apologue du mystique persan, il nous semble enfin entendre la voix du dehors qui dit : "C'est toi-même" : "C'est toi-même."
H. E.
Chapitre 1. Introduction
I
Il a toujours été difficile pour l'homme de se rendre compte que sa vie est un art. Il a été plus difficile de la concevoir ainsi que de l'agir ainsi. Car c'est toujours ainsi qu'il a plus ou moins agi. Au début, en effet, le philosophe primitif qui devait expliquer l'origine des choses arrivait généralement à la conclusion que l'univers tout entier était une oeuvre d'art, créée par un artiste suprême, à la manière des artistes, à partir d'une matière qui n'était pratiquement rien, et même à partir de ses propres excrétions, méthode qui, comme les enfants le sentent parfois instinctivement, est une sorte d'art créateur. La déclaration philosophique primitive qui nous est la plus familière - et qui est en fait aussi typique que toute autre - est celle des Hébreux dans le premier chapitre de leur Livre de la Genèse. Nous y lisons que le cosmos tout entier a été façonné à partir de rien, en un laps de temps mesurable, par l'art d'un Jéhovah, qui a procédé méthodiquement en le formant d'abord à l'état brut, puis en travaillant progressivement dans les détails, les plus fins et les plus délicats, tout comme un sculpteur pourrait façonner une statue. On trouve de nombreuses affirmations de ce genre jusque dans le Pacifique.1 Et, à la même distance, l'artiste et l'artisan, qui ressemblent au divin créateur du monde en fabriquant les objets les plus beaux et les plus utiles à l'humanité, participent eux aussi de la même nature divine. Ainsi, à Samoa, comme à Tonga, le charpentier, qui construisait des canoës, occupait une position élevée et presque sacrée, proche de celle du prêtre. Même chez nous, avec nos traditions romaines, le nom de pontife, ou bâtisseur de ponts, reste celui d'un personnage imposant et hiératique.
Mais ce n'est là que la vision primitive du monde. Quand l'homme s'est développé, quand il est devenu plus scientifique et plus moraliste, si sa pratique est restée essentiellement celle de l'artiste, sa conception l'est devenue beaucoup moins. Il apprenait à découvrir le mystère de la mesure, il abordait les débuts de la géométrie et des mathématiques, il devenait en même temps guerrier. Il voyait donc les choses en lignes droites, de façon plus rigide ; il formulait des lois et des commandements. C'était, nous assure Einstein, la bonne voie. Mais elle était, en tout cas en premier lieu, très défavorable à la vision de la vie comme un art. Elle l'est encore aujourd'hui.
Pourtant, il y en a toujours qui, délibérément ou par instinct, ont perçu l'immense signification dans la vie de la conception de l'art. C'est le cas, en particulier, des plus grands penseurs des deux pays qui, pour autant que nous puissions le deviner - même s'il est difficile de parler ici de manière positive et par démonstration - ont eu les plus belles civilisations, la Chine et la Grèce. Les plus sages et les plus grands philosophes pratiques de ces deux pays ont cru que la vie entière, même le gouvernement, est un art de même nature que les autres arts, comme la musique ou la danse. Nous pouvons, par exemple, rappeler à notre mémoire l'un des Grecs les plus typiques. De Protagoras, calomnié par Platon, - bien qu'il soit intéressant d'observer que la propre doctrine transcendantale des Idées de Platon a été considérée comme un effort pour échapper à l'influence solvable de la logique de Protagoras, - il est possible pour l'historien moderne de la philosophie de dire que "la grandeur de cet homme peut difficilement être mesurée". C'est de la mesure qu'il s'agit dans sa phrase la plus célèbre : "L'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui existent et de celles qui n'ont pas d'existence". C'est par son insistance sur l'Homme en tant que créateur actif de la vie et de la connaissance, l'artiste du monde, le modelant à sa propre mesure, que Protagoras est intéressant pour nous aujourd'hui. Il a reconnu qu'il n'existe pas de critères absolus pour juger les actions. Il était le père du relativisme et du phénoménalisme, probablement l'initiateur de la doctrine moderne selon laquelle les définitions de la géométrie ne sont que des abstractions approximativement vraies des expériences empiriques. Nous ne devons pas, et probablement pas, supposer qu'en sapant le dogmatisme, il mettait en place un subjectivisme individuel. C'est la fonction de l'homme dans le monde, plutôt que celle de l'individu, qu'il avait à l'esprit lorsqu'il énonça son grand principe, et c'est la réduction de l'activité et de la conduite humaines à l'art qui le préoccupait principalement. Ses projets pour l'art de vivre commençaient par la parole, et il fut un pionnier dans les arts du langage, l'initiateur de la grammaire moderne. Il a écrit des traités sur de nombreux arts spéciaux, ainsi que le traité général "Sur l'art" parmi les écrits pseudo-hippocratiques, - si nous pouvons avec Gomperz le lui attribuer, - qui incarne l'esprit de la science positive moderne.
Hippias, le philosophe d'Elis, contemporain de Protagoras, et comme lui communément classé parmi les "Sophistes", cultivait le plus grand idéal de la vie comme un art qui embrassait tous les arts, commun à toute l'humanité comme une communauté de frères, et en accord avec la loi naturelle qui transcende la convention des lois humaines. Platon s'est moqué de lui, et ce n'était pas difficile à faire, car un philosophe qui concevait l'art de vivre comme si vaste ne pouvait pas à tout moment y jouer de manière adéquate. Mais à cette distance, c'est son idéal qui nous préoccupe principalement, et il était vraiment très accompli, même un pionnier, dans nombre des activités multiples qu'il a entreprises. Il était un mathématicien remarquable, un astronome et un géomètre, un poète copieux dans les modes les plus divers, et, de plus, il a écrit sur la phonétique, le rythme, la musique et la mnémotechnique, il a discuté les théories de la sculpture et de la peinture, il était à la fois mythologue et ethnologue, ainsi qu'un étudiant de la chronologie, il avait maîtrisé plusieurs des métiers artistiques. On raconte qu'en une occasion, il se présenta au rassemblement olympique vêtu de vêtements qui, des sandales qu'il portait aux pieds à la ceinture qu'il portait à la taille et aux anneaux qu'il portait aux doigts, avaient été confectionnés de ses propres mains. Un tel être à la versatilité kaléidoscopique, remarque Gomperz, nous l'appelons avec mépris un touche-à-tout. Nous croyons qu'il faut subordonner un homme à son travail. Mais d'autres époques ont porté un jugement différent. Les concitoyens d'Hippias l'ont jugé digne d'être leur ambassadeur dans le Péloponnèse. À une autre époque d'immense activité humaine, la Renaissance, les vastes énergies de Léon Alberti ont été honorées, et à une autre époque encore, Diderot - le pantophile, comme l'appelait Voltaire - a fait preuve d'une même énergie ardente et de vastes intérêts, bien qu'il ne soit plus possible d'atteindre le même niveau d'accomplissement. Bien sûr, les travaux d'Hippias étaient de valeur inégale, mais certains étaient de grande qualité et il ne reculait devant aucun travail. Il semble avoir possédé une modestie gracieuse, tout à fait différente de la pompe vaniteuse que Platon s'est plu à lui attribuer. Il attachait plus d'importance que ce qui était courant chez les Grecs à la dévotion à la vérité, et il était cosmopolite dans son esprit. Il était célèbre pour sa distinction entre Convention et Nature, et Platon a mis dans sa bouche ces mots : "Vous tous qui êtes ici présents, je vous considère comme des parents, des amis et des concitoyens, et par nature, non par loi ; car par nature, le semblable est semblable au semblable, tandis que la loi est le tyran de l'humanité, et nous oblige souvent à faire beaucoup de choses qui sont contre nature." Hippias s'inscrit dans la lignée de ceux dont l'idéal suprême est la totalité de l'existence. Ulysse, comme le remarque Benn, était dans le mythe grec le représentant de cet idéal, et son représentant suprême dans la vie réelle a été, dans les temps modernes, Goethe2.
II
Mais, en fait, la vie est-elle essentiellement un art ? Examinons la question de plus près, et voyons ce qu'est la vie, telle que les hommes l'ont vécue. Il est d'autant plus nécessaire de le faire qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a des gens simples d'esprit - des honnêtes gens bien intentionnés que nous ne devons pas ignorer - qui rejettent une telle idée. Ils désignent les individus excentriques de notre civilisation occidentale qui fabriquent une petite idole qu'ils appellent "l'Art", se prosternent et l'adorent, chantent des chants incompréhensibles en son honneur, et passent la plupart de leur temps à déverser leur mépris sur les gens qui refusent de reconnaître que ce culte de "l'Art" est la seule chose nécessaire à ce qu'ils peuvent appeler ou non "l'élévation morale" de l'époque dans laquelle ils vivent. Nous devons éviter l'erreur des bons simples d'esprit aux yeux desquels ces "Arty" sont si grands. Ils ne sont pas grands, ils ne sont que les symptômes morbides d'une maladie sociale ; ils sont la réaction fantastique d'une société qui, dans son ensemble, a cessé de suivre le cours véritable de tout art réel et vivant. Car cela n'a rien à voir avec les excentricités d'une petite secte religieuse pratiquant son culte dans un Petit Béthel ; c'est le grand mouvement de la vie commune d'une communauté, en fait simplement la forme extérieure et visible de cette vie.
C'est ainsi que toute la conception de l'art s'est tellement rétrécie et avilie chez nous que, d'une part, l'emploi de ce mot dans son sens large et naturel semble soit inintelligible, soit excentrique, tandis que, d'autre part, même s'il est accepté, il reste si peu familier que son immense signification pour toute notre vision de la vie dans le monde est à peine perceptible au premier abord. Cela n'est pas entièrement dû à notre obtusité naturelle, ni à l'absence d'une élimination correcte des stocks subnormaux parmi nous, quelle que soit la part que nous nous plaisons à attribuer à ce facteur dysgénique. Elle semble en grande partie inévitable. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne notre civilisation moderne, elle est le résultat d'un processus social de deux mille ans, le résultat de l'éclatement de la tradition classique de la pensée en divers éléments qui, sous l'influence postclassique, ont été poursuivis séparément3. La religion ou le désir du salut de nos âmes, l'art ou le désir d'embellissement, la science ou la recherche des raisons des choses - ces conations de l'esprit, qui sont en réalité trois aspects d'une même impulsion profonde, ont été autorisées à creuser chacune leur propre canal étroit et séparé, à l'écart des autres, et ainsi elles ont toutes été entravées dans leur plus grande fonction de fertilisation de la vie.
Il est intéressant d'observer, je le note en passant, combien un phénomène peut prendre un aspect totalement nouveau lorsqu'il est transformé d'une autre voie à celle de l'art. Prenons, par exemple, ce remarquable phénomène appelé Napoléon, manifestation individualiste aussi impressionnante que nous puissions trouver dans l'histoire de l'humanité au cours des derniers siècles, et examinons deux estimations contemporaines, presque simultanées, de ce phénomène. Un éminent écrivain anglais, M. H. G. Wells, dans un livre remarquable et même célèbre, son "Outline of History", énonce un jugement sur Napoléon pendant tout un chapitre. M. Wells s'engage dans la voie éthico-religieuse. Il se réveille chaque matin, dit-on, avec une règle pour guider sa vie ; certains de ses critiques disent que c'est chaque matin une nouvelle règle, et d'autres que la règle n'est ni éthique ni religieuse ; mais nous ne nous intéressons ici qu'au canal et non à la direction du courant. Dans l'"Outline", M. Wells prononce son anathème éthico-religieux de Napoléon, "ce sombre petit personnage archaïque, dur, compact, capable, sans scrupules, imitatif et proprement vulgaire." L'élément "archaïque", c'est-à-dire démodé, dépassé, attribué à Napoléon, est encore accentué par la suite, car M. Wells a une opinion extrêmement basse (difficilement justifiable, peut-on remarquer en passant) de l'homme primitif. Napoléon était "un rappel de maux anciens, une chose comme la bactérie de quelque pestilence" ; "la figure qu'il fait dans l'histoire est celle d'une vanité, d'une avidité et d'une ruse presque incroyables, d'un mépris et d'un dédain insensibles de tous ceux qui lui faisaient confiance." Il n'y a pas de figure, affirme M. Wells, aussi complètement antithétique à la figure de Jésus de Nazareth. Il était "un scélérat, brillant et complet".
Il n'y a pas lieu de remettre en question cette condamnation lorsque nous nous plaçons dans la ligne de conduite de M. Wells ; elle est probablement inévitable ; nous pouvons même l'accepter de bon cœur. Pourtant, aussi juste que soit cette ligne, ce n'est pas la seule dans laquelle nous pouvons nous engager. En outre - et c'est là le point qui nous intéresse - il est possible d'entrer dans une sphère dans laquelle il n'est pas nécessaire d'arriver à une conclusion aussi négative, condamnatoire et insatisfaisante. Car elle est évidemment insatisfaisante. Il n'est pas acceptable, en fin de compte, qu'un protagoniste aussi suprême de l'humanité, acclamé par des millions de personnes, dont beaucoup sont mortes pour lui, et qui occupe encore une place aussi grande et glorieuse dans l'imagination humaine, soit finalement rejeté comme une simple canaille. Car le condamner, c'est condamner l'Homme qui a fait de lui ce qu'il était. Il a dû répondre à un cri lyrique dans le cœur de l'homme. Cette autre sphère dans laquelle Napoléon revêt un aspect différent est la sphère de l'art au sens large et fondamental. Élie Faure, critique français, excellent historien de l'art au sens ordinaire, est capable de saisir l'art au sens large parce qu'il n'est pas seulement un homme de lettres mais aussi un homme de science, un homme avec une formation et une expérience médicales, qui a vécu dans le monde ouvert, et non, comme le critique de littérature et d'art semble si souvent l'être, un homme vivant dans une cave humide. Juste après que Wells ait publié son "Outline", Élie Faure, qui n'en savait probablement rien puisqu'il ne lit pas l'anglais, a publié un livre sur Napoléon que certains pourraient considérer comme le livre le plus remarquable qu'ils aient jamais rencontré sur ce sujet. Car pour Faure, Napoléon est un grand artiste lyrique.
Il est difficile de ne pas croire que Faure avait le chapitre de Wells sur Napoléon ouvert devant lui, tant il va droit au but. Il intitule le premier chapitre de son "Napoléon" "Jésus et lui" et, d'emblée, il s'attaque à ce que Wells, lui aussi, avait perçu comme étant le cœur du problème : "Au point de vue de la morale, il n'est pas défendable et il est même incompréhensible. En effet, il viole la loi, il tue, il sème la vengeance et la mort. Mais aussi il dicte la loi, il traque et écrase le crime, il établit l'ordre partout. Il est un assassin. C'est aussi un juge. Dans les rangs, il mériterait la corde. Au sommet, il est pur, distribuant récompenses et châtiments d'une main ferme. C'est un monstre à deux visages, comme nous tous peut-être, en tout cas comme Dieu, car ceux qui ont loué Napoléon et ceux qui l'ont blâmé n'ont pas compris que le Diable est l'autre visage de Dieu." Du point de vue moral, dit Faure (tout comme Wells l'avait dit), Napoléon est l'Antéchrist. Mais du point de vue de l'art, tout devient clair. Il est un poète de l'action, comme l'était Jésus, et comme lui il est à part. Ces deux-là, et ces deux-là seulement parmi les grands hommes du monde dont nous avons une connaissance précise, "ont réalisé leur rêve au lieu de rêver leur action". Il est possible que Napoléon lui-même ait été capable d'estimer la valeur morale de ce rêve réalisé. Alors qu'il se trouvait un jour devant la tombe de Rousseau, il observa : "Il aurait été préférable pour le repos de la France que cet homme et moi n'ayons jamais existé." Pourtant, nous ne pouvons en être sûrs. "Le repos n'est-il pas la mort du monde ?" demande Faure. "Rousseau et Napoléon n'avaient-ils pas précisément pour mission de troubler ce repos ? Dans une autre de ces paroles profondes et presque impersonnelles qui tombaient parfois de ses lèvres, Napoléon observait avec une intuition encore plus profonde de sa propre fonction dans le monde : "J'aime le pouvoir. Mais c'est en tant qu'artiste que je l'aime. Je l'aime comme un musicien aime son violon, pour en tirer des sons, des accords et des harmonies. Je l'aime en tant qu'artiste." En tant qu'artiste ! Ces mots ont inspiré cette étude finement éclairante sur Napoléon, qui, bien que dénuée de tout désir de défense ou d'admiration, semble pourtant expliquer Napoléon, au sens large, justifier son droit à une place dans l'histoire humaine, lui conférant ainsi une satisfaction finale que Wells, nous semble-t-il, s'il avait pu échapper aux liens de l'étroite conception de la vie qui le liait, avait en lui l'esprit et l'intelligence de nous transmettre aussi.
Mais il est temps de tourner la page. Il est toujours possible de contester les individus, même lorsqu'une illustration aussi heureuse se présente à nous. Il ne s'agit pas ici de personnes exceptionnelles, mais de l'interprétation de civilisations humaines générales et normales.
III
Je prends, presque au hasard, l'exemple d'un peuple primitif. Il y en a beaucoup d'autres qui feraient aussi bien ou mieux. Mais celui-ci m'est tombé sous la main, et il a l'avantage non seulement d'être un peuple primitif, mais de vivre sur une île et de posséder ainsi, jusqu'à une date récente, sa propre culture indigène, peu altérée, aussi éloignée que possible de la nôtre dans l'espace ; le récit a été fait, avec autant de soin et d'impartialité qu'on peut l'espérer, par la femme d'un missionnaire qui parle en s'appuyant sur une connaissance de plus de vingt ans4 .
Les îles Loyauté se trouvent à l'est de la Nouvelle-Calédonie, et appartiennent à la France depuis plus d'un demi-siècle. Elles sont donc situées à peu près à la même latitude que l'Egypte dans l'hémisphère Nord, mais avec un climat tempéré par l'océan. C'est l'île de Lifu qui nous intéresse principalement. Il n'y a ni ruisseaux ni montagnes dans cette île, bien qu'une crête de hautes roches avec de grandes et belles grottes contienne des stalactites et des stalagmites et de profonds bassins d'eau douce ; ces bassins, avant l'arrivée des chrétiens, étaient la demeure des esprits des défunts, et donc très vénérés. Un homme mourant disait à ses amis : "Je vous retrouverai tous dans les grottes où se trouvent les stalactites."
Les habitants de l'île Loyauté, qui sont de stature européenne moyenne, sont une belle race, à l'exception de leurs lèvres épaisses et de leurs narines dilatées, qui sont toutefois beaucoup moins prononcées que chez les nègres africains. Ils ont de grands yeux bruns doux, des cheveux noirs ondulés, des dents blanches et une peau brune riche et plus ou moins épaisse. Chaque tribu a son propre territoire bien défini et son propre chef. Bien que possédant de grandes qualités morales, c'est un peuple qui aime rire, et ni leur climat ni leur mode de vie n'exigent un travail dur et prolongé, mais ils peuvent travailler aussi bien que le Britannique moyen, si besoin est, pendant plusieurs jours consécutifs, et, lorsque le besoin est passé, se prélasser ou se promener, dormir ou parler. La base de leur culture - et c'est sans doute le fait le plus significatif pour nous - est artistique. Tous ont appris la musique, la danse et le chant. Il est donc naturel pour eux de considérer le rythme et la grâce dans tous les actes de la vie, et c'est presque une question d'instinct de cultiver la beauté dans toutes les relations sociales. Les hommes et les garçons passaient beaucoup de temps à tatouer et à polir leur peau brune, à teindre et à coiffer leurs longs cheveux ondulés (les mèches dorées, aussi admirées qu'elles l'ont toujours été en Europe, étant obtenues par l'utilisation de la chaux), et à oindre leur corps. Ces occupations étaient, bien entendu, réservées aux hommes, car l'homme est naturellement le sexe ornemental et la femme le sexe utile. Les femmes n'accordaient aucune attention à leurs cheveux, si ce n'est qu'elles les gardaient courts. Ce sont également les hommes qui utilisent des huiles et des parfums, et non les femmes, qui portent cependant des bracelets au-dessus du coude et de beaux et longs chapelets de perles de jade. Aucun vêtement n'est porté jusqu'à l'âge de vingt-cinq ou trente ans, et ensuite tous s'habillent de la même façon, sauf que les chefs attachent la ceinture différemment et portent des ornements plus élaborés. Ces gens ont une voix douce et musicale et ils la cultivent. Ils sont doués pour apprendre les langues et sont de grands orateurs. La langue Lifuan est douce et liquide, un mot se fondant dans un autre agréablement à l'oreille, et elle est si expressive que l'on peut parfois comprendre le sens par le son. Dans l'une de ces îles, Uvea, l'éloquence des habitants est si grande qu'ils emploient l'art oratoire pour attraper les poissons, qu'ils considèrent en effet dans leurs légendes comme à moitié humains, et l'on croit qu'un banc de poissons, lorsqu'il est ainsi poliment assailli de compliments depuis un canot, finit par se laisser envoûter spontanément.
Pour un peuple primitif, l'art de vivre est nécessairement lié en grande partie à l'alimentation. Il est admis que personne ne peut souffrir de la faim quand son voisin a de la nourriture, aussi personne n'était-il appelé à faire une grande démonstration de gratitude en recevant un cadeau. L'aide apportée à l'autre était une aide à soi-même, si elle contribuait au bien commun, et ce que je fais pour toi aujourd'hui, tu le feras pour moi demain. La confiance était implicite, et on laissait traîner les biens sans craindre le vol, qui était rare et puni de mort. Ce n'était pas un vol, cependant, si, lorsque le propriétaire regardait, on prenait un article qu'on voulait. Le fait de mentir, avec l'intention de tromper, est une infraction grave, bien que le fait de mentir quand on a peur de dire la vérité soit excusable. Les Lifuans sont friands de nourriture, mais l'étiquette est de rigueur pour manger. La nourriture doit être portée à la bouche avec grâce, délicatesse et lenteur. Chacun se sert immédiatement devant soi, sans se presser, sans tendre la main vers les petites bouchées (souvent offertes aux femmes), car chacun s'occupe de son voisin, et chacun se sent naturellement le gardien de son frère. Il était donc habituel d'inviter cordialement les passants à partager le repas. "En matière de nourriture et d'alimentation, ajoute Mme Hadfield, ils pourraient faire honte à beaucoup de nos compatriotes". Non seulement il ne faut jamais manger rapidement, ni remarquer les friandises qui ne sont pas à proximité, mais il serait indélicat de manger en présence de personnes qui ne mangent pas elles-mêmes. Il faut toujours partager, si petite que soit sa portion, et le faire agréablement ; il faut aussi accepter ce qui est offert, mais lentement, à contrecœur ; après l'avoir accepté, on peut, si l'on veut, le passer ouvertement à quelqu'un d'autre. Autrefois, les Lifuans étaient parfois cannibales, non pas, semble-t-il, par nécessité ou pour des raisons rituelles, mais parce que, comme certains peuples d'ailleurs, ils aimaient cela, ayant, en effet, parfois une sorte d'envie de nourriture animale. Si un homme avait vingt ou trente femmes et une famille nombreuse, il serait tout à fait correct qu'il cuisine de temps en temps l'un de ses propres enfants, même s'il préférait sans doute choisir l'enfant d'une autre personne. L'enfant est cuit entier, enveloppé dans des feuilles de bananier ou de cocotier. Les inconvénients sociaux de cette pratique sont désormais reconnus. Mais ils éprouvent toujours le plus grand respect et la plus grande révérence pour les morts et ne trouvent rien d'offensant ou de répugnant dans un cadavre. "Pourquoi le serait-il, puisqu'il a été notre nourriture ?" Ils n'ont pas non plus peur de la mort. Ils semblent n'avoir que peu d'objections à l'égard de la vermine, mais pour le reste, ils ont un grand amour de la propreté. L'idée d'utiliser du fumier dans les opérations agricoles leur semble dégoûtante, et ils ne l'utilisent jamais. "La mer était le terrain de jeu public". Les mères emmènent leurs petits pour des bains de mer bien avant qu'ils ne sachent marcher, et les petits enfants apprennent à nager comme ils apprennent à marcher, sans enseignement. A leur révérence pour la mort est associée une révérence pour la vieillesse. "La vieillesse est un terme de respect, et chacun est heureux d'être pris pour plus âgé qu'il ne l'est puisque la vieillesse est honorée." Cependant, le respect des autres était général et ne se limitait pas aux personnes âgées. Dans l'église de nos jours, les lépreux sont assis sur un banc séparé, et lorsque le banc est occupé par un lépreux, les femmes en bonne santé insistent parfois pour s'asseoir avec lui ; elles ne pouvaient pas supporter de voir le vieil homme assis seul comme s'il n'avait pas d'amis. Il y avait beaucoup de démonstration sur la rencontre d'amis après une absence. Un Lifuan disait toujours "Olea" ("Merci") pour toute bonne nouvelle, même si elle ne le touchait pas personnellement, comme si c'était un cadeau, car il était heureux de pouvoir se réjouir avec un autre. Étant divisés en petites tribus, chacune ayant son propre chef autocratique, la guerre était parfois inévitable. Elle était accompagnée de beaucoup d'étiquette, qui était toujours strictement observée. Les Lifuans ne connaissaient pas la coutume civilisée qui consiste à établir des règles de guerre et à les rompre lorsque la guerre éclate. Un préavis de plusieurs jours doit être donné avant le début des hostilités. Les femmes et les enfants, contrairement à la pratique de la guerre civilisée, n'étaient jamais molestés. Dès qu'une demi-douzaine de combattants étaient mis hors de combat d'un côté, le chef de ce côté donnait l'ordre de cesser le combat et la guerre était terminée. Une indemnité était alors versée par les conquérants aux vaincus, et non, comme chez les peuples civilisés, par les vaincus aux conquérants. On considérait que c'était le vaincu plutôt que le conquérant qui avait besoin de consolation, et il semblait également souhaitable de montrer qu'aucun sentiment d'animosité n'était laissé derrière soi. Ce n'était pas seulement une marque délicate de considération envers les vaincus, mais aussi une très bonne politique, comme certains Européens ont pu l'apprendre en la négligeant. Tout cet art de vivre des Lifuans a cependant été mis à mal par l'arrivée du christianisme avec ses accompagnements habituels. Les Lifuans substituent les vices européens à leurs propres vertus. Leur simplicité et leur confiance disparaissent, même si, selon Mme Hadfield, ils se distinguent par leur honnêteté, leur sincérité, leur bonne humeur, leur gentillesse et leur politesse, et restent un peuple viril et intelligent.
IV
Les Lifuans fournissent une illustration qui semble décisive. Mais ce sont des sauvages, et de ce fait leur exemple peut être invalidé. Il est bon de prendre une autre illustration chez un peuple dont la haute et longue civilisation est maintenant incontestée.
La civilisation de la Chine est ancienne : c'est un fait connu depuis longtemps. Mais pendant plus de mille ans, elle n'a été qu'une légende pour les Européens de l'Ouest ; aucun d'entre eux n'avait jamais atteint la Chine, ou, s'ils l'avaient fait, ils n'en étaient jamais revenus pour la raconter ; il y avait trop de barbares féroces et jaloux entre l'Orient et l'Occident. Ce n'est qu'à la fin du XIIIe siècle, dans les pages de Marco Polo, le Colombien vénitien de l'Orient - car c'est un Italien qui a découvert l'Ancien et le Nouveau Monde - que la Chine a enfin pris forme, à la fois comme un fait concret et comme un rêve merveilleux. Plus tard, des voyageurs italiens et portugais l'ont décrite, et il est intéressant de noter ce qu'ils avaient à dire. Ainsi Perera, au XVIe siècle, dans un récit que Willes a traduit pour les "Voyages" de Hakluyt, présente un tableau détaillé de la vie chinoise avec une admiration d'autant plus impressionnante que l'on ne peut s'empêcher de sentir combien cette civilisation était étrangère au voyageur catholique et combien de difficultés il devait lui-même rencontrer. Il est étonné, non seulement par la splendeur de la vie des Chinois sur le plan matériel, tant dans les grandes que dans les petites choses, mais par leurs bonnes manières dans tous les actes ordinaires de la vie, la courtoisie dans laquelle ils lui semblent dépasser toutes les autres nations, et dans l'équité qui surpasse de loin celle de tous les autres Gentils et Maures, tandis que dans l'exercice de la justice, il les trouve supérieurs même à de nombreux chrétiens, car ils font justice aux étrangers inconnus, ce qui est rare dans la chrétienté ; En outre, il y avait des hôpitaux dans chaque ville et on ne voyait jamais de mendiants. C'était une vision de splendeur, de délicatesse et d'humanité, qu'il aurait pu voir, ici et là, dans les cours des princes en Europe, mais nulle part en Occident à une échelle aussi vaste qu'en Chine.
L'image que Marco Polo, le premier Européen à atteindre la Chine (en tout cas dans ce que nous pouvons appeler les temps modernes), a présenté au treizième siècle était encore plus impressionnante, et cela ne doit pas nous surprendre, car quand il a vu la Chine, elle était encore dans sa grande époque augustéenne de la dynastie Sung. Il représente la ville de Hang-Chau comme la plus belle et la plus somptueuse du monde, et nous devons nous rappeler qu'il appartenait lui-même à Venise, bientôt connue comme la plus belle et la plus somptueuse ville d'Europe, et qu'il avait acquis une connaissance non négligeable du monde. Lorsqu'il décrit sa vie, si exquise et raffinée dans sa civilisation, si humaine, si paisible, si joyeuse, si bien ordonnée, si heureusement partagée par toute la population, nous réalisons qu'ici avait été atteint le point le plus élevé de la civilisation urbaine à laquelle l'Homme a jamais accédé. Marco Polo ne trouve aucun mot pour la qualifier, et encore, mais le mot Paradis.
La Chine d'aujourd'hui semble moins étrange et moins étonnante à l'Occidental. Elle peut même lui sembler proche de lui - en partie à cause de son déclin, en partie à cause de ses propres progrès en civilisation - en raison de son caractère direct et pratique. Telle est la conclusion d'un voyageur sensible et réfléchi en Inde, au Japon et en Chine, G. Lowes Dickinson. Il est impressionné par la gentillesse, la profonde humanité, la gaieté des Chinois, par le respect de soi, l'indépendance et la courtoisie inégalés des gens du peuple. "L'attitude fondamentale des Chinois à l'égard de la vie est, et a toujours été, celle de l'Occident le plus moderne, plus proche de nous aujourd'hui que de nos ancêtres médiévaux, infiniment plus proche de nous que l'Inde. "5
Jusqu'ici, il peut sembler que ces voyageurs ne considèrent guère les Chinois comme des artistes. Ils insistent sur leur façon gaie, pratique, sociale, bienveillante, tolérante, pacifique, humaine de considérer la vie, sur l'esprit remarquablement éducable dans lequel ils sont disposés, et facilement capables, de changer même des habitudes anciennes et profondément enracinées lorsqu'il semble commode et bénéfique de le faire ; ils sont disposés à prendre le monde à la légère, et semblent dépourvus de ces instincts conservateurs obstinés qui nous guident en Europe. Le "Résident à Pékin" dit qu'ils sont le moins romantique des peuples. Il le dit avec une nuance de mépris, mais Lowes Dickinson dit exactement la même chose de la poésie chinoise, et sans cette nuance : "C'est de toute la poésie que je connais la plus humaine et la moins symbolique ou romantique. Elle contemple la vie telle qu'elle se présente, sans aucun voile d'idées, sans rhétorique ni sentiment ; elle élimine simplement l'obstacle que l'habitude a dressé entre nous et la beauté des choses et laisse celle-ci apparaître dans sa propre nature." Tous ceux qui ont appris à apprécier la poésie chinoise apprécieront la délicate précision de ce commentaire. La qualité de leur poésie semble correspondre à la qualité simple, directe et enfantine que tous les observateurs notent chez les Chinois eux-mêmes. L'antipathique "Résident à Pékin" décrit l'étiquette bien connue de la politesse en Chine : "Un Chinois vous demandera de quel noble pays vous êtes. Vous répondez à la question, et il vous dit que sa modeste province est untel. Il vous invitera à lui faire l'honneur de diriger vos pieds ornés de bijoux vers sa maison dégradée. Vous répondez que vous, un ver discrédité, ramperez dans son magnifique palais." La vie devient un jeu. Les cérémonies - les Chinois n'ont pas leur pareil en la matière, et il existe un département gouvernemental, le Board of Rites and Ceremonies, pour les administrer - ne sont rien d'autre que des jeux plus ou moins cristallisés. Non seulement la cérémonie est ici "presque un instinct", mais, a-t-on dit, "un Chinois pense en termes théâtraux". Nous nous approchons de la sphère de l'art.