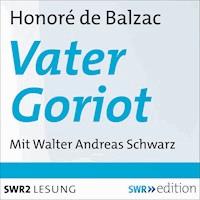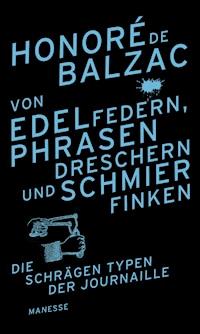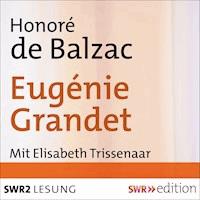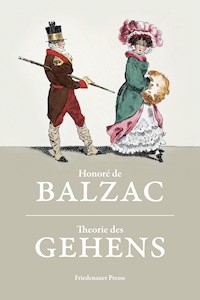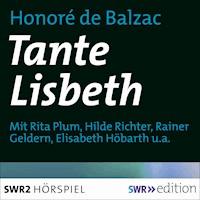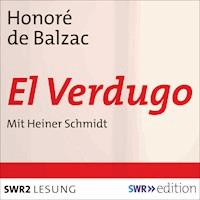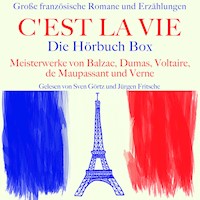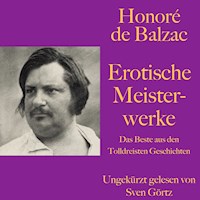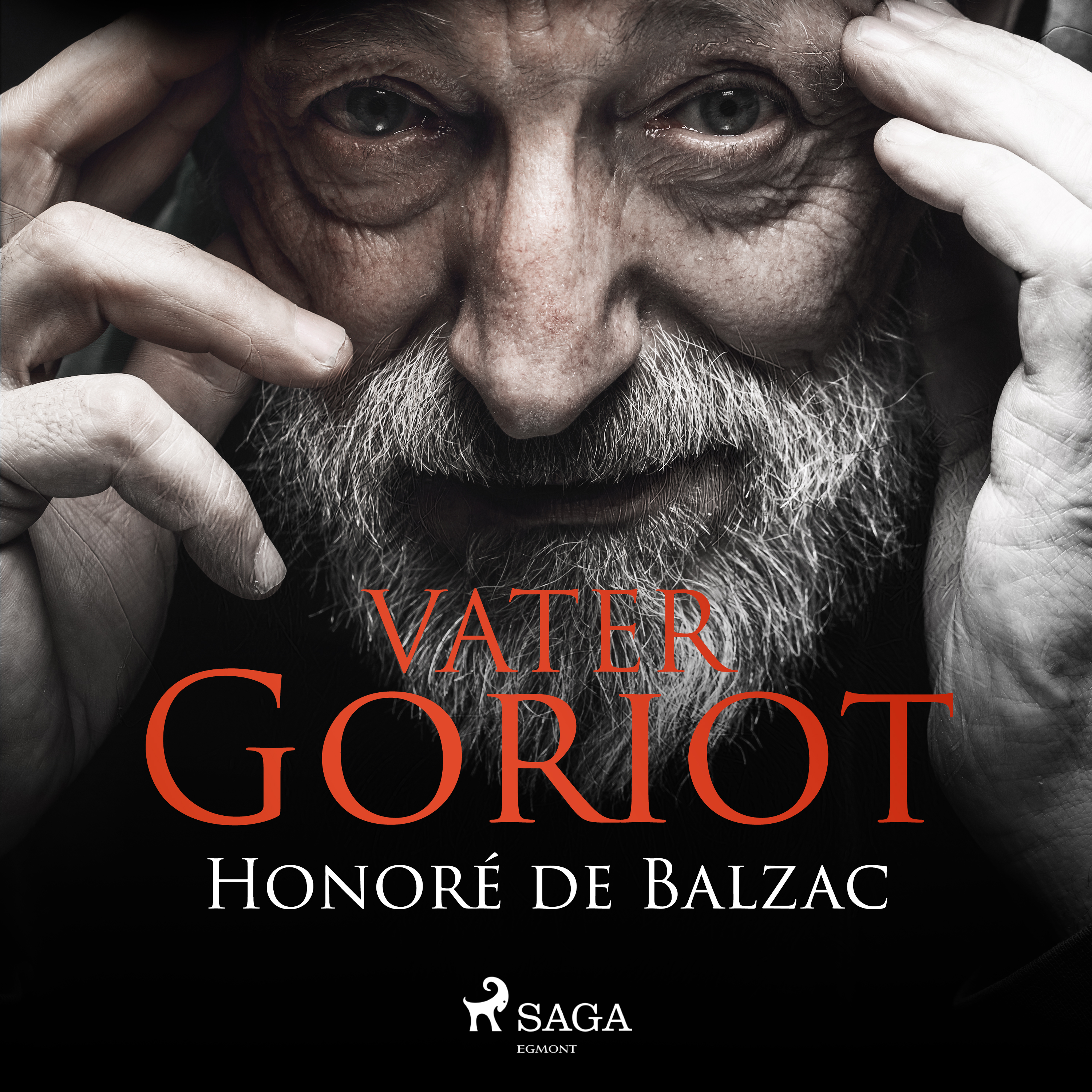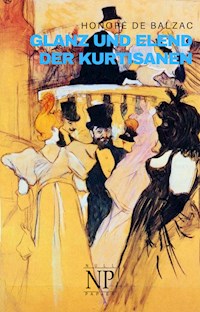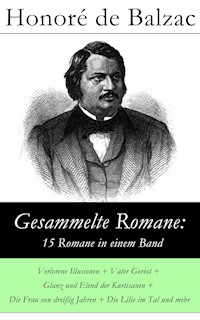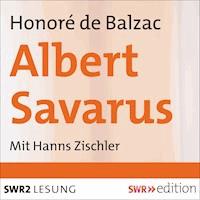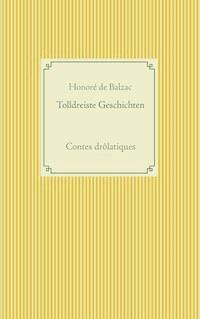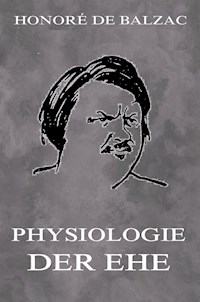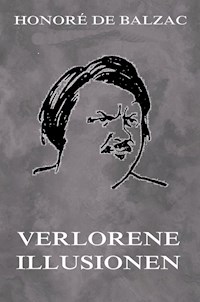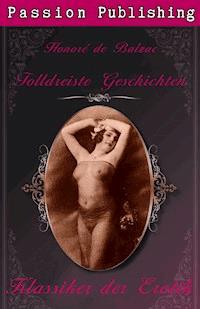Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Perret
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
En 1822, Gaston de Nueil séjourne à Bayeux. Il découvre que la vicomtesse de Beauséant s’est réfugiée dans les environs. Elle vit recluse dans son château de Courcelles depuis qu’elle a été abandonnée par le marquis d’Ajuda-Pinto. Le hasard fera-t-il rencontrer à Gaston Mme de Beauséant ou le jeune homme devra-t-il forcer la porte du destin ? Saura-t-il la convaincre de quitter sa retraite et se fera-t-il aimer de cette grande dame qui avait pourtant choisi de renoncer au monde et à l’amour ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Présentation
La vie au service de la création romanesque
La Femme abandonnée est écrite durant l’été 1832 lors d’un séjour de Balzac chez ses amis les Carraud à la Poudrerie d’Angoulême. Cette Scène de la vie privée, conçue au départ comme une Scène de la vie de province, possède des traits communs avec La Grenadière, cet autre grand récit de l’abandon qui la précède directement dans l’ordre voulu par l’auteur pour l’architecture de son cycle romanesque, et qu’il rédige au même moment. Mais La Femme abandonnée repose sur une matière beaucoup plus personnelle que l’histoire de lady Brandon. Dans l’introduction qui précède son édition du texte pour la Pléiade, et qui est un modèle du genre, Madeleine Ambrière a relevé de manière magistrale les multiples sources biographiques auxquelles Balzac a puisé à pleines mains pour écrire l’histoire du second abandon de Claire de Bourgogne, marquise de Beauséant. Il nous suffira d’en rappeler ici les éléments essentiels.
Le choix de Bayeux pour situer l’intrigue amoureuse de Gaston de Nueil et de Claire de Beauséant n’est pas le fait du hasard : Balzac avait été contraint par sa mère d’y résider chez sa sœur, Laure Surville, à l’été 1822, pour l’éloigner de Mme de Berny. Voilà pour le cadre. C’est là que Balzac aurait joué, avec moins de persévérance et d’audace que son personnage, le rôle de Gaston de Nueil auprès de la très galante comtesse d’Hautefeuille, femme abandonnée par son époux dès 1808, puis par son amant le comte de Gernon-Ranville qui finit par épouser une femme plus jeune. Quant à la duchesse d’Abrantès, dédicataire de l’ouvrage dans l’édition Furne, elle a sans nul doute raconté à Balzac l’histoire bien réelle des amours du comte Charles de Pont et de la comtesse de Castellane, contrariés par le mariage du comte avec Mlle Avoie Michel, et soldés par le suicide du jeune marié (voir le dossier). Les arguments avancés par Gaston pour convaincre Mme de Beauséant de lui céder sont une façon toute romanesque de faire une cour bien sentie à la très réelle marquise de Castries, que Balzac rejoint à Aix-les-Bains après avoir achevé la rédaction de La Femme abandonnée. Enfin se superpose à la figure de Mme de Beauséant celle de Mme de Berny, la Dilecta, première maîtresse d’un très jeune Balzac qui ne lui est déjà plus fidèle en 1832 et qui ne la verra plus après octobre 1835.
On sait les limites de l’explication biographique des textes littéraires. Il est toutefois certains textes dont la compréhension s’enrichit de ces éléments de la vie de l’auteur : La Femme abandonnée appartient résolument à cette catégorie. On ne saurait cependant s’y arrêter : Balzac ne s’est pas contenté de copier, il a créé, avec un sens aigu de la dramaturgie, les différents ressorts psychologiques de cette tragédie de l’abandon, qui est en même temps l’une des plus séduisantes nouvelles de La Comédie humaine.
Femme échaudée craint l’eau froide
Plus encore sans doute que Le Père Goriot, qui sera écrit deux ans plus tard, La Femme abandonnée fixe dans l’imaginaire du lecteur le type de la maîtresse conquise, aimée et finalement délaissée quand les lois sociales et les convenances finissent par s’imposer aux amants. Or, on ne peut pas réellement comprendre les motivations du refus de la vicomtesse de se laisser aimer par Gaston si l’on ne sait pas ce qu’a été sa vie antérieure.
Quand le jeune Rastignac rencontre pour la première fois celle qui est tout à la fois une parente éloignée et l’une des reines du faubourg Saint-Germain, il la découvre aux prises avec son amie la duchesse de Langeais, venue lui fouiller le cœur avec un poignard en lui en faisant admirer le manche. La nouvelle du mariage de son amant, le marquis d’Ajuda-Pinto, s’est répandue dans les salons parisiens, et la duchesse s’est empressée de venir assister au désarroi de la vicomtesse, quittée pour une demoiselle de Rochefide. Mme de Beauséant se garde bien de faire éclater sa douleur en public : elle organise un grand bal auquel tout Paris se presse pour contempler son malheur. La vicomtesse ne donne pas au public la joie mesquine de se donner en spectacle : elle conserve une dignité royale pendant toute la soirée et quitte Paris le soir même, résolue à faire retraite dans son château de Courcelles, non loin de Bayeux, dans le pays d’Auge.
Mme de Beauséant est évidemment une femme coupable : femme adultère, elle n’a voulu dominer le monde qu’afin de le forcer à tolérer sa passion. Abandonnée par le marquis d’Ajuda-Pinto, elle n’a plus de raison de s’accrocher à son sceptre. Sa mise en retrait du monde sans avoir rien laissé paraître de son désespoir force l’admiration des cercles parisiens : dans Le Cabinet des Antiques, la duchesse de Maufrigneuse admire ce geste sublime sans pour autant vouloir le reproduire elle-même. Abdiquant son titre de reine de Paris, Mme de Beauséant semble avoir racheté sa conduite en se condamnant à l’exil. Elle a en outre conscience qu’elle ne peut conserver son honneur qu’en restant fidèle à son amant par-delà son abandon. Cependant, les salons aristocratiques du pays d’Auge sont encore attachés à de vieilles idées et refusent de recevoir Mme de Beauséant, qui est considérée comme « une tête folle » par les douairières normandes ; il n’y a que M. de Champignelles, son parent, qui lui rende visite et qui veuille l’absoudre.
La retraite de Mme de Beauséant s’explique aussi par la conscience du fait qu’elle ne peut conserver ce qui lui reste d’honneur qu’en restant éternellement fidèle à son amant. Sa faute paraîtra moins grave si elle reste unique ; aimer à nouveau reviendrait à céder à la vulgarité de la faiblesse féminine : Claire de Beauséant, issue de la quasi royale maison de Bourgogne, ne saurait se résoudre à ressembler « aux autres femmes » (p. 36). De surcroît, elle sait désormais que l’amour, quand il est déçu, expose à des souffrances qu’elle ne souhaite pas se voir infliger à nouveau. Ces raisons conjuguées la conduisent à repousser les premiers assauts de séduction de Gaston de Nueil.
De fait, rien ne l’oblige à recevoir ce jeune homme qu’elle ne connaît pas et qui n’a pas hésité à employer la ruse pour parvenir jusqu’à elle. Une explication a lieu, grâce à l’audace dont fait preuve Gaston et qui n’est pas dénuée de charme aux yeux d’une femme de trente ans coupée du monde depuis plusieurs années. Une correspondance s’engage. Gaston refuse de se ranger aux arguments que fait valoir Mme de Beauséant pour ne plus le revoir ; elle s’enfuit à Genève ; il suit sa trace ; face à tant de persévérance ou d’obstination juvénile, elle cède, séduite malgré elle par les marques d’intérêt que lui témoigne ce garçon totalement inexpérimenté. S’ensuivent trois années de bonheur à Genève au bord du lac ; mais Gaston hérite du titre de son père et de son frère : il faut rentrer en France pour régler la succession. Le bonheur des amants se perpétue plusieurs années, malgré les réticences de la mère de Gaston qui refuse de rencontrer Mme de Beauséant et qui incite son fils à se marier – avec une femme jeune, libre, et riche !
La catastrophe survient, élevant le récit au rang d’une tragédie : Mme de Beauséant est abandonnée une deuxième fois par l’homme qu’elle aime alors même qu’elle n’a rien à se reprocher. Gaston fait d’abord preuve d’une lâcheté toute masculine : il est parfaitement disposé à continuer sa relation avec Mme de Beauséant tout en se mariant avec Mlle de La Rodière. Mais Claire de Bourgogne ne tient certes pas à partager celui qu’elle aime avec une autre, aussi insignifiante soit-elle. Elle rompt, radicalement et définitivement, renvoyant à Gaston toutes ses lettres sans plus les lire. Gaston, livré seul au désespoir, se tue ; la marquise de Beauséant ne reparaîtra jamais dans le monde.
L’Effet Comédie humaine
Ce que l’on appelle parfois l’« effet Comédie humaine » se comprend d’une manière double dans La Femme abandonnée. D’une part, l’histoire de Mme de Beauséant se découvre dans deux récits différents ; son avenir est écrit en 1832 dans La Femme abandonnée, placée dans l’ordre voulu par l’auteur de La Comédie humaine avant Le Père Goriot écrit en 1834, qui met en scène de manière spectaculaire le premier abandon de cette qui femme qui n’est encore que la vicomtesse de Beauséant. L’ordre de la lecture est donc inverse à celui de la chronologie narrative. Si l’on remet les choses dans l’ordre, il reste une question, fondamentale : que se passe-t-il dans l’intervalle qui sépare l’action du Père Goriot et celle de La Femme abandonnée ? Nul ne sait. C’est au lecteur que revient la tâche d’inventer, d’imaginer, et de combler les vides.
D’autre part, la spécificité du cycle romanesque tel que le conçoit Balzac tient au fait qu’il élabore des types qui ont valeur de référence au sein même de son œuvre fictionnelle. Mme de Beauséant n’est pas la seule femme abandonnée de La Comédie humaine ; elle n’est même pas la première femme abandonnée créée par Balzac, puisqu’il faut rappeler ici que Wann-Chlore met en scène l’abandon d’Eugénie par Horace d’une manière également spectaculaire et tragique. Antoinette de Langeais, lady Brandon, Henriette de Mortsauf sont elles aussi de grandes figures balzaciennes de l’abandon. Pourtant, c’est bien Mme de Beauséant qui devient le type de la femme abandonnée, ne serait-ce qu’en raison du titre de la nouvelle qui lui est consacrée. Partant, c’est à l’aune des malheurs de la vicomtesse puis de la marquise de Beauséant, tels qu’ils sont racontés dans Le Père Goriot puis dans La Femme abandonnée, que doivent être évaluées et comprises les cinquante nuances de l’abandon créées ailleurs dans La Comédie humaine.
Maxime Perret
La Femme abandonnée
À Mme la duchesse d’Abrantès[1],
Son affectionné serviteur,
Honoré de Balzac.
Paris, août 1835.
En 1822, au commencement du printemps, les médecins de Paris envoyèrent en Basse-Normandie un jeune homme qui relevait alors d’une maladie inflammatoire causée par quelque excès d’étude, ou de vie peut-être. Sa convalescence exigeait un repos complet, une nourriture douce, un air froid et l’absence totale de sensations extrêmes. Les grasses campagnes du Bessin et l’existence pâle de la province parurent donc propices à son rétablissement. Il vint à Bayeux[2], jolie ville située à deux lieues de la mer, chez une de ses cousines, qui l’accueillit avec cette cordialité particulière aux gens habitués à vivre dans la retraite, et pour lesquels l’arrivée d’un parent ou d’un ami devient un bonheur.
À quelques usages près, toutes les petites villes se ressemblent. Or, après plusieurs soirées passées chez sa cousine Mme de Sainte-Sevère, ou chez les personnes qui composaient sa compagnie, ce jeune Parisien, nommé M. le baron Gaston de Nueil, eut bientôt connu les gens que cette société exclusive regardait comme étant toute la ville. Gaston de Nueil vit en eux le personnel immuable que les observateurs retrouvent dans les nombreuses capitales de ces anciens États qui formaient la France d’autrefois[3].
C’était d’abord la famille dont la noblesse, inconnue à cinquante lieues plus loin, passe, dans le département, pour incontestable et de la plus haute antiquité. Cette espèce de famille royale au petit pied effleure par ses alliances, sans que personne s’en doute, les Navarreins, les Grandlieu, touche aux Cadignan, et s’accroche aux Blamont-Chauvry[4]. Le chef de cette race illustre est toujours un chasseur déterminé. Homme sans manières, il accable tout le monde de sa supériorité nominale ; tolère le sous-préfet, comme il souffre l’impôt ; n’admet aucune des puissances nouvelles créées par le xixe siècle, et fait observer, comme une monstruosité politique, que le Premier ministre n’est pas gentilhomme. Sa femme a le ton tranchant, parle haut, a eu des adorateurs, mais fait régulièrement ses pâques ; elle élève mal ses filles, et pense qu’elles seront toujours assez riches de leur nom. La femme et le mari n’ont d’ailleurs aucune idée du luxe actuel : ils gardent les livrées de théâtre, tiennent aux anciennes formes pour l’argenterie, les meubles, les voitures, comme pour les mœurs et le langage. Ce vieux faste s’allie d’ailleurs assez bien avec l’économie des provinces. Enfin c’est les gentilshommes d’autrefois, moins les lods et ventes[5], moins la meute et les habits galonnés ; tous pleins d’honneur entre eux, tous dévoués à des princes qu’ils ne voient qu’à distance. Cette maison historique incognito conserve l’originalité d’une antique tapisserie de haute-lisse. Dans la famille végète infailliblement un oncle ou un frère, lieutenant général, cordon rouge[6], homme de cour, qui est allé en Hanovre avec le maréchal de Richelieu[7], et que vous retrouvez là comme le feuillet égaré d’un vieux pamphlet du temps de Louis XV.
À cette famille fossile s’oppose une famille plus riche, mais de noblesse moins ancienne. Le mari et la femme vont passer deux mois d’hiver à Paris, ils en rapportent le ton fugitif et les passions éphémères. Madame est élégante, mais un peu guindée et toujours en retard avec les modes. Cependant elle se moque de l’ignorance affectée par ses voisins ; son argenterie est moderne ; elle a des grooms, des nègres, un valet de chambre. Son fils aîné a tilbury[8], ne fait rien, il a un majorat[9] ; le cadet est auditeur au conseil d’État. Le père, très au fait des intrigues du ministère, raconte des anecdotes sur Louis XVIII et sur Mme du Cayla[10] ; il place dans le cinq pour cent[11], évite la conversation sur les cidres, mais tombe encore parfois dans la manie de rectifier le chiffre des fortunes départementales ; il est membre du conseil général, se fait habiller à Paris, et porte la croix de la Légion d’honneur[12]. Enfin ce gentilhomme a compris la Restauration, et bat monnaie à la Chambre ; mais son royalisme est moins pur que celui de la famille avec laquelle il rivalise. Il reçoit La Gazette et les Débats[13]. L’autre famille ne lit que La Quotidienne[14].
Mgr l’évêque, ancien vicaire général, flotte entre ces deux puissances qui lui rendent les honneurs dus à la religion, mais en lui faisant sentir parfois la morale que le bon La Fontaine a mise à la fin de L’Âne chargé de reliques[15]. Le bonhomme est roturier.
Puis viennent les astres secondaires, les gentilshommes qui jouissent de dix ou douze mille livres de rente, et qui ont été capitaines de vaisseau, ou capitaines de cavalerie, ou rien du tout. À cheval par les chemins, ils tiennent le milieu entre le curé portant les sacrements et le contrôleur des contributions en tournée. Presque tous ont été dans les pages ou dans les mousquetaires, et achèvent paisiblement leurs jours dans une faisance-valoir, plus occupés d’une coupe de bois ou de leur cidre que de la monarchie. Cependant ils parlent de la Charte[16] et des libéraux entre deux rubbers de whist[17] ou pendant une partie de trictrac[18], après avoir calculé des dots et arrangé des mariages en rapport avec les généalogies qu’ils savent par cœur. Leurs femmes font les fières et prennent les airs de la cour dans leurs cabriolets d’osier ; elles croient être parées quand elles sont affublées d’un châle et d’un bonnet ; elles achètent annuellement deux chapeaux, mais après de mûres délibérations, et se les font apporter de Paris par occasion ; elles sont généralement vertueuses et bavardes.
Autour de ces éléments principaux de la gent aristocratique se groupent deux ou trois vieilles filles de qualité[19] qui ont résolu le problème de l’immobilisation de la créature humaine. Elles semblent être scellées dans les maisons où vous les voyez : leurs figures, leurs toilettes font partie de l’immeuble, de la ville, de la province ; elles en sont la tradition, la mémoire, l’esprit. Toutes ont quelque chose de raide et de monumental ; elles savent sourire ou hocher la tête à propos, et, de temps en temps, disent des mots qui passent pour spirituels.
Quelques riches bourgeois se sont glissés dans ce petit faubourg Saint-Germain, grâce à leurs opinions aristocratiques ou à leurs fortunes. Mais, en dépit de leurs quarante ans, là chacun dit d’eux : « Ce petit un tel pense bien ! » Et l’on en fait des députés. Généralement ils sont protégés par les vieilles filles, mais l’on en cause.
Puis enfin deux ou trois ecclésiastiques sont reçus dans cette société d’élite, pour leur étole, ou parce qu’ils ont de l’esprit, et que ces nobles personnes, s’ennuyant entre elles, introduisent l’élément bourgeois dans leurs salons, comme un boulanger met de la levure dans sa pâte.
La somme d’intelligence amassée dans toutes ces têtes se compose d’une certaine quantité d’idées anciennes auxquelles se mêlent quelques pensées nouvelles qui se brassent en commun tous les soirs. Semblables à l’eau d’une petite anse, les phrases qui représentent ces idées ont leur flux et reflux quotidien, leur remous perpétuel, exactement pareil : qui en entend aujourd’hui le vide retentissement l’entendra demain, dans un an, toujours. Leurs arrêts immuablement portés sur les choses d’ici-bas forment une science traditionnelle à laquelle il n’est au pouvoir de personne d’ajouter une goutte d’esprit. La vie de ces routinières personnes gravite dans une sphère d’habitudes aussi incommutables que le sont leurs opinions religieuses, politiques, morales et littéraires.
Un étranger est-il admis dans ce cénacle, chacun lui dira, non sans une sorte d’ironie : – Vous ne trouverez pas ici le brillant de votre monde parisien ! Et chacun condamnera l’existence de ses voisins en cherchant à faire croire qu’il est une exception dans cette société, qu’il a tenté sans succès de la rénover. Mais si, par malheur, l’étranger fortifie par quelque remarque l’opinion que ces gens ont mutuellement d’eux-mêmes, il passe aussitôt pour un homme méchant, sans foi ni loi, pour un Parisien corrompu, comme le sont en général tous les Parisiens.
Quand Gaston de Nueil apparut dans ce petit monde, où l’étiquette était parfaitement observée, où chaque chose de la vie s’harmoniait[20], où tout se trouvait mis à jour, où les valeurs nobiliaires et territoriales étaient cotées comme le sont les fonds de la Bourse à la dernière page des journaux, il avait été pesé d’avance dans les balances infaillibles de l’opinion bayeusaine. Déjà sa cousine Mme de Sainte-Sevère avait dit le chiffre de sa fortune, celui de ses espérances, exhibé son arbre généalogique, vanté ses connaissances, sa politesse et sa modestie. Il reçut l’accueil auquel il devait strictement prétendre, fut accepté comme un bon gentilhomme, sans façon, parce qu’il n’avait que vingt-trois ans ; mais certaines jeunes personnes et quelques mères lui firent les yeux doux. Il possédait dix-huit mille livres de rente dans la vallée d’Auge, et son père devait tôt ou tard lui laisser le château de Manerville[21] avec toutes ses dépendances. Quant à son instruction, à son avenir politique, à sa valeur personnelle, à ses talents, il n’en fut seulement pas question. Ses terres étaient bonnes et les fermages bien assurés ; d’excellentes plantations y avaient été faites ; les réparations et les impôts étaient à la charge des fermiers ; les pommiers avaient trente-huit ans ; enfin son père était en marché pour acheter deux cents arpents[22] de bois contigus à son parc, qu’il voulait entourer de murs : aucune espérance ministérielle, aucune célébrité humaine ne pouvait lutter contre de tels avantages. Soit malice, soit calcul, Mme de Sainte-Sevère n’avait pas parlé du frère aîné de Gaston, et Gaston n’en dit pas un mot. Mais ce frère était poitrinaire, et paraissait devoir être bientôt enseveli, pleuré, oublié. Gaston de Nueil commença par s’amuser de ces personnages ; il en dessina, pour ainsi dire, les figures sur son album dans la sapide vérité de leurs physionomies anguleuses, crochues, ridées, dans la plaisante originalité de leurs costumes et de leurs tics ; il se délecta des normanismes