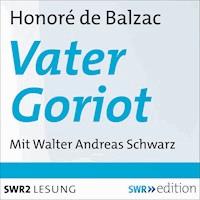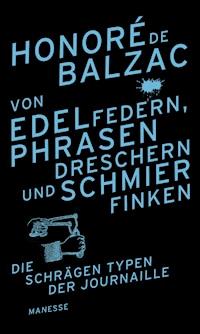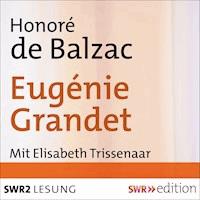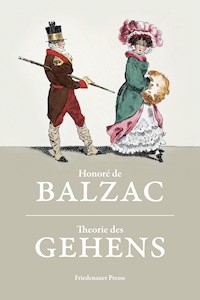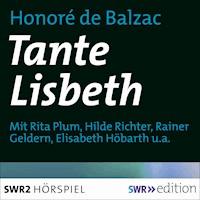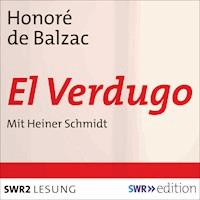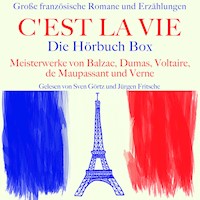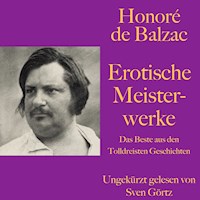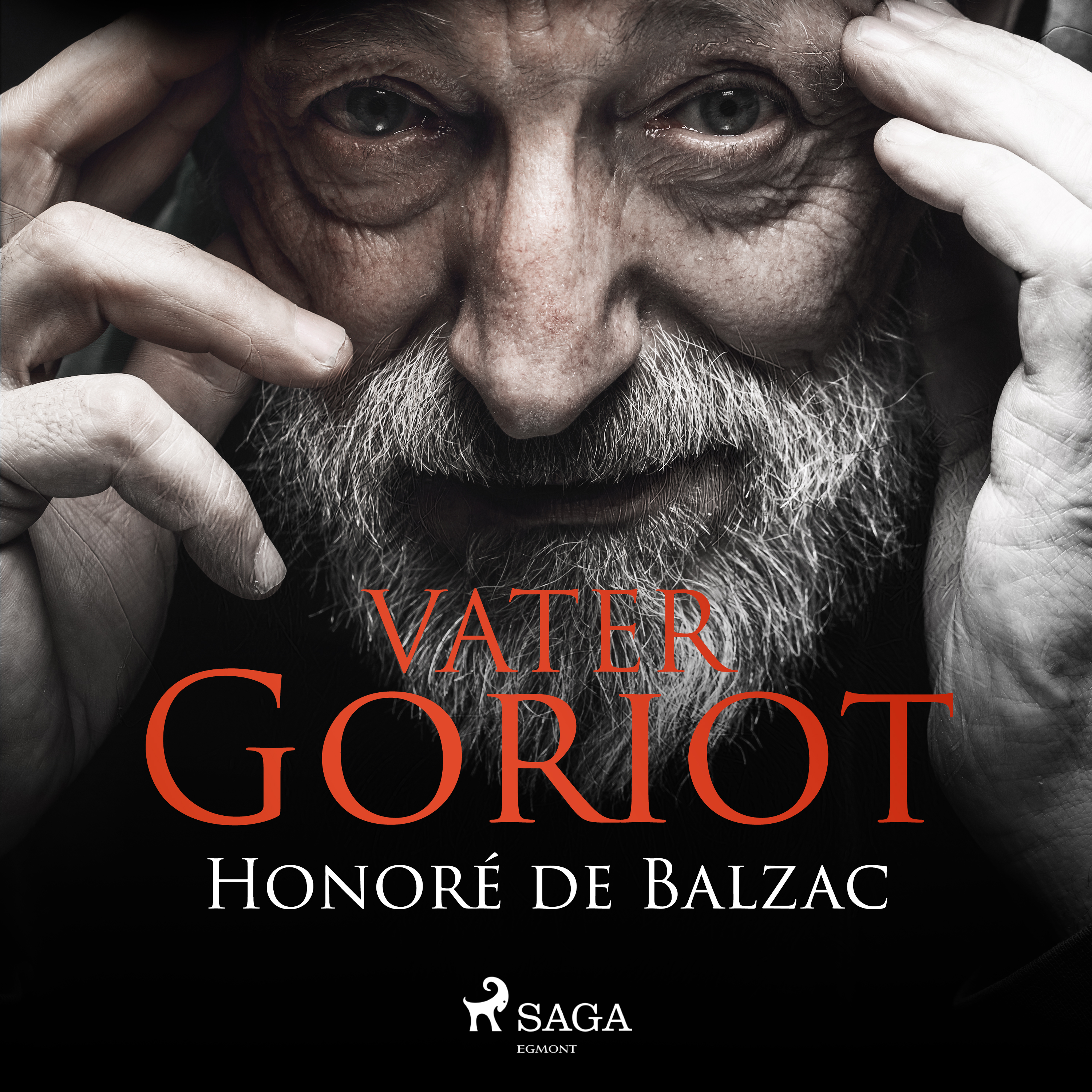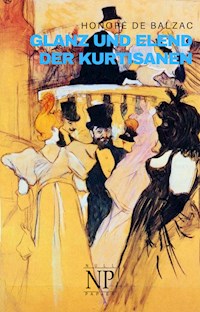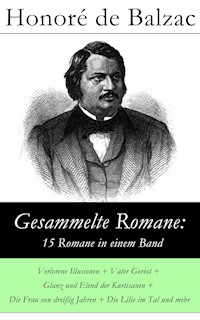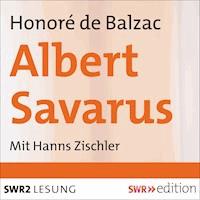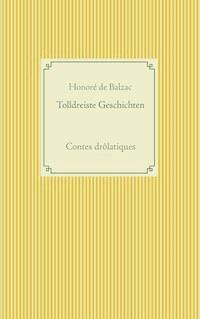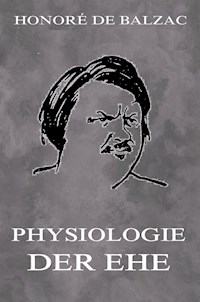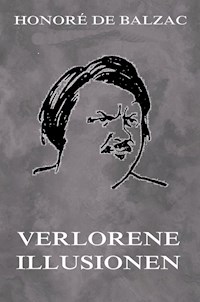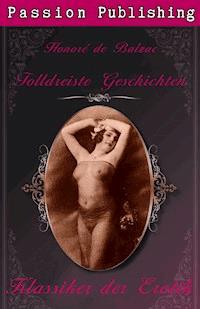Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Perret
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Augustine Guillaume, jeune fille candide et rêveuse, voit sa vie bouleversée par une rencontre inattendue avec Théodore de Sommervieux, un peintre à la mode. Leur amour, né sous le signe de l’art et de la passion, se heurte rapidement aux barrières sociales et aux préjugés de l’époque. Entre la petite bourgeoisie conservatrice et le monde artistique parisien, leur union révèle les failles d’une société en pleine mutation. Balzac nous offre un conte d’avertissement poignant, où les apparences sont trompeuses et les rêves se confrontent à la dure réalité. La Maison du chat-qui-pelote est bien plus qu’une simple histoire d’amour : c’est une réflexion profonde sur les aspirations humaines et les désillusions qui en découlent.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Présentation
Un seuil de La Comédie humaine
Dans l’état actuel de La Comédie humaine, tel du moins que le cycle nous est parvenu, La Maison du chat-qui-pelote est le premier texte de fiction par lequel le lecteur pénètre dans l’univers balzacien. En raison de la place stratégique qu’elle occupe, ce premier récit permet de découvrir certains thèmes et caractéristiques essentiels du roman balzacien : la description archéologique de quartiers de la capitale en pleine reconfiguration ; les conséquences funestes d’unions mal assorties ; la petite bourgeoisie conservatrice et réfractaire aux changements provoqués par les multiples révolutions du début du xixe siècle ; la volonté de concurrencer en littérature l’art de la peinture. On a cependant fait un peu trop souvent et sans doute trop rapidement de La Maison du chat-qui-pelote la véritable porte d’entrée de La Comédie humaine : il faut rappeler, d’une part, que c’est l’Avant-propos de 1842 qui doit faire office de seuil à la cathédrale romanesque ; d’autre part, que le Catalogue de 1845 prévoyait trois titres qui devaient précéder La Maison du chat-qui-pelote dans l’ensemble des Scènes de la vie privée. Si La Maison du chat-qui-pelote est l’une des pièces centrales de la machine balzacienne, c’est avant tout par les liens qu’elle entretient avec les autres rouages, dès l’origine.
Lors de sa première publication, cette nouvelle devenue inaugurale figure, sous le titre de Gloire et Malheur, au deuxième tome des Scènes de la vie privée parues chez Mame et Delaunay-Vallée en 1830, aux côtés de cinq autres récits : Le Bal de Sceaux, Gobseck, La Paix du ménage, Une double famille et La Vendetta. Or, ces Scènes sont précédées d’une importante préface qui révèle que « cet ouvrage a été composé en haine des sots livres que des esprits mesquins ont présentés aux femmes jusqu’à ce jour ». Balzac manifeste l’ambition de pallier les trous béants laissés cyniquement par les mères de famille dans l’éducation des jeunes filles. La Maison du chat-qui-pelote doit donc se lire d’abord comme l’un de ces six contes d’avertissement dans lesquels l’auteur a marqué « d’une branche de saule, les passages dangereux de la vie, comme font les mariniers pour les sables de la Loire ».
On ne saurait négliger non plus le fait que Balzac a fait paraître de manière anonyme la Physiologie du mariage en 1829, dans laquelle il aborde le sujet du mariage sur un mode statistique, satirique, ironique et parodique. Dans La Maison du chat-qui-pelote, le ton est tout à fait sérieux, mais le projet est comparable. On peut considérer, en effet, que les Scènes de la vie privée sont dans une certaine mesure la mise en récit des principes révélés par l’ironie de la physiologie. Dès 1830 donc, le lien d’interdépendance est posé entre les Études analytiques et les Études de mœurs, alors que La Comédie humaine n’existe même pas encore à l’état de projet.
Les chiens font parfois des chats
Fille de deux riches commerçants de la rue Saint-Denis, Augustine Guillaume ne ressemble en rien à ses parents : alors que sa mère, tout à fait laide, est surnommée « la sœur tourière » (p. 25) par le voisinage, Augustine est charmante, gracieuse et pleine de candeur. Pour son malheur, le hasard l’a dotée d’une âme qui lui fait sentir le vide de son existence. La lecture en cachette de romans oubliés dans un placard par une cuisinière renvoyée a contribué à développer les idées de la jeune fille. Entraînée par sa cousine Mme Roguin, elle découvre dans la cohue d’un Salon au Louvre qu’elle a été depuis quelques mois l’objet de toutes les attentions d’un peintre alors à la mode, et qui a été récompensé pour le portrait d’Augustine qu’il a proposé à l’Exposition. Le peintre est là pour constater l’effet produit par le tableau sur la jeune fille : un pacte d’amour est tacitement noué entre les deux jeunes gens. Après ce jour, leur amour ne cessera de grandir : celui d’Augustine en raison de son imagination stimulée par la situation toute romanesque ; celui de Sommervieux avivé par les obstacles apparemment infranchissables qui le séparent de la jeune fille sur laquelle il a artistement jeté son dévolu. Et si les amants trouvent le moyen de communiquer discrètement à la faveur de l’inventaire annuel qui accapare l’attention de toute la maison, tout est révélé quand Mme Guillaume découvre qu’Augustine tient son paroissien à l’envers et qu’elle observe un jeune inconnu pendant la messe à Saint-Leu.
Quand ils découvrent que l’inconnu est Théodore de Sommervieux, peintre de son état, les parents Guillaume sont horrifiés : « Mais vous ne savez donc pas ce qu’est un peintre ? » s’écrie Mme Guillaume, quand le père Guillaume craint déjà pour la fortune de sa fille : « Les artistes sont en général des meurt-de-faim. Ils sont trop dépensiers pour ne pas être toujours de mauvais sujets. » (p. 52). Or, pour convaincre ces vieux et riches commerçants de la rue Saint-Denis de laisser leur benjamine épouser Théodore de Sommervieux, il faut trouver des arguments qu’ils sont susceptibles de comprendre. Augustine tente sans succès de faire résonner la particule de son amant : il n’y a pas là de quoi convaincre ses parents qui n’ont pas, contrairement à beaucoup d’autres bourgeois enrichis de La Comédie humaine, le désir de s’élever socialement en s’alliant avec la noblesse. Ils savent parfaitement que les artistocrates sont dépensiers et qu’ils sont de mauvaises pratiques dans le commerce. L’intervention de Mme Roguin sera une nouvelle fois décisive : elle vient plaider la cause du jeune homme qui, pour lui faire la cour et faire de la notairesse une alliée, lui offre son portrait qui « vaut au moins six mille francs » (p. 54). Une fois Sommervieux admis dans la salle à manger du Chat-qui-pelote, il est soumis à un examen rigoureux. C’est involontairement qu’il avance l’argument décisif aux yeux du commerçant : Sommervieux aime la draperie en peinture ; le père Guillaume comprend qu’il aime la draperie, qui est un commerce respectable. Ce quiproquo n’abuse pas complètement M. Guillaume, qui avertit sa fille que s’il l’autorise à risquer son « capital de bonheur », il exige un mariage en séparation de biens pour protéger les intérêts d’Augustine. C’est que le propriétaire du Chat-qui-pelote ne « se laisse pas prendre à ces trente mille francs que l’on donne à gâter de bonnes toiles » (p. 58).
Gloire et malheur
Le régime de séparation de biens ne suffit pas à protéger Augustine des malheurs qui l’attendent dans un mariage si peu admissible socialement. Car l’explication donnée par Balzac de l’échec du mariage d’Augustine et Théodore est toute sociologique. Le peintre a été charmé par l’apparition du visage si poétique d’Augustine qui contraste avec la vulgarité du cadre dans lequel elle évolue : la petite bourgeoisie commerçante de la rue Saint-Denis. Pourtant, si la jeune femme est en effet douée de qualités qui font d’elle une fleur rare et une femme supérieure dans le cercle étroit dans lequel elle est enfermée, elle ne possède pas le talent de s’affranchir totalement de son milieu d’origine. Certes, on lui reconnaît cette beauté naturelle, qui impressionne même sa rivale la duchesse de Carigliano au point de vouloir la faire admirer au marquis d’Aiglemont, mais elle se révèle incapable de déployer dans la conversation les charmes auxquels sont habitués les gens du monde et les artistes. La lune de miel passée, Théodore et Augustine s’aperçoivent un peu tard, sans doute, qu’ils ne se comprennent pas. L’éducation étriquée qu’a reçue la jeune femme la rend totalement incapable de sentir la poésie, la musique et la peinture. Bientôt, elle se retrouve seule chez elle : son mari, toujours volage, prodiguant ses talents dans les salons parisiens.
Sourdement méprisée par son mari, incomprise par sa famille quand elle leur révèle ses secrètes douleurs, Augustine envisage de se rendre chez la duchesse de Carigliano pour lui demander quelles ressources il conviendrait d’employer pour retenir près d’elle son mari. La duchesse, d’abord stupéfaite de cette démarche inédite de la part d’une femme légitime à l’égard de la maîtresse de son époux, offre son secours à Augustine avec d’autant plus de générosité qu’elle a fini par se lasser des adorations du peintre. À la manière d’une marraine fée (bonne ou maléfique) tout droit sortie d’un conte merveilleux, elle lui prodigue de nombreux conseils sur l’art et la manière de trouver le bonheur conjugal et procure à Augustine un puissant talisman qui doit lui permettre de dominer Théodore : elle lui rend le portrait d’Augustine que Sommervieux avait placé chez elle. Or, la circulation du tableau revêt une importance capitale dans l’économie générale de la nouvelle : elle révèle le lieu où se niche l’amour de Théodore. Assez significativement, le tableau est détruit à la fin de la nouvelle : Augustine gît au milieu des décombres de son portrait et du cadre mis en morceaux. Que Mme Guillaume propose à sa fille de faire une copie du tableau détruit pour cinquante écus achève de démontrer à Augustine qu’elle ne sera jamais heureuse nulle part : le merveilleux glisse résolument vers l’avertissement. Le tragique de la situation d’Augustine, condamnée à la solitude et saisie par la mort à l’âge de vingt-sept ans, contraste singulièrement avec l’amour qui unit finalement Virginie et Joseph Lebas, et achève de transformer le conte d’avertissement en conte édifiant.
Maxime Perret
La Maison du chat-qui-pelote
Dédié À Mlle Marie de Montheau[1]
Au milieu de la rue Saint-Denis, presque au coin de la rue du Petit-Lion[2], existait naguère une de ces maisons précieuses qui donnent aux historiens la facilité de reconstruire par analogie l’ancien Paris[3]. Les murs menaçants de cette bicoque semblaient avoir été bariolés d’hiéroglyphes. Quel autre nom le flâneur pouvait-il donner aux X et aux V que traçaient sur la façade les pièces de bois transversales ou diagonales dessinées dans le badigeon par de petites lézardes parallèles ? Évidemment, au passage de la plus légère voiture, chacune de ces solives s’agitait dans sa mortaise. Ce vénérable édifice était surmonté d’un toit triangulaire dont aucun modèle ne se verra bientôt plus à Paris. Cette couverture, tordue par les intempéries du climat parisien, s’avançait de trois pieds sur la rue, autant pour garantir des eaux pluviales le seuil de la porte, que pour abriter le mur d’un grenier et sa lucarne sans appui. Ce dernier étage fut construit en planches clouées l’une sur l’autre comme des ardoises, afin sans doute de ne pas charger cette frêle maison.
Par une matinée pluvieuse, au mois de mars, un jeune homme, soigneusement enveloppé dans son manteau, se tenait sous l’auvent d’une boutique en face de ce vieux logis, qu’il examinait avec un enthousiasme d’archéologue. À la vérité, ce débris de la bourgeoisie du xvie siècle offrait à l’observateur plus d’un problème à résoudre. À chaque étage, une singularité : au premier, quatre fenêtres longues, étroites, rapprochées l’une de l’autre, avaient des carreaux de bois dans leur partie inférieure, afin de produire ce jour douteux, à la faveur duquel un habile marchand prête aux étoffes la couleur souhaitée par ses chalands. Le jeune homme semblait plein de dédain pour cette partie essentielle de la maison, ses yeux ne s’y étaient pas encore arrêtés. Les fenêtres du second étage, dont les jalousies relevées laissaient voir, au travers de grands carreaux en verre de Bohême, de petits rideaux de mousseline rousse, ne l’intéressaient pas davantage. Son attention se portait particulièrement au troisième, sur d’humbles croisées dont le bois travaillé grossièrement aurait mérité d’être placé au Conservatoire des arts et métiers[4] pour y indiquer les premiers efforts de la menuiserie française. Ces croisées avaient de petites vitres d’une couleur si verte, que, sans son excellente vue, le jeune homme n’aurait pu apercevoir les rideaux de toile à carreaux bleus qui cachaient les mystères de cet appartement aux yeux des profanes. Parfois, cet observateur, ennuyé de sa contemplation sans résultat, ou du silence dans lequel la maison était ensevelie, ainsi que tout le quartier, abaissait ses regards vers les régions inférieures. Un sourire involontaire se dessinait alors sur ses lèvres, quand il revoyait la boutique où se rencontraient en effet des choses assez risibles. Une formidable pièce de bois, horizontalement appuyée sur quatre piliers qui paraissaient courbés par le poids de cette maison décrépite, avait été rechampie d’autant de couches de diverses peintures que la joue d’une vieille duchesse en a reçu de rouge. Au milieu de cette large poutre mignardement sculptée se trouvait un antique tableau représentant un chat qui pelotait. Cette toile causait la gaieté du jeune homme. Mais il faut dire que le plus spirituel des peintres modernes n’inventerait pas de charge si comique[5]. L’animal tenait dans une de ses pattes de devant une raquette aussi grande que lui, et se dressait sur ses pattes de derrière pour mirer une énorme balle que lui renvoyait un gentilhomme en habit brodé. Dessin, couleurs, accessoires, tout était traité de manière à faire croire que l’artiste avait voulu se moquer du marchand et des passants. En altérant cette peinture naïve, le temps l’avait rendue encore plus grotesque par quelques incertitudes qui devaient inquiéter de consciencieux flâneurs. Ainsi la queue mouchetée du chat était découpée de telle sorte qu’on pouvait la prendre pour un spectateur, tant la queue des chats de nos ancêtres était grosse, haute et fournie. À droite du tableau, sur un champ d’azur qui déguisait imparfaitement la pourriture du bois, les passants lisaient Guillaume[6] ; et à gauche, successeur du sieur Chevrel. Le soleil et la pluie avaient rongé la plus grande partie de l’or moulu parcimonieusement appliqué sur les lettres de cette inscription, dans laquelle les U remplaçaient les V et réciproquement, selon les lois de notre ancienne orthographe. Afin de rabattre l’orgueil de ceux qui croient que le monde devient de jour en jour plus spirituel, et que le moderne charlatanisme surpasse tout, il convient de faire observer ici que ces enseignes, dont l’étymologie semble bizarre à plus d’un négociant parisien, sont les tableaux morts de vivants tableaux à l’aide desquels nos espiègles ancêtres avaient réussi à amener les chalands dans leurs maisons. Ainsi la Truie-qui-file, le Singe-vert, etc., furent des animaux en cage dont l’adresse émerveillait les passants, et dont l’éducation prouvait la patience de l’industriel au xve siècle[7]. De semblables curiosités enrichissaient plus vite leurs heureux possesseurs que les Providence, les Bonne-foi, les Grâce-de-Dieu et les Décollation de saint Jean-Baptiste qui se voient encore rue Saint-Denis[8]. Cependant l’inconnu ne restait certes pas là pour admirer ce chat, qu’un moment d’attention suffisait à graver dans la mémoire. Ce jeune homme avait aussi ses singularités. Son manteau, plissé dans le goût des draperies antiques, laissait voir une élégante chaussure, d’autant plus remarquable au milieu de la boue parisienne, qu’il portait des bas de soie blancs dont les mouchetures attestaient son impatience. Il sortait sans doute d’une noce ou d’un bal, car à cette heure matinale il tenait à la main des gants blancs, et les boucles de ses cheveux noirs défrisés éparpillées sur ses épaules indiquaient une coiffure à la Caracalla[9], mise à la mode autant par l’École de David[10] que par cet engouement pour les formes grecques et romaines qui marqua les premières années de ce siècle. Malgré le bruit que faisaient quelques maraîchers attardés passant au galop pour se rendre à la grande halle, cette rue si agitée avait alors un calme dont la magie n’est connue que de ceux qui ont erré dans Paris désert, à ces heures où son tapage, un moment apaisé, renaît et s’entend dans le lointain comme la grande voix de la mer. Cet étrange jeune homme devait être aussi curieux pour les commerçants du Chat-qui-pelote, que le Chat-qui-pelote l’était pour lui. Une cravate éblouissante de blancheur rendait sa figure tourmentée encore plus pâle qu’elle ne l’était réellement. Le feu tour à tour sombre et pétillant que jetaient ses yeux noirs s’harmoniait[11] avec les contours bizarres de son visage, avec sa bouche large et sinueuse qui se contractait en souriant. Son front, ridé par une contrariété violente, avait quelque chose de fatal. Le front n’est-il pas ce qui se trouve de plus prophétique en l’homme ? Quand celui de l’inconnu exprimait la passion, les plis qui s’y formaient causaient une sorte d’effroi par la vigueur avec laquelle ils se prononçaient ; mais lorsqu’il reprenait son calme, si facile à troubler, il y respirait une grâce lumineuse qui rendait attrayante cette physionomie où la joie, la douleur, l’amour, la colère, le dédain éclataient d’une manière si communicative que l’homme le plus froid en devait être impressionné. Cet inconnu se dépitait si bien au moment où l’on ouvrit précipitamment la lucarne du grenier, qu’il n’y vit pas apparaître trois joyeuses figures rondelettes, blanches, roses, mais aussi communes que le sont les figures du Commerce sculptées sur certains monuments[12]