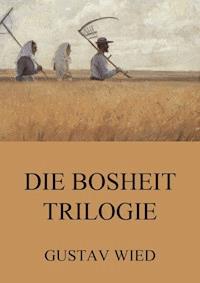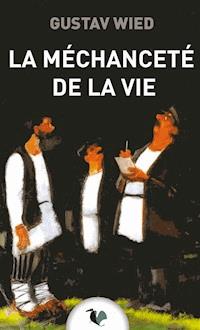
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ginkgo éditeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La petite ville était au bord du fjord. Elle ressemblait à tous les vieux bourgs danois et, comme dans beaucoup de petites villes de campagne au début du XXe siècle en Scandinavie, on y trouvait une grande piété et beaucoup de ragots. Dans cette ville, il y avait la famille Thomsen, avec la mère, Karen, et son fils doux-dingue, « Manuel », dont les frasques faisaient les délices des commères…
Gammelkobing et ses petites gens, avec la méchanceté de la vie (incarnée par le douanier), avec la force des légendes locales et de la piété bornée, avec les discours lénifiants du pasteur, les diatribes naïves du professeur et le gâtisme du conseiller... Et tout ce qui fait les réjouissants tableaux de cette fable féroce, nous tend un miroir entre grotesque et réalisme.
Gustav Wied a délibérément choisi le parti de l'humour, et si la gravité n'est jamais absente du propos, il y a toujours l'espoir... L'espoir de transformer le quotidien en farce.
EXTRAIT
C’était samedi, jour de nettoyage et d’encaustique. Les cloches de l’églises sonnaient sept heures, et les rues étaient encore calmes.
Pourtant, de part et d’autre de la ville, on entendait le bruit incessant des bavardages des servantes et leurs rires étouffés. Leurs robes de coton flottaient au vent. Une main se tenait au montant de la fenêtre, et l’autre frottait les vitres avec le chiffon trempé d’eau-de-vie qui les faisait reluire.
– Où est passé le petit Thomsen ? cria la grande Engeline, qui astiquait énergiquement les fenêtres du consul Mørch, avec de petits bruits qui rappelaient le gazouillement d’un oiseau.
– Il doit être en train de se changer ! murmura la bonne du directeur du téléphone, la grosse Rikke, depuis le second étage. Elle avait la voix chuintante de quelqu’un qui parle dans un tuyau de drainage.
Engeline hurla de rire et se retint au chambranle pour ne pas tomber.
– Qu’est-ce qu’elle dit, Rikke ? Qu’est-ce qu’elle nous dit là ? Est-ce qu’elle a dit quelque chose de drôle ? entendit-on de tous côtés.
– Elle dit que « Thummelumsen » est en train de se mettre une couche propre sur le cul !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Gustav Wied (1858-1914) est un écrivain dont l'influence a été et est encore considérable. Un auteur contemporain comme Dan Turell le considérait comme son père en littérature. Avec cette distance ironique qui le caractérise, il a fait date dans l'histoire scandinave de la satire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Présentation de l'éditeur
Le texte
La petite ville ressemblait à tous les vieux bourgs danois et, comme souvent dans ces petites villes de campagne, la plus grande piété régnait sur les nombreux ragots qui en pimentaient le quotidien.
La Méchanceté de la vie, roman sautillant et drôle écrit en 1897, est le premier volet d'une saga satirique centrée sur la petite bourgade danoise de Gammelkobing, autrement dit en français, Triffoullis-les-Oies. Gammelkobing et ses petites gens, avec la méchanceté de la vie (incarnée par le douanier), avec la force des légendes locales et de la piété bornée, avec les discours lénifiants du pasteur, les diatribes naïves du professeur et le gâtisme du conseiller... Et tout ce qui fait les réjouissants tableaux de cette fable féroce, nous tend un miroir entre grotesque et réalisme.
Gustav Wied, a délibérément choisi le parti de l'humour, et si la gravité n'est jamais absente du propos, il y a toujours l'espoir... L'espoir de transformer le quotidien en farce.
L'auteur
Gustav Wied (1858-1914) est un écrivain dont l'influence a été et est encore considérable. Un auteur contemporain comme Dan Turell le considérait comme son père en littérature. Avec cette distance ironique qui le caractérise, il a fait date dans l'histoire scandinave de la satire. Pour plus d'informations, veuillez consulter son site officiel (danois).
Cher lecteur, Ginkgo éditeur a choisi de commercialiser ses livres numériques sans DRM (Digital Right Management) afin de vous permettre de lire nos ouvrages sur le support que vous souhaitez, sans restriction. Merci de ne pas en abuser et de ne pas diffuser ce fichier sur les réseaux peer-to-peer. Bonne lecture.
© Ginkgo éditeurwww.ginkgo-editeur.fr 34/38 rue Blomet - 75015 ParisRejoignez-nous sur Facebook
`
Première partie
1.
La ville donne sur le fjord. Il y a un sentier de promenade qui longe les jardins, d’où l’on voit l’eau, les collines au loin, les bois et les fermes.
C’est une vieille et belle ville, pleine de petites maisons étranges, de rues qui serpentent et de ruelles aux noms singuliers.
L’église est sur une hauteur, grande et blanche, avec des vitraux de toutes les couleurs et un fronton dentelé.
C’est l’église des « Sœurs Blanches ». Le nom vient des temps catholiques de la ville, quand il y avait un couvent sur les remblais de gravier, des maisons de charité et des écoles religieuses, quand les fils et les filles de bourgeois apprenaient – entre psaumes et vapeurs d’encens – que la vie sur Terre ne pouvait être autre chose qu’une errance dans la prière et le renoncement. Entre forêts sauvages et profonds précipices, où mille dangers guettaient chacun de leurs pas. On ne pouvait que tenter de se rapprocher du but, sain et sauf, en prenant garde aux faux pas, de jour et même de nuit. Toutes les pensées, tous les souhaits et tous les désirs devaient se concentrer non pas sur le Monde et ce qu’il était, mais sur une seule et indicible vérité : la vie n’était qu’une mort éternelle, et la mort n’était que le seuil de la vie éternelle.
Oui, c’est ainsi que l’on vivait alors. Et c’est cela qu’on apprenait.
Maintenant il en est tout autrement.
Non pas que la ville soit « sans Dieu ». En aucune façon ! Le dimanche et les jours saints, on s’asseyait sur les vieilles chaises en chêne brut des « Sœurs Blanches », et on prêtait pieusement l’oreille au sermon du prêtre et aux orgues sonnantes. On s’aquittait de l’impôt et de la dîme auprès des autorités terrestres et ecclésiastiques représentantes de Dieu sur Terre.
Aux pauvres, on trouvait de petits travaux et des quignons de pain avec du beurre – s’ils conservaient une certaine forme de dignité dans le besoin. Et à Noël, toute la ville « empaquetait-cadeau », dans des gilets de flanelle et de petits pantalons, les gamins déguenillés des rues.
Mais – et c’est en cela qu’on savait que le présent n’était plus le passé, comme aurait pu dire un moraliste – on n’allait plus à l’église, on ne donnait plus des quignons de pain beurrés, on ne payait plus son impôt et sa dîme, et on ne tricotait plus des pantalons et des gilets parce qu’on devait le faire, sous l’empire d’une irrépressible nécessité intérieure… Non : on le faisait parce que le voisin le faisait.
Car la ville était petite et les rues n’étaient pas larges, ni longues. Sans le vouloir on regardait chez le voisin. Et on savait à l’odeur ce qu’il mangeait pour déjeuner.
Et les acrobaties culinaires de Mme Heilbunth le dimanche expliquaient en grande partie le poulet au chou rouge de Mme Lassen le mardi...
2.
C’était samedi, jour de nettoyage et d’encaustique. Les cloches de l’églises sonnaient sept heures, et les rues étaient encore calmes.
Pourtant, de part et d’autre de la ville, on entendait le bruit incessant des bavardages des servantes et leurs rires étouffés. Leurs robes de coton flottaient au vent. Une main se tenait au montant de la fenêtre, et l’autre frottait les vitres avec le chiffon trempé d’eau-de-vie qui les faisait reluire.
– Où est passé le petit Thomsen ? cria la grande Engeline, qui astiquait énergiquement les fenêtres du consul Mørch, avec de petits bruits qui rappelaient le gazouillement d’un oiseau.
– Il doit être en train de se changer ! murmura la bonne du directeur du téléphone, la grosse Rikke1, depuis le second étage. Elle avait la voix chuintante de quelqu’un qui parle dans un tuyau de drainage.
Engeline hurla de rire et se retint au chambranle pour ne pas tomber.
– Qu’est-ce qu’elle dit, Rikke ? Qu’est-ce qu’elle nous dit là ? Est-ce qu’elle a dit quelque chose de drôle ? entendit-on de tous côtés.
– Elle dit que « Thummelumsen2 » est en train de se mettre une couche propre sur le cul !
– Ha-Ha ! Hi, hi, hi ! pouffa le cœur de robes de coton en se tortillant de rire.
– Bah! grimaça la vieille Dorthe sous les toits.
– Machines à rire ! dit-elle en faisant claquer le linge de Mme Reiersen. – Gamines !
Une charrette de paysan passa la « porte des Nonnes » en grondant. Les chevaux allaient au petit trot, et le charretier, affaissé sur son siège, somnolent, clignait des yeux comme s’il était en train de s’endormir.
Puis ce fut un chargement de bois, dont le bruit sur le pavé emplit tout la rue et fit trembler les vitres.
Quelques filles tournèrent la tête et lui souhaitèrent bonjour en criant.
Une rafale de vent se coula entre les toits, gonflant les robes de coton comme des ballons.
– Hé, hé, hé ! ricana le garçon de ferme, réveillé, en jouant du fouet en direction d’Engeline.
– Paysan ! murmura la grosse Rikke à travers son tuyau de drainage. Tu aimerais bien, hein !
Et des rires éclatèrent à tous les étages et dans toute la rue. Le paysan lança un œil rusé sur ces dames et préféra s’éloigner un peu…
Cela se passait dans la rue principale de la ville, celle qu’on appelait Søndergade3. Les maisons, des deux côtés, ressemblaient à deux rangées de dents gâtées, vieilles et inégales. Grandes, petites, larges, courtes, ou tronquées, entassées les unes sur les autres.
Une toute petite « dent » d’un seul étage, à trois fenêtres était coincée entre deux autres maisons trop grandes qui avaient un deuxième étage et des combles. C’était là qu’habitait celui qu’on appelait « Thumsen ».
MERCERIE-BONNETTERIE
KAREN THOMSEN
pouvait-on lire sur la porte de la boutique.
La maison était peinte en gris perle, avec l’entresol brun clair. La boutique donnait directement sur la rue.
« Thumsen » s’appelait en réalité Emanuel, et c’était le fils de Karen.
– Le voilà ! chuchota Engeline.
Son chuchotement était distinct et précis, comme un courant d’air dans l’embrasure d’une porte.
La grosse Rikke plia la quenelle qui lui servait de cou pour pencher son visage au-dessus de la rue.
– Bonjour, monsieur Thomsen !
– Bonjour, monsieur Thomsen ! dit aussi Engeline.
Et puis
– Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! lancèrent des voix alentours. Mais le petit homme semblait ne pas voir ni entendre ce qui se passsait autour de lui.
Il était sorti de la boutique avec un broc d’eau et un balai. Il se mit à arroser consciencieusement une partie du trottoir et de la chaussée. Comme s’il était responsable de leur propreté.
Il arrosa en suivant une ligne imaginaire. Pas une goutte ne tomba sur la part de la rue qui aurait pu dépendre des voisins ou des vis-à-vis.
Après l’arrosage, il prit le balai et balaya.
Alentour filles et femmes émergeaient petit à petit des portes et portails de la rue pour aller chercher du pain et du lait. Pendant ce temps, les caissiers et les livreurs, encore ivres de sommeil, débarrassaient les devantures de leurs volets.
Le soleil brillait au-dessus des grands arbres et dans les rues ; et la plupart des cheminées de la rue se panachaient de bleu.
– Thomsen, pourquoi vous balayez comme ça tous les jours ?
C’était le transporteur de la maison voisine, sur le pas de sa porte. Il était paresseusement adossé au mur. Il baillait et s’étirait, faisant craquer ses articulations une par une.
– Je ne comprends pas, dit-il. Et il va falloir tout rebalayer ce soir parce que c’est samedi, hein ! Bonjour ! ajouta-t-il à haute et intelligible voix, mais Thomsen continua son travail sans répondre.
– Bonjour ! fit Thomsen finalement, poliment, mais sans lever la tête.
– On devrait vous donner un appareil auditif comme à Mlle Reiersen, fit l’homme en disparaissant dans son jardin où l’on criait après lui… quand les gens vous parlent, hein ?
Mais Emanuel Thomsen ne daigna pas répondre.
Les voitures grondaient à présent les unes après les autres sous la « Porte des Nonnes ». La plupart traînaient une remorque derrière elles, où étaient entassés deux ou trois cochons.
Le samedi était le « cochondi » de la ville, et les paysans se bouculaient à la boucherie.
À plusieurs reprises, on entendit les cris des bêtes dans leur remorque, réveillées par les cahots des pavés.
– Eu ! Eu ! Aï ! Aï ! hii ! hurlaient-elles.
Et les filles aux fenêtres alentour hurlaient avec elles et secouaient la poussière de leurs chiffons sur la tête des paysans.
– Hé ! grogna Emanuel lorsqu’une voiture fit voler le coquet tas d’ordures devant la boutique de sa mère.
– Tu n’as qu’à construire une palissade ! lui cria le charretier. La rue, c’est pour les voitures !
– Fini ! cria la consulaire Engeline, en disparaissant avec un « hop ! » à l’intérieur de la maison.
– Pareil ! fit Rikke en rampant péniblement sur le chambranle. Elle était si ronde qu’elle ne pouvait pas se dégager autrement que sur le côté.
– Au revoir, Thumsen, dit-elle, avant de fermer la fenêtre. – Salue « Mortensen » pour moi !
Les cloches de l’église sonnèrent huit heures trois quart. Toutes les boutiques étaient ouvertes et il y avait beaucoup de circulation dans Søndergade. On entendait le bruit des portes qui s’ouvraient et se fermaient, et les clochettes des boutiques.
Les petits vendeurs de journaux firent claquer leurs sabots sur les pavés en sifflotant. Et le soleil enflamma les vitres impeccables du côté gauche de la rue.
« Thumsen « avait reposé broc d’eau et balai, et il était maintenant occupé à astiquer consciencieusement la poignée de porte en cuivre de la boutique.
La sage-femme, Mme Fredriksen, passa devant la mercerie, son sac à la main.
– C’est un sacré travail, ça, Thomsen ! dit-elle en s’arrêtant.
– Il faut bien travailler, madame Fredriksen ; c’est pourquoi Dieu nous a mis sur Terre.
– Ah, mais Dieu est aussi avec moi dans mon bon vieux lit !
– C’est un peu différent…
Emanuel continuait à frotter sans relâche.
– Bonjour, madame Fredriksen ! cria le professeur Clausen depuis l’autre trottoir (il faisait sa promenade du matin). Est-ce que les cigognes sont déjà passées ? cria-t-il. Si tôt dans l’année, hi, hi, hi ? … Bonjour, Thomsen !
– Bonjour, monsieur le professeur !
– Vous avez raison, dit Mme Fredriksen. La jeunesse est ardente, monsieur le professeur !
– Hi, hi ! éclata le professeur en s’éloignant.
– Ça, c’est un homme brillant ! dit la sage-femme en hochant la tête. Lui, je l’aime bien.
– Peut-être un peu trop beau-parleur pour les enfants… suggéra Thomsen.
– Oh, toi ! rugit Mme Fredriksen en le chassant gentiment à coups de sac.
– Oui, oui, Madame Fredriksen, mais c’est qu’il y a tellement de choses sales dans ce monde…
– Tu es un entêté, Thomsen !
– On est ce qu’on est, madame Fredriksen…
– Mais on n’est pas toujours ce qu’on aurait dû être !
– On ne comprend pas ce que vous voulez dire…
Il y avait un mot que Thomsen n’employait jamais : je.
– Je veux dire que si les choses étaient si bien faites que cela, alors tu serais certainement une femme ! Hi ! Hi !
Emanuel rougit et se replongea dans son travail.
– Oui, oui, encore un bon mot ! s’écria Mme Fredriksen en lui tapotant généreusement les épaules. – Allez ! Maintenant, je rentre au dodo ! Bonne journée Thomsen !
Et salue ta maman pour moi !
De petits groupes d’écoliers avec des sacs à dos, des cartables et des livres en bandoulière envahirent la rue en traînant des pieds. Les filles d’un côté, les garçons de l’autre. Au moment de se croiser, les filles évitèrent les garçons tandis qu’ils leur jetaient des regards moqueurs.
– Thumsen, Thummelumsen ! dirent quelques grands dadais, en passant près de la mercerie. Et ils s’enfuirent en courant, par crainte des représailles.
Mais le petit Emanuel ne se souciait pas d’eux. Il travaillait encore, calmement et énergiquement, car c’était un homme conscient de son devoir.
– Petit Manuel, tu devrais rentrer et boire ton café, mon garçon !
– On doit d’abord finir la porte, maman Karen !
– Alors je bois le mien, dit doucement Mme Thomsen, en passant dans l’arrière-boutique.
– Bois ! dit Emanuel.
– Quand est-ce que tu viens, toi ?
– Dans un quart d’heure !
Quand la serrure de la porte brilla comme de l’or, Thomsen rassembla ses affaires pour répondre à l’appel de sa boisson matinale.
Au moment où il ouvrait la porte de la boutique, un gros chat gris-bleu vint se frotter contre sa jambe, tendrement.
– Mais c’est Knors ! dit-il d’une voix câline en soulevant l’animal dans ses bras, malgré tout ce qu’il portait déjà. – Comment va mon petit chat-chat ?
– Miaou-ou ! dit Knors en enfouissant son museau sous son bras.
3.
Dans la petite arrière-boutique, Madame Thomsen était assise dans son fauteuil, devant la fenêtre, et elle cousait l’ourlet de quelques mouchoirs.
La lumière du jour se frayait un chemin entre les pots de fleurs sur l’appui de la fenêtre, et se posait sur elle, sur ses cheveux blancs, sur ses joues fraîches et rouges. Elle avait l’air tellement jeune. Et ses yeux bleu clair étaient doux et bons.
– Je vais chercher le café, Manuel, dit-elle en trotinnant.
– Merci, merci, Maman Karen ! dit-il en s’asseyant dans le canapé, derrière la jolie table en acajou ovale.
Il y avait une nappe blanche en crochet sur la table. Et sur le canapé et sur les chaises, il y avait d’autres « pièces » de crochet blanches.
– Alors, Knors, dit Thomsen poursuivant l’interrogatoire du chat qu’il tenait toujours dans ses bras.
Comment ça va ?
Knors frotta sa gueule contre la manche de son maître en essayant de ronronner.
Ce chat était objectivement une antiquité. Les poils n’étaient plus très longs sur son dos ; et ses oreilles étaient déchirées et plusieurs fois mangées, à la suite de nombreuses joutes amoureuses. C’était un mâle. Et il lui manquait un œil.
– Est-ce qu’il y a d’la souris dans le piège, M’man ? cria Thomsen en direction de la porte de la cuisine.
– Je les lui ai déjà données, lui répondit-on.
– Combien y en avait-il ?
– Deux... Mais il n’avait pas envie de les manger.
– Non ! mais il joue avec… hein mon chat ? Ça nous amuse de les voir et de jouer avec ? continua-t-il en caressant le museau du chat avec la paume de sa main. – Ça nous amuse ? hein ? Ça nous amuse ?
Le chat éternua.
– Il éternue ? Il a pris froid ? demanda douloureusement Thomsen, en le déposant prudemment dans un coin du canapé.
Mme Thomsen revint de la cuisine avec un plateau.
– Tiens, petit Manuel. Bois maintenant, pendant que c’est chaud.
Manuel flaira les vapeurs de café.
– Maman fait le meilleur café de tout le Danemark ! dit-il.
La vieille sourit, satisfaite, et retourna à son ouvrage.
Chaque matin, le fils faisait l’éloge de son café. Et s’il ne l’avait pas fait, elle aurait pensé qu’il était malade ou qu’il lui était arrivé quelque malheur…
Parce qu’ils en avaient connu, tous les deux.
Mme Thomsen soupira et regarda craintivement son « garçon », du coin de l’œil.
Knors était maintenant roulé en boule dans un coin du canapé ; et Emanuel buvait son café avec de petits bruits goulus. De temps en temps, il prenait un peu de mie de pain blanc qu’il mettait sous le nez du chat qui les grignotait voracement.
Une tiédeur agréable règnait dans la pièce. On n’était encore qu’à la fin du mois d’avril et l’on faisait du feu dans le poêle. Et dans un coin, un pot-pourri diffusait une odeur épicée.
– C’en est bientôt terminé pour eux, là-bas ! dit brusquement Emanuel.
La vieille sursauta :
– Cela fait si longtemps que tu le dis, Manuel…
– Ce sera un grand jour, quand on reviendra à la ferme, m’man Karen ! dit le fils, l’œil brillant.
– Oh, oui… Mais pour l’instant, on est plus ou moins coincés ici.
– Et on pourra se pavaner devant tous les arrogants de la ville !
– Je trouve qu’ils sont bien gentils, mon petit Manuel.
– Ce sera pour la fin décembre.
– Mais tu n’as pas assez d’argent, Manuel !
– Ça vient, Maman Karen, ça vient !… Ce sera pour la fin décembre. Et alors… ! dit Thomsen en claquant des doigts de triomphe.
– Comment en es-tu si sûr… ?
– Bech, le marchand ! Il ne va pas attendre longtemps que Cornelius le rembourse ! C’est un vieil ami de Papa, tu sais.
– Oh, cette amitié-là…
– Cette fois, ça ne se passera pas comme ça !
– Si Bech l’avait voulu…
– C’était la banque. Bech avait d’autres priorités !
– Oui, oui, Manuel, mais…
– Maman Karen, dit le fils en se tournant soudainement vers la fenêtre, – pourquoi es-tu toujours aussi pessimiste, dès qu’il s’agit de la Ferme ?
– Ce n’est pas ça, Manuel, mais…
– Mais quoi ?
– Quand on n’est sûr de rien...
– Est-ce qu’on ne connaît pas la terre ! dit le petit en se rengorgeant dans le canapé. – Est-ce qu’on n’est pas le fils d’un propriétaire ! Est-ce qu’on n’a pas travaillé au moulin pendant dix-neuf ans !
– Oui, oui, mon petit Manuel ! Et avec la bénédiction de notre Seigneur…
– Dieu est avec nous ! dit Manuel sans hésiter. – Je l’ai souvent remarqué, tu sais !
– Oui, oui, si tu le dis…
Manuel regarda la pièce autour de lui, d’un œil brillant.
– Et tous ces meubles que l’on possède ! Et tu se souviens de la place qui est vraiment la leur, hein ? leur vraie place !
Mais à ce moment un nuage passa devant son visage.
– Pourvu que Mortensen vive jusque là ! dit-il. – Il n’y a rien à craindre en ce qui concerne Knors, il est résistant. Mais l’autre… On pense qu’il est devenu un peu bizarre ces derniers temps.
– Oh, non, c’est toujours la même chose…
– Ils sont venus ici il y a quinze ans, poursuivit Thomsen élégiaque, – et, comme nous, ils se languissent de la Ferme. La méchanceté a souvent été sur eux. Même les meubles sont malheureux, ici…
Il tendit les mains vers le grand secrétaire en acajou à la mode d’autrefois, qui brillait dans le fond de la pièce contre le mur de la cuisine. On y avait rangé en petits tas coquets des cales en pierrre, des cognées et des coquillages tachetés.
– Ah ! S’ils pouvaient comprendre ce que signifie le tableau ! Ils pourraient se souvenir de ce que c’était !
« Le tableau » était accroché au-dessus de la tabatière, dans le coin. C’était une toile peinte à l’eau, de couleurs criardes. Elle représentait une ferme blanche et lumineuse, avec un toit de chaume safrané et des fenêtres et des portes vertes comme l’herbe. Une rangée de très grands arbres, avec des troncs brun-rouge et de formidables feuilles bleu-vert, entourait le bâtiment. Et à droite de l’entrée on voyait la roue du Moulin ; une roue de « chute d’eau », comme semblait le signifier cette masse de peinture étrange et épaisse qui se précipitait dans ses pales, jaillissante, bouillonnante et écumante, comme un Niagara de lait teint en bleu.
C’était le Moulin, c’était la Ferme, la propriété familiale des Thomsen ; le frère de Karen, l’instituteur de Græsted, le chantre de l’église, l’avait peint avec les meilleures intentions du monde. Pour qu’ils emportent cette image avec eux en ville.
Désormais, c’était l’objet d’une adoration presque religieuse.
Emanuel resta assis un moment, silencieux et méditatif. Soudain, il se leva :
– Merci pour le café, maman !
– Je t’en prie, mon garçon.
– On va sortir, maintenant, et travailler pour récupérer la Ferme.
– Oui, c’est ça, petit Manuel.
Thomsen rangea les tasses sur le plateau, ramassa dans le creux de sa main quelques miettes sur le canapé, lissa un peu la nappe et se dirigea vers la cuisine.
– On range le plateau, dit-il.
– Merci, Manuel.
Mme Thomsen leva son petit visage doux et le regarda s’en aller. Puis elle secoua la tête et recommença à coudre.
Le poêle chauffait. La pièce tiédissait de plus en plus. Et la bouilloire, qui était restée sur le feu, commença à ronfler.
– Bonjour ! dit soudainement Mme Thomsen, la voix forte et amicale, en faisant un signe de tête à travers la fenêtre. Car une dame lui faisait signe.
Au même moment, dans le poêle, un brandon enflammé craqua en projetant quelques étincelles hors du foyer.
– Bon sang ! dit la vieille avec un coup d’œil angoissé.
Au contact du sol, les étincelles s’éteignirent rapidemment. Mais le fond de la pièce était si sombre qu’un halo de lumière glissa un instant sur les vieilles photographies passées, élégamment disposées sur le mur. La plus grande était au centre, avec comme une couronne de petites autour. L’un des cadres était décoré d’immortelles. C’était une photographie du grand-père Thomsen, un beau vieillard, avec une barbe blanche magnifique qui coulait sur sa poitrine.
Puis un gros morceau de bois tomba encore obstruant cette fois le foyer. Et les portraits furent à nouveau plongés dans le noir.
Madame Thomsen avait abandonné son ouvrage sur ses genoux et elle regardait devant elle.
Elle pensait à Emanuel et à ses idées fixes.
Seigneur ! elle habitait dans cette gentille petite maison depuis maintenant presque quinze ans et elle s’y était habituée… Mais Manuel ne pensait jamais à rien d’autre qu’à la ferme, là-bas. Ses pensées n’en étaient jamais loin… Ils mangeaient à peine, tellement il économisait pour pouvoir la racheter. C’était presque de la démence chez Manuel, mais c’était aussi une question d’honneur. Extérieurement, il était humble et doux, mais intérieurement, il était aussi fier que le Pape ! Il était travailleur et prévoyant, elle devait l’admettre ; et propre, aussi ! Presque trop propre, pensait-elle ; et elle était pourtant une femme… Les gens de la ville se moquaient de lui... Mais Manuel, lui, il passait son chemin et il les laissait causer… Ah, Seigneur, oui, bien sûr ce serait merveilleux de revenir dans nos vieilles chambres ! Et de retrouver le Moulin ! Et le jardin ! Mais où trouverait-il l’argent ?… Et puis, il n’était pas capable d’exploiter une ferme ; il ne pourrait pas... Tant qu’elle, elle vivrait, elle pouvait travailler, et puis le protéger, et le conseiller... Mais quand elle ne serait plus là… Okja, okja, okja, oh, Seigneur, oui ! … Mais Manuel trouvera bien un moyen…
Madame Thomsen se remit à son ouvrage d’un hochement de tête, et les doigts s’affairèrent de nouveau.
Le fil se faufilait dans la toile raide. Le grondement monotone du poêle et de la bouilloire étaient comme un murmure qui endormait peu à peu l’esprit jusqu’à une totale ataraxie.
De temps en temps une voiture passait devant la maison qui vibrait depuis ses fondations jusqu’au toit, et la pierraille posée sur le secrétaire cliquetait violemment. Mais ça ne gênait plus Karen comme dans les premiers temps, quand ils venaient de s’installer en ville. Bien sûr, elle continuait à regarder mécaniquement entre les pots de fleurs pour tenter d’apercevoir le véhicule. Mais ensuite sa tête revenait à sa position initiale et elle recommençait à coudre.
Au-dessus de la petite table de couture flottaient des vapeurs épicées de roses séchées et de lavande. Le parfum du pot-pourri dans l’encoignure était de plus en plus fort. Et la chaleur montait dans la pièce.
Ses paupières se fermèrent à demi et ses mains se posèrent sur ses genoux… Elle se renversa dans son fauteuil et elle appuya sa nuque sur le dossier :
– Une petite, une toute petite sieste, le matin, ça ne peut pas faire de mal, non ! juste fermer les yeux pendant deux minutes… – Hi, hi, son mari ne pouvait pas s’empêcher de s’asseoir dehors sur une chaise et de somnoler… À midi, il s’asseyait… Et le soir, dans l’obscurité… – Okja, oui, oui, oui-i, c’était cette fois-là, oui… Et alors il était tombé malde… Est-ce que Manuel s’était souvenu de fermer les lucarnes ? En cas d’orage… Et de faire rentrer les poules… Et de mettre le cadenas à la porte de la grange… Des souris, oui, deux souris dans le piège. Okja, oui, oui… Ron, pff, ron…
Madame Thomsen s’était assoupie.
La clochette de la porte sonna : un client.
La vieille se leva, un peu perdue, et se frotta les yeux.
– Dieu ! dit-elle en ramassant ses jupes et en courant dans la boutique.
4.
La cour, derrière la boutique de Karen Thomsen, avait six aunes de long et cinq de large. Les maisons des voisins la fermaient sur deux côtés, et elle était complétée sur le troisième côté par une remise pas très haute, avec un toit de chaume.
Cette remise servait au bois de chauffage. Il y avait aussi quelques caisses et un empilement savant de meubles emballés, ainsi qu’une scie circulaire et un billot.
La petite porte était ouverte et Emanuel était intensément occupé à fendre le bois menu.
Il y avait de plus en plus de lumière dans la cour, le soleil s’élevant progressivement au-dessus du grand entrepôt voisin, à l’est.
Enfin, il se dégagea définitivement, éclaboussant de lumière et de chaleur le coin avec la pompe à eau.
« Thumsen » reposa la cognée sur le billot et se retourna vers le fond de la remise.
– Allez, Mortensen, dit-il – maintenant on va lézarder au soleil.
Et il alla sous la petite fenêtre, dans le coin le plus reculé de la remise, et il souleva prudemment quelque chose qu’il porta dehors.
C’était un coq. Le plus vieux depuis les débuts de l’ère chrétienne.
Squelettique, déplumé, et fripé ! Ses ailes pendaient, flasques, des deux côtés de son corps débile, et il n’avait que deux pauvres plumes chiffonnées et cassées sur le cul. Ses pattes avaient l’air anormalement longues… Mais ses ergots étaient pourvus de cicatrices en abondance, qui se croisaient comme des lames !
Sans un cri, il se laissa porter dans le coin de la cour où il y avait une flaque de soleil.
– Là, Mortensen sera bien, c’est bien chaud ! dit Thomsen en posant l’animal après un examen méticuleux du pavé. – C’est l’été !
Mortensen chancela un moment, comme en pleine mer, sans parvenir à trouver l’équilibre. Finalement, il réussit. Son cou pendait mollement, presque pelé. Ses yeux se fermaient. Il ne pouvait pas lever la tête ; et sa crête, comme une feuille morte, ridée, pendillait faiblement sur le côté… Mais sur ses pattes en aiguilles à tricoter, il y avait les martiales cicatrices !
Il ressemblait à un chef d’escadron de quatre-vingt-dix ans.
– Ça va pas trop mal ? demanda Thomsen avec une infinie compassion dans la voix, en caressant prudemment le dos chiffonné du coq. – On a un peu peur ?
L’animal vacilla sous les caresses. Ses paupières clignaient et sa tête se balançait.
Emanuel enfonça ses mains dans les poches de son pantalon, et resta un moment à regarder son ami, perdu dans de profondes pensées. Puis il prit un air résolu et retourna à la remise fendre le bois menu.
« Knors » et « Mortensen » étaient nés au moulin, peu de temps avant que le vieux Thomsen ne meure. Lorsque le domaine avait été vendu aux enchères quelques mois plus tard et que Karen et son fils avaient déménagé en ville, Manuel avait pris les animaux avec lui. Knors s’appelait Knors depuis toujours, et Mortensen avait été baptisé ainsi à cause d’un vieux garçon de ferme fidèle.
Manuel avait pleuré comme si on l’avait fouetté, quand ils avaient quitté la maison de son enfance. Et Maman Karen s’était assise, livide et calme, à ses côtés, l’avait fait taire et avait eu de bonnes paroles. Manuel serrait Knors dans ses bras et Mortensen faisait des coucous depuis le panier à couvercle posé à ses pieds.
Il y avait maintenant quinze ans de cela. Manuel avait dix-neuf ans à l’époque, et il n’avait jamais passé deux jours entiers sans penser à la ferme paternelle.
Bien sûr, il était la risée de la petite ville, ce rustaud maladroit, avec sa figure ronde et lunaire et ses petits yeux rouges de cochon. Et d’autant plus que l’une de ses épaules était plus haute que l’autre, de sorte que quand il descendait dans la rue, son bras droit semblait significativement plus long que le gauche.
– Il court comme un crabe, disait-on de lui. – Il n’a qu’un seul rein, comme les chiens !
Au début, en ce qui concerne la « course », Manuel ne pratiquait pas beaucoup. Il restait chez lui, oppressé. Et ses pensées tournaient comme un carrousel, le ramenaient sans cesse à la propriété, là-bas, à son moulin, son jardin, et tout ce que lui et sa mère avaient dû abandonner.
Mais, par une belle nuit, une année après leur déménagement, il avait fait un rêve.
En fait, une « Révélation », comme il le disait lui-même : son père lui était apparu et il lui avait dit que le nouveau propriétaire ferait faillite, et puis que deux autres propriétaires après lui feraient également faillite. Et alors, Emanuel connaîtrait à nouveau la Grâce4.
Son père avait précisé dans le rêve que, pour que tout cela s’accomplisse, Knors et Mortensen ne devaient pas mourir avant d’avoir reposé une patte sur la terre qui les avait vus naître.
Le matin suivant, Emanuel s’était levé le cœur plein d’une grande résolution. Il gagnerait de l’argent ! De quelque façon qu’il puisse en gagner, il en gagnerait ; quand bien même il devrait conduire une voiture-latrine dans les rues de la ville.
Il n’était encore que cinq heures ce matin-là et il faisait complètement noir. Mais Manuel avait allumé sa lumière, s’était habillé, et était allé voir Maman Karen qui dormait. Ils avaient chacun une mansarde qui leur tenait lieu de chambre à coucher.
Mme Thomsen s’était réveillée en sursaut et avait jeté un regard furieux sur son fils :
– Au nom béni de Jésus, Manuel… !
Mais Manuel s’était tranquillement assis sur la chaise près du lit, sa chandelle à la main.
– On a eu une révélation ! dit-il.
Maman Karen se mit à pleurer :
– Oh, Seigneur, c’est donc à ce point…
Et le fils avait commencé, calme et maître de lui, à raconter son rêve ; ce que le père avait dit sur la propriété, sur les nouveaux propriétaires et sur Knors et Mortensen.
La vieille s’était relevée dans son lit et l’avait écouté :
– Nous les êtres humains, nous rêvons tant, Manuel…
– Mais le père était si vivant devant nos yeux, Maman Karen! Il était debout, au pied du lit. Et on l’a entendu fermer la porte quand il est parti.
Madame Thomsen avait hoché la tête.
– Oui mais l’argent, l’argent, dit-elle. Où le trouveras-tu ?
– Papa nous le dira ! affirma le fils, solennellement. Quand il reviendra !
– Il ferait cela, Manuel… ?
– C’est ce qu’il a dit !
– Et tu trouves cela raisonnable ?
– On l’a vu ! dit Manuel avec un regard fanatique qui lançait des éclairs. – On l’a vu comme on te voit, toi.
La vieille s’était tue. Elle n’osait plus dire quoi que ce soit à son garçon. « Il a l’air tellement évaporé », avait-elle pensé cette nuit-là.
Le même jour, il devait y avoir une vente aux enchères à l’hôtel. Les meubles de Thomsen étaient là-bas, au milieu d’une foule d’autres choses. Et ils faisaient envie, entre toutes les autres pièces du bric-à-brac, car c’étaient de bons, de solides meubles en acajou. On avait conseillé à Madame Thomsen de les emporter en ville avec eux, car il était probable qu’on puisse en espérer là-bas un meilleur prix qu’en pleine campagne, chez les paysans. Pendant un an, ils avaient été entassés dans tous les coins et recoins des pièces de la petite maison. Elle n’avait pas le cœur de se séparer d’eux. Et puis, ce jour-là, à dix heures, ils devaient être vendus.
Mais aux premières lueurs de l’aube, Emanuel alla à la salle des ventes et reprit les meubles. On a pensé, avait-il prétendu, qu’ils devraient attendre une prochaine fois.
La ville avait parlé, s’était moquée et était même devenue hargneuse. Et c’était à la suite de cette aventure que Emanuel avait été surnommé « Thummelumsen ».
Mais, quelques heures plus tard, les meubles étaient de retour à la maison, entassés dans le grenier et dans la remise du fond de la cour, alors la ville pouvait bien parler !
Madame Thomsen secoua sa tête blanche. Mais il y avait en elle une terreur mystique de cette nuit-là. Mais Manuel était, en fin de compte, un homme ; et elle avait toujours eu l’habitude de considérer les hommes comme plus raisonnables.
Et puis il y avait eu la boutique.
– Papa l’a dit ! dit Manuel.
Et Karen n’osa pas le contredire.
– Il t’a encore visité, Manuel…
– Oui : il était encore là, Maman Karen.
– Oui, oh, oui, je devrais le savoir… Tu as encore parlé avec lui ?
– Oui, cette nuit.
Une autorité distante et sévère était devenue le propre du petit Thomsen depuis qu’il entretenait des relations sérieuses avec l’au-delà. Les « Révélations » le soutenaient et l’avaient rendu énergique. Il avait trouvé un but. Et il travaillait avec la force de dix chevaux pour l’atteindre. Il était en activité du matin au soir… Il installa la boutique tout seul, il fit de la menuiserie, fabriqua un comptoir et des rayonnages, peignit, balaya et nettoya. Et quand tout fut terminé et que vint le moment de faire du commerce, ce fut à maman Karen de s’en occuper... Et lui, il décida de trouver mille autre façons de gagner encore plus d’argent.
Il entreprit de confectionner de petites choses en carton et en cuir, des valises, des sacs, des étuis, qui furent mis en vente au magasin. Il tenta de fonder un commerce de timbres rares. Il voyagea dans tout le pays pour acheter des meubles, des tableaux, des objets en cuivre et en laiton, toujours d’occasion, qu’il réparait et qu’il revendait pour plus du double du prix auquel il les avait achetés. Il avait une excellente écriture, belle et lisible, et il obtint de faire quelques travaux d’écritures pour le bureau cantonal et pour quelques avoués de la ville. Il fut également coursier pour le télégraphe… Et parfois, on le croisait à la gare, où il proposait aux voyageurs de porter leurs bagages jusqu’à l’hôtel. Mais ce trafic incessant poussa les porteurs et les coursiers officiels à lui demander d’interrompre sans délai son activité, sous peine d’un déchaînement de moqueries et de malveillance.
Mais il racla l’argent, comme la pourriture au fond d’un plat, petit à petit.
Il ménageait ses revenus et épargnait par tous les moyens. C’était à peine s’il pouvait faire une exception pour sa nourriture et celle de sa mère. La vieille devait rendre compte de chaque aiguille à tricoter qu’elle vendait à la boutique. Et il se chargeait lui-même des dépenses du ménage… Pendant la première année qui suivit leur déménagement, Mme Thomsen avait engagé une petite écolière pour faire les commissions et l’aider à la maison. Son salaire était de deux couronnes le mois, plus le déjeuner. Mais, un beau jour, elle reçut son congé… : Emanuel pensait que deux personnes seules pouvaient se débrouiller par elles-mêmes ! Deux couronnes par mois, c’étaient vingt-quatre couronnes à la fin de l’année ! Sans parler de la nourriture ! Et c’est ainsi qu’il commença à tout faire tout seul : laver le sol, balayer la rue, astiquer les vitres, aller chercher l’eau et le bois et faire les courses en ville, plus crabe que jamais, avec son bras plus long que l’autre qui tournait dans l’air comme la pale d’une moissonneuse.
Bien sûr, les gens se moquèrent. Mais Manuel les laissa se moquer.
– Attendez que l’on revienne à la Ferme ! disait-il en plissant ses petits yeux de cochon, d’un air à la fois inspiré et sournois. – Alors ce sera mon tour de rigoler !
Car c’était cela qui le faisait se lever et le rendait presque indifférent aux rires de la ville et aux sobriquets dont on l’affublait : cela, c’est-à-dire cette formidable certitude qu’un jour viendrait où ils pourraient s’en retourner dans la propriété paternelle en grande pompe.
Mais cela, il n’en parlait pas, sauf à Maman Karen. Et pour que personne ne se doute de rien, lorsque avec le temps il eut épargné un capital certain, il alla déposer son argent dans une banque de la capitale. Et il était si malin qu’il garda toujours quelques centaines de couronnes à la caisse d’épargne de la ville pour sauver les apparences. Il s’arrangeait pour sortir dix ou vingt couronnes, et puis en remettre dix ou vingt, au moment de payer les impôts, ou quand il avait fait une affaire qui s’était ébruitée. Il ne faisait pas étalage de ses origines paysannes. Et les gens devaient croire que lui et maman Karen profitaient plus que ce qu’ils auraient dû.
Et pas une fois il ne dit à Maman Karen combien il avait épargné.
Manuel en avait fini avec le bois de chauffage pour aujourd’hui. Il rangea les petites bûches le long du mur de la remise, balaya le billot et ses alentours, ramassa les derniers copeaux, et accrocha sa cognée entre deux clous sur le chambranle de la porte.
Puis il examina scrupuleusement la remise, trouva que tout était en ordre et sortit dans la cour.
Le soleil avait presque disparu derrière une maison voisine. Il tombait toujours une bande de lumière, dans le coin, là-bas, près du mur. Mais elle était étroite et blanche.
Le coq était mou et hébété dans son coin près de la pompe, ses ailes pendouillaient et sa tête était courbée vers le sol. Il n’avait pas bougé de la tache lumineuse au centre de laquelle Thomsen l’avait déposé.
– Allez, petit Mortensen, dit Thomsen en allant vers lui – c’est assez de soleil pour aujourd’hui. Maitenant il vaut mieux retourner au lit.
Et il reprit prudemment l’animal dans ses bras, le porta dans la remise et le déposa dans le coin le plus reculé, sous la fenêtre. Il y avait un peu de sable par terre, et on avait répandu de la paille, du duvet, et des feuilles mortes.
Sur le mur, à une aune de hauteur, il y avait un bout de bois qui dépassait. Mais cela faisait cinq ans que Mortensen n’avait pas grimpé dessus.
Et le 27 mai, cela ferait très précisément trois ans qu’il n’avait plus chanté.
5.
C’était un soir de réunion pour la confrérie du « Glouton Danois ».
À peu près au milieu de Søndergade, au coin de la petite rue Maren Smed, il y avait l’hôtel « Stadt Gammelkøbing5 », dans une petite salle au rez-de-chaussée duquel la confrérie se réunissait.
Il y avait quatre réunions par an, trois l’hiver et une l’été.
C’était la dernière des réunions de l’hiver.
L’entrée était de vingt-deux couronnes ; et elle donnait droit à trois verres de Lysholm6.
Comme son nom l’indiquait, les nourritures qui accompagnaient les réunions de cette institution étaient purement terrestres et nationales. Mais lorsque le vieux rédacteur en chef Heilbunth en avait été élu président l’année précédente, il avait tenté d’assouplir certaines règles, notamment concernant les boissons qu’il voulait rendre plus internationales, ce qu’il proposa aux autres membres du bureau…
Et il obtint instantanément leur accord, à l’unanimité des votes.
De même, c’était encore Heilbunth qui avait suggéré de relever le droit d’entrée de quinze à vingt-deux couronnes, et de légiférer rigoureusement sur l’âge (50 ans) et le poids (250 livres) minimum des membres de la confrérie.
– Nous ne devons accepter que des personnes de poids ! avait-il dit, justement.
Le nombre de participants était très variable. Ce soir-là, ils étaient six.
Ces réunions se tenaient à « huis clos ». Quand le dernier participant était arrivé, on fermait à clé la porte qui menait au restaurant. Et il n’y avait plus qu’un seul passage ouvert : le couloir des cuisines.
Il y avait aussi un serveur qui assistait à ces réunions.
Et c’était Emanuel Thomsen.
C’était uniquement sa monomaniaque âpreté au gain qui avait poussé Manuel à rechercher cet emploi. Car c’était cruel quand on avait ses convictions que d’être le témoin d’une prodigalité contre nature comme celle-là. La masse anormale de nourriture et de boisson qui était servie et consommée le scandalisait profondément.
Les restes l’offusquaient le plus.
Il versait des larmes de sang quand il voyait revenir en cuisine une oie à moitié mangée, un sauté d’agneau quasiment intact ou encore un rôti à peine entamé.
C’était assez impie et c’était déjà péché, que des hommes qui mangent et qui boivent tout leur saoûl ! Mais en plus, ces hommes-là, ils avaient l’air tellement vivants quand ils s’aquittaient de leur coûteuse addition !
Ils méritaient le bagne.
Le lendemain d’une telle réunion, le petit homoncule trottait dans toute la maison, titubant comme un crabe débile, avant d’entrer dans l’arrière-boutique en agitant son long bras. Mme Thomsen ne pouvait que hocher la tête dans son fauteuil, le visage livide d’angoisse.
– On va démissionner ! On va démissionner ! gesticulait Thomsen. – Ce n’est pas humain !
– Oui, donne ton congé, petit Manuel…
Mais Manuel ne le donnait pas, son congé !
Car cela lui rapportait cinq couronnes par soirée. En plus de cette consommation qui lui donnait à chaque fois des maux d’estomac. Alors, il travaillait sans plus de commentaires.
L’horloge sonna huit heures moins le quart.
Emanuel, avec son veston de cheviotte bleu et son grand tablier blanc brillant noué à la taille, sortit de la cuisine avec un dessert glacé. Il le portait prudemment avec ses deux mains. Comme s’il s’agissait de Mortensen.
Au moment où il entrait dans la salle, l’hôtelier y amenait trois représentants de commerce. Ils voulaient voir l’arrangement des tables. Elles jetaient un éclat sur l’hôtel qui faisait sa réputation dans toute la région. Et M. Hansen exhibait volontiers ses tables aux habitués pour exciter leurs appétits.
Les trois voyageurs restèrent debout, indécis, devant la porte. Car ça, c’était comme le rêve du royaume de Dieu :
Au milieu de la table recouverte d’une nappe immaculée comme la Conception, il y avait un énorme plat avec six grands homards écarlates. C’était le premier plat. Un animal par « frère ». Et en plus de ce plat au centre de la table, il y avait plats sur plats étalés jusqu’aux deux extrémités, remplis de mets froids de toutes sortes, poissons, mammifères ou volatiles. Il y avait quelques carrelets d’un pouce d’épaisseur, garnis de citrons verts. Il y avait un pâté aux truffes. Un aloyau de bœuf. Un rôti d’agneau d’élevage. Et de l’agneau de lait. De jeunes canards, jeunes oies et chapons. Et à chacun des bouts de table, il y avait une pyramide d’œufs de vanneau, disposés artistiquement sur du sable mouillé. Des assiettes avec des sardines, des anchois saumurés, des harengs marinés, du caviar, de la poitrine d’oie rôtie, du pâté de foie de Strasbourg, du saumon et des langues de bœuf, disposées entre les grands plats comme pour reposer le regard. Et il y avait sept sortes de confitures, des radis de la serre, cinq sortes de fromages, et du beurre de marque.