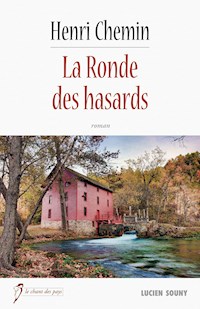C’est par une succession de hasards mineurs que tout a commencé.
23 février 199...
Le vent de Beauce tirait ses derniers boulets sur la ville. Les trois couples
venaient de se retrouver devant la Fnac qui tardait à ouvrir. Ils en étaient aux présentations polies quand la bourrasque, qui annonçait l’averse imminente, les poussa vers la porte de l’estaminet le plus proche. Le plus jeune des trois hommes s’effaça pour laisser le pas à sa voisine. C’est alors qu’il put lire, sur le verre dépoli de l’imposte : Chez Idmir – Spécialités turques. Manifestement, une femme manquait.
Avec ses trois minuscules châssis à tabatière qui s’ouvraient chichement côté cour, ce n’était rien d’autre qu’un troquet borgne qui transpirait misère et mauvais goût. Paumés, filles des rues les jours de pause, bons et mauvais garçons s’y croisaient.
Fixées au mur, des banquettes en faux cuir couraient sur toute sa longueur, jusqu’à l’arrière-salle à l’équerre qui, fraîchement repeinte en vert et ocre, offrait billard, jeux de fléchettes et baby-foot. Au-dessus des banquettes, un mauvais papier fin de série présentait, dans une attitude subjective, des dames sommairement vêtues. Formant une fresque jusqu’au plafond, une bande rouge malsain livrait en continu une course de lévriers afghans.
À hauteur de l’arrière-salle trônait un Godin bois et charbon avec son tuyau au ras du plafond qui marquait la
ligne de partage de deux rangées de tables, anciennes, mais propres. À l’entrée, partageant la largeur de la pièce avec un petit vestibule, le comptoir, surélevé, avait des airs de passerelle.
Une paire de gants de boxe pour mi-lourd accrochée au-dessus du percolateur attestait de la religion sportive du patron. Idmir y
tenait la barre, un œil sur le dedans, un œil sur le dehors, l’oreille à tous les bruits et chuchotements.
L’homme jeune passa la porte en dernier. Il se disait que le commandant Laforgue,
du SRPJ, ou son copain de la section de recherches, avait installé là un outil de travail qui valait ce qu’il valait ! Un outil qu’en jargon voyou, on appelait « sous-marin de surface ». Ce n’était pas bon pour son propre commerce, mais, comme il était trop tard pour sonner le repli, il prit le parti de faire avec et d’ouvrir l’œil.
Il approcha la table pour deux de la table pour quatre, avant de s’installer en bout avec beaucoup de naturel. Il écrasa dans le cendrier une cigarette au quart consumée. Il avait vue sur la salle, l’arrière-salle, le comptoir, les deux ouvertures de la partie privée et le coin toilettes.
Les trois dames s’installèrent sur la banquette, dos au mur, la plus jeune près de son compagnon. Une petite rousse, la soixantaine juvénile, faisait face à son mari. C’était un homme de belle tenue, avec de grandes mains marquées par le travail. Il portait un liseré bleu foncé à la boutonnière et sentait l’entreprise… Bâtiment ? Travaux publics ? Ou peut-être le transport.
Celui qui était assis près de sa femme avait largement dépassé la soixantaine. Il avait le cheveu court et les yeux délavés de ceux qui ont marché longtemps face au soleil. Il dégageait une personnalité forte, faite de calme et de sérénité. On sentait qu’après avoir obéi, il avait longtemps commandé. Sa parka militaire, en partie ouverte, laissait voir cousu à son revers de veste un ruban discret jaune et vert. Son épouse avait posé son bras sur le sien. Elle faisait plus jeune. Son visage, aux traits réguliers, exprimait le désir de combler des manques et des envies, de réaliser des souhaits.
L’homme jeune, qui avançait dans la trentaine, paraissait avoir autorité sur le groupe. C’était un grand gars solide, cheveux courts châtain clair. Son visage « beau gosse » affichait calme, énergie et détermination. À le regarder de plus près, ses yeux gris-bleu laissaient perplexe. Par flashs, lorsqu’il était inquiet ou simplement contrarié, ils disaient la dureté et la violence d’une âme sans repos. C’était présentement le cas.
Sa compagne, svelte, de taille à peine moyenne, aurait pu être orientale avec un rien de sang noir. Ou peut-être métisse avec un soupçon de sang jaune. Ses cheveux de jais, coupés courts, qui frisaient légèrement sur les tempes se cachaient dans un bonnet de laine angora qui avait fait
la mode l’année d’avant. Ses grands yeux noirs, en amande, se réfugiaient derrière de longs cils de geisha. Ils avaient quelque chose de triste et de blasé ! Ce qui frappait d’emblée, lorsqu’on la regardait dans son manteau long et ses bottines Madison, c’était sa classe et sa manière d’être de jeune femme distinguée. Elle n’était pas à sa place chez Idmir !
Sur un signe de l’homme jeune, le patron s’approcha pour prendre les commandes.
— Pouvons-nous fumer ?
Un hochement de tête lui indiqua que oui. On vota à la majorité moins une voix pour un café noir bien serré. Alors, Idmir assura qu’il servait le meilleur café de la ville, qu’il lui arrivait de tous les pays producteurs du monde et que ses bons clients l’accompagnaient d’un armagnac, d’un calva ou d’une Marie Brizard. Il parlait pour faire l’article, le temps de lire le prénom de l’homme jeune qui portait une gourmette d’argent au poignet gauche avec l’inscription François-Jean.
La dame rousse fit alors état de la migraine tenace qui l’affligeait depuis le matin et commanda un décaféiné.
Idmir prit position de biais devant le percolateur pour continuer à avoir l’œil sur cette table qui l’intriguait. Il vit François-Jean tirer de la poche de son bomber fourré un paquet de Pleyelet un briquet de prix en métal doré. Il posa le tout près du cendrier. Le Turc remarqua alors la petite dame rousse au café déca qui se prenait les tempes avant de fourrager dans son sac à main, du genre fourre-tout à cordon.
— Je suis quand même sûre d’avoir de l’aspirine. J’en ai toujours !
Son mari réclama un verre d’eau que le taulier s’empressa d’apporter. La compagne de l’homme jeune entreprit à ce moment-là l’inventaire de son propre sac. Elle en tira un tube cylindrique grand format de
paracétamol, l’ouvrit et déposa sans plus attendre un comprimé dans le verre. Pendant que les bulles montaient en surface, la dame rousse
reprit son inventaire et, de guerre lasse, vida sur la table le contenu du
fourre-tout. Alors apparut un tube de paracétamol de mêmes marque, forme et couleur que celui de sa voisine. Elle l’ouvrit sur-le-champ et déclara :
— J’étais quand même sûre. Il m’en reste deux.
Pendant qu’Idmir tournant le dos revenait à son percolateur, les deux tubes d’anti-migraine avaient changé de sac ! Alors s’engagea une discussion animée entre femmes, sur les thérapies diverses soulageant le mal de crâne et autres maux et envies, qui n’autorisa aucun regard pour le patron lorsqu’il servit enfin les cafés.
Le Turc fit son métier d’indic pour voir et entendre ce qui se disait. Il passa au ras de la table pour
aller régler l’allure du poêle, s’inquiéta avec un « Ce sera tout ? » Il revint enfin pour encaisser l’addition avant de s’installer, déçu, à sa passerelle. C’est alors que son adrénaline monta crescendo.
Il vit ses clients se lever, la dame distinguée boutonner son manteau long, les embrassades de ces dames, les poignées de main de ces messieurs. Il suivit la main gauche de François-Jean qui prenait la cigarette éteinte dans le cendrier, sa main droite qui saisissait le briquet et allumait le
mégot… et la main droite de l’homme du bout de table au ruban vert et jaune qui enfouillait le paquet de
Pleyeldans la poche basse de sa parka ! Dans l’instant, le gros Idmir avait eu un sourire jubilatoire en se disant : « Ce petit con de gamin vient de se faire chourer son paquet de clopes ! » Et le flash était arrivé aussitôt.
Pesta de merda ! Ils sont en train de fourguer les bijoux. Il y a de l’or et des diams dans le paquet de sèches de cet enfoiré de pourri de blanc-bec. Parce que le commandant Laforgue avait dit l’avant-veille, soit deux jours après le casse de l’étude du notaire, qu’il y aurait à négocier bijoux sous roche entre gens bien mis venus d’ailleurs et qu’il convenait d’avoir l’œil.
La fébrilité soudaine de l’indic n’avait pas échappé à François-Jean. Les regards des deux hommes s’étaient croisés, chacun estimant savoir de l’autre ce qu’il y avait à savoir. Ça n’avait pas empêché le gros Idmir de décrocher le téléphone. Il avait composé deux ou trois chiffres. Cinq au plus. Certainement pas dix ! À cet instant, l’homme au bomber aurait parié sa liberté contre un billet d’écrou à Fresnes que le taulier avait une bretelle avec le SRPJ ou la SR. Il voulut en
avoir le cœur net. Lorsqu’il passa la porte de l’estaminet, en serre-file, ses yeux firent clairement comprendre à son adversaire : « Idmir, tu croques dans la main des flics. Tu n’es qu’une crevure de pourri de balance ! » Les yeux de l’autre lui répondirent tout aussi clairement : « Tu n’es qu’une pédezouille de foie blanc. Un merdaillon et pas un homme. »
Bretelle ou pas bretelle ? L’homme au bomber voulait savoir. Pour son présent. Mais aussi pour son futur. Il passa son bras sous celui de sa compagne.
Tranquillement, ils tournèrent à l’angle de la rue puis, revenant sur leurs pas, ils se glissèrent sous un porche d’où ils avaient l’œil sur Chez Idmir – Spécialités turques. Ils attendirent une dizaine de minutes. Ils allaient quitter leur tour de guet
quand la R 21 blanche arriva. Dans un crissement de pneus, elle se gara de biais sur le
trottoir. Le passager, négligeant de fermer sa portière, pénétra dans le troquet alors que son collègue rendait compte d’un déplacement en urgence pour rien. Il aurait aussi bien pu le dire par porte-voix
tant il avait la parole vigoureuse et portante !
L’homme jeune comprit que le commandant Laforgue avait dépêché des bras… Pas des têtes ! Pour aujourd’hui, il s’en tirait sans dommage, mais, dans sa spécialité débutante, on n’était jamais sûr de rien. Le portrait-robot se pratiquait ici comme ailleurs. Pour la première fois de sa vie, un rien aventureuse, quelqu’un avait mis l’œil sur lui. Ce n’était pas fait pour lui plaire !
Il passa le bras sur les épaules de son amie de luxe. Poussés maintenant par la bourrasque, ils montèrent la rue de la Lyonne et gagnèrent le parking souterrain proche de la médiathèque. Une Golf GTI grise immatriculée dans le Loiret les emporta vers La Source par la nationale 20.
***
Dans la nuit du 8 mars, après fermeture, le bar Chez Idmir fut saccagé par trois loubards cagoulés qui tracèrent, à la peinture rouge indélébile sur la glace du comptoir : Ce pourri d’Idmir se vend aux flics. C’est un faux cul, un donneur et une crevure de balance ! Non seulement l’homme au bomber n’y était pour rien, mais il désapprouvait fermement. On ne coule pas impunément un « sous-marin de surface » ! Il y aurait des représailles et de l’agitation policière ! Ceux qui, dans les rues commerçantes, vivaient petitement de petits trafics – de la fume à la dure en passant par la gobe, un peu de contrefaçon et un rien de retape –, firent profil bas. Ils courbèrent l’échine et s’apprêtèrent à vivre des jours difficiles. Les gros bras, ceux qui tenaient le haut du pavé de la pègre et relevaient les compteurs au quotidien désapprouvaient aussi. Ils se mirent en chasse pour que la police règle au plus vite une agitation mineure qui contrariait leurs intérêts.
***
Le commandant de police Laforgue n’était pas content. Non seulement il venait de se faire couler un sous-marin de
bon niveau opérationnel, mais il se faisait chambrer par son divisionnaire qui le glosait de
la perte de son bateau pourri. Il n’aimait pas ça, d’autant qu’Idmir était son indic et que, s’il voulait rester fiable dans le milieu de la donne, il se devait de mettre au
plus vite la main sur ses agresseurs. Il pensait toujours à ce grand jeunard qui avait toisé le Turc. Avec sa gueule d’enfant de Marie et son blouson bomber, il n’était fiché nulle part. Pourtant, à l’intuition, Laforgue avait pressenti que sa route croiserait un jour celle de
François-Jean et de sa Fleur d’Asie petit format. À partir de bandeaux approximatifs, il avait fait crayonner deux
portraits-visages qui serviraient un jour ou ne serviraient pas… Mais qui serviraient certainement ! Mine de rien, il avait demandé à son indic : « De toi à moi, Idmir, ton merdaillon et ses pieds nickelés tu les habilles comment ? » Après mûre réflexion, le Turc avait répondu : « De moi à toi, patron… pas des braqueurs, pas des casseurs et pas davantage des faisans ou tire-laine… Des besoins particuliers peut-être. Mais peut-être pas ! » Formé à l’école des misères de la rue, Idmir était un auxiliaire précieux.
Laforgue fit savoir, dans le mitan, qu’à défaut d’aide sérieuse il risquait de devenir méchant. Quand c’était le cas, mais rarement, le commandant pouvait être le pire des flics de la pire espèce. Dans les maudits jours de fin mars qui suivirent, on embastilla gros et
petit gibier. Cela ne dura pas longtemps. Dans les vilains quartiers, on trouva
l’Arménien, ennemi du Turc, qui avait ourdi des représailles sans doute justifiées. Il lâcha ses trois hommes de main, des petits voyous établis ou en devenir. Pour rendre sa belle humeur au commandant de police, une
voix anonyme, venue d’une cabine publique, donna une ouverture solide sur le casse du notaire. Le
quotidien bon enfant reprit ses droits, le sous-marin remit à flot ses observations et ses écoutes.
Le grand gars à gueule de beau gosse venait d’être blanchi. Mais ça, il ne pouvait pas le savoir. Alors il estima que son commerce de rue débutant l’amènerait un jour ou l’autre à la Bastille. Le SRPJ avait certainement mis, sur les indications de ce pourri d’Idmir, une photo sur sa figure et celle de sa compagne. Sa sécurité professionnelle n’était plus assurée en Val de Loire. Alors, sans état d’âme, il estima qu’il y aurait moins de risques à se faire bandits des campagnes. Fort de l’expérience de son vécu récent, il quitta, avec la femme élégante, la grande ville pour aller chercher fortune ailleurs. Il n’avait pas pour autant l’intention de changer de métier. Mais il espérait le jour où, redevenu un honnête homme, il pourrait sans fausse pudeur parler des ravages de l’amour.
Mardi 28 mai – 23 heures 15
Le vent de Loire chante dans la plaine. Il porte des senteurs de terre et de
colza. Il y a, çà et là, des relents de foyers humides de quelques écobuages borduriers. Il fait doux, calme et bon. Des myriades d’étoiles et un croissant de lune regardent la Beauce endormie, sans parvenir à éclairer une nuit d’encre. Une nuit de prédateur… Une Golf GTI grise, immatriculée 45, file vers Orléans, par la nationale 152. Sa CB capte des bribes d’infos des routiers. On entend : « Petit loup de Pic et Poc… Kilos deux points fox-trott (keufs) carrefour Jargeau à La Ferté ». C’est la routine d’une nuit de semaine. À quelques encablures de Chilleurs-aux-Bois, la GTI s’arrête dans une clairière que prolonge une allée forestière. Un jeune couple s’enfonce sous les couverts. Il laisse sur son siège arrière, avec quelques vêtements de qualité et le journal du jour, un sac en papier fort estampillé Lenôtre. Il est lesté de deux bocaux d’un litre en verre opaque et d’une grosse enveloppe en papier kraft. Chaque minute est une éternité !
Il y a un bruit discret de moteur, un trait de lumière qui perce le layon, à nouveau un faible bruit puis plus rien. Le couple ne s’attarde pas. À son retour, le pochon Lenôtre a été remplacé par un Fauchon Paris – Épicerie fine. Il contient deux bocaux d’un litre en verre opaque… mais pas d’enveloppe.
Une jeune femme, à peine moyenne, se glisse au volant. La Golf GTI reprend sa route et s’enfonce dans la nuit. Après Loury, qu’elle traverse à vitesse réglementaire, elle évite le carrefour de la nationale 60 et gagne la gare d’Orléans-les-Aubrais par Marigny-les-Usages. Il est 0 heure 40.
Un homme athlétique, dans la trentaine, cheveu court, gueule de beau gosse, descend de la GTI.
Il porte polo beige Lacoste, mocassins et pantalon assortis. Il caresse les
cheveux de la conductrice, l’embrasse brièvement sur la joue, prend sur le siège arrière un sac de voyage peu garni, un blouson d’été de belle coupe et un sac en papier marqué Fauchon Paris. Il fait un petit signe de la main.
— Tu es sûre que ça va ?
— Ça bouge un peu dans ma tête. Mais ça va passer. Surtout, ne t’inquiète pas.
— Alors à tout à l’heure, Sophe !
La prénommée rejoint la nationale 20 dans le centre-ville et se dirige vers Limoges via Vierzon. À la sortie de La Ferté, elle entend dans sa CB : « de grand castor… bandes rouges (douaniers) rond-point Déols ». Puis, plus rien. Elle n’a aucune réaction. Elle vit en partie dans son monde à elle. Dans son refus du tremblement de ses extrémités, elle serre fermement son volant à deux mains. Son compagnon a pris un billet de seconde au distributeur
automatique. Il entre au buffet pour y attendre le rapide de 1 heure 23.
Cherchez l’indic !
La grande salle est quasi vide. À une table du fond, quatre loulous partagent des jambons beurre et des bières Kanter qu’ils boivent au goulot. Ils n’ont pas un regard pour l’homme au polo Lacoste qui s’installe dos au mur, face à l’entrée, sur la banquette d’une table pour quatre. Il a posé près de lui, en vrac, le sac de voyage, le blouson et le paquet Fauchon Paris.
La barmaid de nuit, la cinquantaine sexy, jupe largement fendue, corsage à l’avenant, vient prendre sa commande avec le balancement de hanches des
professionnelles de la drague. Son regard accroche.
— Vous êtes perdu tout seul ici !
— C’est bien pour ça que j’espère trouver quelqu’un dans le train.
L’homme commande une Pelforth et un paquet de pistaches. La serveuse revient avec
la bière et l’addition. Il dépose un billet près des pistaches.
— Ça ira.
C’est alors qu’elle remarque le sac papier Fauchon.
— Ben vous alors ! Vous ne faites pas dans les prix cassés !
— Ce n’est pas grand-chose. Juste de quoi faire deux petits tartares Komaroff au
caviar. Elle en raffole !
— Votre femme ?
— Non, ma vieille mère. Je vais faire un petit arrêt à Montauban pour lui dire bonjour. Je serai à Toulouse dans l’après-midi.
— Elle en a de la chance votre maman !
— Ma foi… puisque vous le dites.
La barmaid pose un œil sur les mains de son client. Pas d’alliance. Il porte, au poignet gauche, une gourmette en métal argenté avec l’inscription François-Jean.
— C’est un prénom pas commun !
— De fait, c’est mon nom et mon prénom. Je suis monsieur Jean. Mais on m’appelle aussi François.
De fil en aiguille, comme rien ne presse au comptoir, M. Jean apprend que la serveuse sexy est l’épouse d’un roulant qui tire présentement un convoi lourd quelque part dans le Vaucluse. Elle habite à deux pas. Le buffet fermera à deux heures.
— Vous prenez le 1 heure 23 ?
— Ma foi, oui.
— Le 4 heures 50 vous irait aussi bien !
— La prochaine fois peut-être… Maman ne va pas tarder à faire le pied de grue dans le hall.
— Parce qu’il y aura une prochaine fois ?
Ça, c’est la question d’indic ! Une mauvaise question !
— Sait-on jamais…
C’est fou comme le hasard des mots peut dire le bien et le mal. Parce que le
commandant Laforgue et ses limiers du SRPJ fréquentent nécessairement une barmaid sexy, qui monte chaque nuit en première ligne de l’information en gare d’Orléans-les-Aubrais.
Le rapide Paris-Toulouse entre en gare des Bénédictins. Il est 2 heures 27. Les quais sont déserts. Un vrai clochard dort sur un banc d’attente. L’homme au polo Lacoste monte au second niveau. Il tient dans la même main le sac de voyage qui fait écran et le pochon papier Fauchon plaqué contre sa cuisse gauche.
Une jeune femme élégante, de taille tout juste moyenne qui s’inquiète des horaires des trains, lui fait un « oui » discret de la tête. Elle a de beaux yeux en amande sous ses longs cils de geisha. Elle oblique
vers la consigne, ouvre le compartiment 123 et fait quelques pas vers la sortie. L’homme dépose le paquet Fauchon et retire la clef. Il sort sans un regard pour la femme élégante. Il a repéré les deux archers en civil qui font durer leur Kronenbourg à une table de la cafétéria, face au hall. Sur les hauts du Champ de Juillet, une Golf GTI grise se gare
dans le parking souterrain de l’hôtel Le Norway. Un jeune couple porteur d’un bagage léger en descend.
— Monsieur Jean. Nous avons réservé la chambre 17. L’employé de nuit remet la clef et le passe pour la sortie côté parking. La demie de 3 heures sonne à la grande horloge de la gare des Bénédictins.
Le Norway est un établissement de moyenne gamme dans un rapport qualité-prix très convenable. Il mérite sa réputation de tranquillité et de sérieux. C’est le point de chute des commerciaux, des touristes étrangers de passage et de quelques couples en devenir qui viennent s’y offrir un extra d’après vêpres. Ici, le panneau Ne pas déranger accroché côté couloir à la poignée de porte, est respecté. Un petit déjeuner copieux excepté, il n’y a pas de restauration. Cependant, pour obliger le client, un jambon beurre et
une Heineken sont possibles à toute heure.
— Un petit creux ? Une petite soif, Sophe ?
— Pas. Bien crevée, oui. Allons nous coucher !
La chambre 17, au premier étage, n’est en rien différente de la 16 ou de la 18. C’est une chambre à deux lits. Elle avait été un temps celle d’un nommé Malik, ami et compagnon des mauvais jours de l’homme à la gourmette. Durant ses études d’infirmier dans la capitale limousine, il composait des tracts pour ses amis des
jeunesses communistes. Il les cachait, avant distribution, au-dessus d’une trappe sous plafond. Cet orifice permettait et permet toujours de mettre la
main sur un manchon de jonction de trois conduits de climatisation.
Le temps de laisser à sa compagne la priorité du coucher et le choix du lit, l’homme en Lacoste est allé s’offrir une Pleyel dans le minuscule fumoir du bout du couloir. Quand il est
revenu près d’elle, elle dormait en chien de fusil sur un lit à peine défait. Elle avait laissé sa veilleuse allumée. Elle avait peur dans le noir ! Il était resté longtemps à la regarder dormir, du sommeil agité d’une âme sans repos. Il avait tiré un bout de drap sur sa nuisette grand luxe, avant de s’allonger sur le matelas voisin pour rêver, prier… et peut-être dormir.
C’est elle qui l’avait réveillé. Il était neuf heures quinze. Le soleil filtrait par quelques fentes des volets
disjoints. Elle avait récupéré de ses fatigues de la veille. Elle allait mieux. Ce serait une belle journée ! Après un solide petit déjeuner, ils partent flâner dans les rues de la capitale de la porcelaine. Leurs pas les conduisent dans
le hall de la grande gare. Il y a foule de gens pressés qui montent, descendent, s’embrassent et s’en vont. La jeune femme élégante ouvre la consigne 123. Elle place un sac papier Fauchon Paris dans un grand cabas à provisions. Le couple remonte vers Le Norway, marque l’arrêt devant des vitrines pleines d’intérêt… Aucune présomption de suiveur ou de chandelle. Ils réintègrent la chambre 17. L’homme accroche, côté couloir, le Ne pas déranger et donne un tour de clef. Il est 10 heures 50 à la grosse horloge de la gare. Le soleil frappe de biais le dôme du toit. Il donne au vert dominant des tons vifs argent.
— Un jour tu l’auras ton portrait, ma belle coupole. Pour sûr… Un jour tu l’auras !
Un sachet en plastique opaque est retiré de chaque bocal. La dame de taille à peine moyenne en répartit le contenu dans des taste-vin moyen format. Elle confie les quelques
pastilles restantes à un tube grand format de paracétamol qui habite son sac en continu. Un fourre-tout à cordon. Son compagnon ferme avec une large bande de scotch. Après quoi les taste-vin sont glissés, fond côté adresse préimprimée, dans des enveloppes publicitaires en gros papier kraft toilé. Elles « travaillent » aujourd’hui pour les vins Château-Descourrières Haut-Médoc. Il est 12 heures 15. François-Jean ouvre la trappe plafond avec le tournevis qui équipe son couteau suisse, glisse un carton contenant les enveloppes sur la
brique brute et referme. Sa compagne a replié le paquet Fauchon. Il peut resservir !
Côte à côte, comme frère et sœur, ils montent manger un morceau rue de la Boucherie.
De retour au Norway, ils décident de libérer la chambre et de rentrer chez eux par les sentiers de chèvres et la clef des champs. L’homme règle la note. Le gérant commande deux cartons de Château-Descourrières, leur souhaite bonne route et leur assure la chambre 17 pour le mois prochain. La Golf GTI musarde en ville, s’écarte de la poste centrale, visite Aix et Couzeix. Le conducteur en profite pour
poster quelques enveloppes préalablement choisies. Puis ils empruntent la vieille nationale 20 à allure de sénateur. Ils postent ici et là, dans de petits bureaux de la France profonde où l’on fait, avec le sourire, l’affranchissement qui convient. C’est important pour eux de poster dispersé. Ils reviendront en septembre dans le meilleur des cas. Les enveloppes krafts « travailleront » alors pour les confits Lepoge ou les biscuits Bonlait.
Dans leur commerce nouveau, il faut avoir l’œil à tout. Le moindre loupé peut les envoyer à la Bastille. Fin avril, un client a été hospitalisé entre la commande et la livraison. Le taste-vin publicitaire est resté quelques jours dans sa boîte aux lettres, avant de passer de main en main. Il avait été posté à Feytiat par la femme élégante. Ils se sont posé la question de savoir si un archer mal intentionné aurait pu remonter jusqu’à eux. Ils n’ont pas trouvé de vraies réponses tant les lois du hasard sont impénétrables ! N’empêche que tout ceci, ajouté à la bassesse de gens du calibre de ce pourri d’Idmir, ne peut qu’inciter à la prudence. Depuis, ils cloisonnent. Ils ont adopté la Poste. Rien que la Poste. Le téléphone professionnel est banni. Malgré cela, un mauvais circonstanciel, comme dit parfois le grand gars châtain, est toujours possible. Ça fait partie des risques du métier !
Le couple revient sur ses pas. Il fait beau et chaud. Alors ils profitent. Ils dégustent l’instant présent. Demain sera un autre jour ! Ils prennent un pot au routier de la Borne 40. Puis ils s’enfoncent dans leur belle Corrèze. Leur terre d’accueil ! Adieu Loire, Loiret, Beauce, Brenne et Sologne ! Des trémolos dans la voix, l’homme à la gourmette a murmuré :
— En Val de Loire, ce n’était plus possible. Trop de monde, de risques, de flics, d’Idmir… Trop d’imprévus, de hasards contraires, de voyeurs, de donneurs, d’indics, de jaloux et de malveillants. Dans notre nouveau chez nous, ce sera bien… dans notre moulin du Prioux qui fut un temps moulin misère. Nous allons la blanchir, ma Sophie, ta future boutique de mode. Juste avec
ce qu’il te faudra d’argent. Sans faire de mal à personne !
Ce qu’il leur fallait, c’était pour l’instant une activité porteuse d’espoir, une activité qui occuperait la jolie tête de la femme élégante. Cela faisait partie de la thérapie.
Lorsque, venant de Lubersac, le touriste file sur le Babriolet, il peut certes
prendre la vieille route. Il trouvera à main gauche, entre la Rade et chez le Turc, un petit panneau de lieu-dit ruiné par une décharge de chevrotines. Il indique Les Jumeaux. S’il emprunte sur moins de cinquante mètres le chemin communal qui coupe de biais une grosse pointe de taillis, il
tombera sans transition sur une sorte de verger anarchique où cohabitent, en parfaite harmonie, pieds de vigne, arbres sauvages et fruitiers.
Alors se dessine une belle allée bordée de chênes rouvres, qui mène droit à l’entrée d’un vaste domaine agricole de belle facture et de bel entretien.
Il peut voir, de part et d’autre d’une grande cour rectangulaire, deux grosses constructions en pierre de pays
ayant servi, dans leur usage premier, de granges, d’étables, de remises et de hangars. L’une a été conservée en l’état, l’autre revisitée en lieu de vie sur deux niveaux, avec des portiques, agrès, bacs à sable et jeux d’enfants.
Au centre de l’espace ainsi dégagé trônent deux belles maisons anciennes, récemment restaurées à la mode du moment. Elles partagent en façade un tilleul plusieurs fois centenaire, avec dessous une table en bois et une
niche à chien. L’accès au domaine se fait par un large portail ouvert de jour. Il est soutenu par
deux piliers en brique qui ont eu à souffrir peu ou prou de l’envergure croissante des engins agricoles. Sur le pilier de droite, sens d’entrée, il y a une plaque en cuivre d’entretien sommaire, avec l’indication : Labarde Prosper et Rancelier Jean-Claude – Experts. Plus bas, on a ajouté Enquêtes, en petits caractères tirés à la pince Dymo. Sur le pilier de gauche, on peut lire l’impératif, Sonnez. Alors il y a le choix entre une sonnette de porte, une clarine de troupeau et
une corne de rappel des chiens de meute. Si bravement le promeneur avance sans
prévenir, Pétulon, un Beauceron énorme aussi doux que disgracieux, lui sautera à la poitrine avec l’espoir d’un « brave chien » et, sait-on jamais, celui d’une caresse. Pétulon ne mord que la nuit ! S’il cherche un Rancelier ou un Labarde à Naves, Sadroc ou Objat, sa demande n’éveillera aucun écho. Mais s’il parle des experts du domaine des Jumeaux, alors on lui dira qu’il s’agit de Prosper et Gentelou. Le sourire de son interlocuteur lui donnera à penser qu’ils sont très cordialement connus.
Tous deux sont nés ici en février et avril 1957. Ils vont partager un destin commun. Les deux garçons se sont, comme on disait à l’époque, élevés ensemble. Ils auraient pu être jumeaux. Leur affection réciproque a perduré. La trentaine venant, leur complicité en tout crève les yeux. Sur le plan relationnel, ils n’avaient pas eu une enfance facile, rejetés qu’ils étaient par les gamins du village. Tout ceci parce que leurs aïeux venaient d’ailleurs.
Dans l’avant-Grande Guerre, le bourgeois du secteur avait vendu ses deux métairies attenantes pour investir dans la porcelaine et le textile. Malgré un prix annoncé prohibitif, qui appelait toutefois négociations, plusieurs familles du cru auraient pu acheter. À trop vouloir gagner, elles avaient tout perdu. Par relations de notaires, elles
s’étaient fait souffler l’article par deux migrants du Berry, installés par leurs parents après héritage. C’était la loi de l’argent ! Quoi qu’il en soit, des gens d’ailleurs étaient venus prendre le pain de ceux d’ici. Grave entorse au droit du sol ! Car les Labarde et Rancelier, cousins seconds, venaient des terres riches d’Issoudun.
Berrichons typés, travailleurs, pas très causants, respectueux de l’ordre et des convenances, ils avaient leurs habitudes, leurs coutumes et leurs
travers. Ils ne voulaient faire de tort à personne, rien devoir ou demander. Ce n’était pas pour autant qu’ils étaient disposés à subir.