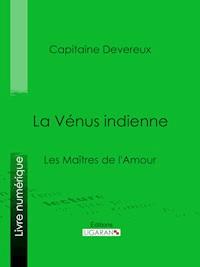
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"La Vénus indienne de Capitaine Devereux est un roman captivant qui nous plonge au cœur de l'Inde coloniale du XIXe siècle. Écrit par un auteur talentueux, ce livre nous transporte dans un monde exotique et mystérieux, où les cultures se rencontrent et les destins se croisent.
L'histoire se déroule à Calcutta, où le capitaine Devereux, un officier britannique, est envoyé en mission pour enquêter sur une série de meurtres étranges. Alors qu'il se plonge dans cette enquête complexe, il découvre l'existence d'une statue antique, la Vénus indienne, qui semble être au centre de tous les événements.
Au fur et à mesure que l'intrigue se développe, le lecteur est emporté dans un tourbillon d'aventures, de trahisons et de secrets. Devereux se retrouve confronté à des personnages hauts en couleur, tels que des maharajas corrompus, des espions russes et des mystiques indiens, tous liés de près ou de loin à la Vénus indienne.
Ce roman est bien plus qu'un simple récit d'enquête. Il explore également des thèmes profonds tels que la colonisation, la quête de pouvoir et la dualité des cultures. L'auteur nous offre une réflexion subtile sur les relations entre l'Orient et l'Occident, tout en nous tenant en haleine avec une intrigue palpitante.
La plume de l'auteur est riche et évocatrice, nous transportant dans les rues animées de Calcutta, les palais somptueux et les jungles luxuriantes de l'Inde. Les descriptions sont si vivantes que l'on peut presque sentir les odeurs et entendre les bruits de ce pays lointain.
La Vénus indienne de Capitaine Devereux est un livre qui ravira les amateurs de romans d'aventure, d'histoires exotiques et de mystères. C'est un véritable voyage littéraire qui nous emmène dans un monde fascinant et inoubliable.
Extrait : ""La guerre en Afghanistan semblait toucher à sa fin, lorsque je reçus l'ordre soudain de partir immédiatement d'Angleterre pour cette contrée, afin d'y rejoindre le premier bataillon du régiment où je servais alors. Je venais d'être promu capitaine, et j'étais marié depuis dix-huit mois, j'étais donc peiné plus qu'on ne le saurait dire de quitter ainsi ma femme et ma petite fille."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Parmi les ouvrages que leur domination dans l’Inde a inspirés aux Anglais, il en est peut-être de plus littéraires, de plus singuliers, de plus sublimes, mais il n’en est pas de plus curieux, de plus directs comme impressions, de plus véridiques, en un mot, que le fameux roman très libre d’expressions et de descriptions intitulé Vénus dans l’Inde ou Aventures d’amour dans l’Hindoustan.
Au reste, voici la bibliographie très courte de cet ouvrage unique dont on ne connaît point de réimpression.
VENUS IN INDIA | OR | LOVE ADVENTURES | in | Hindustan | by | Capt. G. Devereux | of the general Staff. |
« Puellis idoneus fui,
Nec militavi sine gloria. »
First [Second] volume [ici marque d’éditeur : une grue ailes éployées et avalant un serpent se détachant en blanc sur fond noir dans un cartouche rond que les ailes débordent.] Printed at Carnopolis | for the Delectation of the Amorous and the | Instruction of the Amateur in the year | of the Excitement of the sexes | MDCCCXCVIII.
C’est-à-dire : VÉNUS DANS L’INDE ou Aventures d’amour dans l’Hindoustan, par le capitaine C. Devereux, de l’État-major…
L’ouvrage comporte deux vol. in-8° de 6 ff. non chif., 175 pp., 4 f. blanches et 6 ff. non chif., 266 pp. et 4 ff. blancs. La couverture rose est mobile et porte le titre entier dans un encadrement, les titre et couverture sont imprimés en noir et rouge ; le dernier plat de la couverture comprend une annonce dans un encadrement à un filet pour la traduction en anglais du manuel érotique arabe : Kitab Ruju’a as-Shaykhits ila Sabah fi-’l-Kuwwat’ala-l-Bah”. L’ouvrage lui-même est imprimé sur du japon français et tout porte à croire qu’il a été imprimé en France.
Quant à l’auteur de ce fameux livre, on en est réduit à des conjectures. Tout ce que l’on sait, c’est que celui qui a signé Capitaine C. Devereux, de l’État-major, fut un des chefs les plus appréciés de l’armée anglaise dans les Indes. Il paraît même que son véritable nom est historique et qu’il étonnerait bien des gens si on le révélait.
Une des distractions de l’officier anglais dans les Indes, pourvu d’argent et de loisirs, mais généralement dépourvu de femmes, c’est la lecture des ouvrages érotiques. C’est pour répondre à ce besoin que Liseux avait adjoint à sa bibliothèque française une série de traductions anglaises du plus grand mérite. Sa clientèle anglaise des colonies était fort développée, et s’il n’avait pas tenu à former une bibliothèque pour ses compatriotes, il ne serait pas mort dans le dénuement que l’on sait, car les officiers et fonctionnaires anglais eussent suffi à le faire vivre dans l’aisance.
Le livre intitulé Vénus dans l’Inde est le fruit des loisirs que laisse la vie de garnison dans les colonies à un officier qui, après avoir connu de nombreuses aventures, connut aussi, avec l’ennui des garnisons solitaires, la consolation des livres venus de France.
C’était en France la pleine époque du naturalisme et en Angleterre le grand triomphe de la vertu ou, dirait-on mieux, de l’hypocrisie victorieuse.
Les livres venus de France avaient une réputation de liberté qui a toujours plu aux Anglais, malgré leur pudibonderie apparente.
L’officier qui nous occupe et qui, répétons-le, est un des plus grands hommes militaires de l’Angleterre moderne, ne semble avoir connu ni les livres publiés sous le manteau, ni les éditions Liseux.
Toutefois il a connu beaucoup de traductions de romans français et, s’il ne semble pas s’être attaché aux romans dits naturalistes, il a, au contraire, infiniment goûté la Mademoiselle de Maupin, de Théophile Gautier, et c’est sur ce modèle illustre qu’il a entrepris d’écrire les souvenirs de ses premières années de garnison dans l’Hindoustan.
Il l’a fait avec une liberté d’expressions entière et un esprit complètement dégagé des préjugés, donnant ainsi un supplément nécessaire et passionnant aux récits que Rudyard Kipling a consacrés à l’Inde et particulièrement à la vie des officiers anglais dans l’Inde.
Ce que le grand conteur n’a pas osé dire, le pseudonyme capitaine Devereux ne le cache point, et quelques papiers retrouvés par un de ses camarades intimes ont permis de compléter sur bien des points cet ouvrage, dont l’auteur a toujours souhaité de publier une édition qui ne fût point imprimée sous le manteau.
F.L.
La guerre en Afghanistan semblait toucher à sa fin, lorsque je reçus l’ordre soudain de partir immédiatement d’Angleterre pour cette contrée, afin d’y rejoindre le premier bataillon du régiment où je servais alors.
Je venais d’être promu capitaine, et j’étais marié depuis dix-huit mois, j’étais donc peiné plus qu’on ne le saurait dire de quitter ainsi ma femme et ma petite fille.
Nous tombâmes d’accord pour décider qu’elles viendraient me rejoindre, car il était préférable de différer leur départ jusqu’au moment où je connaîtrais d’une manière certaine l’endroit où mon régiment serait cantonné lorsqu’il reviendrait dans l’Hindoustan après avoir quitté les pierres désolées de l’Afghanistan.
On était en outre dans la saison chaude, et sauf ceux qui y étaient forcés, nul ne quittait l’Angleterre. C’était un moment mal choisi pour voyager, surtout pour une jeune femme délicate et un bébé.
D’autre part, il n’était pas absolument certain que ma femme dût venir aux Indes, car j’avais la promesse d’un emploi à l’état-major, en Angleterre. Pourtant, avant de pouvoir entrer dans cette nouvelle fonction, je devais rejoindre mon nouveau bataillon, parce qu’il était sur le théâtre de la guerre.
Cependant je souffrais tout de même d’être obligé de partir. Il était clair, en effet, que si la guerre était finie, il serait trop tard pour participer à ses gloires, mais non pour souffrir des incommodités d’un séjour aussi rude que l’Afghanistan. Sans compter qu’il fallait toujours s’attendre à voir son existence finir sous le vulgaire couteau d’un Afghan, au lieu de périr avec gloire sur un champ de bataille.
Ainsi donc l’avenir ne me semblait pas rose, mais il me fallait obéir et je le fis, quoique à regret.
J’épargnerai à mes lecteurs les tristesses de ma séparation d’avec ma femme. Je ne lui fis aucune promesse de fidélité, l’idée ne me vint jamais d’en faire, car quoique ami des plaisirs de l’amour et favorisé de celui-ci avant mon mariage, je m’étais toujours conduit depuis en bon mari dont les désirs ne dépassaient jamais l’alcôve conjugale. Mon épouse répondait toujours à mes caresses par d’autres aussi ardentes, et ses charmes, loin d’avoir perdu de leur éclat, semblaient devenir plus attrayants à mesure que j’entrais davantage en leur possession. Ma chère femme était tout amour et toute passion, et non de ces femmes froides et soumises par devoir aux caresses maritales comme si elles accomplissaient une pénitence. Ce n’est pas elle qui aurait dit :
« Oh ! laissez-moi dormir cette nuit, nous avons fait deux fois l’amour la nuit dernière, et vous ne devez plus en avoir besoin. Soyez plus sage et ne me traitez pas comme une catin ! Ôtez votre main ! Laissez ma chemise tranquille, c’est inconvenant… »
Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’excédée par l’obstination de l’époux, elle décide avec mauvaise humeur de se laisser faire, lui permet en maugréant de pénétrer ses attraits intimes tout de glace, et lui ouvre en rechignant ses bras inhospitaliers, en s’étalant comme une loque sans passion, insensible à tous les efforts de son époux pour tirer un semblant de plaisir de ses sens refroidis.
Oh ! que c’était différent avec ma Louise ! Les caresses succédaient aux caresses, les étreintes aux étreintes, chaque doux sacrifice devenait plus doux que le précédent, car elle savait apprécier justement les plaisirs de l’amour. Il était impossible d’obtenir davantage d’une femme et il semblait à Louise impossible d’obtenir plus de passion.
« Encore une fois ! mon chéri, me susurrait-elle à l’oreille. Je suis sûre que cela vous fera du bien et cela me fera tant de plaisir ! »
Et une fois de plus j’ajoutais le déchaînement de mes voluptés aux riches profondeurs de ses charmes tout frémissants de passion.
« Oh ! ma Louise chérie ! comme je m’arrachai péniblement à votre étreinte, à la veille de mon départ vers ces Indes inconnues, où d’autres femmes voluptueuses et nues devaient bientôt partager mon lit et dont les membres allaient m’enlacer dans des étreintes extatiques ! Comme je pensai qu’avant longtemps je ne me retrouverais entre vos bras pleins de lascivetés ! Je rends surtout grâces au ciel, ma Louise chérie, de ce que vous n’ayez jamais connu la jalousie, et je remercie Vénus d’avoir tiré un rideau impénétrable, d’avoir caché à vos yeux mes jeux charmants avec certaines nymphes, jeux semblables à ceux de Jupiter lui-même, qui était invisible lorsqu’il parcourait les collines pour rencontrer celles d’entre les filles des hommes qui le charmaient ! »
Mais redescendons sur la terre, il en est temps, et racontons mon histoire d’une manière plus appropriée à mes lecteurs. J’ai déjà, cher lecteur, outrepassé mes droits en vous froissant peut-être, pour avoir parlé des charmes de ma femme. Mais je vous demande pardon et je sollicite même le libre usage de ma plume, car malgré la difficulté d’une pareille narration, j’espère vous faire partager les joies que j’éprouvai pendant les cinq années de mon séjour dans le glorieux Hindoustan. Si mon lecteur ne peut, dans sa pudeur offensée, supporter qu’un écrivain traite de l’amour, alors qu’il ferme ce livre. Et vous, tendres amants qui vous hasarderez peut-être à plonger les yeux dans cette prose, si l’idée vous choque de lire le récit d’exploits pareils à ceux que vous avez accomplis, fermez aussi ce livre.
Mais si vous aimez sentir vos sens chatouillés, si les scènes habituellement cachées des combats de l’amour et des convulsions des amants ont des charmes pour vous, veuillez bien penser que vos yeux émus considéreront seulement le charme de l’action et non les mots au moyen desquels il faut cependant bien la décrire.
Quand j’abordai à Bombay, royale capitale de l’Inde occidentale, on était au mois d’août. Du voyage, rien de très important à relater. Les passagers étaient de stupides fonctionnaires de l’Inde, retournant à regret vers le siège de leur fonction et emportant dans cette contrée chaude le souvenir de leur court séjour en Angleterre. Ce n’était pas la saison où bien des dames vont visiter l’Inde avec l’espoir que leurs charmes replets ou leurs joues pleines de santé et de fraîcheur pourront captiver quelque époux. Nous formions au contraire une compagnie assez triste. Quelques-uns comme moi avaient laissé leurs femmes en Angleterre ; d’autres étaient accompagnés des leurs, mais ils étaient tous d’un âge où le temps a apaisé les ardeurs brûlantes de la passion et où la dernière pensée en se couchant est d’essayer de profiter encore, si possible, des restes de beauté qui reposaient à leur côté.
Parmi mes compagnons de voyage, avec les officiers et les civilians de tout grade, retournant à leur poste après un congé prolongé par tous les moyens possibles, il y avait aussi des jeunes gens, la plupart attachés à quelque grande maison de commerce de Londres ou de Manchester, qui devaient se répandre sur divers points de l’Hindoustan ou de l’Empire chinois, et enfin de blondes jeunes misses assez putains avec leurs airs de n’y pas toucher et qui, sous la protection de l’honneur et du pavillon anglais, allaient rejoindre leurs fiancés, pour se marier et échanger, après quelques mois de séjour dans l’Inde, le frais incarnat de leur teint contre la pâleur mate ou la teinte jaunâtre que le climat de ce pays appose sur le visage de l’Européen.
Notre capitaine était un homme de fort bonnes manières, sans prétention, mais sans l’autorité réelle nécessaire à bord d’un vaisseau de cette importance. Sous le rapport administratif, il était subordonné au purser, sorte de commissaire ou d’homme de confiance de la Compagnie, chargé des premiers de ses intérêts, de ses intérêts d’argent ; et, sous le rapport de la navigation, il ne pouvait avancer ou s’arrêter, ancrer ou déraper qu’avec l’autorisation de l’agent spécial que l’administration des postes entretient à bord de tous les paquebots.
À la poupe de ces bâtiments est une dunette traversée par une galerie sur laquelle s’ouvrent des deux côtés d’élégantes cabines, aérées par des persiennes. Sous cette dunette s’étend la pièce principale du navire, la salle à manger, donnant accès encore à quelques cabines, qui complètent les chambres de la première classe. Celles de la seconde sont sur l’avant, avec les logements des officiers et des matelots.
Pendant toute la traversée, nos habitudes furent celles de la société anglaise à terre. Nous nous levions de bonne heure pour prendre un bain, auquel succédait une tasse de thé ou de café. Vers neuf heures, les dames, en toilette du matin, sortaient de leurs cabines, et, non sans flirter, on procédait au déjeuner pendant lequel le négligé des dames laissait apparaître quelque sein rose, un pied blanc et parfois (un peignoir s’entrouvrant), tout un joli corps toisonné ; seconde toilette à deux heures et second repas, le lunch ; troisième toilette pour dîner, et après on se rendait sur la vaste poupe, où chacun, selon ses goûts, se promenait, causait ou dansait, car le bâtiment possédait quelques musiciens portugais engagés à Bombay ; puis on servait le thé, et ce n’était qu’après cette collation, qui est encore un repas, que chacun se retirait chez soi.
C’étaient des festins de Lucullus, une bombance perpétuelle, et encore trouvait-on moyen de faire des extra. Deux fois par semaine la boucherie du navire état en activité, et ces jours-là on servait du champagne, c’est-à-dire qu’on ne buvait pas d’autre vin. J’aurais préféré, je l’avoue, payer moins cher et être traité avec plus de simplicité ; ces toilettes sans fin et cette bonne chère sans trêve étaient également fatigantes et m’excitaient. Mais l’exagération du luxe et des dépenses entre précisément dans les combinaisons de la société britannique, et il suffisait pour s’en convaincre de considérer ce qui se passait aux secondes places.
Après avoir successivement laissé à notre gauche le mont Sinaï et le golfe de Tor, les côtes de l’Hedjaz, où se cachent Médine et la Mecque, les villes sacrées de l’Islam, puis les terrasses volcaniques de l’Yémen, où mûrit la fève de Moka, nous vînmes jeter l’ancre, le sixième jour de notre voyage, dans le port d’Aden, ancien cratère éboulé, que nous appelons le Gibraltar de la mer Rouge.
Aussi, ce fut avec un vif sentiment de joie que j’aperçus, dans cet affreux bassin, le paquebot de Bombay, sur lequel notre steamer, qui poussait jusqu’à Singapour, devait verser tous ceux de ses passagers et de ses colis qui n’avaient pas à doubler le cap Comorin. J’étais dans cette catégorie.
Dès le lendemain, notre nouveau navire débouchait dans l’Océan Indien, nous laissant entrevoir à tribord, dans l’horizon embrasé du sud, la masse élevée du cap Gardafui et les arides rochers de Socotora, la Dioscoride des anciens. Après huit jours d’une navigation paisible, sur ces flots que les flottes des Ptolémées mettaient trois mois à traverser, nous aperçûmes à notre avant une longue ligne de côtes, courant du nord au sud, basse, boisée, chargée de chaudes vapeurs et doublée sur l’arrière-plan d’une seconde ligne de hauts sommets. C’étaient les rivages de l’Inde, la côte du Concan, l’archipel de Salcette et de Bombay, et dans l’horizon lointain la chaîne des Ghauts occidentaux.
En ce moment, le soleil, incliné au couchant, étendait horizontalement ses rayons sur la surface plane de l’océan, en la diaprant de tous les reflets de la nacre et de l’opale, tandis qu’il pénétrait de ses vivifiants effluves les chaudes vapeurs dont le voile diaphane flottait sur les contours boisés de la côte et sur les gradins étagés des montagnes de l’arrière-plan. Seule, la zone de forêts qui couvre les terres basses de l’île de Salcette demeurait dans l’ombre, et sur cette ombre veloutée, d’un pourpre presque noir, se détachaient d’une manière admirable les monuments de Bombay, ses villas, ses palmiers et les agrès de ses vaisseaux.
À peine le disque solaire eut-il disparu qu’un jet immense d’un vert pâle et transparent, qu’on eût dit lancé par un prisme invisible, vint occuper sa place et marquer jusqu’au zénith la route qu’il avait suivie dans l’espace. Ni la plume ni le pinceau ne sauraient rendre la variété de tons, d’accidents et de mouvements que cette apparition répandit à travers les magiques ondulations de la lumière défaillante ; un réseau d’or et de feu, semé d’une éblouissante poussière de pierres précieuses, n’eût rien produit qu’on pût lui comparer.
Je remarquai en cette occasion un fait que j’ai été à même de constater depuis, en dépit de l’opinion de la plupart des voyageurs et des savants. L’intervalle qui s’écoule entre la disparition du soleil et la tombée de la nuit est plus grand dans ces régions qu’on ne le pense et qu’on ne le dit généralement. Je fis part de mes doutes à cet égard à un missionnaire qui se trouvait à bord, homme instruit et qui a fait de longs séjours dans ces latitudes ; il les partageait entièrement. Plus de trois quarts d’heure après le coucher du soleil, la lueur du crépuscule suffit encore pour éclairer notre débarquement et nos premiers pas dans Bombay.
Héritière de toutes les grandeurs déchues de la côte occidentale de l’Inde, de tout le commerce qui fit autrefois la renommée et la fortune de Cochin, de Calicut, de Goa, de Surate et de Cambaye, Bombay s’élève au milieu d’une forêt de palmiers, sur un îlot coralligène qu’une chaussée unit à la grande île de Salcette. Son port, où aboutissent tous les produits de l’ouest et du nord de l’Inde à la destination de la Chine et de l’Angleterre, ne le cède à aucun autre en importance et en activité. Ses relations commerciales sont plus étendues que celles de l’ancienne Carthage ou des républiques marchandes de Gênes et de Venise, au temps de leur splendeur.
Cette grande cité est dans les meilleures conditions pour préparer le nouveau débarqué à l’étude du monde indou. À la première vue de ces hommes à demi vêtus de blanc, à la peau couleur de bronze, ayant presque toujours le visage et le buste saupoudrés de curcuma ; de femmes demi-nues aussi, délicieuses, et dont les seins sont aussi doux que la soie, et dont les jambes sont étrangement drapées de gaze rouge, blanche ou violette, chargées d’ornements d’argent et d’or aux pieds, aux mains, aux bras, au cou, au nez et aux oreilles, et couronnant leurs longs cheveux noirs de guirlandes de fleurs aromatiques ; à l’aspect de ces petits temples indiens, où de monstrueuses idoles sont sans cesse entourées de fakirs décharnés, aux ongles longs et crochus comme des serres de vautour ; en contemplant ces vastes étangs bordés d’escaliers de pierre, où il y a toujours encombrement de vivants qui se purifient et de cadavres que l’on lave ; et surtout en plongeant le regard dans ces chapelles silencieuses des Guèbres, où brûle, éternellement entretenu, le feu sacré, allumé au principe des choses humaines par les patriarches de la primitive Asie, on se sent entraîné au fond des mœurs de l’Inde et des siècles écoulés.
En circulant dans les rues des quartiers indigènes, on voit souvent des habitations légères comme des cages à jour laisser échapper de longs jets de lumière et de discordantes symphonies. Là se passent des cérémonies de noces indoues. Ce sont de petits enfants qu’on marie : un garçon de dix ou douze ans à une fille de cinq ou six. Ils sont tout nus, mais chargés d’anneaux et de bracelets, barbouillés de jaune, entourés d’une multitude de parents. Tour à tour on les lave et on les enduit de nouveau de curcuma ; puis, à plusieurs reprises, on leur présente de l’eau, qu’ils prennent dans la bouche pour se la jeter mutuellement sur leurs petits corps et particulièrement sur les parties pudiques. Ces absurdités se prolongent pendant trois ou quatre jours et autant de nuits sans interruption, accompagnées d’un tintamarre de tambours et de violons qui passe toute idée.
À côté de cette poésie un peu puérile des temps primitifs, Bombay tient en réserve, dans sa partie européenne, tous les raffinements de la civilisation moderne : d’excellentes chaussées en macadam sur lesquelles passent et repassent d’élégants cavaliers anglais, et, dans de riches équipages, des femmes mises avec la recherche de Londres et de Paris. Quand on parcourt en calèche légère les environs de la ville et que, à l’ombre d’arbres et d’arbustes merveilleux, on aperçoit les belles villas anglaises, aux larges terrasses, aux longues colonnades, on pourrait se croire à Naples ou à Palerme ; mais lorsque, sur le fond vert clair des bananiers ou sous les fûts élancés des cocotiers et des sveltes aréquiers au panache aérien, on voit passer comme des ombres les indigènes bruns et nus, à la longue chevelure flottante, on est vite ramené aux réalités de la terre du soleil.
Le lendemain de mon arrivée, je me rendis chez l’important lord Barrye, pour lequel j’apportais d’Europe des lettres de recommandation. Il habite un palais superbe, au centre d’un beau jardin. Chaque marche du vaste escalier qui conduit au perron est garnie d’Hindous accroupis, habillés aux couleurs des armes d’Écosse.
La pièce de réception est une salle immense et très élevée ; dans toute sa longueur, au haut du plafond, est attaché un énorme éventail (punka), avec des franges en toile, que des serviteurs ad hoc agitent continuellement au moyen de cordes. Les fenêtres sont revêtues de stores tressés en herbes odoriférantes et constamment mouillées ; à travers cette sorte de tamis l’air s’imprègne d’une certaine fraîcheur, malgré la chaleur suffocante du dehors.
Lord Barrye m’invita à une fête qu’il donnait le soir même : « Je ne vous presserais pas d’y venir, me dit-il, si vous n’y deviez rencontrer que des visages et des uniformes européens ; mais parmi mes invités il y a bon nombre d’indigènes et vous pourrez ainsi prendre contact avec la population aborigène. »
Effectivement, dans la foule animée qui, le soir, vint remplir le palais, je rencontrai des représentants de toutes les races que les siècles et les révolutions ont juxtaposées dans l’Inde : Hindous brahmaniques descendants directs des Arians-sanscrits, musulmans, fils de Sem, issus des envahisseurs du Xe et du XVe siècle, et Guèbres exilés de l’Iran. Beaucoup de ces natifs, pour plaire à leurs maîtres actuels, ont adopté d’assez vilains costumes de fantaisie, dans le goût étriqué de l’Europe, et se rendent chez le gouverneur dans des cabriolets qu’ils conduisent eux-mêmes. Mais il y avait là un jeune Hindou revêtu du pittoresque costume de ses ancêtres et qui, loin de donner tant bien que mal dans nos usages, affectait de rester tout à fait oriental. Il s’exprimait cependant assez bien en anglais ; mais sa jeunesse, ses traits fins et réguliers, ses longs cheveux d’ébène flottant demi-bouclés, sa taille souple et élancée et la coupe antique de sa robe de gaze brochée d’or me faisaient songer involontairement aux héros déifiés de Kalidasa et de Valmiki. J’en devins presque amoureux, et si j’avais été pour hommes, je n’aurais pas hésité à lui faire la cour, ce qu’il semblait attendre de ma part. En somme, je le déçus. À sa beauté réelle, j’aurais pu le prendre pour une exception parmi les siens, si je n’avais su dès longtemps que, toute vieillie qu’est aujourd’hui la grande famille indoue, toute déchue qu’elle est de son ancienne suprématie dans les arts, dans les lettres, dans les armes et dans les aspirations de l’âme vers les choses d’en haut, elle n’en demeure pas moins une des plus belles variétés de notre espèce, la plus remarquable peut-être par le nombre autant que par l’uniformité et la distinction du type.
Autant et plus encore que les Hindous brahmaniques, les Parsis que je vis chez lord Barrye reportèrent ma pensée vers les âges écoulés.
Descendants des Guèbres de Perse qui échappèrent aux-persécutions mulsumanes, lors de la conquête de leur patrie par les califes, ils ont trouvé un asile parmi les frères dont les avait séparés, il y a plus de quarante siècles, l’antique rivalité des Asouras et des Dêvas. Comme au temps de Zoroastre leur législateur, ils révèrent encore dans le soleil l’image la plus noble de l’être suprême, Ahourad Mosda, et dans le feu sacré entretenu dans leurs temples le symbole de l’astre divin. Descendus dans l’Inde, il y a plus de mille ans, ils se sont répandus dans la partie occidentale de la Péninsule ; la ville de Bombay seule en compte de quinze à vingt mille. Ils se distinguent de tous les autres habitants par leurs belles physionomies, leur aisance et leur industrie. Dans les ports du Concan, du Goudjerat et du Malabar, il n’y a pas de maison de commerce européenne dans laquelle, au moins un d’eux ne soit intéressé, et c’est ordinairement le Parsi qui fournit le plus de capitaux. Propriétaires des deux tiers de la grande ville de Surate, ils possèdent la plus grande partie de Bombay et de sa banlieue. Ayant demandé à un de ces Guèbres, qui alors même faisait construire de magnifiques habitations dans la ville et de fort jolies villas dans la campagne, pourquoi il plaçait ainsi à trois ou quatre pour cent, tout au plus, sa fortune, dont il pouvait si facilement tirer dix ou douze en opérations de banque ou de négoce, il me répondit : « Cette terre est maintenant mon pays ; mes pères y ont vécu, j’y suis né et j’y mourrai comme eux. Il est donc naturel que nous cherchions à y fonder quelque héritage durable pour nos enfants. Si les Anglais, qui ne sont ici que pour un court espace de temps, aiment à faire valoir leur argent le plus possible, c’est, j’imagine, pour regagner au plus vite leur patrie et y faire sans doute ce que nous faisons en ces lieux. »
S’ils ont appris à connaître et à aimer le luxe intérieur des Anglais leurs maîtres, si leurs maisons sont ornées avec profusion de glaces, de gravures, de meubles européens, on doit dire qu’ils ne fournissent pas la moindre recrue aux cohortes de danseuses, de courtisanes et de gitons aux croupes remuantes, qui abondent à Bombay. Leurs femmes cependant jouissent de plus de liberté que les autres femmes de l’Orient. En somme et sous tous les points de vue, ils sont, de tous les natifs de l’Inde, les plus vigoureux, les plus actifs et les plus intelligents.
Bien plus que les Hindous gardiens fidèles des plus anciennes traditions religieuses de l’Asie centrale, ils rendent encore un culte sans images, sans idoles, aux forces élémentaires de la nature, mais donnent au feu la prééminence. La beauté de l’esplanade de Bombay, baignée par les longues lames bleues de l’Océan, revêtait pour moi un nouvel attrait par la présence de ces adorateurs du soleil, qui le matin et le soir y venaient en foule, avec leurs brillants costumes blancs et leurs turbans aux couleurs éclatantes, pour saluer l’astre à son lever ou offrir leurs hommages à ses derniers rayons. Que de fois me suis-je arrêté à les contempler, à genoux sur le sable humide, les mains jointes et priant avec un air de profonde émotion dans une langue qu’ils ne comprennent plus ! À ces heures, leurs femmes ne se montrent point avec eux ; c’est le moment où, comme les compagnes des anciens patriarches, elles s’assemblent autour des puits pour y faire la provision d’eau nécessaire à leurs ménages.
Le cimetière des Parsis est sur une colline qui domine la côte ; dans une de mes courses journalières je rencontrai un cortège funèbre qui la gravissait. Le corps, enfermé dans une bière recouverte d’un linceul blanc, était porté par six hommes, tous vêtus de longues robes blanches et voilés de capuchons, comme les pénitents des confréries de Provence. Ils étaient précédés et suivis d’une nombreuse procession costumée de même et marchant deux à deux, chaque couple attaché par un mouchoir blanc. Le haut de la colline est excavé d’un trou large et profond, intérieurement divisé en trois compartiments : l’un pour les hommes, l’autre pour les femmes, le troisième pour les enfants. Autour de l’ouverture béante est un petit mur d’appui sur lequel on dépose les cadavres. On les y laisse en proie aux vautours qui planent sans cesse autour de cet endroit, tandis que les parents des défunts se tiennent à une certaine distance pour épier quel œil leur sera arraché le premier, augurant de cette circonstance la destinée bonne ou mauvaise de l’âme.
Lorsque la chair a été tout entière rendue aux éléments, on précipite les ossements dans le puits, où ils se décomposent pêle-mêle.
Au pôle opposé de cet usage funéraire, il faut placer celui des Hindous, qui brûlent leurs morts. En me promenant un jour sur le rivage de Pile de la Salcette, qui fait face à Bombay, j’atteignis sans le chercher un des lieux consacrés à l’incinération des cadavres ; plusieurs bûchers, composés en grande partie de bûches artificielles en bouse de vache desséchée, étaient allumés et répandaient au loin une chaleur intense et une odeur de côtelettes brûlées à soulever le cœur. Je m’empressai de fuir et j’eus longtemps le flair affecté par les exhalaisons révoltantes que j’avais respirées en ce lieu.
Le soir, je me rendis avec plusieurs jeunes gens des bureaux et de l’état-major du gouverneur à une natch ou fête de nuit, qu’un riche banian donnait pour l’inauguration de sa maison nouvellement bâtie. Une brillante illumination éclairait l’édifice et dessinait en traits de feu tous les détails de son architecture orientale. Une foule immense encombrant la rue et la porte d’entrée, ce ne fut pas sans peine que je pénétrai jusqu’à la grande salle de réception, qui n’était autre que la cour intérieure de l’édifice, recouverte, selon la coutume des Hindous, en pareille occasion, d’une vaste tente écarlate ; le sol était caché sous un beau tapis de même couleur ; tout alentour régnaient deux rangs de galeries soutenues par de hautes colonnes de marbre ou de stuc jouant le marbre, et des portes ouvrant sur ces galeries conduisaient dans les petits appartements. L’étage supérieur était habité par les femmes de la famille : nous n’en vîmes aucune, mais elles pouvaient jouir, à travers les jalousies, du coup d’œil de la fête, qui n’était pas à dédaigner : une moisson de fleurs en gerbes, en guirlandes, en festons ; une prodigieuse quantité de très grands candélabres en cristal ; l’animation de la foule, la variété et la beauté des costumes formant un ensemble digne des Mille et une nuits.
Lorsque nous entrâmes, on faisait cercle autour d’un chœur dansant de bayadères habillées de gazes roses, blanches, lilas ou cerise, brochées d’or ou d’argent, et dont la coupe remonte aux siècles de Sita et de Savitri. Chargées d’anneaux et de chaînes à leurs pieds nus, ces brunes mais gracieuses créatures produisaient, en frappant la terre de leurs talons, comme un bruit argentin d’éperons.
Le rythme de leur danse est si différent de tout ce que j’avais pu voir auparavant, si ravissant de grâce et d’originalité, leurs chants sont si mélancoliques et si sauvages, leurs gestes si doux, si voluptueux et si vifs parfois, la musique qui les accompagne si discordante, qu’il est bien difficile d’en donner l’idée.
Croupes merveilleuses, melons à deux tranches, seins se haussant en cadence, nombrils parcourant une ellipse comme le soleil, vous attisiez tous mes désirs.
Quand on songe que cette danse, d’une signification inconnue, remonte probablement à l’antiquité la plus reculée, et que ces filles répètent, sans se rendre compte de ce qu’elles font, les pantomimes que leurs pareilles exécutaient, il y a plus de trois mille ans, devant les chefs divinisés de leurs ancêtres, on s’égare dans de profondes rêveries sur les mystères de cette Inde merveilleuse. Je n’ai jamais vu, en Europe, de danseuses de profession avoir plus de décence que ces bayadères dans le costume et dans les attitudes. Mais les maîtres actuels du pays apprécient peu ces choses, et la fin de ces danses mystiques fut brusquement troublée par de jeunes Anglais qui, sans égard pour leur hôte, ou croyant faire une charmante plaisanterie, voulurent entraîner ces Terpsichores indoues dans le tourbillon prosaïque d’une valse. Effarouchées de ce procédé, elles éclatèrent en cris et en pleurs et se retirèrent immédiatement.
Trop préoccupés des intérêts positifs, je le dis avec franchise à mes compatriotes, les Anglais ne savent pas jouir de tout ce que l’Inde leur offre de si original, je dirai même de si exquis ; pour eux, tout y est trivial et commun. En vain la nature indienne se développe à leurs yeux, gracieuse et naïve, sauvage et grandiose ; ils lui préfèrent la nature conventionnelle et un peu chétive de leurs parcs.
Autour de leurs habitations ils écartent avec soin tout ce qui pourrait leur rappeler l’Asie et le tropique. Leur premier soin, en établissant un jardin ou un parc, est d’abattre tous les palmiers, d’arracher toutes les plantes qui donnent au sol son caractère spécial, d’y substituer des casuarinas ou des cèdres déodars dont le port rappelle un peu celui du sapin du Nord, et de semer sous leurs maigres ombrages des pelouses de gazon anglais, contre lesquelles proteste un implacable soleil. Voilà à quoi s’ingénie dans l’Inde le patriotisme des Anglais. La grâce sans apprêt de leurs vassaux asiatiques est lettre close pour eux, car le naturel choque l’esprit habitué au factice. À cet égard, l’antagonisme de goût et de génie des deux races se révèle au premier coup d’œil dans leurs costumes nationaux : quoi de plus déplorable, sans autre parallèle, que la toilette grotesque qui défigure nos femmes, comparée aux admirables draperies du vêtement antique des Hindoues, dont la nature elle-même forme les plis et dont la réminiscence semble avoir inspiré les artistes de la Grèce et de Rome aux plus belles époques de l’art ancien.
Les hommes de l’Hindoustan forment une race remarquablement belle ; plus belles encore sont leurs femmes, et presque toujours aimables et belles à la fois. Chaque province a son type, chaque type ses traits distinctifs de beauté ; nous devons nous contenter de les caractériser ici d’une manière générale.
Droite, gracieuse, délicieusement arrondie, la taille des jeunes Hindoues peut servir de modèle au sculpteur le plus exigeant. Leurs membres souples et délicats sont d’une symétrie parfaite. Elles ne sont pas grandes, et cependant leur port est celui des nymphes d’Homère ; leurs gestes sont dignes, aisés, expressifs ; leurs pieds et leurs mains d’une petitesse mignonne. Leurs seins sont les plus divins des fruits tropicaux, elles ont des hanches qui peuvent faire mourir d’amour. Leur tête peu forte, leur visage ovale, leur angle facial présentent ces lignes, ces contours que l’on admire tant dans les œuvres de l’art grec ; leur bouche, je dois l’avouer, est parfois trop grande, souvent trop droite, ou roide et pincée, si elle est petite… Mais leurs yeux de houris, noirs comme la mort et brillants de vie, leurs yeux surmontés d’admirables sourcils et voilés de longs cils d’ébène défient la critique et la comparaison. L’abondance et la noirceur brillante de leur chevelure est proverbiale. Suivant la latitude et le niveau du sol, le soleil a doré leur peau satinée et diaphane de ses teintes les plus variées, depuis le blanc mat de la Languedocienne et de la Catalane jusqu’aux nuances du safran, de l’olive et du bronze. Ne riez pas : c’est sous le charme de la fascination exercée par les brunes filles de l’Inde que tous les voyageurs, tous les auteurs, depuis Orme, Sousa, Bernier, ont sanctionné ce proverbe à l’usage des conquérants européens de cette contrée, proverbe aussi vrai de nos jours qu’au temps des Portugais : « Il y a cent portes pour entrer dans l’Indoustan, pas une seule pour en sortir. »
Est-ce à dire que cet éloge s’applique à toutes les femmes de l’Inde, et que cette vaste contrée ait échappé à cette terrible loi qui, depuis Adam, veut que partout la laideur, comme la sottise, soit en majorité ? Hélas ! ne savons-nous pas que les réputations de beauté physique ou intellectuelle, attribuées comme privilège à certains sols, à certains milieux, ne sont dues qu’aux rayonnements épars d’exceptions plus ou moins nombreuses ? Bien des vierges d’Albion figureraient fort mal dans les albums de Lawrence ; toutes les Parisiennes, avouons-le, ne sont pas des types d’amabilité ; tous les académiciens ne sont pas des immortels ; eh bien ! dans l’Inde comme ailleurs, quand on parle de type, c’est de la minorité qu’il s’agit. Je dois même reconnaître que l’amateur de l’antique et du grimé ne trouverait nulle part une collection de figures ratatinées et décrépites, ayant incontestablement droit au titre de vieilles femmes, comparable à celle que lui offrira ce pays où tout croît, se développe et se fane avec une désespérante rapidité… Mais nulle part aussi, parmi les créatures de douze à seize ans, âge de l’épanouissement complet des fleurs humaines dans cette serre chaude, le poète rêvant l’idéal de l’éternelle beauté ne trouvera plus souvent à faire l’application de cette lyrique apostrophe, échappée il y a trente siècles au moins à l’enthousiasme du vieux Valmiki :
À ton aspect on rêve de pudeur, de splendeur, de félicité et de gloire ; on pense à Lakchmi, l’épouse de Vichnou, ou à Rati, la riante compagne de l’amour. De ces divinités laquelle es-tu, ô femme à la séduisante ceinture ?
On aimera aussi ce soupir du poète Dhyssorh :
Écoute le vent, il t’apporte mes serments et vœux ; si tu sens sous ta ceinture s’agiter l’effroyable vide que je puis remplir et le vide que mes yeux voient devant moi, ta croupe seule le pourrait emplir.





























