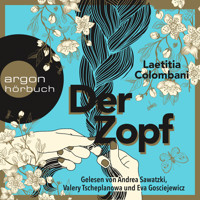Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Extrait : "Nous sommes à la troisième année de la 112e Olympiade. Deux jeunes garçons de onze à treize ans suivent les rues tortueuses de Pella, en Macédoine, accompagnés de leur précepteur ou « pédagogue » ; celui-ci chargé de manuscrits, d'instruments de musique et boitant visiblement ; ceux-là gambadant à ses côtés. « Par ici, Proas ! dit Perdiccas, l'aîné, d'une voix impérieuse en tirant le maître par sa tunique ou chiton. Tu sais bien que nous voulons..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nous sommes à la troisième année de la 112e Olympiade. Deux jeunes garçons de onze à treize ans suivent les rues tortueuses de Pella, en Macédoine, accompagnés de leur précepteur ou « pédagogue » ; celui-ci chargé de manuscrits, d’instruments de musique et boitant visiblement ; ceux-là gambadant à ses côtés.
« Par ici, Proas ! dit Perdiccas, l’aîné, d’une voix impérieuse en tirant le maître par sa tunique ou chiton. Tu sais bien que nous voulons suivre la grande route !…
– La grande route ! objecta le précepteur. Nous nous éloignons de la maison ! Cela nous fait une demi-heure de chemin supplémentaire. À quoi bon, mes enfants ?
– Nous voudrions aller voir le portrait d’Alexandre, expliqua Amyntas, le plus jeune des deux élèves.
– Oui, nous voulons entrer au palais et voir le portrait, comme tout le monde, » dit péremptoirement le frère aîné.
Puis, soudain, s’emportant :
« Je suis bien libre, j’imagine, de choisir ma promenade !… Oublies-tu, captif, qui tu es et qui nous sommes ?… Faut-il te rappeler que tu as pour élèves les arrière-neveux d’Hercule et les cousins d’Alexandre ?…
– Tu me l’as assez souvent répété pour que je n’en ignore ! » répliqua le précepteur, sans autrement s’offusquer du ton de Perdiccas.
Et traînant de son mieux sa jambe gauche, qui n’avait cessé de le faire souffrir depuis certain coup de lance macédonienne reçu à la bataille de Chéronée, il suivit ses deux élèves avec résignation.
Mais déjà Perdiccas, qui avait le cœur généreux autant que sa langue était prompte, se reprochait ses paroles malsonnantes.
« Pardonne-moi, Proas, dit-il en se retournant vers le précepteur, je viens de te parler étourdiment. Si tu es captif, ce n’est pas ta faute !… Le sort des armes l’a voulu, et je serais plus vil qu’un autre d’offenser un brave soldat, moi qui n’ai d’autre ambition que de me distinguer un jour sur le champ de bataille… Peut-être m’arrivera-t-il, à moi aussi, de tomber aux mains de l’ennemi !… Tu sais, n’est-ce pas ? que je parle trop souvent sans réfléchir et que mon ardeur impétueuse l’emporte sur mon jugement. Ma mère dit qu’il faut mettre cela au compte du sang des Héraclites, » ajouta l’enfant avec un naïf orgueil.
« Brave et loyale nature, Héraclite ou non ! » se disait le bon Proas en donnant un regard de paternelle affection à la fière mine et à l’œil bleu de son élève.
« Je n’accusais point ton cœur, mon fils, reprit-il tout haut ; je connais ton humeur vive et bouillante, et c’est à elle seule que j’attribue les écarts de ta langue. Mais tu as raison de respecter en moi le malheur des armes, et il est digne d’un futur guerrier de reconnaître franchement ses torts. »
Cependant on avait quitté les ruelles sombres, mal alignées, pour prendre la voie principale où se trouvait le palais. Ici des maisons spacieuses, élégantes, un sol entretenu avec soin, un alignement régulier ; ces signes incontestables de civilisation témoignaient assez que ceux que les Grecs appelaient encore des « barbares », tout en se laissant battre par eux, leur avaient emprunté le secret des arts, tandis qu’ils gardaient celui des vertus guerrières. Il n’y avait pas cent ans encore que le roi Archélaüs, comprenant l’immense supériorité de ses voisins, avait résolu de les imiter ; qu’il avait transporté d’Agæ à Pella le siège de son gouvernement ; qu’il avait rebâti la ville, élevé des fortifications, tracé des routes, réformé l’armée, favorisé de tout son pouvoir les lettres, les sciences et les arts. Zeuxis avait été appelé à décorer sa demeure. Euripide était venu se fixer chez lui. D’aussi nobles exemples n’avaient pas été négligés ; ses successeurs l’avaient dépassé et même éclipsé. Qui se souvient d’Archélaüs, quand on nomme Philippe de Macédoine ? Et le nom de Philippe lui-même ne pâlit-il point auprès de celui d’Alexandre ?
Le progrès avait marché à pas de géant. Appelles avait remplacé Zeuxis, et les chefs-d’œuvre de son pinceau laissaient bien loin les peintures tant admirées jadis.
Un nom plus glorieux encore que celui d’Euripide était dans toutes les bouches. Aristote, le plus grand éducateur que le monde ait connu, après avoir ébloui Athènes de son enseignement, était revenu, sur les instances de Philippe, se fixer à Stagyre, sa ville natale, pour y faire l’éducation d’Alexandre, et dans ce petit coin obscur de la Chalcidique on avait vu le maître sans pareil former le sublime enfant à toutes les vertus et à toutes les excellences.
Philippe, enfin, avait fait de la phalange cet instrument de précision qui devait d’abord asservir les Grecs, et, plus tard, aux mains d’Alexandre accomplir tant de prodiges.
À peine âgé de vingt ans lorsque la mort de son père l’appela subitement au trône, l’élève d’Aristote avait prouvé tout d’abord, par la sagesse et la force de sa politique intérieure, qu’il était mûr pour le gouvernement.
Il avait pacifié la Grèce, soumis les barbares voisins. Mais la presqu’île hellénique était un champ trop étroit pour son ambition, et bientôt, lâchant la bride à l’humeur conquérante qui le possédait, il s’était jeté sur l’Asie, avait marché de succès en succès.
Les nations civilisées s’inclinaient devant le jeune conquérant, qui avait pu, avec une poignée d’hommes, briser le colossal empire des Perses ; et lui, poursuivant sa carrière, jetait chaque jour au monde un nouveau nom de victoire destiné à rester immortel : c’était Issus après le Granique, et Tyr après Issus, – en attendant Arbèles.
Si l’univers retentissait des triomphes d’Alexandre, on peut penser qu’à Pella l’enthousiasme était plus grand encore qu’ailleurs. Les vieillards et les enfants, – seuls restés au foyer, – ne parlaient plus d’autre chose. Les uns regrettant leur vigueur disparue, les autres gémissant de n’être pas en âge de porter les armes. Du matin au soir, le palais habité par la reine-mère était assiégé de curieux avides de nouvelles : on savait qu’Alexandre lui était tendrement attaché et lui adressait chaque jour ses plus rapides messagers.
Touchée des hommages unanimes qu’on rendait à la gloire de son fils, l’altière Olympias s’était laissé persuader d’exposer publiquement le fameux portrait, chef-d’œuvre d’Appelles, Alexandre brandissant la foudre, que tout le monde souhaitait voir et qui n’avait été montré jusque-là qu’à un petit nombre d’amis. Le tableau était placé sous un dais de riches draperies, dans le vestibule du palais royal, vaste édifice d’ordre composite élevé par une succession d’architectes grecs.
Rangés sur trois rangs, à l’entrée même, les visiteurs attendaient leur tour de défiler devant l’image de celui qui remplissait l’univers de sa gloire, et la renommée du peintre ajoutant son prestige à celle du vainqueur, c’est dans un sentiment de respect quasi religieux que la cérémonie se poursuivait.
Les deux élèves de Proas l’accomplirent en silence avec leur maître. Un instant ils contemplèrent le demi-dieu, parmi les nuées, planant sur l’empyrée et levant sur les faibles humains l’attribut symbolique de la toute-puissance céleste. Mais bientôt un avertissement des gardes mit fin à leur visite ; ils cédèrent la place à ceux qui les suivaient et se retrouvèrent dans la rue.
Aussitôt, leurs langues se délièrent. Amyntas, très sensible au beau, sous toutes ses formes, admirait surtout la perfection de l’image. Perdiccas était plus fortement impressionné par l’apothéose même.
« Comment est-il possible de donner à ce point l’illusion de la vie ? disait l’un. C’est à croire, vraiment, qu’on voit le roi en personne, et qu’il va parler…
– Pourquoi ne suis-je qu’un enfant et pourquoi ne m’est-il pas donné de participer aux exploits d’un tel héros ? s’écriait l’autre. Cinq ou six ans de plus, et mon père me l’aurait permis, sans nul doute !… Je serais avec lui aux côtés d’Alexandre !… Je m’associerais à ses hauts faits. Peut-être pourrais-je, comme un autre, m’illustrer dans les combats et montrer au monde que je ne suis pas indigne de mon nom… Ah ! sort cruel ! sort injuste, qui m’attache ici avec les femmes et les vieillards, tandis que les Macédoniens marchent à la conquête de l’Asie !…
– Patience, patience, répondait Proas. L’occasion de donner des coups et d’en recevoir arrivera toujours assez tôt. Elle ne manque guère ici-bas.
– Non ! non ! disait Perdiccas, qu’une généreuse ambition éclairait sur les réalités, en dépit de sa grande jeunesse. Il ne restera plus rien à faire quand je serai d’âge à prendre rang dans la phalange.
– Crois-tu donc que l’âge soit tout pour un homme de guerre ? objectait le précepteur. Dis-toi bien, cher enfant, qu’il s’agit maintenant de te préparer par de fortes études à tes devoirs futurs et mets ton amour-propre à être un bon élève, si tu veux devenir un bon officier.
– Un bon officier ! riposta Perdiccas avec un dédain peu dissimulé. Comme si la bravoure s’apprenait dans les livres ?
– La bravoure, non, certes ; mais le moyen de l’utiliser à point et de s’en servir à propos. En serais-tu, d’aventure, à t’imaginer qu’on naît grand général, et qu’on le devient sans travail ?
– Tu vas peut-être me dire qu’Alexandre est un rat de bibliothèque ?
– Je ne dis rien de tel, mon cher Perdiccas ; mais je dis qu’Alexandre lui-même est le produit supérieur de la plus haute culture, et que, sans son maître Aristote, il n’eût pas été Alexandre.
– Comment cela ? demandèrent les deux enfants, vivement intéressés par cette leçon pratique.
– C’est très simple, répondit Proas, heureux de voir leur curiosité en éveil. Un grand général, mes enfants, est peut-être ce qu’il y a au monde de plus rare. Pour vaincre, – non pas dans une rencontre isolée, mais dans une longue suite de combats et contre les adversaires les plus divers, – il faut un ensemble de qualités physiques et morales, très exceptionnellement réunies chez un mortel, et qu’une éducation complète peut seule amener à maturité. Eh bien, je dis qu’à en juger par son éclatante carrière et par ce que je sais de lui, Alexandre est le produit parfait et comme la fleur de notre éducation grecque. C’est parce qu’il l’a reçue, – uniquement parce qu’il l’a reçue, aux mains d’un maître sans rival, – qu’il est ce que nous le voyons… Son triomphe, on peut le dire, est celui d’Athènes et du pédagogue athénien.
– Aristote est né à Stagyre ! objecta Perdiccas.
– Oui, mais il fut chez nous l’élève du divin Platon.
– Tu l’as connu, Platon ? demanda Amyntas.
– J’ai eu le bonheur de le voir dans ma jeunesse.
– Et le peintre Zeuxis, l’as-tu vu aussi ?
– Oh ! non, je ne le connais, comme vous, que par ses œuvres et sa réputation, dit le précepteur en souriant, il était mort bien avant ma naissance.
– Vraiment ? fit Perdiccas en ouvrant de grands yeux. Mais il n’y a pas cent ans qu’il peignait à la cour d’Archélaüs.
– Eh bien ! quel âge me donnes-tu donc ?
– Que sais-je, moi ? dit l’enfant en considérant la barbe grise de son maître et les deux rides profondes qui sillonnaient verticalement son front ; tu dois être bien vieux ?…
– Quatre-vingts ans ? suggéra Amyntas, très intéressé par cette enquête personnelle.
– Pas encore, pas encore ! protesta le maître en souriant. Mais les campagnes vieillissent un homme, – surtout les campagnes malheureuses, » ajouta-t-il avec mélancolie.
Et presque aussitôt, secouant sa tristesse :
« … Voyons celui de vous deux qui sait le mieux ses dates et qui est capable d’un petit calcul. J’avais trente-huit ans le jour de la bataille de Chéronée…
– Oh ! s’il faut faire de l’arithmétique et de la chronologie en récréation, je n’en suis pas ! s’écria Perdiccas.
– Tu as quarante-six ans ! dit Amyntas qui avait compté sur ses doigts.
– Très bien, répliqua le pédagogue. N’es-tu pas honteux, Perdiccas, de ne pouvoir te plier au moindre effort de réflexion et de te laisser ainsi dépasser par ton cadet ?
– Tu assistais donc à la bataille de Chéronée ? reprit Amyntas, se hâtant de détourner la semonce qui menaçait son frère.
– Oui, mon enfant. C’est là que j’ai été grièvement blessé et fait prisonnier… Je dois à Chéronée l’honneur d’être votre précepteur, ajouta Proas avec une pointe d’amertume.
– Oh ! conte-nous cela, je t’en prie ! s’écria Perdiccas. Ce sera bien plus amusant que l’arithmétique !… Dis-nous toute ta vie, ton enfance, tes aventures d’écolier et de soldat… Bien souvent tu nous l’as promis et jamais tu n’as réalisé ta promesse…
– Je veux la tenir, mes amis, dit le bon Proas, – mais à une condition : c’est que mes récits seront la récompense d’une sagesse exemplaire. Chaque fois que vous m’aurez donné pleine satisfaction dans vos études, je vous dirai une année de ma vie… Est-ce convenu ?
– Convenu ! répétèrent ensemble les deux garçons.
–… Mais tu nous conteras surtout les bons coups de lance ! ajouta Perdiccas. Car enfin tu es un soldat, toi, et non pas un peintre ou un scribe !…
– Je suis citoyen d’Athènes, répliqua fièrement le captif, et cela dit tout. Sache, mon enfant, qu’un Athénien se pique d’exceller à la fois aux arts de la paix et aux arts de la guerre, et que jamais, sous le soleil, pareille prétention ne fut mieux justifiée… Je vous dirai donc ma vie d’écolier, – non pas, certes, que je prétende me donner en exemple, – mais pour vous expliquer cette éducation d’Athènes, vraiment virile et complète, qui mit son honneur à cultiver simultanément toutes les facultés physiques, intellectuelles et morales de l’être humain…
Vous comprendrez alors comment Eschyle a pu devenir à la fois l’illustre auteur des Euménides et le valeureux soldat de Marathon ; pourquoi un Alcibiade et un Socrate combattirent à Délium avec une bravoure égale ; pourquoi j’affirme qu’Alexandre le Grand est la fleur glorieuse de nos écoles…
Vous verrez enfin que la culture raisonnée, le parfait équilibre et l’harmonie de tous les dons naturels sont le principe même et le but de cette éducation, – la plus noble que le monde ait jamais connue, la plus belle qu’il puisse s’attacher à retrouver, si le malheur des temps voulait qu’il en perdît un jour la tradition… »
Ainsi parla Proas, et, dès le lendemain, ce programme était appliqué.
Chaque soir, après les leçons du jour, le captif allait avec ses deux élèves s’asseoir près de la fontaine, sous les cèdres du jardin, et leur contait un chapitre de sa vie. C’est ce récit qu’on va donner ici.
Ce n’est pas à Athènes même que j’ai vu le jour, mes chers enfants. Je suis né en pleine campagne d’Attique, à quelque deux cents stades de la ville. Mon père Nicias, homme libre, y vivait dans la modeste maison héréditaire, cultivant sa terre avec un petit nombre d’esclaves, car sa fortune était médiocre. Mon aïeul Hilarion, accablé par l’âge, avait renoncé, en faveur de son fils, à tout ce qu’il possédait, et il vieillissait doucement dans l’antique demeure, chéri de tous, vénéré au loin comme un sage.
On attendait ma naissance avec impatience. Ma mère Phédime s’était préparée par les sacrifices et la prière à mettre au monde un fils. Chacun m’avait souhaité d’avance les dons heureux de l’esprit et du corps. La mère de Phédime, ses amies, étaient accourues de tous les environs afin d’assister à ma naissance, et mon père avait mille fois demandé aux dieux de lui donner pour son premier-né un fils.
Je naquis. Aussitôt mon grand-père, d’une main tremblante de joie, attacha sur la porte d’entrée de notre demeure une couronne d’olivier, symbole de l’agriculture à laquelle l’homme est destiné ; si, au lieu d’un garçon une fille avait ouvert les yeux à la lumière, on eût suspendu à la porte une bandelette de laine, indiquant que la femme doit filer, tisser, s’occuper de travaux domestiques.
… Le père, vous ne l’ignorez pas, enfants, adroit de vie et de mort sur sa famille dans toute la Grèce, sauf à Thèbes où les lois lui défendent d’user de ce privilège. À peine né, la mère de Phédime, Cornétho de Prasiès, m’apporta devant le maître. Tremblante, elle s’agenouilla, et me coucha aux pieds de Nicias. Les esclaves, les femmes, les affranchis, les yeux attachés aux siens avec anxiété, attendaient son premier geste. Il abaissa ses regards sur moi, tout petit, si humble et vagissant faiblement, couché nu sur la vieille terre. Il me considéra, et me voyant robuste et bien formé, il se pencha et me prit dans ses bras… Aussitôt des cris d’allégresse retentirent. Mon père m’avait relevé. J’allais vivre, grandir, devenir comme lui un homme libre !… Si, au contraire, il eût détourné de moi ses yeux, me voyant affligé d’une constitution débile ou défectueuse, on m’aurait emporté bien vite, et, m’exposant en quelque lieu désert, on m’eût laissé exhaler dans les pleurs la faible étincelle de vie qui seule animait mon petit être… Quelquefois, hélas ! accablé par les maux de la guerre et de l’esclavage, je me suis demandé s’il n’eût pas mieux valu pour moi ne jamais vivre que tomber dans la misère que j’ai connue depuis mon âge mûr…
Proas soupira, et un moment appuya son front au long bâton recourbé, indice de son autorité sur ses jeunes élèves. Perdiccas, l’œil brillant d’un feu sombre, sembla penser que, pour lui, il eût préféré la mort à l’esclavage… Mais le doux Amyntas, glissant sa main dans celle du pédagogue, trouva un mot affectueux pour consoler le pauvre exilé.
– Ne regrette pas que ton père t’ait laissé vivre, puisque, sans cela, nous ne t’eussions jamais connu, dit-il. Continue, raconte ce qui advint après que Nicias t’eut pris entre ses bras.
– Les dieux te protègent, cher Amyntas, car ton cœur est doux et généreux, dit le captif. Je reprends : les femmes me saisirent, elles me rapportèrent avec joie au gynécée. On me plongea dans l’eau fraîche, je fus lavé et parfumé, puis couché sur un de ces vans d’osier qui servent chez nous à séparer le grain de la paille. C’est, dit-on, le présage d’une opulente fortune et d’une nombreuse postérité.
Mon aïeule maternelle, Cornétho, avait gardé les principes de l’ancien temps. C’est grâce à elle que je fus plongé dans l’eau froide au lieu d’eau tiède, comme cela se pratiquait d’habitude. Elle n’eut garde d’enchaîner mes petits membres sous ces mille bandelettes dont on se sert chez nous pour emmailloter les enfants, et qui nuisent à leur développement, disait-elle.
C’est à peine si elle me couvrit de quelques langes, voulant m’accoutumer de bonne heure au froid… Cinq jours passèrent. Le sixième, Cornétho me prit entre ses bras, et, suivie de tous les gens de la maison ; mon père et mon aïeul en tête, elle fit plusieurs fois en courant le tour de l’autel d’Apollon, placé à la porte de notre demeure et où le feu brûlait nuit et jour. C’est la cérémonie de la purification de l’enfant.
On attendit le septième jour : souvent les nouveau-nés périssent pendant cette période, emportés par les convulsions. Ce jour heureusement écoulé, mon père, ayant réuni ses parents, ceux de sa femme et tous ses amis, leur déclara vouloir me donner le nom de Proas, mon aïeul maternel, mort depuis longtemps, selon la coutume qui veut que l’aîné porte le nom de son grand-père. La cérémonie terminée, on s’assembla pour le repas solennel autour d’une longue table dressée au dehors devant la porte, car elle eût été trop grande pour tenir dans l’intérieur de la maison.
Bien souvent mon aïeul m’a redit les détails de ce jour où je reçus mon nom. Il m’a vanté la pureté incomparable de ce beau soir d’été, la brise embaumée qui soufflait de la mer, faisant frémir doucement le rameau d’olivier fixé à la porte, courbant les épis verdoyants du champ de blé derrière l’habitation, agitant la cime des figuiers au-dessus du toit paternel. Il croyait se voir lui-même à la naissance de Nicias, et, dans le petit être inconscient que j’étais, il retrouvait son fils, aujourd’hui plein de force et de bonheur…
Mon grand-père, ainsi que beaucoup de nos vieillards, se nourrissait exclusivement de miel ; c’est à cette douce nourriture qu’il attribuait sa verte vieillesse, exempte de toute infirmité, son intelligence et sa mémoire intactes. Le miel, en outre, prolonge la vie, affirmait-il. En ce jour, pourtant, voulant fêter lui aussi ma venue au monde, il trempa ses lèvres dans la coupe ornée de roses qui passa à la ronde de main en main, et qui, vidée ainsi au début du repas, est regardée comme le symbole et le garant de l’amitié qui doit unir les convives.
Dès le matin, les esclaves avaient lavé à grande eau la table du festin ; puis ils y avaient amoncelé les corbeilles de pain, les vases de fruits, les mets froids et les gâteaux mis en réserve depuis plusieurs jours ; et maintenant ils circulaient sans bruit autour des lits où les convives couronnés de fleurs étaient étendus, offrant à chacun les plats préparés pour leur délectation.
En cette occasion propice, mon père avait voulu donner un festin aussi recherché que s’il eût été un des plus riches citoyens d’Athènes. On présenta d’abord des coquillages variés, accommodés de diverses manières ; les uns tels qu’ils sortent de la mer, – et selon moi ce sont les meilleurs, – les autres, cuits dans l’huile d’olive, ou sous la cendre ; tous, saupoudrés de poivre et de cumin. En même temps, on servit des œufs frais de nos poules et des œufs de paonnes, plus appréciés encore. Mon père possédait un grand nombre de ces beaux oiseaux de Junon, et mon grand-père m’a dit qu’en ce jour de fête les magnifiques créatures, faisant traîner leur queue splendide ou la relevant en éblouissante corolle, semblaient s’associer aux réjouissances données en mon honneur… Si je vous raconte tout cela, enfants, ce n’est point vaine gloire, croyez-le bien. Mais c’est pour vous faire sentir que les plus heureux commencements ont souvent de bien tristes épilogues…
– Va, va, continue !… dit Perdiccas avec impatience. Que mangea-t-on ensuite à la fête ?
– On mangea, reprit Proas, après les coquillages, toutes les variétés de la viande de porc : andouilles, saucisses, jambons et longes conservés à la fumée du foyer ; pieds farcis, échine rôtie, et jusqu’à un petit cochon de lait cuit tout entier sous la cendre ; puis un foie de sanglier et des gigots d’agneau ; de la fraise de veau, ainsi que la poitrine d’une truie, assaisonnée de cumin, de vinaigre et de silphium, termina cette partie du repas. Alors parurent des petits oiseaux qu’on arrosa d’une sauce fumante, composée d’huile, de vinaigre, de fromage râpé, de silphium. Pour le second service on offrit ce que mon père avait pu se procurer de plus exquis en gibier, volailles et poissons : la murène, la dorade, la vive, le xiphias, le pagre, l’alose, le thon, les congres aux anneaux serpentins, et les glaucus qui se pêchent à Mégare, et les sardines qu’on prend aux environs de Phalère, et qui, disait mon père, mériteraient d’être servies à la table des immortels, lorsqu’on ne les a laissées séjourner qu’un instant dans l’huile bouillante…
Je ne parle ni des champignons, ni des asperges, ni de cette variété infinie de légumes qui abondent sous notre beau climat. Mais je dois un mot de louange à nos fruits exquis, nos figues, nos raisins, nos poires et nos pommes d’Eubée ; nos coings de Corinthe, aussi doux au palais que superbes à l’œil, et nos amandes de Naxos dont la renommée s’étend par toute la Grèce…
Quant au pain, il était d’une blancheur, d’une finesse, d’une saveur délicieuse… Que de fois, j’ai regretté cet aliment frugal de mon enfance !… Une belle tranche de pain de froment, quelques amandes, des figues, une pomme, qu’y a-t-il de plus savoureux ?… Jamais je ne retrouverai de pain semblable à celui qu’on mangeait chez mon père. – Et les gâteaux qu’on servit en ce jour de ma fête, et que tu aurais croqués avec tant de plaisir, Perdiccas !… Je voudrais bien avoir à vous offrir une de ces corbeilles de jonc, pleine de nos gâteaux, enfants, pareilles à celles que, si souvent, ma bonne mère m’apporta, quand je fus écolier à Athènes !… Ces pains de Cappadoce, faits d’un peu de farine de froment, de lait, d’huile et de sel ; ces globes légers, qu’on mange tout chauds et qui se font avec de la farine de sésame, du miel et de l’huile d’olive ; cette bouillie d’orge mondé, pétrie et saturée des sucs de viande et de poularde ; ces galettes, faites simplement de lait et de miel, celles qui sont relevées d’huile et de fromage… Et ces tourtes légères renfermant des fruits confits au miel… ce mélange de raisins et d’amandes qu’on incorpore à la pâte, et enfin, ces tubes aussi légers qu’une feuille de papyrus qu’on mange roulés, en les trempant dans le vin : rien de tout cela, vous pouvez m’en croire, ne manqua au festin en l’honneur du petit Proas…
Les vins, bien entendu, coulèrent à flots. Vins de Corinthe, et vin blanc de Mende, et celui de Naxos qu’on a comparé au nectar des dieux, et enfin le vin de Chio, le roi de tous, à mon sens. Chez nous, il est d’usage d’adoucir parfois le jus de la treille en y incorporant de la farine pétrie avec du miel, ou de le parfumer d’origan, de fruits, de fleurs et d’aromates. Mon père répétait souvent qu’il aimait, en perçant un tonneau, d’être salué par le parfum de la rose et de la violette. Il ne voulait pas cependant que l’arôme des fleurs prédominât sur le goût propre de la grappe.
Le grand-père, instruit par l’expérience, avait conseillé à son fils de mêler au vin un peu d’eau de mer, qui empêche ses fumées puissantes de monter à la tête. C’est avec discrétion qu’il faut mélanger les deux liquides ; une mesure d’eau de mer, enseignait Hilarion, suffit pour cinquante mesures de vin…
Il régnait sur la table une si grande profusion que plus de la moitié des mets se fût perdue, si un usage antique n’avait permis aux convives de choisir parmi les plats ceux qui leur plaisaient davantage, pour les envoyer à leur famille ou à leurs amis.
À la fin du repas, un éphèbe, Calliclès, prit sa lyre et célébra ma naissance et les joies de ce beau jour. À leur tour, tous ceux des convives qui connaissaient l’art divin du chant se firent entendre ; puis les plus jeunes, se levant de table, se livrèrent au plaisir de la danse, pendant que les esclaves enlevaient les restes du festin, que les hommes mûrs et les vieillards, assis en cercle, regardaient s’ébattre la jeunesse en devisant paisiblement.
Après une dernière libation en l’honneur du Bon Génie et de Jupiter Sauveur, les convives se séparèrent avec mille souhaits de bonheur à mon adresse…
L’éducation d’un jeune Grec, mes enfants, commençait le jour de sa naissance, pour finir à sa vingtième année. Le premier soin des parents était de préparer à leur rejeton une constitution robuste. À cet effet, on n’épargnait aucun soin, aucune peine. Ma mère, la douce Phédime, la sévère Cornétho, mon aïeule, étaient sans cesse occupées de moi. L’enfant, jusqu’à sa cinquième année, est animé d’une vitalité si forte que son corps, disent quelques philosophes, n’augmente pas du double en hauteur dans les vingt années suivantes. Il a donc besoin d’une nourriture abondante, d’un exercice constant.
Les nourrices, obéissant à ce besoin de remuer que manifeste le petit être, le bercent, le secouent doucement entre leurs bras, l’élèvent dans les airs, et l’enfant montre qu’il prend plaisir à cet exercice ; c’est grâce à ces ébats qu’il jouit d’un sommeil paisible et d’un heureux réveil.
Dès que je pus me tenir sur mes jambes, ma mère me fit marcher, et souvent mon aïeul me retraça la scène : moi debout, tout nu, sauf un cordon d’amulettes autour du cou, vacillant sur mes faibles jambes, tandis que Phédime et Cornétho, penchées, m’appelaient, et que je semblais, entre elles deux, ne savoir de quel côté me tourner… Le petit chien Pyrrhos, né le même jour que moi, mais combien plus agile !… sautait en jappant jusqu’à mes épaules, m’effarouchant par ses cris ; parfois, perdant soudain l’équilibre, je tombais de mon haut, et Phédime ou Cornétho accouraient me relever, tandis que ce fripon de Pyrrhos profitait de ce que j’étais par terre pour passer sa langue rose sur mon visage…
Bientôt je sus marcher. Alors, ma mère, continuant mon éducation, m’accoutuma à ne faire aucune différence entre les divers aliments qu’on me présentait, qu’ils fussent grossiers ou délicats. Elle m’habitua à me servir de ma main gauche, aussi bien que de la droite ; à ne point pleurer sans cause ; à ne jamais m’imaginer que j’obtiendrais ce que je désirais par des cris de colère ; à ne pas ressentir de frayeur dans les ténèbres ; à avoir horreur du mensonge. Je me rappellerai toujours l’indignation que manifesta ma mère un jour qu’elle entendit une nourrice dire à son élève que c’était en punition d’une faute légère que les dieux l’avaient fait tomber et se fouler le pied… Jamais elle n’eût cherché à agir sur moi par de pareils moyens.
Dès l’enfance, je fus accoutumé à coucher sur la dure, à m’inonder, en toute saison, d’eau froide de la tête aux pieds, à me montrer obéissant, courageux, respectueux envers les vieillards, doux aux animaux, aux êtres plus faibles que moi.
Pendant mes cinq premières années, on ne me prescrivit aucun travail ; le jeu seul m’intéressait et remplissait mes jours… Ah ! mes enfants, quelles bonnes parties je faisais, sous l’œil indulgent de mon aïeul, en compagnie de mon cher camarade Pyrrhos !… Quelles courses, quelles luttes de vitesse avec mon chien, et comme nous sautions à qui mieux mieux par-dessus les tas de paille, les haies, roulant pêle-mêle dans la poussière, mais nous relevant toujours sains et saufs, souples comme deux tiges de jonc !… En vérité, parmi tous mes compagnons de jeu, Pyrrhos est un de ceux dont j’ai gardé le plus tendre souvenir…
Cependant, mes chers parents s’entretenaient souvent de mon avenir. Ma mère désirait que je fusse élevé auprès d’elle et que je devinsse simplement un cultivateur aisé comme mon père, mon grand-père et mes aïeux, depuis sept générations. Je posséderais, disait-elle, après eux tout ce qu’ils possédaient ; ils avaient vécu heureux dans leur modeste sphère ; je suivrai leur exemple. Je vivrai et je mourrai paisible à l’ombre de la vieille maison, je m’y marierai, j’y élèverai mes enfants et j’y cultiverai mon bien… « Y a-t-il un sort plus heureux que celui-là ? » demandait-elle…
Mon père secouait la tête, disant qu’il fallait attendre, pour se décider, que la nature de mes facultés se fût prononcée.
Quant à mon cher grand-père, dont je devins, dès que je pus marcher, l’inséparable compagnon, il affirma toujours que, selon lui, j’étais destiné à apprendre. « Le petit, répétait-il, est doué d’une insatiable curiosité sur toutes choses. Il n’est rien de ce qui se passe autour de lui qu’il n’ait soif de comprendre. – Pourquoi, grand-père ?… Comment ?… Dis, quelle est la raison de telle chose ?… et de cette autre ?… Et puis encore de ceci ?… »
« Voilà, disait mon aïeul, le refrain constant de sa chanson. Pouvons-nous laisser s’atrophier une faculté aussi marquée, permettre que s’éteigne sans aliment une pareille flamme intellectuelle ?… Si l’enfant est le père de l’homme fait, comme l’a dit un sage, le nôtre est assurément destiné à devenir un savant… Notre devoir, je l’estime, est de le mettre en mesure de donner à son esprit la pâture qu’il demande…
– Tu as toujours raison, répondait Phédime, et la sagesse parle par ta bouche ; mais comment, ô père ! donnerons-nous à l’enfant une science que nous ne possédons pas nous-mêmes ?
– Ma fille, répliquait le vieillard, il existe, tu le sais, des hommes qui ont pour métier d’instruire la jeunesse.
– Il n’en existe pas chez nous, objectait ma mère en me serrant dans ses bras.
– Aussi n’est-ce point chez nous que l’enfant recevra l’éducation dont il a soif, répondait le grand-père. Crois-moi, Phédime, nous devons, si son bien l’exige, nous résoudre à nous séparer de ce cher petit être, la joie de mon cœur comme du tien… Et s’il doit trouver le bonheur dans le savoir, il faut le lui donner, ma fille, quoi qu’il nous en puisse coûter… »
Ma mère pleurait ; mais ces entretiens, souvent renouvelés, portèrent peu à peu la conviction dans son âme… Elle eût désiré me faire instruire à la maison, sous ses yeux, pour ne point perdre de vue son trésor, tant elle me chérissait, ma pauvre mère !… Cependant Hilarion et Nicias, après de longues délibérations, conclurent en faveur de l’éducation publique.
Ils craignaient que l’éducation particulière développât en moi certains défauts. J’étais, ils l’avaient remarqué, trop enclin, – comme certains petits hommes de ma connaissance, – à l’arrogance, à l’orgueil, presque à la tyrannie, quelque soin qu’on eût pris de m’enseigner l’horreur de ces vices affreux.
Peut-être, à l’école, perdu au milieu de la troupe des enfants de mon âge, trouverais-je mon niveau, apprendrais-je mieux, en même temps que les arts libéraux, le peu d’importance de ma petite personne dans le vaste plan du Cosmos… Et puis, si on voulait former mon esprit, où me faire élever, sinon dans cette Athènes, brûlant flambeau du savoir humain, dont nous distinguions au loin le profil aérien, par les jours clairs ? N’étais-je pas en quelque sorte fils de la cité de Pallas, et ne devais-je pas sucer le lait de la science à son sein puissant ?… Après bien des hésitations et des pleurs, on résolut de me mettre en pension à Athènes.
Toutefois, les supplications de ma mère l’emportèrent sur la résolution de Nicias : on ne m’enverrait point au loin, dès ma cinquième année accomplie, âge auquel commence habituellement chez nous l’éducation scolaire. On attendrait que j’eusse atteint ma dixième année ; mais, afin que je ne fusse pas alors en retard sur mes camarades, mon aïeul se chargerait, dès à présent, de m’enseigner les éléments : l’alphabet, les premières opérations de l’arithmétique, et même les principes initiaux du chant… Pour la flûte, devenue de rigueur à cette époque dans toute éducation soignée, personne à la maison ne pouvait me l’enseigner, et force serait de laisser venir le moment où on me placerait à Athènes.
C’est donc en compagnie de mon grand-père que je fis le premier pas dans le sentier ardu de l’étude ; sa main tremblante traçait, sur la cire molle des tablettes, les lettres de l’alphabet. Je les étudiais longuement, puis il les effaçait, et, les retraçant au hasard, il me demandait de les reconnaître. Souvent je me trompais et je trépignais alors d’impatience ; mais quelle joie si je devinais juste !… Quand je connus mes lettres, il m’enseigna les syllabes, – avec quelle patience, le cher vieillard !… Il usa, pour me les mettre en tête, de cette strophe ingénieuse qu’on trouve, me disait-il, dans une comédie du poète athénien Callias. Vous la connaissez, mes enfants.
Et le pédagogue commença sur un ton de mélopée :
Mais les deux enfants, sautant debout, joignirent leurs fraîches voix à la sienne, formant un accord parfait, et tous trois ils répétèrent cette espèce de strophe, qu’aujourd’hui encore redisent leurs successeurs sur la machine ronde :
Amyntas, égayé, continua même à chanter de sa voix perçante, en reprenant le chemin du palais.
pendant que Perdiccas criait à tue-tête sur un autre ton :
et que le précepteur, souriant de leur zèle, hochait la tête en mesure.
« Et l’arithmétique ? demandait Amyntas le lendemain ; ton grand-père te l’enseigna-t-il aussi telle que tu me l’as montrée ?…
– Sans doute, répliqua le pédagogue. Les méthodes qui nous viennent des anciens sont les meilleures, crois-le bien, Amyntas, et nous ne saurions les faire progresser en les changeant. Ainsi que vous, je débutai en comptant sur mes doigts, puis j’appris à me servir de cailloux que je ramassais sur la grève et je commençai à répéter à haute voix : “Un et un font deux. Deux et deux font quatre. Trois et trois font six, etc. ” Tant que j’étudiai sous mon aïeul, je ne me servis jamais de la table de Pythagore, avec laquelle je fis connaissance à Athènes seulement. Mais je reçus de Nicias, au sixième anniversaire de ma naissance, une abaque semblable à celle que vous connaissez bien, enfants, et que tu égares trop souvent, Perdiccas !… La mienne était une simple planchette de bois blanc sur laquelle les divisions séparant les divers ordres d’unités étaient tracées en couleur rouge, plaisante à l’œil et facile à distinguer, même pour la vue affaiblie du vieillard : de petits jetons formés de la mère de la perle me servaient à figurer telle ou telle valeur, selon la place qu’ils occupaient ; j’avais, comme presque tous mes compatriotes de l’Attique, le goût le plus vif pour le calcul, et c’était de toutes mes leçons celle que je préférais. Point n’était besoin que grand-père s’inspirât, pour me l’enseigner, des subterfuges recommandés par le divin Platon dans sa République :
On n’aurait, dit-il, pour rendre cet enseignement moins aride, qu’à s’inspirer des calculs qu’inventent eux-mêmes les enfants, et qui consistent, soit à partager également tantôt entre plus, tantôt entre moins de leurs camarades, un certain nombre de pommes ou de couronnes, soit à s’attribuer successivement par la voie du sort, dans leurs exercices de lutte ou de pugilat, les rôles de lutteur pair ou impair ; soit à mêler ensemble en se jouant les phiales d’or, d’argent, de bronze ou de quelque autre matière, puis à les répartir comme il vient d’être dit…
– Ce que tu disais d’abord, interrompit Perdiccas, me paraît un excellent système, et je veux bien, moi, apprendre l’arithmétique par le pugilat !…
– Patience !… patience !… répondit le pédagogue, tu apprendras toutes ces choses en temps et lieu, ne crains point !… Mais tu m’as interrogé trop tôt sur l’arithmétique, Amyntas, avant de l’aborder, j’avais commencé les éléments de l’écriture ; Platon, dans sa République, assigne le terme de trois ans pour savoir lire, écrire et compter. Dès ma sixième année, mon grand-père avait guidé ma main malhabile sur la tablette de cire ; armés d’un roseau taillé, mes doigts rebelles cherchaient à suivre les contours légèrement tracés par le vieillard ; c’est là ce qui me donna le plus de peine. Souvent, de dépit, je brisais le roseau, je jetais loin de moi les tablettes… mais le visage attristé du bon aïeul me faisait honte de ma violence et, tout penaud, je reprenais mes outils, m’efforçant de mieux faire cette fois…
– Alors, dit Perdiccas très amusé, tu étais indocile aussi, toi, pédagogue ?
– Crois-tu donc que je sois né tel que tu me vois, avec cette barbe et ce bâton ?… Non, Perdiccas, j’étais alors un enfant libre comme toi, avec les défauts de l’enfance, et ce n’est pas sans de nombreuses corrections que je m’en suis guéri.
– N’y pense plus, dit avec douceur Amyntas. Retrace-nous plutôt les jours heureux que tu passas sous le toit paternel… Qui sait ? Peut-être reviendront-ils un jour !…
– Tu as raison, cher enfant ! l’espérance resta seule au fond de la boîte de Pandore, quand tout le reste s’en échappa… Et chez moi, pauvre captif, exilé que je suis, elle survit… Elle survit malgré tout !… Je ne veux pas désespérer de revoir les nobles plaines de l’Attique, sa mer et son ciel d’azur, de respirer une fois encore cet air léger et sain, qui prête aux plus communs objets une beauté presque surnaturelle… Doux pays !… ton souvenir me soutient, au milieu des tristesses de la décadence physique et de l’exil… »
Un instant le précepteur s’absorba dans ses douloureuses réflexions. Perdiccas lui-même, touché de sa mélancolie, se taisait ; mais bientôt relevant la tête, Proas reprit :
Notre famille s’était augmentée, au cours des dix années que je passai à me préparer à l’école. Deux jeunes frères jumeaux, une petite sœur nous étaient nés. Phédime, absorbée par les soins de ses jeunes enfants, voyait avec plus de résignation approcher le moment où il faudrait se séparer de moi. Pour ma part, j’attendais non sans une joyeuse impatience le temps de m’envoler hors du nid familial. Il me semblait que je serais déjà presque un éphèbe du jour où je me trouverais lancé seul dans la grande ville !… Jamais encore je n’y étais entré. Qu’il me tardait de voir par mes yeux toutes les merveilles de l’art, tous les glorieux monuments que nos immortels ancêtres y ont accumulés ! Je ne me lassais point d’interroger mon grand-père sur ce que je verrais à Athènes. Et lui, infatigable, ne se lassait point de répondre à mes questions. Souvent, assis au bord de la mer, il me traçait de son bâton, sur le sable, le plan de la noble cité. Au centre, l’Acropole, forteresse sacrée à laquelle on accède par les Propylées. Là s’élève la colossale statue de Minerve aux yeux bleus, la déesse de la sagesse, dont l’égide protège la ville. Toutes les régions de l’Attique sont sous sa protection, mais on peut dire qu’elle a véritablement élu domicile dans la citadelle. Que de statues, que d’édifices, d’autels, de temples, lui sont consacrés !… Le Parthénon !… à ce nom seul je sentais mon cœur battre d’impatience, tant j’avais soif de contempler par mes yeux les miracles dus au génie de nos artistes, et que si souvent Hilarion m’avait décrits. Bien avant de les voir, je connaissais ces métopes impérissables, retraçant le combat des Centaures et des Lapithes. J’admirais les majestueux degrés du temple, où se déroulait, aux époques consacrées par l’usage, la gracieuse théorie des jeunes filles, couronnées de fleurs, apportant à la déesse les prémices de leurs riantes campagnes ; j’aspirais au moment où mes yeux seraient éblouis pour la première fois par la glorieuse image d’ivoire et d’or, où je sentirais se fixer sur moi l’œil étincelant de la fille de Zeus. Ô déesse au regard de saphir !… qu’il me tardait de pénétrer dans ton temple, et de sentir que moi aussi j’étais un de tes enfants privilégiés !…
Et l’Agora, où tant de bouches glorieuses s’étaient ouvertes pour laisser tomber les flots de l’immortelle éloquence !… Et la palestre, où plus tard, mes membres assouplis me gagneraient peut-être, à moi aussi, une couronne, où je sentirais se poser sur mon front ce rameau d’olivier plus précieux aux fils de la Grèce qu’un diadème de pierreries… Et le Lycée, les Portiques, réservés aux sages, et le peuple innombrable des statues, les hermès souriants, les Hercules déifies, les guerriers, les orateurs, tous ceux qui ont fait ma patrie si grande… Et encore la joie de me mêler à la foule, de vivre de son intense vie, moi le pauvre petit rat des champs, qui n’avais jamais, les dieux me pardonnent !… parlé à plus de huit ou neuf étrangers dans ma courte existence !…
Enfin mes dix ans sonnèrent. C’était l’époque où mes parents avaient résolu de se séparer de moi. Après bien des irrésolutions et des recherches, Nicias avait décidé de me placer chez Lysis, maître d’une école célèbre. Mais la plus grande difficulté était de savoir en quel lieu on m’installerait pour vivre, en dehors de l’école, que je devais fréquenter seulement aux heures de classe. Voulant être certain de la moralité et de la bienveillance de ceux qui me recevraient sous leur toit, mon père était resté longtemps indécis. Le grand-père se rendit avec lui à Athènes. Ils consultèrent leurs amis, s’informèrent avec soin, et enfin eurent le bonheur d’être adressés à une famille modeste, habitant presque à la porte de l’école de Lysis, où je serais reçu avec joie, où mon jeune cœur ne trouverait que soins maternels et bons exemples.