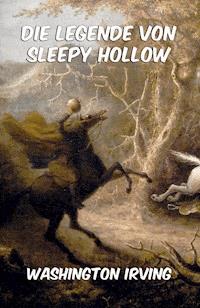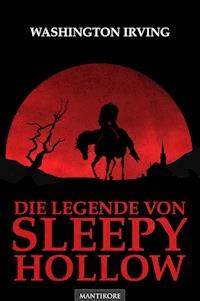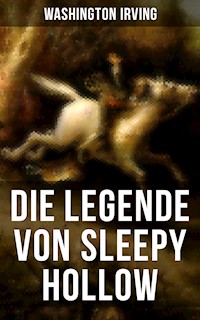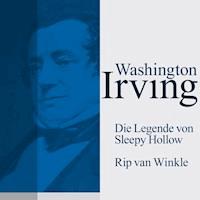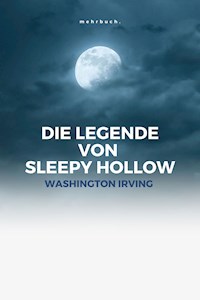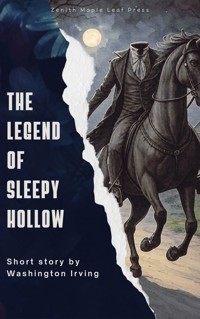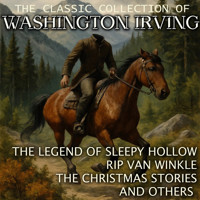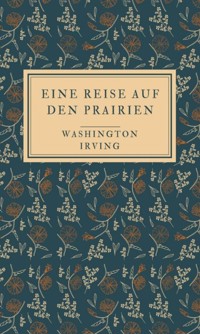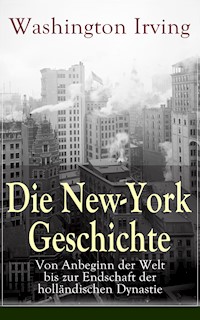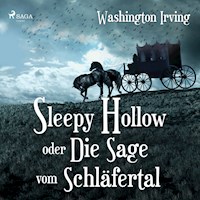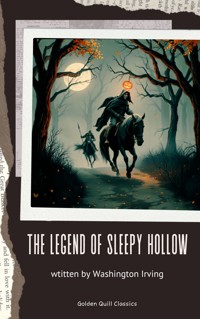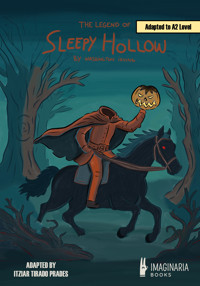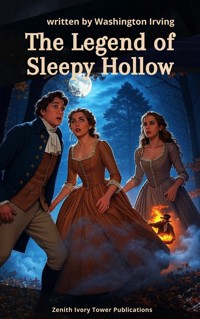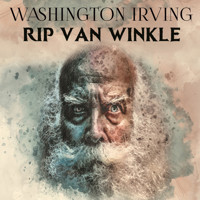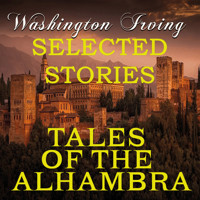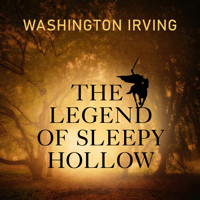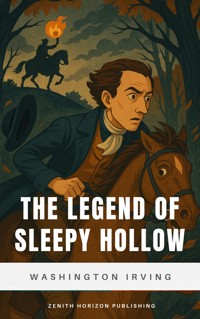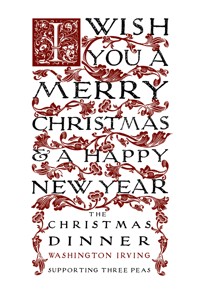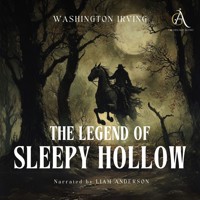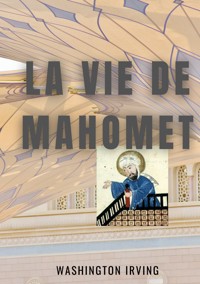
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "La vie de Mahomet" de Washington Irving est une exploration détaillée de la vie du prophète Mahomet, fondateur de l'islam. Ce livre s'attache à retracer les événements marquants de sa vie, depuis sa naissance à La Mecque jusqu'à sa mort. Irving, connu pour sa rigueur historique, s'appuie sur des sources anciennes pour dépeindre un portrait nuancé de Mahomet, en abordant ses enseignements, ses batailles, et ses relations politiques et sociales. L'auteur met en lumière les défis auxquels Mahomet a été confronté, notamment les résistances initiales à sa prédication. Le livre examine également l'impact durable de Mahomet sur l'Arabie et le monde musulman, offrant une perspective historique précieuse pour comprendre la montée de l'islam. Grâce à une écriture claire et précise, Irving parvient à rendre accessible une période complexe de l'histoire, tout en respectant les sensibilités culturelles et religieuses. "La vie de Mahomet" est une lecture essentielle pour ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de l'islam et de ses origines. __________________________________________ BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR : Washington Irving, né le 3 avril 1783 à New York, est un écrivain et historien américain renommé, souvent considéré comme l'un des premiers auteurs professionnels des États-Unis. Il est surtout connu pour ses oeuvres de fiction telles que "La Légende de Sleepy Hollow" et "Rip Van Winkle". Irving a également marqué le domaine de l'histoire avec ses biographies et ses essais. Son intérêt pour l'histoire et les cultures étrangères l'a conduit à vivre en Europe pendant plusieurs années, notamment en Espagne, où il a écrit des ouvrages sur Christophe Colomb et l'Alhambra. En tant que diplomate, Irving a servi comme ambassadeur des États-Unis en Espagne de 1842 à 1846. Son style littéraire, caractérisé par une prose élégante et un sens aigu du détail, a influencé de nombreux écrivains américains. Irving est décédé le 28 novembre 1859 à Tarrytown, New York, laissant derrière lui un héritage littéraire et historique durable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Être fidèle au sens de l’original, en reproduire les formes, et ne pas choquer le goût dans la langue où l’on écrit ; voilà ce que l’on demande à un traducteur.
Je me suis efforcé de ne pas perdre de vue cette triple obligation, mais je n’ai pas la prétention d’avoir complètement réussi.
Ce livre a un mérite : ce n’est pas un livre de controverse. Il fut composé par un homme éclairé, déjà célèbre comme romancier et historien, et préparé à cette tâche par les recherches qu’avaient nécessitées la Chronique de la conquête de Grenade et les Légendes de l’Alhambra, dans le but de donner aux Américains une juste idée du caractère du fondateur de l’Islamisme. Il raconte sur Mahomet ce que l’on sait être vrai et les légendes que l’imagination orientale a enfantées à son sujet ; ce qui nous permet à la fois d’asseoir notre jugement sur l’homme et de comprendre ce qu’est le prophète pour ses sectateurs.
Je n’ai pas à défendre la conclusion à laquelle arrive Washington Irving : la croyance de Mahomet dans sa mission prophétique. Le lecteur a devant les yeux les pièces du procès ; c’est à lui de décider si cette conclusion est ou non admissible.
Voltaire, qui enveloppait dans un même dédain toutes les questions religieuses, pense que Mahomet était un imposteur de génie. Il lui a prêté une pénétration, une ambition et une étendue de vues que W. Irving lui dénie.
Avant lui, Bossuet avait tracé de l’homme qui rappelle le mieux Mahomet, de Cromwell, un portrait fort brillant, que M. Guizot a démontré plus tard être faux de tout point.
Si la lecture de ce livre fait déchoir Mahomet dans l’esprit des politiques profonds, peut-être lui vaudra-t-elle les sympathies de ceux qui placent la conviction avant le calcul, le but avant le succès.
Table des matières
I — Notice préliminaire sur l’Arabie et les Arabes
II — Naissance et famille de Mahomet — Son enfance
III — Traditions concernant la Mecque et la Kaaba
IV — Premier voyage de Mahomet avec la caravane allant en Syrie
V — Occupations commerciales de Mahomet, — son mariage avec Kadichah
VI — Conduite de Mahomet après son mariage — Il rêve une réforme religieuse — Ses habitudes d’abstraction solitaire — La vision de la caverne — Son annonciation comme prophète
VII — Mahomet inculque ses doctrines secrètement et lentement — Il reçoit d’autres révélations et de nouveaux ordres — Il annonce sa mission à ses parents — De quelle façon on le reçoit — Enthousiaste dévouement d’Ali — Sinistres présages chrétiens
VIII — Quelques mots sur la foi musulmane
IX — Ridicule jeté sur Mahomet et ses doctrines — Demandes de miracles — Conduite d’Abou-Taleb — Violence des Koreischites — Rokaia, fille de Mahomet, se réfugie en Abyssinie avec son oncle othman et quelques disciples — Mahomet dans la maison d’Orkham — Animosité d’Abou-Jarl — Sa punition
X — Omar-Ibn-Al-KhattÂB, neveu d’Abou-Jahl, entreprend de venger son oncle en tuant Mahomet — Son étonnante conversion — Mahomet cherche un refuge dans le château d’Abou-Taleb — Abou-Sofian à la tête de la branche rivale des Koreischites, persécute Mahomet et ses adhérents — Obtient contre eux un décret de mise au ban — Mahomet quitte sa retraite et fait des conversions pendant le mois de pèlerinage — Légende de la conversion d’Habib-le-sage
XI — Le ban d’interdiction mystérieusement détruit — Mahomet peut retourner à la Mecque — Mort d’Abou-Taleb ; de Kadichah — Mahomet se fiance à Aiescha — Il épouse Sada — Les Koreischites renouvellent leur persécution — Mahomet cherche un asile à Tayef — Il en est expulsé — Il est visité par des génies dans le désert de Naklam
XII — Voyage de nuit du prophète de la Mecque à Jérusalem ; puis aux sept ciels
XIII — Mahomet convertit des pèlerins de Médine — Il prend la résolution de se réfugier dans cette ville — Complot pour le tuer — Il y échappe miraculeusement — Son hégire ou fuite — Sa réception à Médine
XIV — Les Musulmans à Médine — Mohadjerins et Ansariens — Le parti d’Abdallah-Ibn-Obba et les hypocrites — Mahomet bâtit une mosquée ; prêche ; fait des conversions parmi les chrétiens — Lenteur des Juifs à croire — Fraternité établie entre les fugitifs et les alliés
XV — Mariage de Mahomet avec Aiescha — De sa fille Fatimeh avec Ali — Leur intérieur
XVI — L’épée annoncée comme l’instrument de la foi — Première incursion contre les Koreischites — Surprise d’une caravane
XVII — Bataille du Bedr
XVIII — Mort de la fille du prophète Rokaia — Sa fille Zeinab lui est rendue — Effets de la malédiction du prophète sur Abou-Lahab — Rage frénétique de Henda femme d’Abou-Sofian, Mahomet échappe miraculeusement à un assassinat, — Ambassade des Koreischites — Le roi d’Abyssinie
XIX — Pouvoir croissant de Mahomet — Son ressentiment contre les Juifs — Insulte faite à une jeune arabe par la tribu juive de Kainoka — Tumulte — Les Beni-Kainoka se réfugient dans leur château — Vaincus et punis de confiscation et de bannissement — Mariage d’Othman avec la fille du prophète, Omm-Colthum, et du prophète avec Hafza
XX — Henda excite Abou-Sofian et les Koreischites à venger la mort de leurs parents tués à la bataille du Bedr — Les Koreischites se mettent en mouvement, suivis par Henda et ses compagnes — Bataille d’Ohod — Horrible triomphe de Henda — Mahomet se console en épousant Hend, fille d’Omeya
XXI — Trahison de certaines tribus juives ; leur punition — Dévouement de l’affranchi Zeid ; il divorce d’avec Zeinab pour qu’elle puisse devenir femme du prophète
XXII — Expédition de Mahomet contre les Beni-Mostalek — Il épouse Barra, une captive — Trahison d’Abdallah-Ibn-Obba — Aiescha diffamée — Sa justification — Son innocence prouvée par une révélation
XXIII — Bataille du fossé — Bravoure de Saad-Ibn-Moad — Défaite des Koreischites — Prise du château juif de Koraida — Saad décide quel sera le châtiment des Juifs — Mahomet épouse Réhana, captive juive — Sa vie mise en péril par un sortilège ; sauvée par une révélation de l’ange Gabriel
XXIV — Mahomet entreprend un pèlerinage à la Mecque — Il échappe à Khaled et à une troupe de cavaliers envoyés contre lui — Campe près de la Mecque — Négocie avec les Koreischites pour obtenir la permission d’entrer et de compléter son pèlerinage — Traité pour dix ans qui lui permet de faire une visite annuelle de trois jours — Il retourne à Médine
XXV — Expédition contre la ville de KhaÏBar — Siège — Exploits des capitaines de Mahomet — Combat d’Ali et de Marhab — Assaut donné à la citadelle — Ali se fait un bouclier d’une porte — Mahomet empoisonné ; il épouse Safiya, une captive, et Omm-Habiba, une veuve
XXVI — Mahomet envoie des ambassades auprès de différents princes ; à Héraclius ; à Chosroës II ; au préfet d’Égypte — Leur résultat
XXVII — Pèlerinage de Mahomet à la Mecque ; son mariage avec Maimuna — Kaled-Ibn-Waled et Amrou-Ibn-Aass se convertissent
XXVIII — Un envoyé musulman tué en Syrie — Expédition pour venger sa mort — Bataille de Mouta — Ses résultats
XXIX — Projets de Mahomet sur la Mecque — Mission d’Abou-Sofian — Son résultat
XXX — Mahomet s’empare de la Mecque par surprise
XXXI — Hostilités dans les montagnes — Camp de l’ennemi dans la vallée d’Autas — Bataille au défilé d’Honein — Prise du camp ennemi — Entrevue de Mahomet avec sa nourrice — Partage du butin — Mahomet au tombeau de sa mère
XXXII — Mort de Zeinab, la fille du prophète — Naissance de son fils Ibrahim — Députations venues de tribus éloignées — Combien Mahomet était sensible aux charmes de la poésie — Soumission de la ville de Tayef ; destruction de ses idoles. Négociations avec Amir-Ibn-Tafiel, Orgueilleux chef bédouin : caractère indépendant de ce dernier — Entrevue d’Adi, autre chef, avec Mahomet
XXXIII — Préparatifs d’une expédition contre la Syrie — Intrigues d’Abdallah-Ibn-Obba — Contributions des fidèles — Marche de l’armée — La région maudite d’Hedjar — L’armée campe à Tabouk ; soumission des provinces circonvoisines — Khaled surprend Okaider et son château — Retour de l’armée à Médine
XXXIV — Entrée triomphale de Mahomet à Médine — Punition de ceux qui avaient refusé de se joindre à l’expédition — Effets de l’excommunication — Mort d’Abdallah-Ibn-Obba — Dissensions dans le harem du prophète.
XXXV — Abou-Bekr conduit les pèlerins à la Mecque — Mission d’Ali pour annoncer une révélation
XXXVI — Mahomet emploie ses capitaines dans des entreprises éloignées — Désigne des lieutenants pour gouverner l’Arabie heureuse — Envoie Ali réprimer une insurrection dans cette province — Mort du seul fils du prophète, Ibrahim — Conduite de Mahomet auprès du lit de mort et du tombeau — Ses infirmités croissantes — Son pèlerinage d’adieu à la Mecque ; sa conduite et ses prédications pendant son séjour dans cette ville
XXXVII — Des deux faux prophètes, Al-Asouad et Moseilma
XXXVIII — L’armée est prête à marcher contre la Syrie — Commandement donné à Osama — Adieux du prophète aux troupes — Sa dernière maladie — Ses sermons dans la mosquée — Sa mort ; circonstances qui l’accompagnent
XXXIX — Portrait de Mahomet — Considérations sur sa carrière prophétique
I NOTICE PRÉLIMINAIRE SUR L’ARABIE ET LES ARABES
Durant une longue succession de siècles, s’étendant depuis la période la plus éloignée qu’enregistre l’histoire jusqu’au septième siècle de l’ère chrétienne, cette grande Chersonèse ou péninsule formée par la mer Rouge, l’Euphrate, le golfe Persique et l’océan Indien, et connue sous le nom d’Arabie, ne subit aucun changement, et ne fut presque pas affectée par les événements qui bouleversèrent le reste de l’Asie et ébranlèrent, jusqu’en leurs fondements, l’Europe et l’Afrique. Pendant que des royaumes et des empires s’élevaient et croulaient, que les anciennes dynasties disparaissaient, que les limites et les noms des pays étaient changés, et leurs habitants exterminés ou emmenés captifs, l’Arabie, quoique ses provinces frontières éprouvassent quelques vicissitudes, conserva dans la profondeur de ses déserts, son indépendance et son caractère primitifs, et jamais ses tribus nomades ne courbèrent leurs têtes altières sous le joug de la servitude.
Les Arabes font remonter les traditions de leur pays à la plus haute antiquité. Il fut peuplé, disent-ils, aussitôt après le déluge, par les descendants de Sem, fils de Noé, qui graduellement formèrent diverses tribus, dont les plus connues sont les Adites et les Thamudites. Toutes ces tribus primitives auraient été balayées de la surface de la terre en punition de leurs iniquités, ou auraient disparu dans les modifications postérieures des races, de sorte qu’il ne reste, en ce qui les concerne, rien que d’obscures traditions et quelques passages du Coran. Elles sont parfois mentionnées dans l’histoire de l’Orient, comme « les vieux Arabes primitifs, » « les tribus perdues. »
Le peuplement définitif de la Péninsule est attribué, par les mêmes autorités, à Kahtan ou Jectan, descendant de Sem à la quatrième génération. Sa postérité se répandit sur la partie méridionale de la Péninsule et le long de la mer Rouge. Jarab, un de ses fils, fonda le royaume d’Yémen, où il donna son nom au territoire d’Araba, d’où dérivent ceux d’Arabe et d’Arabie, Jurham, autre fils de Jectan, fonda le royaume de Hedjaz, sur lequel ses descendants régnèrent pendant plusieurs générations. Ceux-ci reçurent avec bonté Agar et son fils Ismaël, quand ils furent exilés par le patriarche Abraham. Plus tard, Ismaël épousa la fille de Modad, prince régnant de la famille de Jurham. Ainsi un étranger, un hébreu, s’enta sur la vieille souche arabe. Ce fut une greffe vigoureuse : la femme d’Ismaël lui donna, douze fils, qui s’emparèrent de l’autorité dans le pays et dont la race prolifique, divisée en douze tribus, chassa ou absorba la race primitive de Jectan.
Tel est le récit que font de leur origine les Arabes de la Péninsule,1 et les écrivains chrétiens le citent comme contenant l’accomplissement du pacte de Dieu avec Abraham, ainsi qu’on le trouve dans les Saintes Écritures : « Abraham dit à Dieu : Je te prie qu’Ismaël vive devant toi ! et Dieu dit : Je t’ai exaucé touchant Ismaël ; voici, je l’ai béni, je le ferai croître et multiplier très abondamment. Il engendrera douze princes et je le ferai devenir une grande nation. » (Genèse, XVII — 18, 20.)
Ces douze princes, avec leurs tribus, sont encore mentionnés dans les Écritures (Genèse XXV, 18), comme occupant le pays qui s’étend « d’Havila jusqu’à Sur, qui est vis-à-vis de l’Égypte, quand on vient d’Assyrie, » et que les géographes sacrés regardent comme une partie de l’Arabie. La description de ces tribus s’accorde avec celle que l’on fait des Arabes de nos jours. On les représente : quelques-uns comme habitant des villes et des châteaux ; d’autres comme vivant sous des tentes ou dans des villages au milieu du désert. Nébajoth et Kédar, les deux aînés d’Ismaël, sont très célèbres parmi les princes pour leurs richesses en gros et menu bétail, et la beauté de la laine de leurs moutons. De Nébajoth descendirent les Nabathéens qui habitaient l’Arabie Pétrée ; pendant que le nom de Kédar est quelquefois employé dans l’Écriture Sainte pour désigner la nation Arabe tout entière. « Malheur à moi, dit le Psalmiste, qui séjourne dans Mesech, qui vis sous les tentes de Kedar. » Tous deux paraissent avoir été les ancêtres des Arabes errants ou pasteurs, les francs pirates du désert. « L’opulente nation, dit Jérémie, qui vit sans soucis ; qui n’a ni portes ni barreaux, qui vit isolée. »
Une grande différence se fit remarquer dès les temps les plus reculés entre les Arabes qui « possédaient des villes et des châteaux, » et ceux qui « vivaient sous des tentes. » Quelques-uns des premiers occupaient les fertiles wadies, ou vallées, qui se rencontrent çà et là dans les montagnes, où ces villes et châteaux étaient entourés de vignes et de vergers, de bosquets, de palmiers, de champs de blé et de pâturages bien peuplés. Ils avaient des habitudes sédentaires, s’adonnant à la culture du sol et à l’élève du bétail.
D’autres de cette classe pratiquaient le commerce, auquel les invitaient leurs ports et leurs villes, situés le long de la mer Rouge, le long des côtes méridionales de la Péninsule et du golfe Persique, et se servant à cet effet de navires et de caravanes. Tel était surtout le peuple de l’Yémen, ou Arabie Heureuse, cette terre des épices, des parfums et de l’encens, la Sabée des poètes, la Saba des Écritures sacrées. Ils étaient comptés parmi les plus actifs navigateurs des mers d’Orient. Leurs navires rapportaient sur leurs rivages la myrrhe et les baumes recueillis sur la côte opposée, avec l’or, les épices et d’autres riches marchandises de l’Inde et de l’Afrique tropicale. Tout cela, joint aux produits de leur propre territoire, était transporté par des caravanes, à travers les déserts, aux états semi-arabes d’Ammon, de Moab, d’Édom ou d’Idumée, et aux ports phéniciens de la Méditerranée, puis de là, distribué dans le monde occidental.
Le chameau a été appelé le navire du désert ; on pourrait dire que la caravane en est la flotte. Les caravanes de l’Yémen étaient généralement équipées, armées et protégées par les Arabes nomades, auxquels l’on pourrait donner le nom de navigateurs du désert. Ils fournissaient les innombrables chameaux nécessaires, et contribuaient aussi au chargement par les belles toisons de leurs immenses troupeaux. Les écrits des prophètes nous montrent l’importance, aux temps bibliques, de cette chaîne commerciale intérieure qui reliait les riches contrées du Sud : l’Inde, l’Éthiopie et l’Arabie Heureuse, à l’ancienne Syrie.
Ézéchiel, dans ses lamentations sur Tyr, s’écrie : Les Arabes et tous les principaux de Kédar ont été des marchands que tu avais en ta main, trafiquant avec toi, en agneaux, en moutons et en boucs. Les marchands de Séba et de Rahma ont été tes facteurs, faisant valoir tes foires en toutes sortes de drogues les plus exquises, en toutes sortes de pierres précieuses et en or. Haran et Canne et Héden et les marchands de Séba, d’Assyrie et de Chelmad étaient tes marchands ! »
Et Isaïe parlant à Jérusalem dit :
« Une abondance de chameaux te couvrira : les dromadaires de Madian et de Népha, et tous ceux de Séba viendront ; ils apporteront de l’or et de l’encens. Toutes les brebis de Kédar seront assemblées vers toi ; les moutons de Nébajoth seront pour ton service. » (Isaïe XL. — 6-7.)
Les Arabes agriculteurs et commerçants, les habitants des villes n’ont jamais été considérés comme le type de la race. Ils s’amollirent par des occupations sédentaires et paisibles, et perdirent beaucoup de leur caractère original par leurs relations avec les étrangers. L’Yémen, en outre, étant plus accessible que les autres parties de l’Arabie, et offrant une plus grande tentation aux spoliateurs, avait été plusieurs fois envahi et soumis.
Ce fut dans l’autre catégorie d’arabes, les pillards du désert, les « habitants des tentes », de beaucoup la plus nombreuse, que le caractère national conserve toute sa force et toute sa fraîcheur. Nomades dans. leurs habitudes, pasteurs dans leurs occupations, et connaissant d’expérience et de tradition les ressources cachées du désert, ils menaient une vie errante, allant d’un endroit à un autre, en quête de ces puits et de ces fontaines qui avaient été le rendez-vous de leurs pères depuis l’époque des patriarches ; campant partout où ils pouvaient trouver des dattiers pour s’abriter, et des pâturages pour leurs troupeaux ; puis changeant de résidence aussitôt que ces ressources temporaires étaient épuisées.
Ces Arabes nomades étaient divisés et subdivisés en une quantité innombrable de petites tribus ou familles, chacune avec son Cheik ou Émir, le représentant du patriarche d’autrefois, et dont la lance, plantée à côté de sa tente, était l’insigne du commandement. Sa dignité, cependant, quoiqu’elle se transmît pendant des générations dans la même famille, n’était pas strictement héréditaire, mais dépendait du bon plaisir de la tribu. Il pouvait être déposé et remplacé par quelqu’un d’une ligne différente. Son pouvoir était limité et mesuré à son mérite personnel et à la confiance qu’il inspirait. Ses prérogatives consistaient à conduire les négociations pour la paix et la guerre, à commander la tribu devant l’ennemi, à choisir le lieu du campement, à recevoir et traiter les étrangers de distinction. Mais dans l’exercice de ces privilèges et autres semblables, il devait tenir compte de l’opinion et des désirs de son peuple.2
Quel que fût le nombre des subdivisions d’une tribu, les diverses sections avaient toujours présents à l’esprit les liens qui les unissaient. Tous les Cheiks d’une même tribu reconnaissaient un chef commun, appelé le Cheik des Cheiks, qui, caché dans un château bâti dans des rochers, ou campé dans le désert au milieu de ses troupeaux, pouvait appeler autour de son étendard toutes les branches de cette tribu, chaque fois que cela était nécessaire au bien-être de la communauté.
La multiplicité de ces tribus errantes, chacune avec son petit prince et son petit territoire, mais sans chef national, produisait de fréquentes collisions. La vengeance, en outre, était presque un principe de religion. Venger un parent tué était le devoir de sa famille, et engageait souvent l’honneur de sa tribu ; et ces dettes de sang restaient quelquefois des générations sans se régler, produisant des haines mortelles.
La nécessité d’être toujours sur le qui-vive pour défendre ses troupeaux familiarisait, dès son enfance, l’Arabe du désert avec l’usage des armes. Personne ne savait mieux que lui tirer de l’arc, manier la lance ou le cimeterre ; nul n’était aussi adroit et aussi gracieux dans les exercices d’équitation. C’était, en plus, un guerrier adonné au pillage, car, quoiqu’il s’engageât parfois au service du marchand, lui fournissant des guides, des chameaux et des conducteurs pour le transport de ses marchandises, il était plus enclin à lever une contribution sur la caravane ou à la piller à fond dans son pénible voyage à travers le désert. Tout cela, il le regardait comme un emploi des armes très licite, tenant les heureux enfants du trafic pour une race inférieure, dégradée par des habitudes et des préoccupations sordides.
Tel était l’Arabe du désert, l’habitant des tentes, en qui s’accomplissait la destinée prophétique de son ancêtre Ismaël. « Ce sera un homme sauvage ; sa main sera tournée contre tous, et la main de tous sera tournée contre lui. » (Genèse, XVI. 12). La nature l’avait fait exprès pour ce genre de vie. Son corps souple et grêle, mais nerveux et robuste, pouvait supporter les fatigues et les privations les plus grandes. Il était sobre et même abstème, n’ayant besoin que de fort peu de nourriture, et encore de l’espèce la plus simple. Son esprit était, comme son corps, vif et agile. Il possédait au plus haut degré les attributs intellectuels de la race sémitique : la sagacité, la finesse, la conception rapide et l’imagination brillante. Ses sensations étaient vives et profondes, quoique peu durables. La fierté et l’audace se lisaient sur son blême visage, et l’étincelle jaillissait de son grand œil noir. Il était facile à entraîner par les appels de l’éloquence et à charmer par les grâces de la poésie. Parlant une langue abondante à l’excès, et dont les mots ont été comparés aux joyaux et aux fleurs, il était naturellement orateur, mais il avait plus de goût pour les proverbes et les apophtegmes que pour les discours soutenus, et aimait à traduire ses idées, à la façon orientale, par l’apologue et la parabole.
Ce guerrier turbulent et pillard n’était pas moins brave et hospitalier. Il se plaisait à faire des cadeaux ; sa porte était toujours ouverte au voyageur, avec lequel il était prêt à partager son dernier morceau ; et son plus mortel ennemi, quand il avait rompu le pain avec lui, pouvait reposer en toute sûreté sous l’inviolable asile de la tente.
Les Arabes, dans ce qu’ils appellent les jours d’ignorance, étaient partagés en deux religions principales : celle des Sabéens et celle des Mages, qui dominaient alors dans le monde oriental. La Sabéenne, cependant, était celle qui comptait le plus d’adhérents. Ceux-ci prétendaient la tenir d’un fils de Seth, Sabi, qu’ils supposaient être enterré, avec son père et son frère Enos, dans les Pyramides. D’autres font dériver ce nom du mot hébreu Saba, ou les étoiles, et font remonter l’origine de la foi aux pasteurs Assyriens qui, veillant de nuit leurs troupeaux sur leurs plaines unies et sous un ciel sans nuages, notèrent l’apparition et les phénomènes des corps célestes, et formèrent une théorie de leurs bonnes ou mauvaises influences sur les affaires humaines ; vagues notions dont les philosophes et les prêtres Chaldéens firent un système que l’on croit plus ancien que celui même des Égyptiens.
D’autres la faisaient venir de bien plus haut, et réclamaient pour elle l’honneur d’avoir été la religion du monde antédiluvien. Elle survécut, disaient-ils, au déluge, et se continua parmi les patriarches. Elle fut enseignée par Abraham, adoptée par ses descendants, les enfants d’Israël, sanctifiée et confirmée dans les tables de la loi remises à Moïse sur le mont Sinaï, au milieu des éclairs et du tonnerre.
À l’origine, la foi Sabéenne était pure et toute spirituelle, inculquant la croyance en l’unité de Dieu, la doctrine d’un avenir de peines et de récompenses, et la nécessité d’une vie pure et sainte pour obtenir une heureuse immortalité. Le respect que les Sabéens portaient à l’Être suprême était si profond, qu’ils ne mentionnaient jamais son nom, et ne s’aventuraient à l’approcher que par l’intermédiaire des anges. Les anges étaient censés habiter et animer les corps célestes, absolument comme l’âme habite et anime le corps humain. Ils étaient placés dans leurs sphères respectives pour surveiller et gouverner l’univers, sous les ordres du Très-Haut. En s’adressant directement aux étoiles et autres luminaires célestes, les Sabéens ne les adoraient donc pas comme des divinités, mais cherchaient à obtenir de leurs angéliques habitants d’intercéder pour eux auprès de l’Être suprême, voyant, à travers ces choses créées, Dieu, le grand Créateur.
Peu à peu, cette religion perdit sa simplicité et sa pureté primitives, s’obscurcit de mystères, et fut dégradée par l’idolâtrie. Les Sabéens, au lieu de regarder les corps célestes comme le séjour d’agents intermédiaires, les adorèrent comme des divinités, érigèrent des statues en leur honneur dans des bosquets sacrés et d’obscures forêts, et à la fin, transportèrent ces idoles dans les temples, et les vénérèrent comme si elles eussent été distinctes de la divinité. Le Sabéisme subit, en outre, des changements et des modifications dans les diverses contrées où il s’était répandu. L’Égypte a été longtemps accusée de l’avoir réduit au dernier degré de la plus abjecte dégradation ; les statues, les hiéroglyphes et les sépulcres peints de ce mystérieux pays étant considérés comme les archives d’un culte rendu, non pas simplement aux intelligences célestes, mais aux animaux de l’ordre le plus bas, et même à des objets inanimés. Toutefois, les investigations et les recherches faites dans ces derniers temps lavent peu à peu de cette honte la nation la plus policée de l’antiquité, et à mesure qu’elles soulèvent lentement le voile de mystère qui recouvre les tombeaux d’Égypte, on reconnaît que ces objets d’une adoration apparente n’étaient que les symboles des attributs variés du seul Être suprême, dont le nom était trop sacré pour être prononcé par des mortels. Chez les Arabes, la foi Sabéenne fut bientôt mêlée de sauvages superstitions, et déshonorée par une grossière idolâtrie. Chaque tribu adorait son étoile ou sa planète, ou élevait son idole particulière. L’infanticide joignait ses horreurs à leurs rites religieux. Dans les tribus nomades, la naissance d’une fille était considérée comme un malheur ; son sexe la rendant de peu d’utilité pour une vie errante et de pillage, tandis qu’elle pouvait attirer le déshonneur sur sa famille, par son inconduite ou sa captivité. Une politique dénaturée se mêlait peut-être à leurs sentiments religieux, quand ils sacrifiaient des petites filles à leurs idoles, ou les enterraient vivantes.
La secte rivale des Mages ou Guèbres (adorateurs du feu), qui, comme nous l’avons dit, partageait avec le Sabéisme l’empire en Orient, prit naissance en Perse, où, après quelque temps, ses doctrines orales furent réunies en un corps écrit par son grand prophète et propagateur, Zoroastre, dans son volume du Zend-Avesta. Leur foi, comme celle des Sabéens, fut primitivement simple et spirituelle, inculquant la croyance en un Dieu suprême et éternel, en qui et par qui l’Univers existe ; elle enseignait que ce Dieu produisit par sa parole créatrice deux principes actifs : Ormuzd, le principe ou ange de lumière ou du bien, et Ahriman, le principe ou ange des ténèbres ou du mal ; que ceux-ci formèrent le monde d’un mélange de leurs éléments contraires, et sont entre eux en lutte continuelle pour le diriger. De là les alternatives de bien et de mal, selon que l’ange de lumière ou celui des ténèbres a le dessus : cette lutte continuera jusqu’à la fin du monde, époque à laquelle il y aura une résurrection générale et un jour de jugement ; l’ange des ténèbres et ses disciples seront bannis dans une demeure d’une obscurité affreuse, et leurs opposants entreront dans les royaumes bienheureux d’éternelle lumière.
Les rites primitifs de cette religion étaient extrêmement simples. Les Mages n’avaient ni temples, ni autels, ni symboles religieux d’aucune sorte, mais adressaient leurs prières et leurs hymnes directement à la divinité, dans ce qu’ils concevaient être son séjour : le Soleil. Ils révéraient ce luminaire comme étant sa demeure, et comme la source de la lumière et de la chaleur, dont tous les autres corps célestes sont composés ; et ils allumaient des feux sur le sommet des montagnes pour s’éclairer pendant son absence. Zoroastre introduisit le premier l’usage des temples, où le feu sacré, que l’on prétendait être descendu du ciel, était entretenu par le ministère de prêtres qui veillaient sur lui nuit et jour.
Dans le cours du temps, cette secte, comme celle des Sabéens, perdit de vue le principe divin dans le symbole, et en vint à adorer la lumière ou le feu, comme la Divinité réelle et abhorrer les ténèbres comme Satan ou le Diable. Dans leur zèle fanatique, les Mages s’emparaient des incrédules et les jetaient dans les flammes pour se rendre propice leur brûlante divinité.
C’est aux dogmes de ces deux sectes qu’il est fait allusion dans ce beau texte de la Sagesse de Salomon : « Sûrement bien fous étaient ces hommes qui ignoraient Dieu, et ne pouvaient pas, en considérant l’œuvre, reconnaître le maître de l’œuvre ; mais qui pensaient que le feu, ou le vent, ou l’air rapide, ou le cercle des étoiles, ou l’eau violente, ou les lumières du ciel, sont des dieux qui gouvernent le monde. »
De ces deux religions, comme nous l’avons déjà dit, la Sabéenne était de beaucoup la plus répandue parmi les Arabes, mais sous une forme extrêmement corrompue, mêlée d’abus de toute sorte, et variant avec les diverses tribus. Le Magisme prévalait chez celles qui, par leur position frontière, avaient des rapports fréquents avec la Perse, pendant que d’autres partageaient les superstitions et les idolâtries des nations auxquelles elles confinaient.
Le Judaïsme avait pénétré de bonne heure en Arabie, mais vaguement et imparfaitement. Néanmoins, beaucoup de ses rites et de ses fantasques traditions s’étaient implantés dans le pays. À une époque plus rapprochée pourtant, quand la Palestine fut ravagée par les Romains, et la ville de Jérusalem prise et saccagée, beaucoup de juifs se refugièrent chez les Arabes, s’incorporèrent aux tribus indigènes, se formèrent en communautés, acquirent des territoires fertiles, bâtirent des châteaux et des forteresses, et s’élevèrent à un haut degré de puissance et d’influence.
La religion chrétienne avait pareillement des adhérents parmi les Arabes. Saint Paul, lui-même, déclare, dans son Épître aux Galates, qu’aussitôt après avoir été appelé pour prêcher le christianisme chez les païens, il « alla en Arabie. » Les dissensions, qui désolèrent l’Église d’Orient dans la première moitié du troisième siècle, la partageant en sectes qui se persécutaient l’une l’autre, exilèrent beaucoup de chrétiens dans les contrées reculées d’Orient, remplirent d’anachorètes les déserts d’Arabie, et implantèrent la foi du Christ chez quelques-unes des principales tribus.
Les circonstances physiques et morales qui précèdent peuvent donner une idée des causes qui maintinrent les Arabes dans un état stationnaire. Pendant que leur position isolée et leurs vastes déserts les protégeaient contre la conquête, leurs querelles intérieures et le manque d’un lien commun, politique ou religieux, les empêchaient d’être redoutables comme conquérants. Ils formaient une vaste agrégation de parties distinctes, pleines de vigueur individuelle, mais sans force de cohésion. Quoique leur vie nomade les rendît courageux et actifs, quoique la plupart d’entre eux fussent guerriers dès leur enfance, leurs armes n’étaient tournées que contre eux-mêmes, à l’exception de quelques-unes des tribus frontières, qui s’engageaient parfois, comme mercenaires, dans des guerres extérieures. Aussi, pendant que les autres races nomades de l’Asie centrale, qui n’avaient pas une plus grande aptitude pour la guerre, avaient pendant des siècles envahi et conquis le monde civilisé, cette race belliqueuse, ignorant sa force, restait inoffensive dans la profondeur de ses déserts.
Le temps arrivait enfin où ces tribus discordantes allaient s’unir dans une même croyance, s’exalter pour une cause commune, où un puissant génie allait se lever pour rassembler ces membres épars, les animer de son esprit enthousiaste et audacieux, et les lancer, géant du désert, à l’assaut et au renversement des empires de la terre.
1 Outre les Arabes de la Péninsule, qui étaient tous de race sémitique, il y en avait d’autres appelés Cuschites et qui descendaient de Cusch, fils de Cham. Ils habitaient les rives de l’Euphrate et du golfe Persique. Le nom de Cusch est souvent donné dans l’Écriture Sainte aux Arabes en général, aussi bien qu’à leur pays. Ce sont probablement des arabes de cette race, ceux qui errent maintenant dans les contrées désertes de l’ancienne Assyrie, et qui récemment ont été employés à déterrer les ruines de Ninive. On les distingue quelquefois par le nom de Syro-Arabes. Le présent ouvrage ne parle que des Arabes de la Péninsule ou Arabie propre.
2 En été, les Arabes errants, dit Burckhardt, restent rarement plus de trois ou quatre jours dans le même lieu. Aussitôt que son bétail a consommé le fourrage près d’un abreuvoir, la tribu se met en quête d’un pâturage, et l’herbe qui repousse sert pour un nouveau camp. Le nombre des tentes d’un campement varie de six à huit cents ; quand ce nombre est faible, elles sont disposées en cercle ; mais s’il est plus considérable, elles sont en droite ligne, généralement le long d’un ruisseau. En hiver, quand l’eau et les pacages ne manquent jamais, la tribu entière s’étend sur la plaine, par détachements de trois ou quatre tentes, éloignées d’une demi-heure de marche l’un de l’autre. La tente du Cheik est toujours placée du côté d’où l’on attend des ennemis ou des hôtes. S’opposer aux premiers et honorer les seconds, voilà la grande affaire du Cheik. Chaque père de famille plante sa lance dans le Sol à côté de sa tente, et attache son cheval en face. C’est là aussi que les chameaux reposent pendant la nuit. (Burckhardt, note sur les Bédouins, vol. 1, page 33.) La description suivante, quoique faite à propos des Arabes d’Assyrie, peut jusqu’à un certain point s’appliquer à la race entière : Il serait difficile de peindre l’effet que produit une nombreuse tribu, en route pour de nouveaux pâturages. Nous nous trouvâmes bientôt au milieu de troupeaux de moutons et de chameaux. Aussi loin que la vue pouvait atteindre, à droite, à gauche et en avant, partout la même masse mouvante. De longues files d’ânes et de taureaux chargés de tentes noires, d’énormes chaudrons et de tapis bariolés ; des vieillards des deux sexes, incapables de marcher longtemps, attachés sur des tas d’ustensiles de ménage ; des enfants bourrés dans des valises, la tête sortant par une étroite ouverture ayant pour contrepoids des chevreaux et des agneaux attachés de l’autre côté ; des jeunes filles vêtues seulement de la collante chemise arabe qui faisait ressortir plutôt qu’elle ne cachait leurs formes gracieuses ; des mères avec leurs enfants sur les épaules ; des petits garçons chassant des troupeaux d’agneaux ; des cavaliers armés de longues lances avec leurs flammes, traversant la plaine sur leurs légères juments ; d’autres excitant leurs dromadaires avec leurs petits bâtons fourchus, et menant par le licol leurs chevaux pur sang ; des poulains galopant parmi la foule ; tel était le pêle-mêle à travers lequel nous avions à nous frayer un chemin. (Layard, Ninive. — 1-4.)
II NAISSANCE ET FAMILLE DE MAHOMET — SON ENFANCE
Mahomet, le grand fondateur de la foi d’Islam, naquit à la Mecque dans le mois d’avril de l’année 569 de l’ère chrétienne. Il était de la vaillante et illustre tribu de Koreisch, laquelle se composait de deux branches descendues de deux frères, Haschem et Abd-Schems. — Haschem, le bisaïeul de Mahomet, avait rendu de grands services à la Mecque. Cette ville est située au milieu d’une plaine stérile et pierreuse, et était dans les premiers temps souvent exposée à la disette. Au commencement du VIe siècle, Haschem établit deux caravanes annuelles, l’une en hiver pour l’Arabie méridionale ou Yémen, l’autre en été pour la Syrie. Par ce moyen, on apportait à la Mecque des provisions et une grande variété de marchandises. La ville devint bientôt un grand marché commercial, et la tribu de Koreisch qui prenait une large part à ces expéditions, y acquit la richesse et la puissance. Haschem était, à cette époque, gardien de la Kaaba, le grand tabernacle du culte et des pèlerinages arabes, dont la garde n’était confiée qu’aux tribus et aux familles les plus honorables, absolument comme autrefois le temple de Jérusalem ne l’était qu’aux soins des lévites. En effet, la garde de la Kaaba conférait des dignités et des privilèges civils, et le droit, pour le titulaire, d’inspection sur toute la ville sacrée.
À la mort de Haschem, son fils Abd-Al-Motâlleb lui succéda dans ses honneurs et hérita de son patriotisme. Il délivra la ville sainte d’une armée d’invasion, composée de troupes et d’éléphants, envoyée par les princes chrétiens d’Abyssinie, qui étaient alors maîtres de l’Yémen. Ces services signalés rendus par le père et le fils confirmèrent la garde de la Kaaba à la ligne de Haschem, au grand mécontentement de l’envieuse ligne d’Abd-Schems.
Ab-Al-Motâlleb eut plusieurs enfants. Ceux de ses fils qui figurent dans l’histoire furent : Abou-Taleb, Abou-Lahab, Abbas, Hamza et Abdallah. Le dernier nommé était le plus jeune et le préféré. Il épousa Amina, d’une branche éloignée de cette même famille illustre de Koreisch. Si remarquable était Abdallah pour sa beauté et ces qualités qui captivent l’affection des femmes, que, si l’on peut ajouter foi aux traditions musulmanes, la nuit de son mariage avec Amina, deux cents vierges de la tribu de Koreisch moururent de désespoir.
Mahomet fut le seul fruit de cette union tristement célèbre. Sa naissance, suivant des traditions pareilles à celles que nous venons de citer, fut accompagnée de signes et de prodiges annonçant un enfant du miracle. Sa mère ne souffrit aucune des douleurs d’enfantement. Au moment où il vint au monde, une lumière céleste éclaira le pays environnant, et le nouveau-né, levant les yeux vers le ciel, s’écria : « Dieu est grand ! Il n’y a pas d’autre Dieu que Dieu, et je suis son prophète. »
Le ciel et la terre furent agités par cet avent. Le lac Sâa recula vers ses sources secrètes, laissant ses rives à sec ; pendant que le Tigre, rompant ses digues, inonda les terres voisines. Le palais de Chosroês, roi de Perse, fut ébranlé jusque dans ses fondements, et plusieurs de ses tours furent renversées. Dans cette nuit mémorable, le Cadi, ou juge de Perse, vit, dans un rêve, un chameau féroce, vaincu par un coursier arabe. Il conta son rêve, dans la matinée, au monarque Persan et l’interpréta dans ce sens, qu’il présageait un grand danger du côté de l’Arabie.
Dans cette même nuit, si pleine d’événements, le feu sacré de Zoroastre, qui, gardé par les Mages, brûlait sans interruption depuis plus de mille ans, s’éteignit soudain, et toutes les idoles du monde tombèrent à terre. Les démons ou mauvais génies du Zodiaque, et exerçant une influence maligne sur les enfants des hommes, furent expulsés par les purs anges, et précipités avec leur chef Eblis, ou Lucifer, dans les profondeurs de la mer.
Les parents du nouveau-né, disent les mêmes autorités, étaient frappés d’épouvante et d’admiration. Le frère de sa mère qui était astrologue, tira son horoscope et prédit qu’il s’élèverait à un immense pouvoir, qu’il fonderait un empire et établirait une foi nouvelle parmi les hommes. Son grand-père, Abd-Al-Matàlleb, donna une fête aux principaux Roreischitites, le septième jour après sa naissance, leur présenta cet enfant comme la gloire future de leur race, et lui donna le nom de Mahomet (ou Muahamed) pour indiquer ses hautes destinées.
Tels sont les merveilleux récits que les écrivains musulmans nous font de la naissance de Mahomet, et nous n’avons guère que de semblables fables sur ses premières années. Il était à peine âgé de deux mois quand son père mourut, ne lui laissant en héritage que cinq chameaux, quelques moutons et une esclave éthiopienne, nommée Barakat. Sa mère Amina l’avait nourri jusquelà, mais les travaux et les chagrins lui desséchèrent les seins, et l’air de la Mecque étant mauvais pour les enfants, elle lui chercha une nourrice parmi les femmes des tribus bédouines du voisinage. Celles-ci avaient l’habitude de venir à la Mecque deux fois par an, au printemps et en automne, pour allaiter les enfants des habitants ; mais elles recherchaient ceux des riches auprès desquels elles étaient sûres d’une ample récompense, et se détournaient avec mépris de cet héritier de la pauvreté. Enfin Halêma, femme d’un berger Saa-dite, fut touchée de compassion et emporta chez elle le petit malheureux. C’était dans une des vallées pastorales des montagnes.3
Nombreuses étaient les merveilles racontées par Halêma sur son nourrisson. Pendant la route, la mule qui le portait devint miraculeusement douée de parole, et proclamait à haute voix qu’elle portait le plus grand des prophètes, le chef des ambassadeurs, le favori du Tout-Puissant. Les moutons s’inclinaient vers lui quand il passait ; et quand il était étendu dans son berceau et regardait la lune, elle s’abaissait vers lui en signe de vénération.
La bénédiction du ciel, disent les écrivains arabes, récompensa la charité d’Halêma. Tout le temps que l’enfant resta sous son toit, tout autour d’elle prospéra. Les puits et les fontaines ne tarirent jamais, les pacages furent toujours verts ; ses troupeaux décuplèrent ; une merveilleuse abondance régna dans ses champs et la paix dans sa maison.
Les légendes arabes exaltent de même les qualités surnaturelles, physiques et morales, manifestées par cet étonnant enfant dès l’âge le plus tendre. À trois mois il pouvait se tenir debout tout seul ; à sept, courir hors de la maison ; et à dix se joindre aux autres dans leurs jeux, à l’arc et aux flèches. À huit mois il parlait assez pour se faire comprendre ; le mois suivant il causait couramment, déployant une sagesse qui étonnait tous ceux qui l’entendaient.
À l’âge de trois ans, étant à jouer dans les champs avec son frère de lait, Masroud, deux anges en brillant costume lui apparurent. Ils étendirent doucement Mahomet sur le sol, et Gabriel, un des anges, lui ouvrit la poitrine, mais sans lui faire le moindre mal. Alors lui enlevant le cœur, il le nettoya de toute impureté, exprimant ces gouttes noires et amères du péché originel, héritage de notre premier père Adam, et qui sont cachées dans le cœur des meilleurs de ses descendants, les incitant au crime. Quand il l’eut empiétement purifié, il le remplit de foi, de science et de lumière prophétique, et le replaça dans le sein de l’enfant. Alors, continuent toujours les mêmes autorités, commença à émaner de son visage cette mystérieuse lumière transmise depuis Adam, à travers la série des prophètes, jusqu’au temps d’Isaac et d’Ismaël, mais qui était restée latente dans les descendants de ce dernier, jusqu’à ce qu’elle jetât un nouvel éclat en s’échappant des traits de Mahomet.
Au moment de cette visitation surnaturelle, ajoute-t-on, fut imprimé entre les épaules de l’enfant, le sceau de prophétie qui fut considéré pendant sa vie comme le signe de sa divine mission ; quoique les mécréants n’y vissent qu’un môle de la grosseur d’un œuf de pigeon.
Quand la merveilleuse visitation de l’ange fut rapportée à Halêma et à son mari, ils furent alarmés, craignant que quelque malheur ne menaçât enfant, ou que ses visiteurs surnaturels ne fussent de la race des malins esprits ou génies qui hantent les solitudes du désert et font du mal aux enfants des hommes. Sa nourrice Saadite le ramena donc à la Mecque et le remit entre les mains de sa mère Amina.
Il resta avec elle jusqu’à sa sixième année. Elle le conduisit alors à Médine pour faire une visite à ses parents de la tribu d’Adji, mais elle mourut en route et fut enterrée Aboua, village situé entre Médine et la Mecque. Son tombeau, comme on le verra, fut, pour son fils, un but de pieux pèlerinage et de tendre souvenir, dans la dernière période de sa vie.
La fidèle esclave abyssinienne, Barakat, tint alors lieu de mère au jeune orphelin et le conduisit à son grand-père Abd-Al-Motâlleb, dans la maison de qui il resta pendant deux ans, traité avec soin et tendresse. Abd-Al-Motâlleb était alors bien cassé par l’âge, ayant dépassé le terme ordinaire de l’existence humaine. Voyant sa fin approcher, il fit appeler son fils aîné, Abou-Taleb, et recommanda Mahomet à sa protection spéciale. Le bon Abou-Taleb prit son neveu sur son sein, et toujours depuis fut pour lui un autre père. Celui-ci ayant succédé à Abd-Al-Motâlleb dans la garde de la Kaaba, Mahomet passa plusieurs années dans une espèce de ménage sacerdotal, où les rites et les cérémonies de la maison sacrée étaient rigidement observés. Et maintenant nous jugeons nécessaire de nous étendre sur la prétendue origine de la Kaaba, sur les rites, les traditions et les superstitions qui s’y rattachaient et qui sont si intimement mêlés à la foi d’Islam et à l’histoire de son fondateur.
3 Les Béni Sad (ou fils de Sad) datent de l’antiquité la plus reculée, et sont, avec les Arabes Katan, les seuls restes des tribus primitives d’Arabie. Leur vallée est située dans les montagnes qui courent vers le Sud, à partir de Tayef. — Burckhardt, On the Bedouins, vol. 2, p. 47.
III TRADITIONS CONCERNANT LA MECQUE ET LA KAABA
Quand Adam et Ève furent chassés du paradis terrestre, disent les traditions arabes, ils tombèrent en différents lieux de la terre : Adam sur une montagne de l’île de Serendib ou Ceylan ; Ève en Arabie, sur les bords de la mer Rouge, là où est maintenant situé le port de Djeddah. Pendant deux cents ans ils errèrent sur la terre jusqu’à ce que, en considération de leur repentir et de leur misère, Dieu leur permit de se rencontrer de nouveau sur le mont A’ared ou Hérat, non loin de la présente ville de la Mecque. Au plus fort de son chagrin et de son repentir, Adam, dit-on, leva les mains et les yeux vers le ciel, et implora la clémence de Dieu ; le suppliant de lui accorder un temple pareil à celui où il adorait, quand il était en Paradis, et autour duquel les anges faisaient leurs processions.
La supplication d’Adam eut son effet. Un tabernacle ou temple formé de nuages radieux fut descendu par la main des anges, et placé immédiatement au-dessous de son prototype dans le Paradis céleste. C’était vers ce monument descendu du ciel qu’Adam depuis lors se tournait pour prier ; il en faisait journellement sept fois le tour en imitant des rites d’adoration des anges.
À la mort d’Adam, disent les mêmes traditions, le tabernacle de nuages se dissipa, ou fut de nouveau enlevé au ciel ; mais un autre de même forme fut bâti au même lieu, de pierre et d’argile par Seth, fils d’Adam. Celui-là fut balayé par le déluge. Plusieurs générations après, au temps des patriarches, quand Agar et son fils Ismaël étaient sur le point de périr de soif dans le désert, un ange leur révéla une source ou un puits près de l’ancien emplacement du tabernacle. C’était le puits de Zem-Zem, regardé comme sacré par la postérité d’Ismaël jusqu’à nos jours. Peu après, deux individus de la race gigantesque des Amalécites, en quête d’un chameau qui s’était écarté de leur camp, découvrirent le puits, et ayant apaisé leur soif, y amenèrent leurs compagnons. Là ils fondèrent la ville de la Mecque, prenant Ismaël et sa mère sous leur protection. Ils furent bientôt chassés par les habitants du pays, parmi lesquels Ismaël resta. Quand il eut atteint l’âge viril, il épousa la fille du prince régnant, dont il eut une nombreuse, progéniture, les ancêtres du peuple arabe. Plus tard et par l’ordre de Dieu, il entreprit de rebâtir la Kaaba sur le lieu même où avait été le tabernacle de nuages. Il fut aidé dans cette œuvre pieuse par son père Abraham. Une pierre miraculeuse servait à Abraham d’échafaud, s’élevant ou s’abaissant avec lui pendant qu’il construi