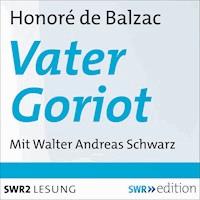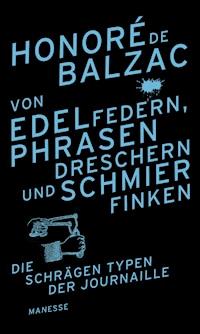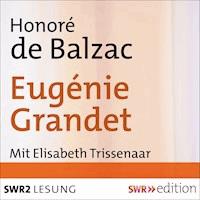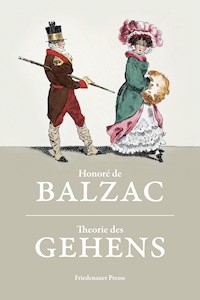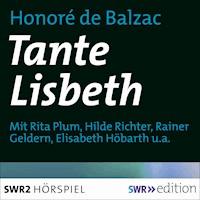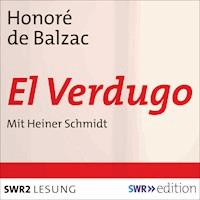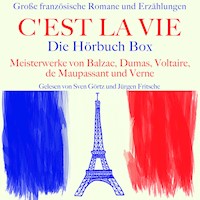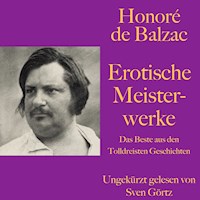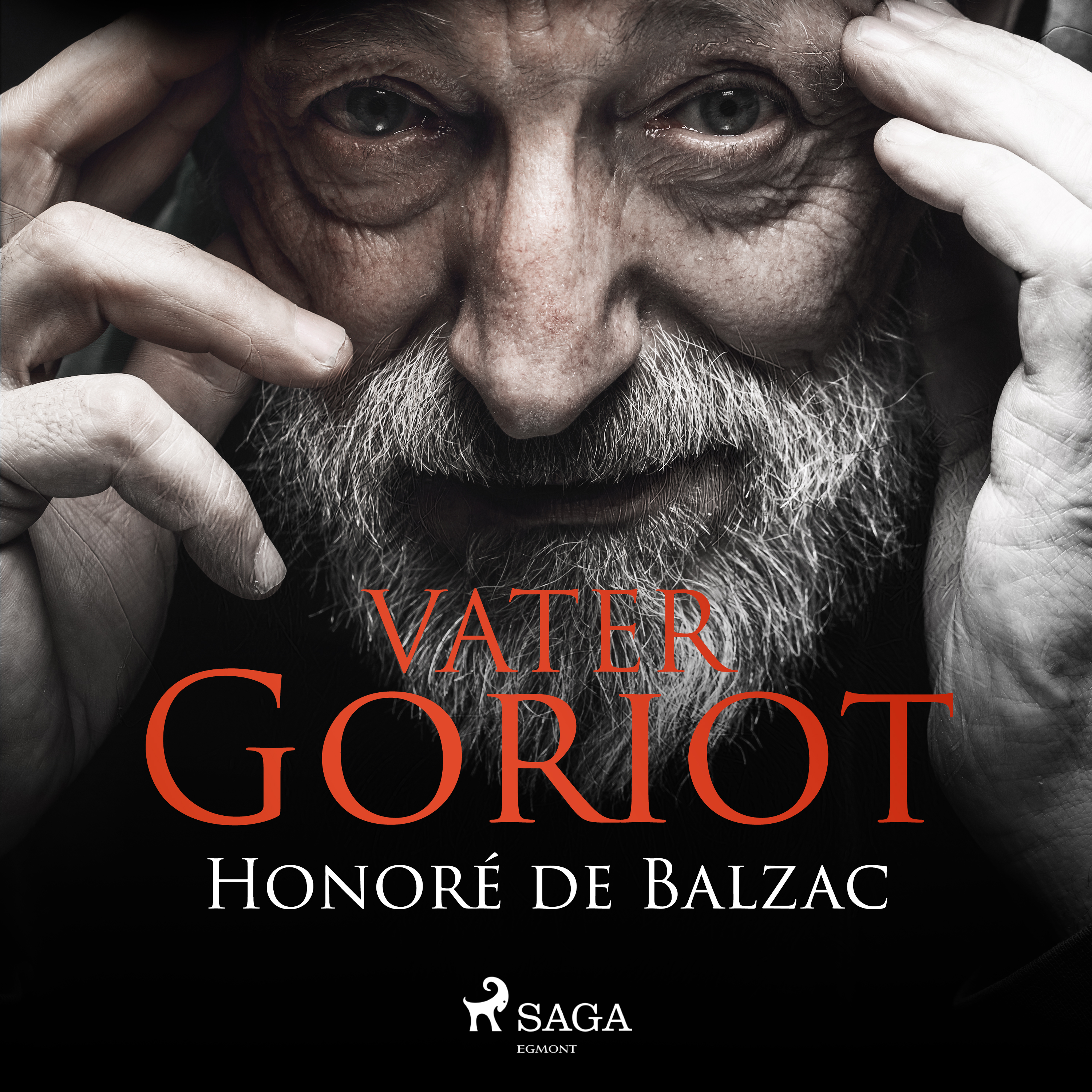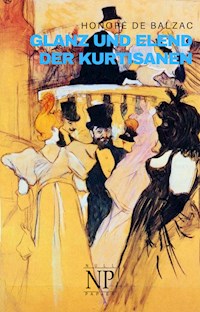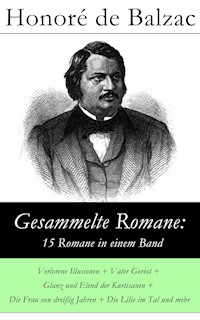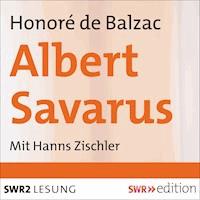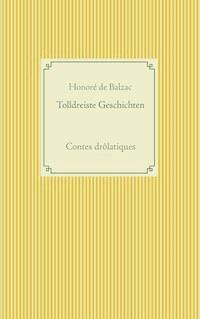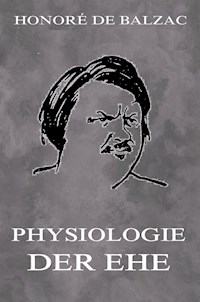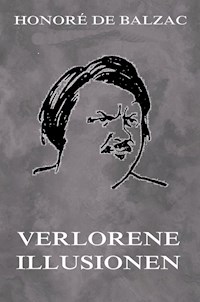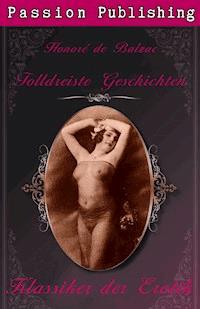Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Perret
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le comte de Fontaine désespère de marier sa troisième et dernière fille, Émilie. La jeune femme est aussi belle qu’orgueilleuse ; aussi intelligente que mordante ; aussi bien née qu’elle est pleine de vanité. Elle est surtout bourrée de principes, entichée de noblesse et prétend n’épouser qu’un homme qui sera un jour pair de France. Un soir d’été, Émilie de Fontaine se rend avec sa famille au bal de Sceaux. Elle y rencontre celui qui pourrait bien être son prince charmant.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Préface
Orgueil et vanités
De même que les autres premières Scènes de la vie privée parues chez Mame et Delaunay-Vallée en 1830, Le Bal de Sceaux est présenté comme un conte d’avertissement à destination des jeunes filles. Il s’agit pour Balzac d’éclairer ses lectrices sur les dangers qui les guettent au sein de l’institution sacrée du mariage et contre lesquelles leurs mères ne les ont pas toujours mises en garde. Ici, les fautes commises par Émilie de Fontaine apparaissent comme la funeste conséquence de la mauvaise éducation donnée à la benjamine de la famille. Les talents d’Émilie sont réels : elle est belle, gracieuse, pleine d’esprit, cultivée et possède un goût sûr. Le malheur vient du fait que ces grandes qualités sont contrebalancées par des défauts longuement cultivés : la vanité et l’orgueil que lui procurent sa jeunesse, sa beauté, son esprit et son nom. La comtesse de Fontaine, née de Kergarouët, apparentée aux Rohan, n’est pas la seule à avoir entretenu la morgue aristocratique de sa fille : toute sa famille contribue à ne pas contrarier la pente naturelle de ce caractère.
Car il s’agit bien d’un caractère, au sens moraliste et classique du terme, que dessine Balzac à travers Émilie. Adorée comme toute petite dernière, Mlle de Fontaine a échappé aux traumatismes de la Révolution ainsi qu’aux privations auxquelles se sont astreintes les grandes familles de la noblesse qui ne voulaient pas se compromettre avec l’Empire. Découvrant le monde sous la Restauration, parée d’un beau nom, membre d’une famille bénéficiant des largesses aussi discrètes que réelles du souverain, elle s’entiche de noblesse et devient la plus ultra des enfants Fontaine, alors même que le comte a accepté comme une nécessité le nouveau mode de gouvernement constitutionnel.
Imbue de sa naissance et de la haute opinion qu’elle s’est faite d’elle-même, Émilie peine à trouver un homme qu’elle jugerait digne d’être épousé. Malgré l’énergie déployée par son père pour attirer dans son salon tous les partis envisageables, Émilie ne cesse d’éconduire les prétendants sur des prétextes toujours plus futiles. Les membres de sa parentèle, qui font parfois eux-mêmes les frais des sarcasmes et des épigrammes de cette Célimène en herbe, s’amusent des critères résolument superficiels promus par leur jeune sœur. Cependant, leurs légères moqueries ne permettent pas à Émilie de comprendre combien est ridicule le fait d’ériger la maigreur au rang d’une vertu cardinale. Son prince – car c’est bien une sorte de prince charmant qu’elle cherche à attirer dans ses filets – est tellement idéalisé qu’elle exige qu’il soit au moins fils d’un pair de France pour jouir de cette dignité lui-même un jour.
Un drame en trois bals
Conte d’avertissement, Le Bal de Sceaux a aussi des allures de conte de fées. La quête du prince charmant entraîne Émilie, devenue maîtresse de son destin, dans une série de bals. Le premier, celui de Sceaux, est celui où naît irrémédiablement la passion amoureuse d’Émilie pour l’inconnu. Outre le bonheur de réunir toutes les qualités physiques exigées par la belle, le jeune homme donne l’apparence d’ignorer superbement Émilie qui n’a guère l’habitude de n’être pas toujours admirée. Séduite par la beauté de l’homme dont elle ne connaît pas le nom autant que piquée de son indifférence, Émilie va battre la campagne pendant des jours, chaperonnée par son vieil oncle le vice-amiral de Kergarouët, pour essayer de retrouver la trace de l’homme qui a si vivement suscité un embryon de passion chez elle. Ses investigations finissent par porter leurs fruits ; les manœuvres du vice-amiral permettent d’attirer Maximilien de Longueville dans le pavillon familial.
L’identité de ce jeune homme qui a « des manières fort distinguées » (p. 57) et qui semble avoir toutes les qualités qu’exige la vie en société reste pourtant un mystère. Comme il esquive parfaitement toutes les demandes formulées par la famille de Fontaine, personne ne parvient à déterminer la grande question qui préoccupe Émilie et qui doit décider de son mariage : Maximilien est-il noble et pourra-t-il accéder un jour à la pairie ? Pour résoudre cette question, on imagine de donner un nouveau bal improvisé au pavillon Planat : la belle Émilie souhaite profiter de l’occasion pour interroger la sœur de Maximilien. Or, rien ne se passe comme prévu : Clara est encore plus habile dans la conversation que son frère et la question reste entière. Malgré tout, Émilie se laisse aller au bonheur d’éprouver des sentiments inconnus d’elle jusqu’à présent : elle se découvre à aimer Maximilien, au point de perdre parfois sa redoutable assurance. Cependant, l’orgueil et la vanité restent les traits dominants. Certes, elle comprend les défauts de son éducation et elle aperçoit le ridicule de ses exigences aristocratiques en présence de l’amour véritable. Pourtant, elle se révèle incapable de se fier à la spontanéité de ses sentiments ; elle hésite mais pose la question fatidique à Maximilien : est-il ou n’est-il pas noble ? Sans apporter de réponse directe à cette question, le jeune homme avoue son amour à Émilie et la prie de patienter quelques semaines encore : il a besoin de ce temps pour mettre sa situation en conformité avec les attentes d’une jeune fille de haut rang.
La belle saison prenant fin, Émilie retourne à Paris. Un jour, elle aperçoit Maximilien dans une boutique : il vend du tissu. Par vanité, Émilie rompt définitivement avec Maximilien et tombe dans une profonde dépression. Quelques semaines plus tard, elle se rend à un bal – un troisième – chez l’ambassadeur de Naples. Elle danse avec un jeune diplomate qui n’est autre que le frère de Maximilien : son cavalier lui révèle le secret de la conduite de son frère et sa fortune prochaine. Incapable de reconnaître son erreur et de présenter des excuses même à un homme qu’elle aime et dont elle est aimée, Émilie succombe à l’irrésistible pente de son caractère et laisse échapper un trait d’esprit mordant plutôt qu’abdiquer devant la droiture de Maximilien. Le conte de fées s’achève irrémédiablement en raison du caractère obstiné des deux amants : tous deux sont également fiers et coupables de vanité.
La plus politique des scènes de la vie privée
À bien y regarder, le conte de fées tient aussi de la fable politique : Le Bal de Sceaux est probablement la plus politique de toutes les scènes de la vie privée. Lors du premier retour des Bourbons, le comte de Fontaine ne cache pas son agacement devant ce qu’il prend pour de l’ingratitude : il comprend, un peu tard, qu’il a participé à la guerre de Vendée à ses frais et qu’il peut sans doute faire une croix sur les 300 000 livres qu’il y a dépensées ; il n’est pas loin de jurer qu’on ne l’y prendrait plus. À cette époque, il est clairement du parti du comte d’Artois, le futur Charles X, et considère que « le système constitutionnel est le plus mauvais de tous les gouvernements » (p. 15). Au retour de l’Empereur de l’île d’Elbe, au lieu de s’exiler dans sa terre bretonne, le comte de Fontaine a l’adresse de suivre la famille royale à Gand pendant les Cent-Jours. C’est là qu’en homme d’esprit, il gagne l’estime de Louis XVIII.
Au second retour des Bourbons, la faveur royale qui protège la famille de Fontaine permet de placer et de marier richement les trois garçons, puis les deux premières filles. Le comte est en première ligne pour qu’on lui attribue, ainsi qu’à ses fils, les places discrètement rémunératrices du nouveau système de gouvernement. Forcément, le vénérable vendéen se rallie aux idées de Louis XVIII qui « voulait fondre les partis comme Napoléon avait fondu les choses et les hommes » (p. 23) ; en homme pragmatique, il comprend tous les avantages et tout l’intérêt de réconcilier la nation pour mieux asseoir les intérêts de la noblesse. Les obstacles surviennent quand Louis XVIII refuse, par une raison qui ressemble à un caprice, de faire un dernier miracle matrimonial pour la dernière fille du comte de Fontaine. L’avènement de Charles X fait pressentir au noble vendéen qu’il doit marier sa fille sans tarder, tant qu’il possède encore une influence à la cour. Il est rare, en effet, que les favoris se maintiennent d’un règne à l’autre. Mais le comte de Fontaine a d’autres raisons de penser qu’il ne saurait bénéficier d’autant de faveurs de la part du nouveau monarque : il est trop modéré aux yeux de Charles X, qui entend favoriser le parti ultra et renouer avec les privilèges de l’Ancien Régime de manière beaucoup plus décomplexée que son frère. On ne peut oublier le fait que c’est dans ce nouveau contexte politique que le comte de Fontaine se résout à laisser sa fille maîtresse de son avenir : son orgueil de classe, sa vanité la conduisent à épouser son oncle, dont la noblesse est indiscutable et qui admet lui-même qu’il est « une vieille ganache d’ultra » (p. 61).
Le propos du Bal de Sceaux est en définitive assez comparable à celui qui sera développé dans Le Cabinet des Antiques en 1838. Dans ces deux récits, Balzac fait la démonstration que les principes de l’Ancien Régime sont résolument dépassés. Le touchant personnage de Clara avertit pourtant Émilie de la manière la plus claire possible : « Aujourd’hui, ces sortes de discussions sont sans objet » (p. 69). Accrochée à des valeurs d’un autre temps, Émilie en est réduite à épouser son oncle septuagénaire et à voir s’éteindre le nom de Kergarouët. En absence de descendance, les bons principes tant vantés par le vice-amiral disparaissent nécessairement. Incapables de s’adapter à leur époque, les thuriféraires absolus de l’Ancien Régime sont bel et bien condamnés à l’extinction de leur noble race.
Maxime Perret
Le Bal de Sceaux
À Henri de Balzac[1],
Son frère
Honoré.
Le comte de Fontaine, chef de l’une des plus anciennes familles du Poitou, avait servi la cause des Bourbons avec intelligence et courage pendant la guerre que les vendéens[2] firent à la République. Après avoir échappé à tous les dangers qui menacèrent les chefs royalistes durant cette orageuse époque de l’histoire contemporaine, il disait gaiement : « Je suis un de ceux qui se sont fait tuer sur les marches du trône ! » Cette plaisanterie n’était pas sans quelque vérité pour un homme laissé parmi les morts à la sanglante journée des Quatre-Chemins[3]. Quoique ruiné par des confiscations, ce fidèle vendéen refusa constamment les places lucratives que lui fit offrir l’empereur Napoléon. Invariable dans sa religion aristocratique, il en avait aveuglément suivi les maximes quand il jugea convenable de se choisir une compagne. Malgré les séductions d’un riche parvenu révolutionnaire qui mettait cette alliance à haut prix, il épousa une demoiselle de Kergarouët sans fortune, mais dont la famille est une des plus vieilles de la Bretagne.
La Restauration[4] surprit M. de Fontaine chargé d’une nombreuse famille. Quoiqu’il n’entrât pas dans les idées du généreux gentilhomme de solliciter des grâces, il céda néanmoins aux désirs de sa femme, quitta son domaine dont le revenu modique suffisait à peine aux besoins de ses enfants, et vint à Paris. Contristé de l’avidité avec laquelle ses anciens camarades faisaient curée des places et des dignités constitutionnelles, il allait retourner à sa terre, lorsqu’il reçut une lettre ministérielle, par laquelle une Excellence assez connue lui annonçait sa nomination au grade de maréchal de camp, en vertu de l’ordonnance qui permettait aux officiers des armées catholiques de compter les vingt premières années inédites du règne de Louis XVIII comme années de service[5]. Quelques jours après, le vendéen reçut encore, sans aucune sollicitation et d’office, la croix de l’ordre de la Légion d’honneur et celle de Saint-Louis[6]. Ébranlé dans sa résolution par ces grâces successives qu’il crut devoir au souvenir du monarque, il ne se contenta plus de mener sa famille, comme il l’avait pieusement fait chaque dimanche, crier Vive le Roi dans la salle des Maréchaux aux Tuileries quand les princes[7] se rendaient à la chapelle, il sollicita la faveur d’une entrevue particulière. Cette audience, très promptement accordée, n’eut rien de particulier. Le salon royal était plein de vieux serviteurs dont les têtes poudrées, vues d’une certaine hauteur, ressemblaient à un tapis de neige. Là, le gentilhomme retrouva d’anciens compagnons qui le reçurent d’un air un peu froid ; mais les princes lui parurent adorables, expression d’enthousiasme qui lui échappa, quand le plus gracieux de ses maîtres, de qui le comte ne se croyait connu que de nom, vint lui serrer la main et le proclama le plus pur des vendéens. Malgré cette ovation, aucune de ces augustes personnes n’eut l’idée de lui demander le compte de ses pertes, ni celui de l’argent si généreusement versé dans les caisses de l’armée catholique. Il s’aperçut, un peu tard, qu’il avait fait la guerre à ses dépens. Vers la fin de la soirée, il crut pouvoir hasarder une spirituelle allusion à l’état de ses affaires, semblable à celui de bien des gentilshommes. Sa Majesté se prit à rire d’assez bon cœur, toute parole marquée au coin de l’esprit avait le don de lui plaire ; mais elle répliqua néanmoins par une de ces royales plaisanteries dont la douceur est plus à craindre que la colère d’une réprimande. Un des plus intimes confidents du roi ne tarda pas à s’approcher du vendéen calculateur, auquel il fit entendre, par une phrase fine et polie, que le moment n’était pas encore venu de compter avec les maîtres : il se trouvait sur le tapis des mémoires beaucoup plus arriérés que le sien, et qui devaient sans doute servir à l’histoire de la Révolution. Le comte sortit prudemment du groupe vénérable qui décrivait un respectueux demi-cercle devant l’auguste famille ; puis, après avoir, non sans peine, dégagé son épée parmi les jambes grêles où elle s’était engagée, il regagna pédestrement à travers la cour des Tuileries le fiacre qu’il avait laissé sur le quai. Avec cet esprit rétif qui distingue la noblesse de vieille roche chez laquelle le souvenir de la Ligue et des Barricades n’est pas encore éteint[8], il se plaignit dans son fiacre, à haute voix et de manière à se compromettre, sur le changement survenu à la cour. « Autrefois, se disait-il, chacun parlait librement au roi de ses petites affaires, les seigneurs pouvaient à leur aise lui demander des grâces et de l’argent, et aujourd’hui l’on n’obtiendra pas, sans scandale, le remboursement des sommes avancées pour son service ? Morbleu ! la croix de Saint-Louis et le grade de maréchal de camp ne valent pas trois cent mille livres que j’ai, bel et bien, dépensées pour la cause royale. Je veux reparler au roi, en face, et dans son cabinet. »
Cette scène refroidit d’autant plus le zèle de M. de Fontaine, que ses demandes d’audience restèrent constamment sans réponse. Il vit d’ailleurs les intrus de l’Empire arrivant à quelques-unes des charges réservées sous l’ancienne monarchie aux meilleures maisons[9].
« Tout est perdu, dit-il un matin. Décidément, le roi n’a jamais été qu’un révolutionnaire[10]. Sans Monsieur[11], qui ne déroge pas et console ses fidèles serviteurs, je ne sais en quelles mains irait un jour la couronne de France, si ce régime continuait. Leur maudit système constitutionnel est le plus mauvais de tous les gouvernements, et ne pourra jamais convenir à la France. Louis XVIII et M. Beugnot nous ont tout gâté à Saint-Ouen[12]. »
Le comte désespéré se préparait à retourner à sa terre, en abandonnant avec noblesse ses prétentions à toute indemnité. En ce moment, les événements du Vingt-Mars[13] annoncèrent une nouvelle tempête qui menaçait d’engloutir le roi légitime et ses défenseurs. Semblable à ces gens généreux qui ne renvoient pas un serviteur par un temps de pluie, M. de Fontaine emprunta sur sa terre pour suivre la monarchie en déroute, sans savoir si cette complicité d’émigration lui serait plus propice que ne l’avait été son dévouement passé ; mais après avoir observé que les compagnons de l’exil étaient plus en faveur que les braves qui, jadis, avaient protesté, les armes à la main, contre l’établissement de la République, peut-être espéra-t-il trouver dans ce voyage à l’étranger plus de profit que dans un service actif et périlleux à l’intérieur. Ses calculs de courtisan ne furent pas une de ces vaines spéculations qui promettent sur le papier des résultats superbes, et ruinent par leur exécution. Il fut donc, selon le mot du plus spirituel et du plus habile de nos diplomates, un des cinq cents fidèles serviteurs qui partagèrent l’exil de la cour à Gand, et l’un des cinquante mille qui en revinrent[14]. Pendant cette courte absence de la royauté, M. de Fontaine eut le bonheur d’être employé par Louis XVIII, et rencontra plus d’une occasion de donner au roi les preuves d’une grande probité politique et d’un attachement sincère. Un soir que le monarque n’avait rien de mieux à faire, il se souvint du bon mot dit par M. de Fontaine aux Tuileries. Le vieux vendéen ne laissa pas échapper un tel à-propos, et raconta son histoire assez spirituellement pour que ce roi, qui n’oubliait rien, pût se la rappeler en temps utile. L’auguste littérateur remarqua la tournure fine donnée à quelques notes dont la rédaction avait été confiée au discret gentilhomme. Ce petit mérite inscrivit M. de Fontaine, dans la mémoire du roi, parmi les plus loyaux serviteurs de sa couronne. Au second retour, le comte fut un de ces envoyés extraordinaires qui parcoururent les départements, avec la mission de juger souverainement les fauteurs de la rébellion[15] ; mais il usa modérément de son terrible pouvoir. Aussitôt que cette juridiction temporaire eut cessé, le grand-prévôt s’assit dans un des fauteuils du Conseil d’État, devint député, parla peu, écouta beaucoup, et changea considérablement d’opinion. Quelques circonstances, inconnues aux biographes, le firent entrer assez avant dans l’intimité du prince, pour qu’un jour le malicieux monarque l’interpellât ainsi en le voyant entrer : « Mon ami Fontaine, je ne m’aviserais pas de vous nommer directeur général ni ministre ! Ni vous ni moi, si nous étions employés