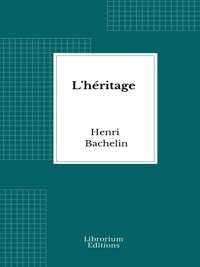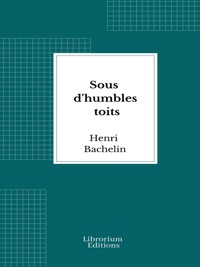0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Henri Bachelin est un écrivain français né le 27 mars 1879 à Lormes (Nièvre) dans le quartier de La Grange Billon dans la maison de son grand-père. Il est décédé à Paris le 21 septembre 1941.
Extrait :
Nous attendions le chariot à l’entrée du bourg. Malgré notre impatience de le voir, nous n’étions pas de taille à faire six lieues à pied pour aller le prendre au sortir d’Autun ; le plus âgé de la bande devait avoir dix ans ; j’en avais sept. C’était un matin de septembre : des feuilles tombaient des peupliers, et sur l’herbe des prés il y avait encore de la rosée. Nous nous étions tous levés de bonne heure comme pour un jour de grande fête dont on veut profiter de la première à la dernière minute. La nuit précédente m’avait paru longue.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
HENRI BACHELIN
LE BÉLIER, LA BREBIS ET LE MOUTON
1920
© 2021 Librorium Editions
ISBN : 9782383831167
Première partie
Deuxième partie
Troisième partie
Le bélier, la brebis et le mouton
PREMIÈRE PARTIE
LE BOURG
I
Nous attendions le chariot à l’entrée du bourg. Malgré notre impatience de le voir, nous n’étions pas de taille à faire six lieues à pied pour aller le prendre au sortir d’Autun ; le plus âgé de la bande devait avoir dix ans ; j’en avais sept. C’était un matin de septembre : des feuilles tombaient des peupliers, et sur l’herbe des prés il y avait encore de la rosée. Nous nous étions tous levés de bonne heure comme pour un jour de grande fête dont on veut profiter de la première à la dernière minute. La nuit précédente m’avait paru longue.
Mme Duverne était arrivée la veille en voiture. Comme elle manquait de tout, elle avait dîné chez nous, c’est-à-dire à l’hôtel. Elle connaissait bien mon père, qui plusieurs fois par an allait les voir, elle et son mari. Elle ne ressemblait pas aux femmes de notre pays, bien qu’elle y fût née. Elle avait été domestique à Autun. C’est une ville où non seulement on apprend les belles manières, mais où l’on finit par se faire un visage que n’ont pas les paysannes ; pas aussi jolie, certainement, que Mme Lagoutte, la femme du pharmacien, qui était à vrai dire la seule dame du bourg, mais Mme Lagoutte ne venait jamais chez nous. Et j’étais heureux, ce soir-là, d’être tout près de Mme Duverne. Elle dit :
— Imaginez vous que je n’ai pas pu amener Valentine. Elle s’est cramponnée à la porte. Elle veut à toute force venir sur le chariot. Son père va être bien embarrassé jusqu’à demain matin, mais rien n’y a fait : c’est déjà une vraie tête de pioche. Elle ajouta en me regardant : Ce sera une petite camarade pour Jean.
Je rougis jusqu’aux oreilles de ce que Mme Duverne eût daigné penser à moi.
— Quel âge a-t-il ?
— Sept ans, répondit ma mère.
— Elle n’en a que cinq, dit Mme Duverne, mais on lui en donnerait neuf, tellement elle est endiablée.
Des camarades, garçons et filles, je n’en manquais pas, mais j’étais heureux à l’idée d’en avoir une qui ne fût pas une petite paysanne. C’est pourquoi ce matin-là j’étais avant tous les autres arrivé sur la route. Peu à peu ils m’avaient rejoint, et nous étions bien une dizaine, dont Henri Lagoutte, le fils du pharmacien, Desbœufs, Satinet, Louise Rouvray, Jeanne Guidon. Mme Duverne avait dit aussi :
— Ils partiront d’Autun avant le lever du jour, mais il ne faut pas compter qu’ils soient ici plus tôt qu’à dix heures.
La route ne cessait guère de monter ; et tout le monde sait que les bœufs ne vont pas plus vite aux descentes qu’aux montées.
L’installation des Duverne était pour tout le bourg un grand événement. Il n’arrivait pas une fois par an que quelqu’un déménageât d’une maison pour aller dans une autre ; à plus forte raison était-il rare que quelqu’un vînt d’un autre pays se fixer dans le nôtre. La population se composait de quelques commerçants, de cultivateurs et de bûcherons, qui, toute l’année, travaillaient dans les bois d’alentour : du printemps à l’automne ils abattaient et écorçaient les arbres ; l’hiver, tapis sous des huttes recouvertes de mottes de terre, ils creusaient des sabots. Il y avait aussi les galvachers qui s’en allaient très loin, au mois de mars, avec leurs attelages de bœufs qu’ils louaient dans le Berry, dans les pays de l’Est et du Nord. Ils revenaient en novembre avec beaucoup d’argent. Là-bas ils avaient vécu de privations ; partis avec du pain pour eux et du foin pour leurs bœufs, jamais ils ne s’étaient arrêtés dans une auberge, couchant à la belle étoile, mais quelle noce au retour ! On ne prenait pas plus garde, d’ailleurs, à leur départ et à leur rentrée qu’à ceux des hirondelles. Depuis des années cela faisait partie de la vie du pays.
Pour nous surtout qui commencions à trouver longues les vacances, on comprend quelle distraction nous promettait l’arrivée des Duverne. Nous n’aurions pas attendu avec plus d’impatience l’apparition d’un régiment en manœuvres, musique en tête, ou du Président de la République. C’était pour nous comme l’annonce d’un grand changement qui allait se produire dans notre vie monotone.
Il était plus de dix heures quand nous aperçûmes le chariot. Il ne nous fut pas difficile de le reconnaître au tas de meubles dont il était chargé. Je m’attendais à voir Valentine perchée tout en haut. Elle n’y était pas.
— Allons au-devant, dit Lagoutte, qui dirigeait toutes nos expéditions.
Nous ne demandions pas mieux. Nous fîmes en courant beaucoup plus de la moitié du chemin. Selon leur habitude, les bœufs avançaient tête baissée. Un charretier les précédait qui causait avec un homme que je supposai être M. Duverne. Des yeux je cherchais Valentine. Les deux hommes ne faisant pas attention à nous, des deux côtés nous nous mîmes à escorter le chariot. J’en fis le tour, sans découvrir Valentine. Nous regardions les armoires calées contre les ridelles avec de la paille, les bois de lits, les tables, les chaises, en un mot tout un mobilier qu’il nous paraissait drôle de voir se promener le long des routes, nous qui habitions des maisons où depuis longtemps pas un meuble n’avait changé de place. Quand une descente se présenta, le charretier serra le frein : un vieux sabot que nous entendîmes frotter sur la roue de derrière. Il nous dit en riant :
— Hé ! la gaminerie. C’est-il que vous êtes envoyés en délégation ?
— En avant-garde, lui répondit Lagoutte.
Il faut croire que l’avant-garde était plus forte que le gros de l’armée, car au bas de la côte qui commence à la première maison du bourg il n’y avait que Mme Duverne.
— Et Valentine ? dit-elle à l’homme qui causait avec le charretier.
— N’aie pas peur, répondit-il : elle n’est pas perdue.
Les bœufs s’étaient arrêtés pour reprendre des forces, bien qu’ils fussent au terme de leur voyage. Etonnée sans doute, et peut-être réveillée par ce brusque arrêt, une petite fille, qui ne pouvait être que Valentine, passa sa tête à travers un enchevêtrement de meubles en criant : Maman ! Maman ! Elle ne me produisit pas l’impression que j’attendais : c’était une gamine comme les autres, rien de plus, rien de moins. Nous faisions cercle autour des Duverne. Nous nous étions abattus sur eux, contre leur gré, comme les dernières mouches sur les bœufs. Mme Duverne s’approcha de sa fille et réussit à la prendre dans ses bras.
— C’était bien la peine, dit-elle, de ne pas vouloir venir hier avec moi pour dormir tout le long de la route !
En roulant une cigarette Duverne expliqua qu’au moment du départ, comme elle refusait de se lever, il lui avait fallu l’habiller de force, tout endormie, puis, les derniers meubles chargés, la déposer sur un matelas et sous des couvertures : de tout le voyage, bercée par le chariot, elle n’avait soufflé mot.
Nous écoutions, très intéressés. Quand ils durent se remettre en marche, les bœufs firent de vains efforts, tant la montée était raide et tant ils en avaient lourd à traîner. Le charretier eut beau les piquer à coups d’aiguillon : rien n’y fit. Je n’avais pas la hardiesse de Lagoutte, mais une fois que l’idée me fut venue que je pouvais sauver la situation, j’allai vers Mme Duverne à qui Valentine donnait la main et je lui dis :
— Madame, si vous voulez, je vais aller chercher notre âne.
Il s’appelait Casimir, et c’était une bête vigoureuse.
— Voici, dit-elle au charretier, le petit Corniaux qui offre de nous prêter son âne.
— Ma foi, répondit-il, ça n’est pas de refus.
Je partis à toutes jambes, malgré la montée, heureux de jouer un rôle dans ce grand événement. Dix minutes après je revins avec Casimir. On l’attela en flèche. S’arcboutant, il donna un bon coup de collier. Je le flattais de la main, et le chariot s’ébranla ! J ’en fus aussi fier que si c’était moi qui l’eusse mis en mouvement. Tout à l’heure encore je n’étais qu’un gamin quelconque parmi nous dix : je devenais quelqu’un, et de toutes façons c’était moi qui marchais devant les autres. C’était même moi qui dirigeais. Bientôt je fis obliquer Casimir à droite.
Nous arrivâmes sur la place de l’église à qui faisait face la boutique des Duverne. Ce n’est pas à proprement parler une place mais plutôt un chemin qui s’élargit entre l’église et une rangée de maisons, dont presque toutes sont occupées par des commerçants.
L’église est bâtie sur un petit terre-plein ; une dizaine de marches y donnent accès Son clocher est couvert de lames de vieux bois, et vraiment il n’est pas haut : c’est à peine s’il dépasse le toit de la nef. On dit qu’elle est très ancienne. Dedans, il y a les statues d’un nommé Gérard de Roussillon et de sa femme.
Je dételai Casimir et le ramenai à l’écurie, puis je revins. Beaucoup de gens étaient déjà rassemblés autour du chariot. Les femmes regardaient les meubles, qu’elles trouvaient plus beaux que les leurs : ce n’était pas pour rien que les Duverne avaient longtemps habité Autun. Très peu d’hommes : ils étaient tous occupés dans les bois ou dans leurs champs, mais il y avait mon père. Il causait avec Duverne qu’il appelait « voisin ». Vingt pas à peine séparaient la boutique de notre hôtel.
— Alors, demanda Mme Duverne, est-ce qu’on commence à décharger ?
— Nous avons bien le temps ! répondit mon père. Cette après-midi, en deux temps trois mouvements ce sera fait. Mon voisin doit avoir soif ; je paie l’apéritif.
Il suffisait en effet de regarder mon père pour se dire qu’il était bien capable de transporter à lui seul tous les meubles. C’était un homme très grand, rouge de teint, avec du ventre et une longue moustache grise qu’il avait beau friser : elle retombait toujours. Il ne s’occupait que de rouler les feuillettes dans la cave, de mettre le vin en bouteilles et de le boire avec les clients.
— Mais, disait Duverne, on pourrait peut-être tout de même commencer ?
Et sa femme :
— Voyons, M. Corniaux, laissez-le travailler un peu !
Elle disait cela gentiment, en souriant. Ma mère aussi était là, l’air d’être en colère. Je l’entendis qui soufflait à mon père :
— Laisse-les donc tranquilles, enfin !
Mais, faisant la sourde oreille, il attrapa Duverne et le charretier chacun par un bras : il ne se possédait plus. Pour lui comme pour nous c’était une grande journée. Le charretier dressa son aiguillon devant le joug des bœufs.
Duverne ne ressemblait pas à mon père. Tout petit, il avait le visage grêlé, de gros sourcils et une barbiche. A notre grand désespoir ils partirent : nous nous étions imaginé que l’emménagement allait commencer tout de suite et nous nous étions fait une fête d’y aider. C’était remis à plus tard. Donner un coup de main à Mme Duverne ne nous disait rien : nous aurions voulu voir les hommes s’attaquer aux meubles les plus lourds. Du moins eus-je la consolation de pouvoir les rejoindre chez nous. Ils étaient attablés. Je vois bien quels devaient être ce jour-là les sentiments de Duverne. Il venait de quitter Autun où il travaillait dans la charpente pour le compte d’un patron ; là-bas il avait lié connaissance avec sa femme qui était domestique chez un capitaine du 29e d’infanterie. Comme elle s’ennuyait de son pays et qu’ils avaient quelques économies, ils avaient acheté la boutique où ils emménageaient aujourd’hui. « Ainsi, maintenant, devait penser Duverne, je serai mon maître. Je ne dépendrai plus de personne. Ma femme gagnera largement pour elle et pour Valentine, puisque Mlle Malardier, dont nous prenons la suite, a amassé là de quoi se retirer : il est vrai qu’elle a soixante-cinq ans. Moi je travaillerai de mon métier, tout en n’étant plus tenu d’être à l’heure. Dans une vingtaine d’années nous aurons de quoi vivre tranquilles, et Valentine sera mariée. L’existence a du bon. » Pour lui, comme pour nous, comme pour mon père, c’était une grande journée, et la première, pour lui seul, d’une vie nouvelle ; et c’était lui, le plus petit, qui parlait le plus fort. Le charretier écoutait : il devait avoir une soixantaine d’années et portait une blouse déteinte et des sabots qui n’avaient jamais été noircis ; pour lui il n’y avait pas de vie nouvelle qui pût commencer : sans doute était-il trop vieux pour s’en aller au loin ; il se contentait de faire des charrois dans le pays même quand il en trouvait l’occasion.
Ils buvaient de l’absinthe, cette liqueur verte qui devient jaune à mesure qu’on la mélange d’eau, et qui a été cause de la perte de bien des hommes. Ce matin-là, rien qu’à la sentir, la tête me tournait et je dus sortir.
Sur la place, c’était un bourdonnement autour du chariot : gamins et gamines allaient et venaient comme fourmis qui se croisent. Lagoutte, bien entendu, dirigeait les opérations, et Valentine, un doigt dans la bouche, le regardait avec admiration. Il ne se contentait pas de donner des ordres : il avait enlevé son veston et payait de sa personne. Pour lui, dont le père gagnait beaucoup d’argent sans se fatiguer, travailler n’était qu’un plaisir. Déjà beaucoup de menus ustensiles avaient pris le chemin de la maison. Je me précipitai pour que Mme Duverne vît que moi aussi je tenais à l’aider : j’estimais qu’il était insuffisant d’avoir prêté Casimir. Elle en était tout étonnée. Elle nous disait :
— Mais laissez donc ! Vous allez vous fatiguer, mes petits !
Pour Lagoutte, elle était confuse qu’un jeune monsieur en bottines, un fils de pharmacien, mît la main à la pâte, et elle ne se lassait pas de lui répéter :
— Allons, Monsieur Henri, c’est assez, cette fois-ci. Madame votre maman va vous gronder.
Car elle avait beau avoir vécu plus de quinze ans à Autun : elle connaissait tout le monde du bourg et n’ignorait rien de ce qui s’y passait.
— Pensez-vous, madame ! ripostait Lagoutte. On va montrer aux hommes qu’on n’a pas besoin d’eux.
Il exagérait. Ce n’était pas en nous y mettant à dix que nous aurions pu décharger les armoires, ni les sommiers. Mais, à midi sonnant, il ne resta plus sur le chariot que les grosses pièces : c’était un beau résultat. Mme Duverne donna deux sous à chacun de ceux qui étaient le plus malheureux. Nous fûmes trois ou quatre auxquels elle n’offrit rien, de crainte de blesser nos parents. Nous nous dispersâmes, chacun courant du côté du déjeuner. Chez nous, les trois hommes étaient encore occupés à boire.
— Tout est fini, dis-je à mon père avec fierté.
Trop pris par une discussion avec Duverne pour faire attention à moi, il était plus rouge encore que de coutume, et Duverne lui-même commençait à prendre des couleurs. Mais ils surent bien me trouver pour m’envoyer chercher Mme Duverne qui vint avec Valentine. Nous déjeunâmes tous ensemble. Ma mère avait un air soucieux que je ne lui connaissais pas.
Les hommes seraient restés à table certainement jusqu’à la nuit, si, vers deux heures, Mme Duverne n’avait dit :
— Tout de même, il faudrait vous décider, si vous ne voulez pas que nous couchions à la belle étoile.
— Oh ! fit mon père, ce ne sont pas les chambres qui manquent chez nous.
Pourtant il se leva en même temps que Duverne et que le charretier. Celui-ci eut beaucoup de peine à rester debout ; je suppose qu’il n’avait l’habitude ni de si bien manger, ni de si bien boire.
— Reste donc là, vieux, lui dit Duverne. Tu nous embarrasserais plus que tu ne nous aiderais.
Le charretier se rassit, et, tout de suite, s’endormit, les coudes sur la table.
A eux deux mon père et Duverne s’attaquèrent aux gros meubles ; à l’exception de Lagoutte, gamins et gamines étaient revenus, espérant qu’il y aurait peut-être encore deux sous à gagner. Mme Duverne fut inquiète.
— Pourvu, dit-elle, que sa maman ne l’ait pas grondé et qu’elle ne soit pas fâchée contre nous ! Jean, si tu allais voir ?
De nouveau, je partis à toutes jambes, puisqu’il s’agissait d’être agréable à Mme Duverne. Je trouvai Lagoutte qui s’amusait tout seul dans la cour sablée de la pharmacie. Je lui dis :
— Je croyais que tu serais venu cette après-midi. Est-ce qu’on te l’a défendu ?
— Penses-tu ! répondit-il. Moi, je fais ce que je veux. J’ai travaillé ce matin parce que ça me disait. Maintenant j’en ai assez de m’esquinter pour des croquants.
Qu’allais-je rapporter à Mme Duverne ? Après m’être creusé la tête j’imaginai de lui dire :
— Sa mère l’a retenu pour qu’il achève ses devoirs de vacances. Il paraît qu’il est très en retard.
Toute l’après-midi nous ne fîmes que regarder sans pouvoir nous rendre utiles en quoi que ce soit. Mon père et Duverne avaient de la paille et du foin dans les cheveux et dans la barbe.
Ce fut fini un peu avant le coucher du soleil. Tout à coup il fit froid. Le vent arriva de l’est ; les feuilles des arbres eurent comme un frisson. Je fus très triste : c’était la fin de cette grande journée que j’attendais depuis si longtemps ! Il était vide, maintenant, le chariot que ce matin j’avais guetté. La paille et le foin jonchaient la place ; je pensais à des jours de foire où pareillement aux approches de la nuit le silence m’avait paru si lourd à supporter après tous les bruits extraordinaires de la journée. L’un après l’autre gamins et gamines s’en allèrent. Dans la boutique Duverne et mon père se regardaient, bras ballants. Un des bœufs meugla : l’autre tout de suite lui répondit.
— Il fait soif, dit Duverne.
Moi je trouvais qu’il faisait froid et triste. Ils reprirent le chemin de notre hôtel.
— Ne sois pas trop longtemps parti, dit Mme Duverne à son mari. Tout n’est pas fini.
— Vous n’aurez qu’à venir le chercher, lui dit mon père. Maintenant, nous sommes voisins.
Nous rencontrâmes le charretier : il s’était enfin réveillé. Duverne le paya.
Je les laissai entrer et restai sur la place. Les premières ombres de la nuit se répandaient comme l’eau d’un étang qu’on lâche ; elles noyaient les derniers restes de lumière. Je regardais la flamme de la bougie dans la boutique où tout était encore en désordre, en même temps que j’écoutais grincer les essieux du chariot qui s’éloignait, allégé des meubles et lourd de ma joie disparue. Le charretier s’était assis sur le timon après avoir allumé sa petite lanterne qu’il avait accrochée à la ridelle de gauche et qui obéissait au balancement du chariot.
II
A cette époque, déjà, beaucoup de maisons étaient couvertes en ardoise, et, des ardoises, il n’y en avait pas que sur les toits : à cause des grands vents de l’est et du nord, à cause de la pluie et de la neige on en mettait aussi du haut en bas des murs pignons.
En serpentant la route traverse le bourg et continue de monter beaucoup plus loin jusqu’à l’endroit où elle arrive au sommet des montagnes toutes boisées qui dominent le pays ; avec des fermes, des hameaux et des villages, il est posé dans le creux comme les œufs dans un nid de poule.
Je peux dire qu’on nous connaissait à dix lieues à la ronde. Si loin que je remonte dans mes souvenirs, je revois notre hôtel, l’hôtel Corniaux, — il y a encore notre nom au-dessus de la porte, mais on a ajouté : Basdevant, successeur, et quand j’y entre c’est comme si je trouvais des étrangers installés chez moi, — je revois notre hôtel avec sa grande cour où il y avait de tout : du fumier, de la paille, des fagots, des tonneaux vides, des souches qui pourrissaient là depuis des années, des troncs d’arbres qui attendaient d’être fendus et sciés, des voitures de toutes formes et, parmi tout cela, des poules, des canards et des oies qui du matin au soir entretenaient la conversation à leur manière. L’écurie était grande. Parfois il y avait à l’intérieur plus d’une douzaine d’ânes et de chevaux. En été, des gens riches d’Autun venaient faire un tour afin de respirer le grand air. Le reste du temps, c’étaient des commis-voyageurs qui commençaient alors à se répandre dans nos campagnes, et la diligence qui s’arrêtait à notre porte : des voyageurs en descendaient avec le conducteur pour casser la croûte en buvant un grand verre de vin blanc ou un petit verre d’eau-de-vie : c’étaient les paysans qui venaient aux foires, et que sais-je encore ! Un va-et-vient continuel qui ne se ralentissait un peu que pendant les deux ou trois mois de neige, et même alors on voyait des visages nouveaux.
Au milieu de tout ce monde-là j’étais heureux. Il y avait deux salles, une pour ceux qui mangeaient, avec une grande table arrondie à ses deux extrémités ; une autre pour ceux qui venaient seulement boire, avec six petites tables carrées : les jours de foire elle était envahie comme l’autre, car on mangeait partout.
Je me promenais entre les clients. Certains me prenaient sur leurs genoux. Il y en avait qui me faisaient peur, avec leur barbe autour des joues, leurs gros bâtons, leurs fouets qui devaient cingler dur.
C’était en hiver, les jours de foire, qu’il fallait voir notre cuisine où il n’y avait pas encore ce grand fourneau que Basdevant a fait installer depuis. Dans la vaste cheminée on jetait du fagot à pleines brassées ; les rôtissoires étaient tout environnées de flammes. Cela sentait bon. Il y faisait chaud. Il y avait toujours de gros marchands de bœufs qui s’attardaient. Vers trois heures de l’après-midi, quand ils avaient fini de déjeuner, ils commençaient à boire de la bière après le pousse-café, et ils étaient plus rouges que s’ils eussent passé leur journée le visage exposé au feu. On pense bien que mon père se chargeait de leur tenir tête. C’étaient de bons vivants tels qu’il n’en existe plus. Mais tout de même mon père buvait trop.
Car il n’y avait pas que la clientèle de passage ; il fallait compter aussi avec les hommes du pays qui venaient surtout le dimanche après la messe et après les vêpres. En ce temps-là tout le monde ou peu s’en faut assistait aux offices, et notre hôtel est situé juste derrière l’église en bordure de la route qui monte. Sa façade est tournée un peu de biais, du côté de l’ancienne boutique de Mlle Malardier et des Duverne. L’hiver, quand ils apportaient avec leurs sabots de la neige qui fondait tout de suite et que notre gros poêle était bourré de bois, leur plaisir de boire était décuplé de ce qu’ils se sentaient au chaud, tandis que sur les montagnes et dans les bois le vent soufflait à perdre haleine et que le clair de lune bleuissait la neige partout étalée. Ils frappaient du poing sur les tables. Les verres sautaient. J’avais peur qu’ils ne les cassent, mais c’étaient des verres épais comme on n’en fait plus.
Ma mère s’occupait de la cuisine. J’ai souvent entendu dire que jamais personne n’a pu la remplacer.
III
Deux ans après son installation Duverne était devenu un des plus acharnés buveurs. Même s’il avait eu de la neige jusqu’aux épaules, il serait venu chez nous matin et soir. Avec mon père c’étaient des parties de cartes à n’en plus finir ; je les regardais les jeter sur la table comme s’ils avaient voulu les enfoncer dans le bois. Son métier de charpentier, Duverne l’avait laissé dans un coin avec ses outils. C’est un grand malheur qu’un homme se détourne du travail pour se livrer à la boisson. Pour mon père, passe encore : à la rigueur, on pouvait dire que boire était son métier. Mais Duverne ! Il s’ennuyait d’Autun, disait-il, et buvait pour se distraire. Sa femme aussi regrettait d’être venue ici, on peut deviner pourquoi. Elle disait :
— J’aurais mieux fait de ne pas quitter ma place où j’étais si tranquille, et de ne pas me marier.
Elle avait beau le sermonner : elle ne pouvait pas l’attacher au pied du lit comme un gamin. Parfois c’était elle qui venait le chercher, et quand je voyais son visage triste je pensais qu’à la place de mon père j’aurais dit à Duverne : Il ne faut plus venir ici. Tu fais de la peine à ta femme. Mais ils étaient bien trop inséparables.
Mme Duverne faisait son possible. Leur boutique était certainement la mieux achalandée du bourg ; on y trouvait des étoffes, de l’épicerie, du papier à lettres. Je n’y entrais qu’avec respect, même quand j’y allais jouer avec Valentine, qui, à mesure qu’elle grandissait, prenait tournure. Chez nous la plupart des gamines s’appellent Jeanne, Marie, Louise ou Catherine. Rien que ce prénom de Valentine mettait à part celle qui le portait. C’était Mme Duverne qui l’avait voulu, parce que la petite fille de ses maîtres avait reçu ce prénom le jour de son baptême.
Nous nous amusions à cacher à tour de rôle un couteau. Ce n’étaient pas les places qui manquaient : derrière les sacs de graines, dans les tiroirs, dans les casiers. Moi je jouais franc-jeu. Pendant qu’elle était un quête d’une cachette, je ne me contentais pas de tourner le dos : je fermais les yeux à m’en faire mal, et plus d’une fois je dus donner ma langue au chat. Je disais : Je renonce. Et elle dansait de joie. Car, pour se moquer de moi, elle me répétait : tu brûles ! justement lorsque j’étais le plus éloigné du couteau. Quant c’était mon tour, elle faisait semblant de ne pas regarder : elle mettait ses mains devant ses yeux, mais plus d’une fois je l’ai surprise à se retourner en écartant les doigts. Je continuais comme si je ne m’étais aperçu de rien. Elle, le moment venu, faisait semblant de chercher ; mais, parce que j’ai toujours eu le goût d’observer à défaut de celui d’apprendre des choses compliquées, je remarquais son premier mouvement dont elle n’était pas maîtresse et qui aurait suffi à la trahir ; elle prenait tout de suite la direction du couteau. Après quoi, elle faisait exprès d’aller en sens opposé. Je ne lui disais rien. Je voulais avoir l’air de croire qu’elle cherchait vraiment.
Le plus souvent c’était elle qui venait appeler son père, et elle n’était pas plus que lui pressée de repartir. Je dois avouer que je ne demandais pas mieux qu’elle restât auprès de moi. Qu’on n’aille pas croire, surtout, que je fusse amoureux d’elle ! Je ne pensais qu’à Mme Duverne. Mais, à l’âge de sept ans, Valentine avait déjà des airs de grande dame et me rappelait sa mère. Nos clients ne pouvaient s’empêcher de rire d’elle ; lorsqu’ils voulaient la prendre sur leurs genoux, elle leur échappait, vexée qu’ils eussent l’air de la traiter comme une gamine ordinaire.
Elle allait dans la cuisine. Ma mère nous donnait à chacun une tartine de confitures ; elle grignotait la sienne en courant avec moi dans les chambres du premier étage. Il y en avait une qu’elle préférait, parce qu’on y voyait une armoire à glace, la seule qu’il y eût dans tout le bourg ; il n’y en avait pas même chez les Lagoutte. Elle s’y regardait, tenant d’une main son morceau de pain, de l’autre s’arrangeant les cheveux.
Il nous arrivait aussi de nous asseoir à côté l’un de l’autre sur le tapis au pied d’un lit, ou chacun sur une chaise. Elle disait : Hue ! dada ! Et elle poussait des cris comme si vraiment elle fût partie pour un long voyage. Moi je ne m’illusionnais pas : même en fermant les yeux, j’aurais su que je restais au même endroit. Mais, pour la contenter, je faisais semblant de croire que nous étions déjà très loin. Elle était devenue ma camarade, et bien souvent, le jeudi, surtout en hiver, je ne sortais même plus pour jouer avec les autres. Mais c’était avant tout pour faire plaisir à Mme Duverne qui me considérait comme un petit garçon raisonnable avec qui Valentine ne courait le risque ni de se déchirer ni de se blesser en courant.
Il ne faudrait pourtant pas croire que je fusse toujours fourré sous les jupes de ma mère. Il me semblait que si j’avais eu pour mère Mme Duverne, ou Mme Lagoutte, je serais resté continuellement auprès d’elle, et pourtant je voyais Lagoutte qui n’avait rien de plus pressé que de s’échapper de la maison. Donc je le rejoignais tout de même de temps en temps, ainsi que Desbœufs, Satinet et quelques autres, pour courir par les champs et par les bois. A la fonte des neiges, nous barrions des ruisseaux avec des pierres, des branches mortes, des mottes de terre. Nous attrapions des grenouilles pour les gonfler avec des pailles jusqu’à ce que les yeux leur sortent de la tête et qu’elles éclatent. Au printemps nous cherchions des nids dans les haies, et nous grimpions aux peupliers pour dénicher les pies : ce n’était pas toujours facile, mais nous n’en étions ni à une déchirure ni à une écorchure près. Si Mme Duverne m’avait vu !... Pourtant j’aurais été heureux qu’elle me vît en ces moments-là : j’étais vexé qu’elle me considérât comme un enfant trop sage.
Nous rôdions autour du moulin. Les plus hardis levaient ou baissaient la vanne, selon les circonstances, pour mettre en mouvement ou pour arrêter la roue, à seule fin de faire endêver le meunier. Quand il arrivait avec son bâton, nous étions déjà loin. Je dis « nous », bien que je n’aie jamais aimé ces sortes de plaisanteries. Je suis partisan de l’ordre et, pour ce qui est de faire des méchancetés aux autres, cela ne me convient pas du tout. Nous abattions les noix à coups de pierres quand nous ne trouvions pas la gaule dressée contre le tronc du noyer. Assez souvent les gamines venaient avec nous : elles n’étaient pas les moins enragées. Elles regrettaient de ne pas pouvoir comme nous grimper aux arbres, mais en bas elles tendaient leurs tabliers pour que nous y jetions les nids avec les œufs, et quelquefois avec de tout petits oiseaux que nous emportions pour les élever en cage. Quand il prenait à Valentine fantaisie de se joindre à nous, les autres en étaient plutôt gênés, parce qu’elle avait vite fait de dire :
— Je n’en peux plus, et de s’asseoir sur un talus ou sur un tas de pierres.
Ils se moquaient d’elle :
— Regardez-la donc ! Il te faudrait peut-être une voiture à deux chevaux ?
J’étais seul à prendre son parti, et c’était à moi qu’elle faisait le moins attention.
Ces jours-là je me montrais le plus endiablé : puisque Mme Duverne n’était pas là pour me voir j’aurais voulu que du moins sa fille m’admirât. Peine perdue : elle n’avait d’yeux que pour Lagoutte, qui ne prenait pas plus garde à elle qu’à moi.
IV
Quand elle eut sept ans, elle vint à l’école. Il n’y avait pas, comme aujourd’hui, un instituteur pour les garçons et une institutrice pour les filles : il n’y avait que M. Mariller dont nous avions tous peur. Non pas qu’il fût méchant, mais son âge et son savoir nous imposaient. Aux heures de classe, même les plus dissipés se tenaient tranquilles, et les plus fainéants faisaient semblant de travailler.
Ce n’est pas pour me vanter, mais j’étais toujours parmi les premiers et souvent le premier. Mon fort, c’étaient les problèmes et les dates de l’histoire de France : dans les dictées je ne faisais de fautes qu’aux mots très difficiles.
Nous n’étions pas nombreux. En hiver la neige, en été les travaux des champs empêchaient ceux des villages de venir jusqu’au bourg. M. Mariller avait beau menacer les parents ; ils promettaient de lui envoyer plus régulièrement leurs enfants, et aussitôt qu’il avait le dos tourné ils n’y pensaient plus. Ils disaient que pour cultiver la terre on en sait toujours assez. Pour mon compte l’instruction que j’ai acquise chez M. Mariller ne m’a point nui : au contraire. Il est vrai que j’ai été le seul du pays à aller aussi longtemps à l’école : jusqu’à près de quinze ans.
J’ai peu connu le curé Latrasse, qui pourtant m’a fait le catéchisme deux années de suite. Mon père n’allait à l’église que pour les grandes fêtes. Ma mère n’était pas une dévote comme Mlle Malardier [Maladier] : elle assistait à la messe le dimanche et faisait ses pâques, comme les autres femmes ; c’était tout.
Henri Lagoutte était le fils du pharmacien qui faisait office de médecin. Nés à un mois de distance, nous étions les deux meilleurs camarades, bien que nous ne nous ressemblions guère. De ma nature je ne suis ni turbulent, ni vantard, ni mauvais, du moins je m’en flatte. Lagoutte était tout cela, quoique pour la méchanceté je ne m’en sois aperçu que par la suite. Si je peux parler ainsi, il « sentait le riche ». Il ne portait pas comme nous de sabots ni de blouse : toujours en veston, avec des bottines et un vrai faux-col.
Son père était le plus riche du pays, et c’était lui qui se fatiguait le moins. On disait :
— Derrière ses bocaux, il est toujours à l’abri du froid et du soleil et il n’a pas à se déranger pour gagner de l’argent : il faut qu’on vienne le trouver quand on a besoin de lui.
A l’époque de mon enfance surtout, les gens de chez nous étaient résistants, et ils n’allaient ou n’envoyaient chez M. Lagoutte qu’à la dernière extrémité. Malgré cela, comme il était le seul dans un rayon de plusieurs lieues, il lui venait assez de clients pour qu’il pût amasser de l’argent non seulement pour leurs vieux jours à lui et à sa femme, mais pour faire instruire son fils. Pas fier, en pantoufles l’été, en sabots l’hiver, il traversait le bourg pour venir prendre son absinthe chez nous. C’était réglé comme du papier à musique : pantoufles ? six heures du soir ; sabots ? cinq heures. Moi, je l’admirais pour son exactitude : j’ai toujours aimé les hommes d’ordre. Et puis il me semblait qu’il détînt tous les secrets de la vie et de la mort. J’ai vu bien des vieux malins qui profitaient de sa présence chez nous pour entrer, sous le prétexte de boire un verre, en réalité pour tâcher de lui soutirer une consultation à l’œil, comme on dit aujourd’hui. Ils commençaient par lui dire :
— Ça ne va pas fort, M. Lagoutte.
Et de fil en aiguille il apprenait que l’un avait mal ici, l’autre là. Il les écoutait en faisant son absinthe et les regardait de ses yeux ronds. Il laissait causer les vieux malins. Moi, de mon coin, je ne le perdais pas de vue. Quand ils avaient terminé, il ne répondait rien. Ou bien il disait :
— Ça n’est pas dangereux. Une bonne nuit de sommeil, et il n’y paraîtra plus.
Quelques-uns ripostaient [rispostaient] :
— Mais justement, M. Lagoutte, depuis deux semaines je n’ai pas fermé l’œil.
— Ça reviendra, disait-il.
Cinq, dix minutes passaient ainsi. Même il parlait le premier de la neige, ou des récoltes, ou des semailles. Et ils étaient obligés de lui répondre, tout en ne pensant qu’à leur maladie. Tout à coup il éclatait de rire en leur tapant sur l’épaule et il leur disait ce qu’ils avaient. Quand c’était un vrai malheureux il ajoutait :
— Tu viendras prendre tes médicaments demain matin. Surtout n’apporte pas d’argent.
Et il lui payait son verre de vin.
C’est ainsi que s’écoula ma vie jusqu’à l’âge de douze ans. Elle ne fut pas compliquée. Aucun accident ne la bouleversa. Et la vie du pays ressemblait à la mienne, du moins à ce qu’alors je croyais. Les hommes, pensais-je, ne s’occupent que de leur travail et les femmes que de leur ménage. Je les considérais tous et toutes comme des êtres infiniment supérieurs avec lesquels je ne pouvais rien avoir de commun. Ils étaient grands, forts et sages. Elles étaient douces, mais inflexibles, et possédaient à fond la science de la vie qu’elles inculquaient à leurs enfants. Si elles nous giflaient, c’était que nous l’avions mérité, non point parce qu’elles cédaient à un mouvement de mauvaise humeur. Si elles nous prenaient sur leurs genoux pour nous embrasser, ce n’était point pour passer sur nous une joie où nous n’étions pour rien, mais pour nous récompenser de quelque bonne action. Pour moi, d’ailleurs, ma mère ne m’embrassait pas souvent, pas plus qu’elle ne me giflait. Y étant habitué, je ne m’en plaignais ni ne m’en félicitais. Je grandissais comme un peuplier dans les prés, comme un chêne dans les bois, à peu près livré à moi-même, mon père ni ma mère n’ayant guère le temps de s’occuper de moi. Si j’avais eu de mauvais instincts, il ne m’aurait pas été difficile de mal tourner.
V
C’était le premier octobre, un samedi, l’année de ma première communion. Depuis le quinze août nous étions en grandes vacances. Plusieurs nuits de suite il avait gelé blanc. Vers une heure de l’après-midi nous partîmes six pour ramasser des prunelles. Il y avait moi, Lagoutte et Satinet du côté des garçons ; du côté des filles, Valentine, Louise Rouvray et Jeanne Guidon. Nous avions chacun notre panier, sauf Lagoutte, qui, étant notre chef, avait assez à faire de nous diriger. Valentine elle-même portait des sabots, ce qui ne lui plaisait guère. Quand nous eûmes dépassé la dernière maison, — nous avions déjà des prunelles dans nos paniers, car chez nous ce n’est pas une ville : il y a des haies un peu partout, les jardins, les champs et les prés faisant corps avec le bourg, — Lagoutte dit :
— Aujourd’hui, c’est notre dernière promenade. Il faut que ça barde. On rentrera quand on pourra. En avant, marche !
Et il s’élança comme un lièvre. Le mardi suivant il devait entrer au collège d’Autun. Il en était enchanté, répétant qu’il s’ennuyait dans ce pays de croquants, qu’au moins là-bas il serait dans une ville, et qu’il ne reviendrait ici que lorsqu’il ne pourrait pas faire autrement. Je le laissais dire. Je n’ai jamais eu le goût des aventures. Il a fallu vraiment que la vie y mette du sien pour que je parte de mon pays. Mais, lorsqu’il parlait ainsi, je voyais bien Valentine l’écouter, écarquillant les yeux et bouche bée. Après avoir fait notre possible pour le suivre, je me rappelle que nous nous sommes arrêtés. Lui, il pouvait courir, n’ayant pas de panier. Quand il s’aperçut que nous restions en route, il revint sur ses pas et nous traita de poules mouillées.
— Pas plus que toi ! répondit Satinet. Tu n’es pas si malin que ça ! On peut faire autant de chemin que toi sans courir. Tu verrais, si je n’avais pas mon panier qui m’embarrasse !...
Pourtant nous nous sommes levés, et nous avons marché longtemps. Le ciel était gris, comme quand il va pleuvoir. Le haut des montagnes d’alentour était caché par les nuages. Je m’occupais surtout de Valentine. Elle avait l’air triste. Je lui dis :
— Qu’est-ce que tu as ? Es-tu fatiguée ? Si tu veux, nous allons nous reposer, puis nous rentrerons tous les deux. Moi aussi j’en ai assez.
Ce n’était pas vrai. J’ai toujours été bon marcheur. Quand je retourne chez nous, mon plus grand bonheur est encore de m’en aller sur les routes, comme ça, pour le plaisir. Elle ne me répondit rien, et pressa le pas pour rejoindre Lagoutte qui était avec Louise Rouvray. Je la savais susceptible, orgueilleuse et entêtée, aimant à imposer ses caprices. A l’école M. Mariller n’en faisait pas ce qu’il voulait. Elle n’ignorait pas que, si elle s’était assise en disant qu’elle n’en pouvait plus, nous nous serions arrêtés, bien que cela nous eût déplu. Alors, bien que j’en aie eu grand’honte, je dis à Lagoutte :
— Tu sais, moi je ne vais pas plus loin.