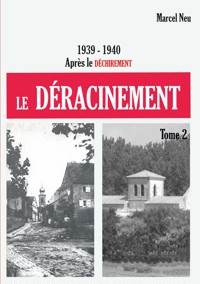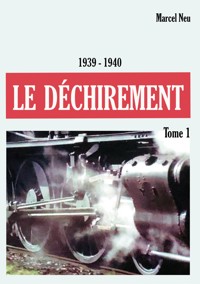
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le 1er septembre 1939, l'Etat français déclenche l'évacuation de la population frontalière de l'Est de la France. Les habitants sont contraints d'abandonner leur maison et leurs biens. Joséphine, une Lorraine germanophone, mère célibataire, est, certes, confrontée au déroulement de la gigantesque opération, mais aussi aux tourments concernant sa relation avec son ex-compagnon sarrois qui a juré fidélité au Führer, et à ceux d'une relation naissante avec un ancien camarade. Au-delà du récit-fiction, c'est également une métaphore de la situation des Alsaciens-Mosellans toujours ballottés par les vents dominants.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aux évacués mosellans.
A mes parents.
SOMMAIRE
Ils ne savaient pas
La paix pour mille ans
La rumeur gagne
La tension monte
Le tocsin balaye les rumeurs
Bindle und Klamotte
Long comme un train interminable
Une nuit de paille et de foin
L’espoir et la crainte font ménage
La paix est prise de court
La guerre pousse au train
La fatalité mise sur les rails
Ils ne savaient pas
Dans la perspective d’un possible nouveau conflit avec l’Allemagne, l’Etat français avait commencé l’étude d’un plan1 de sauvegarde de biens et de certaines populations. En effet, le 11 février 1922, André Maginot, ministre de la Guerre, avait signé une « Instruction provisoire sur la protection individuelle contre les bombardements aériens des populations des villes, des personnels des gares et établissements industriels du territoire national. » Jusqu’en 1939, les études évoluèrent en fonction des tensions et des risques. Et dès août 1923, on préconisa déjà l’évacuation, vers l’Intérieur, des habitants dont la présence était jugée inutile ou qui pouvait entraver la protection : d’enfants en bas âge avec leurs mères, vieillards, malades hospitalisés, etc. Mais c’est dans l’Instruction du 10 mai 1936 que l’étude cibla plus particulièrement la population frontalière avec l’emploi du terme de « transplantation en définitive », vers un département dit de « correspondance. » La zone frontalière de la 20e région militaire se verra ensuite dotée d’un plan particulier qui évoluera encore jusqu’en 1939. (La population a été volontairement tenue dans l’ignorance de l’ensemble des travaux réalisés dans le secret. Toute divulgation tombait sous le coup d’une condamnation d’espionnage.)
Entre-temps, la construction de la ligne Maginot avait éveillé une vague idée d’évacuation en cas de conflit. Puis,
l’Anschluss de l’Autriche et la crise des Sudètes en 1938 avec la mobilisation partielle entraînèrent une vague de rumeurs de plus en plus persistantes. Cependant, le déclenchement de l’évacuation, le 1er septembre 1939, prit tout le monde de court : l’ordre tomba comme le couperet. Personne n’imagina devoir répondre, sans attendre, à un tel ultimatum et quitter son foyer dans l’heure en abandonnant tous ses biens sur-le-champ et dans les champs.
A noter que l’évacuation a été une mesure d’ordre militaire destinée à permettre la mise en place de la couverture et, éventuellement, de plans de feux.
Ce qui suit est un récit basé sur des témoignages recueillis dans les années 80 auprès d’habitants de mon village de Petit-Réderching, à Lorentzen, à Hertzing et Héming. J’ai volontairement omis de citer les noms de famille, tout comme j’ai pris la liberté de modifier des prénoms et de créer quelques personnages fictifs comme convoyeurs de mémoire et d’histoire. Bonne lecture.
1 Pour en savoir plus : L’Evacuation en Lorraine 1939. Tout… ou presque… était prévu depuis 1922 ! Marcel Neu. Editions Pierron, 1989. Epuisé en librairie.
La paix pour mille ans
L’incendie du Reichstag, le 23 février 1933, est pour Hitler le tremplin pour obtenir le pouvoir total. « C’est un signe de Dieu, Herr Vice-Chancelier ! Si ce feu, comme je le crois, est l’œuvre des communistes, nous devons écraser cette peste meurtrière d’une main de fer ! » avait-il dit à Von Papen, le 28 février. Les élections parlementaires du 5 mars lui donnent la quasi-majorité au Reichstag. Puis sous sa pression, le président de la République de Weimar, Paul von Hindenburg, signe un décret2 pour la protection du peuple et de l’État et annule dans la foulée l’essentiel des libertés civiles et politiques. Un mois plus tard, Hitler réclame les pleins pouvoirs au Reichstag.
Le 29 mars, la « main de fer » fait voter des lois d’urgence pour abolir les libertés fondamentales : les partis politiques sont interdits. Des milliers de militants communistes et socialistes sont poursuivis, emprisonnés ou éliminés. Le premier camp de concentration est ouvert à Oranienbourg où de nombreux opposants politiques seront internés. Et le 14 juillet 1933, le NSDAP 3 est proclamé parti unique. Commencent alors les premières persécutions envers les juifs, puis envers des minorités et tous les adversaires au régime.
La nazification est en marche.
S’ensuit la « Nuit des longs couteaux » du 29 au 30 juin 1934 qui va éliminer la branche politique remuante au sein de la SA4. Exécutions sommaires et emprisonnements sont au menu.
Le lendemain de la mort du président Hindenburg, le 2 août 1934, Hitler est désigné Führer et chancelier conformément à une loi qu’il avait lui-même fait voter. Dans la foulée, le 19 août, après une consultation populaire, un véritable plébiscite avec 90 % des voix, il obtient les pleins pouvoirs. Pouvoirs qui lui seront renouvelés trois ans plus tard, en 1937 pour quatre nouvelles années par une loi légalisant également la dictature.
Désormais seul maître à bord, il a un boulevard devant lui pour appliquer son programme, dont l’agrandissement du Lebensraum, l’espace vital, est l’écran de fumée à travers lequel il compte prendre la « revanche » sur le Versailler Diktat, le traité de Versailles, et ainsi se réapproprier les pays et régions perdus ; incorporer les populations de culture et de langue allemande ; forger la race aryenne pure et renforcer la fibre nationaliste et conquérante : le tout pour former Ein Volk, ein Reich, ein Führer ! Un seul peuple, un seul Etat, un seul chef et hisser l’Allemagne à la première place de la puissance politique et économique d’Europe centrale ; faire de l’Allemagne un pays au-dessus de tout, Deutschland über Alles.
Le traité de Versailles lui a offert une première occasion, « démocratique », pour récupérer le Sarrgebiet5. Le traité fixait en effet des élections libres pour le 15 janvier 1935 dans cette région pour : soit la réintégration de ce territoire à l’Allemagne, soit le statu quo, c’est-à-dire son autonomie vis-à-vis de l’Allemagne en restant sous le contrôle de la SDN6, soit l’union à la France. Ce sera un plébiscite pour la réintégration à l’Allemagne, qui sera effective le 1er mars 1935.
Hitler jubile. Il doit son succès à sa politique nationale-socialiste menée depuis près de deux ans déjà, aux aides financières, à la propagande, aux pressions diverses et aux actions de groupuscules d’intimidation à la « botte nazie » semant souvent la terreur morale sinon physique dans la population. Mais aussi en raison d’un comportement jugé parfois hautain, voire arrogant, de l’armée française d’occupation envers la population autochtone. La France avait aussi renforcé la méfiance, et avait semé le ferment pour la réintégration.
Fort de ce succès, et en violation du traité de Versailles, Hitler introduit la conscription le 16 mars 1935. Le volet militaire avec le réarmement se dévoile. Puis en mai, les juifs sont bannis de l’armée tandis que des mesures restrictives, coercitives, répressives se multiplient envers eux et celles et ceux qui représentent un frein ou une menace à la formation d’une race ayrienne pure. En exemple, certaines catégories de femmes pouvant nuire à l’amélioration de la race subissent la stérilisation. Il poursuit ainsi sa politique d’oppression envers les non-Allemands, ordonne l’autodafé de livres non favorables à la race ayrienne, renforce la répression des délits et crimes de droits communs, etc. De nouveaux camps de concentration sont créés : Dachau près de Munich, Lichtenburg, Oaranienbourg-Sachsenhausen. Buchenwald en février 1937, puis Ravensbrück dédié aux femmes et aux enfants…
Mais l’Europe de l’Ouest voit en lui un rempart contre l’expansion du communisme. Le 26 juin 1935, les Britanniques l’autorisent même à former une marine égale à 30 % de leur tonnage et signent un accord d’armement naval. Le 7 mars 1936, des soldats allemands occupent la zone démilitarisée de Rhénanie. En réaction, la France met en alerte des troupes d’active.
Le 24 août 1936, Hitler porte le service militaire obligatoire à deux ans. Le 14 novembre, le Reischstag déclare nulles les conditions du traité de Versailles et rétablit sa souveraineté sur les voies fluviales allemandes. L’année 1937 est relativement calme, c’est-à-dire sans grands éclats provocateurs sur la scène internationale sinon que l’Allemagne s’illustre dans la guerre d’Espagne. Son aviation bombarde des civils notamment dans la petite ville de Guernica le 26 avril 19377.
L’année 1938 réserve quelques surprises de tailles. Le 4 février, Hitler devient le chef suprême de la Wehrmacht. Il commence alors des négociations avec l’Autriche et aboutit à l’Anschluss le 12 mars 1938, sans coup férir. En août, il décrète la mobilisation générale et en septembre réclame l’annexion du Pays des Sudètes en s’appuyant sur le fait que cette région est, elle aussi, essentiellement peuplée d’Allemands.
Si l’Anschluss n’avait guère provoqué de réactions en France si ce n’est une alerte dans les troupes de forteresses entre mars et mai 1938, la revendication des Sudètes va, elle, soulever un début d’inquiétude en Europe et entraîner de plus larges pourparlers. Britanniques, Français et Italiens, un peu dans le dos de la Tchécoslovaquie, négocient avec Hitler. Il faut à tout prix sauver la paix qui est menacée, dit-on. Fin septembre 1938, des accords8 concèdent le Pays des Sudètes à Hitler qui promet en échange, une fois de plus, que « L’Europe connaîtra ensuite la paix pour mille ans », et qu’il renoncera à toute nouvelle exigence territoriale en Europe et à ses velléités de vouloir mettre la main sur l’Alsace-Lorraine. « Seul un fou pourrait croire à la guerre entre les deux Etats », affirmait-il déjà le 14 octobre 1934 pour apaiser les esprits.
Les négociateurs ont-ils cru sauver la paix ? « Mes bons amis, voici la seconde fois que nous rentrons d’Allemagne à Downing Street avec une paix honorable. Je crois qu’il s’agit de la paix pour notre temps. Nous vous remercions du fond du cœur. À présent, je vous conseille de rentrer chez vous, et dormez en paix », proposa Chamberlain à ses citoyens britanniques à son retour de Munich. Même esprit et communication en France.
Mais, durant le temps des négociations, dans l’est de la France dans les villages alentour de la frontière allemande, la mobilisation partielle avait été ordonnée. Des réservistes avaient été appelés à rejoindre leur unité. Ils y « séjourneront » une quinzaine de jours. « J’étais troufion au Guisberg près d’Enchenberg, se souvient le Seppel. On passait le temps comme on pouvait : on jouait aux cartes toute la journée et le soir on allait boire et manger au Hoernerhof, où l’on dilapidait tout notre argent. Pendant ce temps, nos ministres étaient à Munich pour se mettre d’accord avec les Allemands à propos du Pays des Sudètes. Mais, quand on entendait les discours grandiloquents de Hitler et lorsqu’on avait quelque chose dans la tête, on pouvait comprendre que cela ne pouvait pas durer. » L’épisode du Pays des Sudètes a semé les premiers ferments d’un possible conflit et ils reviendront en leitmotiv dans toutes les conversations.
Malgré les promesses de retenue de Hitler, sa soif d’annexion n’est pas tarie. En effet, quelques mois plus tard, le 14 mars 1939, l’Armée allemande envahit la Bohême-Moravie et en crée un protectorat. La Tchécoslovaquie, un assemblage concocté dans le cadre du traité de Versailles, est ainsi démantelée et privée de près de 80 % de son économie. Et le 21 mars, il demande la restitution du couloir de Dantzig. Trois jours après, il annexe, encore, le territoire de Memel 9 majoritairement peuplée par des Allemands. Ce territoire était, lui aussi, inscrit dans le traité, placé d’abord sous administration française au nom des Alliés avant d’être envahi par la Lituanie en 1923.
En réaction à la revendication de Dantzig, l’Angleterre et la France garantissent à la Pologne, le 31 mars 1939, son indépendance et son intégrité territoriale. Quinze jours plus tard, le 14 avril, Hitler dénonce le pacte décennal de non-agression conclu avec la Pologne en 1934. Et le 23 mai, il annonce clairement qu’il « n’est pas question d’épargner la Pologne » et qu’il lui fera la guerre. Ne veut-il pas assurer : « la paix pour mille ans… », comme il le répète depuis des années.
La machine de guerre est huilée et lancée.
Dans l’Est de la France, à partir du 21 juillet 1939, les unités de forteresses sont mises en alerte et la moitié de l’armement devient opérationnel dans les ouvrages. La signature du pacte germano-russe de non-agression10 le 23 août sonne comme le coup de grâce à la paix. Le lendemain, la France déclenche la mobilisation de tous les réservistes frontaliers et la totalité de ses armes. Le surlendemain, Hitler décrète, lui, la mobilisation générale. Le 27 août, le gouvernement français ordonne, lui, une mobilisation partielle.
Cette mobilisation a ouvert le champ aux rumeurs d’une guerre imminente assortie d’une possible évacuation de la population frontalière avec l’Allemagne. Elle a aussi, et surtout, ponctionné une partie des forces vives et a laissé les femmes, les jeunes gens et les anciens affronter les suites que chacun est encore loin d’imaginer.
Toutefois, en cette fin du mois d’août, on veut toujours croire à un dénouement à l’instar de celui lors de la crise des Sudètes en 38 avec un retour au calme. Néanmoins, le 26 août, le gouvernement met en place un service d’accueil de réfugiés en gare d’Angoulême et ouvre le droit de réquisition. Le 1er septembre au matin, Hitler met, lui, le feu aux poudres et envahit la Pologne.11
2 La Reichstagsbrandverordnung (décret de l'incendie du Reichstag), ou, sous sa dénomination officielle la Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28 Februar 1933 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Reichstagsbrandverordnung
3 Nationalsoziallistische Deutsche Arbeirterpartei - Parti ouvrier allemand national-socialiste.
4 Sturmabteilung - Section d’assaut, (Chemises brunes). Une organisation paramilitaire du NSDAP.
5 Territoire allemand du bassin de la Sarre administré par la Société des Nations (SDN). La France y exploite les mines de charbon domaniales en dédommagement de la destruction des mines du Nord de la France.
6 Société des Nations créée en1920 et que l’Allemagne a quitté en octobre 1933.
7 Un prélude aux bombardements des civils jetés sur les routes de France en mai/juin 1940.
8 Les Accords de Munich.
9 Memelland, région située à l’extrémité orientale de la Prusse.
10 L’on ne sait alors que le pacte contient une annexe secrète sur le partage de la Pologne. Il marque aussi l’échec de longues négociations et tractations entre l’Angleterre et l’Allemagne d’une part, la Russie et l’Angleterre d’autre part. Les unes pour isoler la France sur l’échiquier européen. Les secondes pour isoler l’Allemagne et empêcher son annexionnisme.
11 Ce texte a été écrit avant l’invasion russe de l’Ukraine. Toute extrapolation ou supputation sur l’avenir serait totalement arbitraire… Je l’espère !
1 La rumeur gagne
Depuis plusieurs années déjà, hommes, matériaux et matériels arrivent en gare de marchandises du Meyerhof pour alimenter des chantiers de la ligne Maginot du secteur fortifié de Rohrbach. Ces chantiers d’envergure ont permis la conversion de nombreux ruraux en ouvriers salariés auprès de sous-traitants locaux pour diverses tâches manuelles dont celles de décharger les wagons : de sables, graviers, ciments, briques, ferrailles… et de les charrier vers les ouvrages avec leurs propres voitures hippomobiles… Même si, depuis 1937, la dizaine de casemates et abris sur le territoire de Petit-Réderching sont achevés dans leur gros œuvre, des travaux d’aménagement et de consolidation se poursuivent.
Chacun sait désormais que la ligne Maginot a inscrit durablement dans le sol et dans les esprits les limites que l’ennemi ne devra et ne pourra pas dépasser. Ce « voisin » que l’on évite toutefois de nommer clairement dans les conversations : Die doa Unner, ceux de là en bas, dit-on avec un coup de menton dans leur direction.
Depuis la mise en chantier de la ligne Maginot, les villageois se sont habitués à la présence de soldats. A leurs allées et venues, sans entrain, entre le village, leurs lieux de travail et leurs abris ou casernements. Leurs vêtements transpirent l’odeur de la terre, du béton et de la sueur plus que celle de la poudre ou de la discipline militaire.
Les jours de repos, ils promènent leur ennui à la recherche d’une sociabilité autre que celle du cantonnement. Certains guettent la petite aventure, et pourquoi pas la rencontre avec une âme sœur jusqu’à troquer l’uniforme contre le costume de marié comme Caroline et Edouard, en juillet dernier. Des enfants suivent ces soldats, imitent leur démarche, les touchent, leur tournent autour dans l’espoir de grappiller on ne sait quoi : une pièce ? Un objet ? Un bonbon ? Un semblant de coup de pied au derrière les fait déguerpir…
En ce mois d’août, les activités se sont encore intensifiées tandis que les rumeurs se sont amplifiées sur les risques d’une guerre assortie d’une évacuation. Celles-ci vont et viennent au gré des interprétations des informations des uns et des autres, de la presse locale ou de la radio, de celles véhiculées dans les veillées, dans les cafés… De là où chacun exprime son avis, ses suppositions avec son scénario, voire sa peur. Où l’on discute à fleurets mouchetés ou de manière plus frontale : entre celui qui sait tout et celui qui en sait moins, entre le militariste et le pacifiste, l’autonomiste et le fédéraliste, ou encore l’indécis. Et si le nom de Hitler est dans toutes les conversations, on dit cependant qu’il n’est pas un Bismarck ni un Kaiser Guillaume quitte à éveiller la nostalgie du Reichsland, de l’Empire. Et quand ça coince, et, pour éviter une guerre fratricide, on aborde la météo du jour et du lendemain, on rappelle la ou les dernières histoires de clocher dans un esprit champêtre.
Mais en cette fin du mois d’août, on porte aussi son attention vers le Kirchefescht, la fête patronale, dédiée à l’Exaltation de la Sainte Croix dans la deuxième semaine de septembre. Cette célébration marque une trêve, du moins sonne-t-elle la fin des récoltes d’été en attendant celles de l’automne : des pommes de terre et des betteraves. Cette fête religieuse offre l’occasion de remercier le Plus-Haut pour ses interventions divines sur la fertilité des sols et ses régulations météorologiques. Mais elle offre également, et surtout, l’opportunité de retrouvailles et de rassemblements familiaux incontournables, autour d’une table garnie. Ne dit-on pas que les habitants « fêtent la Sainte Croix le matin et se remplissent le ventre l’après-midi12 ! », mais fera-ton ripaille et franc régal cette année ? Mais l’enthousiasme ne règne pas.