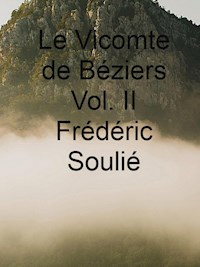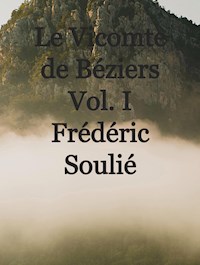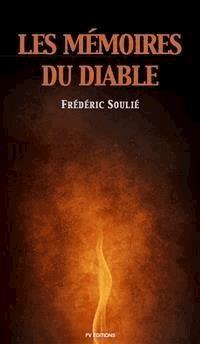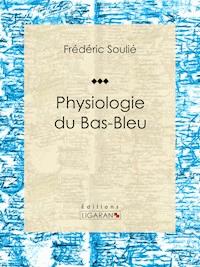Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le Magnétiseur, écrit par Frédéric Soulié, est un roman captivant qui plonge le lecteur dans un univers mystérieux et fascinant. L'histoire se déroule au XIXe siècle et met en scène un personnage énigmatique, le magnétiseur.
Ce dernier possède un don exceptionnel qui lui permet de guérir les maladies par le simple pouvoir de son esprit. Mais derrière cette apparence bienveillante se cache un homme tourmenté, hanté par ses propres démons.
Au fil des pages, le lecteur est entraîné dans une intrigue palpitante où se mêlent secrets, trahisons et manipulations. Le magnétiseur devient alors le centre d'une série d'événements étranges et inquiétants, mettant en péril sa propre vie ainsi que celle de ses proches.
Frédéric Soulié, maître du roman noir, nous offre ici un récit haletant, où le suspense est à son comble. Avec une plume fluide et descriptive, il nous transporte dans les ruelles sombres de Paris, nous faisant ressentir toute l'atmosphère oppressante de l'époque.
Le Magnétiseur est un livre qui ne laisse pas indifférent. Entre fascination et effroi, il nous plonge dans les méandres de l'âme humaine et nous pousse à nous interroger sur les limites de la science et du pouvoir de l'esprit.
Un roman à lire absolument pour tous les amateurs de mystère et de frissons, qui saura vous tenir en haleine jusqu'à la dernière page.
Extrait : "– Quelle heure est-il? – Midi, madame. – C'est odieux ! Tout aussitôt la duchesse d'Avarenne se leva de son vaste fauteuil, fit un tour dans l'énorme chambre où elle se trouvait, s'arrêta devant un lit à estrade qui en occupait le fond, le considéra quelques instants, haussa les épaules avec un air d'humeur et se détourna vivement."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1787
– Quelle heure est-il ?
– Midi, madame.
– C’est odieux !
Tout aussitôt la duchesse d’Avarenne se leva de son vaste fauteuil, fit un tour dans l’énorme chambre où elle se trouvait, s’arrêta devant un lit à estrade qui en occupait le fond, le considéra quelques instants, haussa les épaules avec un air d’humeur et se détourna vivement. Elle continua sa promenade, prit en passant devant un canapé un manchon qu’on y avait posé, le tourna, le retourna, en lissa la noire fourrure avec sa blanche main, puis le jeta sur un autre meuble. Elle s’approcha d’une console, dérangea trois ou quatre tasses, ouvrit et referma un livre qu’elle rencontra sous ses yeux, et alla s’asseoir devant une toilette couverte en basin blanc. Là, elle se mit à se regarder dans la glace en la touchant presque du visage ; alors, du bout de son doigt, elle écarta ses lèvres et examina ses dents étincelantes de blancheur avec une attention minutieuse, puis elle se recula un peu, ferma les yeux à moitié, se donna quelques airs de tête, jeta un œil de poudre sur deux boucles qui laissaient percer le noir de jais de ses cheveux, enleva avec la lame d’or d’un couteau de toilette le blanc que la houppe avait déposé sur son front, unit avec le coin d’un mouchoir le rouge qui cachait ses jeunes couleurs, et reprit : – Que fait-on là-bas ?
– Monsieur le marquis reçoit les gens du bailliage qui viennent lui présenter leur hommage.
– Qui ça ?
– Il y a, je crois, madame, le juge et les avocats de la juridiction de monsieur le marquis, le maire et les consuls du bourg, le curé et les chanoines de l’abbaye de Saint-Severin.
– Comment sont-ils faits ?
– Qui, madame ? les chanoines ?
– Tous ?
– Mais, madame, ils sont faits… ils sont faits comme tout le monde.
– Ah !
Et la duchesse d’Avarenne continua son manège devant sa glace, mirant ses mains, sa taille, sa gorge, se minaudant, se faisant la révérence, se disant un petit bonjour de la main, puis elle ajouta :
– Ah ! ils sont faits comme tout le monde.
– D’ailleurs madame la duchesse peut les voir, car j’entends que la réception est finie, et les voilà qui sortent du grand salon.
– Voyons…
La belle duchesse alla vers la croisée qu’Honorine venait d’ouvrir, se pencha sur le balcon avec un long bâillement et se mit à regarder dans l’immense cour d’honneur qui précédait le château de Lagarde. Une douzaine de personnes descendaient le perron qui menait au rez-de-chaussée.
– Quel est cet homme en velours noir, auquel parle mon père ?
– Madame, c’est le docteur Lussay.
– Ça, un docteur ? il n’a pas trente ans !
– On dit pourtant que c’est un très savant médecin ; et puis un homme terrible, madame.
– Bon ! c’est un avorton. S’il m’appartenait, j’en ferais un nain. Est-ce que ces chanoines ne sentent pas mauvais ?
– Madame, ce sont tous des prêtres très respectables.
– Ils ne sont pas très gras. Qu’est-ce que c’est que tous ces gens là-bas, près des écuries ?
– Ce sont des fermiers qui attendent leur tour pour présenter leur hommage à monsieur le marquis.
– Est-ce que les fermiers portent de la poudre en Auvergne ?
– Non, madame, jamais.
– Qu’est-ce que c’est donc que ce paysan qui cause avec ces deux filles ?
– C’est Jean, madame.
La duchesse se retourna au soupir qui s’échappa de la bouche d’Honorine lorsque la jeune fille lui fit cette dernière réponse, puis elle ajouta :
– Ce garçon est ton amoureux ?
Honorine devint rouge et triste, et répondit en secouant la tête avec un sourire mélancolique :
– Hélas ! non, madame, ce n’est pas mon amoureux !
– Eh bien, pourquoi n’est-il pas ton amoureux ?
– Oh ! madame, Jean ne fait pas attention à une pauvre fille comme moi : c’est un meunier qui est riche, et il y a plus d’un bourgeois de la ville qui lui donnerait sa fille…
– En mariage ? à un paysan !
– À coup sûr, madame.
– Ces bourgeois-là se vendraient pour un écu. Ils ont pourtant une sorte de rang entre eux.
– Ah ! madame, il y a des bourgeoises de la ville, des plus huppées et des plus jolies, qui ne disent pas comme vous ; et si le maire et le premier échevin sont brouillés et ont failli se battre, il y a quelques mois, c’est que leurs femmes en voulaient toutes deux.
– Pour leurs filles ?
– Oh ! non, madame, pour elles.
– C’est bien différent. Ah ! ce garçon a des maîtresses parmi vos bourgeoises ?
– Et parmi les dames aussi.
– Comment ça ?
– Dame ! on dit que la femme du seigneur du Berbis lui donnait des rendez-vous la nuit dans le petit bois de l’Étang.
– Dans un bois ! elle est donc folle, cette femme ? ça n’a donc pas une chambre ?
– Oh ! madame, c’est qu’on ne fait pas faire tout ce qu’on veut à Jean, et on le prend comme on peut.
– Mais c’est donc un héros que ce garçon ? qu’est-ce qu’il a donc de si séduisant ?
– Dame ! madame, c’est qu’il est très beau, voyez-vous ; une si belle figure ! et tourné comme un seigneur !
– Ah ! il est beau ? c’est l’Apollon de l’Auvergne !
– Et puis, madame, il y a autre chose, c’est qu’il ne pense qu’à ça.
– À quoi ?
– On dit, madame, on dit que c’est un enragé après les femmes.
À ce singulier propos, la duchesse regarda Honorine ; mais il y avait tant de bonne foi dans le visage de la jeune fille, que madame d’Avarenne vit bien qu’elle n’attachait pas un sens exact à un mot qu’elle avait sans doute entendu et qu’elle redisait tout naïvement ; aussi la duchesse se mit-elle à rire en répétant deux ou trois fois :
– Ah ! c’est un enragé après les femmes. Voyons un peu ce superbe. Donne-moi ma lunette.
Honorine rentra dans la chambre, et la duchesse, demeurée sur le balcon, promena autour d’elle un regard ennuyé qui s’arrêta subitement sur la grande avenue qui, du bourg de l’Étang, montait jusqu’au château. Elle prit vivement la lunette que lui présenta la jeune fille ; mais, au lieu de la diriger sur le beau meunier, comme celle-ci s’y attendait, elle regarda attentivement dans l’avenue. Enfin elle murmura avec un dépit marqué :
– Oui, c’est le carrosse de mon oncle, c’est lui… Oh ! c’est trop violent… ce n’est pas assez de l’exil, on veut encore m’infliger le sermon. Oh ! qu’il reste à prêcher ses ouailles de Clermont, monsieur l’évêque auvergnat ! C’est juste, mon père a appelé un auxiliaire. J’écrirai au prince, il faut que tout ceci finisse ; je suis lasse d’être persécutée.
Aussitôt elle quitta le balcon avec humeur, jeta sa lunette sur une table et s’assit dans son grand fauteuil, où elle demeura plongée dans ses réflexions jusqu’à ce que le bruit des roues vînt l’avertir que le carrosse entrait dans la cour. Aussitôt elle se leva violemment ; et, prenant un parasol, elle s’apprêta à sortir en disant à Honorine :
– Je suis malade pour toute la journée ; je ne puis sortir de ma chambre ni recevoir personne, entends-tu ? tu diras cela à mon père, s’il me fait demander ou s’il veut m’amener mon oncle.
– Oui, madame.
– S’il arrivait un courrier, fais sonner un retour par Dubois, sans lui dire pourquoi ; je saurai ce que cela signifie.
– Oui, madame.
La duchesse gagna, par un long corridor, un escalier qui descendait à l’une des extrémités des bâtiments, en sortit furtivement et s’enfonça rapidement dans un bois qui était tout proche. Pendant quelques moments, elle marcha avec rapidité, écoutant avec anxiété si elle n’était pas poursuivie ; puis, lorsqu’elle fut assez avant dans le taillis pour qu’aucun regard ne vînt l’atteindre, elle s’arrêta, s’assit et se mit à réfléchir à son aise.
C’était un singulier esprit que celui de mademoiselle Charlotte-Diane de l’Étang, devenue, par mariage, duchesse d’Avarenne. La morgue nobiliaire la plus insolente, le philosophisme le plus silencieux, se confondaient en elle, et même s’y fondaient de manière à composer un caractère déjà bien rare à l’époque où elle en faisait scandale, et qui, pour nous, doit prendre date dans le romanesque des temps passés. Madame d’Avarenne avait deux prétentions qu’elle seule ne trouvait pas contradictoires : la première était d’être d’une maison qui ne s’était jamais salie par une mésalliance ; la seconde, celle de ne pas avoir de préjugés. L’une de ces prétentions est assez facile à comprendre, l’autre demande quelques explications. La première était cet orgueil de pur-sang, si facile à l’homme, qu’il menace d’envahir tout cordonnier dont le père et le grand-père ont été honorablement cordonniers ; c’était cette vanité de bonne descendance qui accolait la probité comme blason aux noms de certaines familles bourgeoises, et qui, parmi la noblesse, n’avait d’autre tort que de pouvoir se passer de mérite. Cette prétention était un héritage antique recueilli en naissant, idée prise au berceau, grandie avec le temps, entrée dans la nature de la duchesse ; la seconde était le mauvais fruit d’une fausse éducation, ou plutôt d’une éducation mal déduite. Si nous voulions régenter, nous pourrions faire ici la guerre à l’esprit d’erreur qui a égaré le besoin d’affranchissement du dix-huitième siècle.
La société gémissait alors, entravée par les mille liens de patronage que la féodalité avait légués à la gentillâtrerie et par la suprématie que le clergé s’était arrogée sur toute pensée. Chacune de ces tyrannies avait ses ennemis directs et particuliers ; ceux de l’aristocratie furent d’abord les bourgeois de la Cité, dont la vanité s’irritait qu’il y eût encore une ligne de démarcation entre eux et une noblesse qu’ils touchaient de si près par la fortune et l’instruction. Richelieu et Louis XIV, en descendant la noblesse à ce degré de n’avoir plus qu’un parchemin pour rempart, furent les véritables destructeurs de la féodalité. Le jour où un Montmorency put dépouiller tous ses privilèges en déclinant à la tribune de la Constituante deux feuilles de papier, ce jour-là il n’y avait déjà plus de véritable aristocratie. Le noble baron eût sans doute mis plus de temps à rendre ses bons châteaux du Languedoc et à enclouer ses canons, s’il les avait possédés encore. Les autres ennemis de la noblesse étaient les paysans, les seuls qui souffrissent véritablement d’un reste de féodalité terrienne qui les atteignit par la redevance, l’impôt, la dîme et ce qu’on appelait la basse justice : misères presque toujours aggravées par l’interoffice des intendants et juges bourgeois qui faisaient à leur profit de l’exaction et de la tyrannie seigneuriale. La lutte de la noblesse contre la bourgeoisie et le peuple a eu son histoire si terriblement écrite en pages de sang, d’incendie et de destruction depuis 1790, qu’il est inutile d’en parler. Mais la lutte qui précéda et prépara celle-ci fut celle de l’indépendance de la pensée contre la puissance théologale. À part les droits seigneuriaux qui appartenaient au clergé comme à la noblesse, et qui leur donnaient des adversaires communs, l’Église avait de plus ceux que son autorité spéciale heurtait à part et gênait dans leur marche ; je veux dire les écrivains, les philosophes, les savants. Ceux-ci, gens du monde, élégants, spirituels, à belles manières, fêtés et caressés par les grands, n’eurent point de haine contre eux ; ils ne pensèrent point à les combattre en masse. Voltaire faisait la Henriade pour chanter les grands noms de France, et, s’il oubliait Sully dans l’histoire de Henri IV, ce n’était point en haine de sa caste, mais parce que l’arrière-petit-fils de ce ministre avait fait une impertinence au poète. Il ajoutait plus tard à cette œuvre, Zaïre pour les Lusignan ; Adélaïde duGuesclin pour nommer Vendôme, et mille petites balivernes pour cajoler Richelieu. Monsieur de Montesquieu tenait pour la noblesse de robe ; d’Alembert criait à toute force qu’il était bâtard d’une grande dame ; le baron d’Holbach était baron comme un Allemand qu’il était, et Rousseau, ne lui reprochait de le paraître que parce qu’il était fils d’un parvenu ; Marmontel arrangeait comme un laquais des intrigues de ruelles, pour chasser madame, de Châteauroux du lit de Louis XV ; Diderot louait monsieur Malesherbes pour avoir caché dans son hôtel les manuscrits de l’Encyclopédie, qu’il avait ordre de faire saisir comme magistrat, et allait en Russie pour remercier Catherine II de la pension de mille livres dont elle lui avait fait payer cinquante années d’avance. Mais tous, sans exception, frappaient au cœur le clergé, le clergé qui jugeait, condamnait et brûlait les livres. N’osant cependant l’attaquer dans son pouvoir terrestre, ils l’assiégèrent dans son pouvoir spirituel ; ils nièrent son origine, contestèrent le principe pour abolir les conséquences, et voulurent tuer Dieu pour ôter la dîme aux prêtres et la censure à la Sorbonne.
De là naquit cette grande émotion morale qui donna à chacun besoin et droit de discussion contre tout pouvoir qui existait à son détriment, et qui persuada au tiers état et à la campagne de se débarrasser du seigneur terrien qui l’opprimait, ad exemplar du philosophe qui honnissait le Christ au nom duquel on supprimait ses œuvres : 89 fut le résultat de toutes ces puissances destructives, l’aphorisme vivant de toutes ces discussions écrites. Mais cela posé, montrer comment toute puissance essayée pour la première fois va toujours au-delà du but qui lui est marqué, comment le premier ballon se perdit dans l’espace, comment éclata la première machine à feu, et comment la liberté poussa la théorie jusqu’à décréter en pratique la permanence de la guillotine, ce serait redire une triviale vérité que de réduire nos observations à ces vulgaires propositions. D’une autre part, ce serait une histoire de l’esprit humain, au-dessus de nos forces et au-delà des prétentions de ce livre, que d’analyser et de suivre ce mouvement prodigieux dans son ensemble et ses détails, jusqu’au moment où il creva la société par toutes ses faces. Tout le monde voit la foudre quand elle éclaire ; il faut être Franklin pour découvrir l’électricité. Nous laisserons donc ces grandes questions à de plus savants ; et, de cette mine féconde d’où la philosophie peut faire sortir tant de systèmes, nous tirerons un tout petit filon imperceptible et ténu comme la sécrétion du ver à soie, et nous le suivrons pour nous guider dans le caractère inextricable de la duchesse d’Avarenne.
Diane était une femme née ardente d’esprit et de corps ; froide de cœur, peu vaniteuse de sa personne, mais fière à l’extrême de sa race ; heureuse d’être belle parce qu’elle était femme, mais n’en tirant point profit comme femme. Elle avait désiré l’union qu’elle avait contractée parce que son mari était un grand seigneur, et que le nom de l’Étang s’alliait bien à celui d’Avarenne ; mais elle ne demandait aucune reconnaissance pour s’être livrée, belle et blanche, à un bossu noir et sale. Lorsque son esprit hardi et subtil voulait s’exercer et tenter une conquête, elle cherchait quelque esprit à vaincre et était flattée de la louange du plus bas faquin qui passait pour homme de talent. Elle avait disputé les amours d’un prince à une courtisane sortie d’un mauvais lieu ; mais elle n’avait été charmée de l’emporter que parce que le prince lui avait dit qu’elle était plus belle et plus amusante que la courtisane. Elle eût rougit d’elle-même, si la considération de son rang fût entrée pour quelque chose dans cette victoire. Lorsque la jeunesse de son corps inquiétait ses nuits solitaires, elle ne rêvait ni empereur ni roi, mais force et beauté. Elle trouvait juste que tout fût traité d’égal à égal ; mademoiselle Diane de l’Étang contre le duc d’Avarenne ; le nom contre le nom ; le but du combat, le mariage ; la coquette belle et spirituelle Diane, contre la coquette, belle et spirituelle courtisane ; la séduction contre la séduction, le but était l’hommage d’un prince connaisseur. La femme belle, passionnée, infatigable, délirante, fougueuse et nue, au plus beau, au plus infatigable des hommes. Elle avait sa trinité qu’elle distribuait ainsi : la fille noble au noble mari ; Aspasie à Alcibiade ; Messaline au portefaix du coin. Elle ouvrait son salon aux plus puissants noms de France, son boudoir aux plus experts en galanterie, son lit aux plus jeunes et aux plus beaux.
Ce caractère, dont les mémoires de l’époque nous ont légué plus d’un modèle, semble incompréhensible à la raison de notre époque, et il nous est difficile de nous expliquer l’existence d’une vanité sincèrement aristocratique, avec un si brutal abandon de sa dignité personnelle. C’est ici le cas de faire application de nos observations sur la marche philosophique du dix-huitième siècle. La philosophie de ce siècle, comme nous l’avons dit, parla bien de liberté naturelle, mais point de liberté politique. Jamais, à aucune époque de notre histoire, il ne fut moins question du droit de régler les dépenses de l’État, droit que possédaient le quinzième et le seizième siècle ; mais jamais on ne s’occupa davantage du droit de nier Dieu, la religion et les prêtres. La noblesse, et ce fut une grande faute, la noblesse, qui ne s’apercevait pas qu’elle finirait par être de la partie, non vis-à-vis des philosophes, mais vis-à-vis du peuple, laissa faire et alla même jusqu’à approuver une morale qui s’accommodait si fort à ses goûts de libertinage et qui n’attaquait pas ses prérogatives. Quelques questions d’égalité furent bien soulevées parmi toutes ces discussions auxquelles la noblesse prenait part ; mais c’étaient des questions d’égalité humaine et non point politique. On voulut bien reconnaître qu’un manant était l’égal d’un noble, en tant que le manant avait les jambes et le visage aussi bien faits que le noble ; mais cela dans le simple rapport d’homme à homme, la question du bourgeois et du gentilhomme demeurant intacte. De là cette distinction subtile qui fit de tant de grands seigneurs et de grandes dames des êtres doubles qui consentaient à l’état de nature pour les jouissances de leur corps, mais qui conservaient très entière la supériorité de leur position sociale. En conséquence, la duchesse d’Avarenne et beaucoup d’autres usaient naturellement et philosophiquement de leurs laquais ; tirant ainsi des principes d’une philosophie vraie dans sa généralité, mais appliquée faussement à des exceptions, les conséquences qui allaient à leurs passions. Ce ne fut que plus tard que le peuple y puisa celles qui allaient à ses intérêts. Cherchez dans tous les écrivains du dix-septième siècle, jusqu’au règne de Louis XVI, où les embarras matériels des finances ramenaient l’esprit public à une application matérielle des principes de liberté ; cherchez un écrivain qui ait osé tirer des principes de l’égalité humaine, si radicalement posés, les conséquences de la destruction des privilèges et de la participation de tous au gouvernement ; vous ne le trouverez point. On écrivait, à la vérité, en vers mal rimés :
mais personne ne pensait à dire qu’à ces hommes égaux il fallait des droits égaux.
Soit que le besoin d’égalité naturelle, soit que la protection qu’une grande partie de la noblesse avait accordée aux philosophes trompassent ceux-ci sur l’anomalie de l’existence de l’aristocratie avec leurs principes, soit qu’ils n’en eussent pas calculé toute la portée, il est certain que l’aristocratie se crut longtemps à l’abri du mouvement qui renversa la religion et le clergé, et qu’elle laissa faire, sans s’apercevoir que tous les privilèges de l’ancienne monarchie s’étayaient l’un l’autre, et qu’un tombé, tous les autres crouleraient.
Voilà bien des réflexions à propos d’un caprice de femme qu’un autre eût rapporté tout naïvement, et qui se fût expliqué tant bien que mal à l’esprit du lecteur ; d’autant que ce caprice n’est point encore consommé, comme dirait Beaumarchais, et que nous nous sommes arrêté au milieu de notre récit, pour divaguer sur un caractère au lieu de le faire agir, ce qui est bien plus dans les données des romans actuels. Reprenons donc.
La duchesse d’Avarenne était dans le taillis, assise sur un banc de gazon, pensant à sa situation présente. Comme elle suivait volontiers le cours de son histoire dans le passé pour en mieux calculer les chances dans l’avenir, nous allons nous mettre à la piste de ses réflexions et les noter chemin faisant.
– Me voici donc, se disait-elle, confinée dans le château de mon père, au moment où je me croyais au sommet de la fortune et de la puissance. Il n’y a dans toute la cour de Louis XVI qu’un prince qui vaille la peine qu’une femme en fasse son amant, et ce prince était mon esclave. Déjà, grâce à son crédit, mon mari, exilé dans une ambassade, ne mettait plus d’obstacle à nos plaisirs, à mes triomphes, au luxe de ma maison, à mes fêtes qui faisaient envie aux privilégiés du Petit-Trianon ; je commençais à être heureuse ce que je valais, lorsque voilà une femme qui se jette à la traverse de mon avenir : dans le but de s’emparer de celui qui m’appartient, elle me fait un crime d’une liaison qu’elle ambitionne pour elle, et parce qu’elle ne sera que la maîtresse de demain, elle a l’art de faire entrer dans ses intérêts l’épouse imbécile de ce prince, et de faire renvoyer la maîtresse d’aujourd’hui. On mêle à tout cela la pruderie de la reine, l’austère vertu du roi, la dévotion de Mesdames. On menace mon père ; on parle de rappeler mon mari, on me fait entendre que la terre de l’Étang a besoin de la présence de mon père, et mon père de la présence de sa fille ; et pour que tout cela arrive sans que je puisse y rien opposer, on envoie le prince dans sa province sous prétexte d’une assemblée des notables qui n’a été convoquée que pour ça ; et je suis forcée de partir dans les vingt-quatre heures, et me voilà reléguée dans un désert épouvantable où je meurs d’ennui depuis ce jour et demi que j’y suis. En vérité, tout cela s’est succédé si vite, que je n’ai pas eu le temps d’y réfléchir. Il faut pourtant prendre un parti. Irai-je retrouver M. d’Avarenne ? ce serait abandonner la partie sans la défendre. Retournerai-je à Versailles dès que le prince y sera arrivé ? ce serait m’exposer peut-être à un nouvel ordre d’exil que cette fois ma désobéissance rendrait irrévocable. Faut-il attendre ici que tout soit apaisé là-bas ? mais le prince a un cœur tout au plus vaniteux, qui m’aimait parce qu’il y avait mode à m’avoir, danger de me perdre, et qu’il était en rivalité avec les hommes les plus charmants. Il me laissera mourir ici : dans quinze jours je serai remplacée par une autre ; qui sait même si déjà il ne m’a pas oubliée ? Car enfin j’ai bien calculé : il eût pu m’envoyer un courrier pour me dire ce qui se passe ; nous avons voyagé assez lentement pour cela. Ce misérable courrier ! je n’entendais pas galoper un cheval derrière ma voiture, qu’il ne me semblât que ce dût être une livrée verte à galon d’or qui me poursuivait pour me remettre un ordre de retourner sur-le-champ ; mais le cheval passait, et c’était quelque bourgeois qui galopait. Peste soit du bourgeois qui galope ! Voilà comment j’ai fait mon voyage jusqu’ici ; toujours attendant et toujours trompée. Je suis arrivée depuis avant-hier et je n’ai rien reçu… c’est inconcevable ! c’est monstrueux ! Ce prince est si crédule quelquefois ! on lui aurait fait peur du diable, et puis, si libertin ! il se vautre dans quelque orgie ; et d’une incurie ! il passe tout son temps à des sottises. Décidément je suis abandonnée, perdue ; je suis…
Elle en était là, lorsqu’elle entendit marcher dans le bois. Celui qui venait semblait s’arrêter de temps en temps, comme quelqu’un qui examine les endroits par où il passe, pour y découvrir une personne ou un objet. La première pensée de la duchesse fut que c’était elle qu’on cherchait, et son premier mouvement fut de s’éloigner ; le second fut d’attendre et d’accueillir l’importun, fût-ce son père ou son oncle, de manière à se débarrasser de leur morale pour quelque temps. Déjà elle avait préparé deux ou trois phrases à emportement, de ces phrases avec lesquelles les femmes ont presque toujours raison : parce que, si c’était un homme qui vous les adressât, il faudrait y répondre par un soufflet, et que ce moyen n’étant pas de mise avec le sexe et à une certaine hauteur sociale, il faut se taire et boire les impertinences. On parle beaucoup de la tyrannie de la force ; la tyrannie de la faiblesse est bien autrement cruelle et abusive. Il y a aussi la tyrannie de l’infamie, celle qui s’établit si bien dans le vice, s’y pavane si fièrement, s’y graisse si complètement de boue, qu’il ne reste plus un endroit où puisse arriver une vengeance. Nous avons tous commun malheureux qui est mort, et qui se délectait à écrire dans son journal quelque calomnie sur le premier honnête homme dont la pensée lui venait en s’éveillant ; l’injure écrite s’imprimait, l’honnête homme la lisait ; il se mettait en fureur, prenait un ami, des pistolets et une épée, et allait trouver le libelliste. Il lui demandait raison, celui-ci lui riait au nez ; il l’insultait alors celui-ci riait plus fort ; il l’appelait lâche, le lâche haussait les épaules ; il le souffletait, le souffleté criait à l’assassin. Satisfait de sa vengeance, l’honnête homme sortait, se croyant en repos dans sa bonne renommée, par la correction qu’il avait infligée. Le lendemain amenait une autre feuille et une autre injure, partant autre fureur, autre visite, autre ricanement, autre insulte ; ce jour-là il crachait au visage du calomniateur et pensait tout fini. Le calomniateur attendait que la porte de la rue fût fermée, et une plus mortelle, plus infâme injure se levait avec l’aurore et la feuille du lendemain. À cette hideuse obstination, j’ai vu de paisibles honnêtes gens rugir et demander comment il fallait faire taire ce misérable. Ils se calmaient, car il leur naissait une idée de vengeance. Le soir même, ils attendaient l’homme au coin d’une rue, le prenaient au collet, le bâtonnaient jusqu’à la poignée de la canne et le renvoyaient avec le bras droit cassé. Le gueux savait écrire de la main gauche, et l’insulte quotidienne se réveillait encore le lendemain, colportée dans Paris à quelques centaines d’abonnés, expédiée par la poste à un millier de lecteurs. Que faire alors ? se taire, ou composer, ou devenir assassin. L’honnête homme était le plus faible, il restait honnête homme, et l’infâme riait et se pavanait dans sa victoire. Voilà ce que nous appelons la tyrannie de l’infamie ; elle a mille autres moyens de procéder, mais nous nous contenterons de cet exemple. Nous aurions encore à développer les divers systèmes de la tyrannie du malheur : depuis le proscrit qui s’amuse à enfreindre les lois du pays qui le recueille, et qui traite la plus simple réprimande d’outrage au malheur ; jusqu’à l’enfant trouvé reçu dans une famille et qui crie à la plus légère correction : – C’est parce que je suis seul et misérable qu’on m’opprime : l’un et l’autre gagnant quelquefois l’impunité par la peur où ils mettent d’honnêtes gens de manquer au respect qu’on doit à l’infortune.
Madame d’Avarenne avait à sa disposition ces trois genres de tyrannie. Supposons que ce qu’elle craignait fût arrivé, que c’eût été quelque sermonneur qui fût venu lui porter au bois une réprimande bien méritée ; supposons un frère qui parle :
– Ma sœur, votre intrigue avec le prince a scandalisé la cour et déshonoré votre nom !
– Mon frère, vous n’avez eu rien à dire contre cette intrigue, lorsqu’elle vous a fait nommer colonel, puis brigadier des armées du roi.
– Si j’avais su le moyen…
– Laissez donc, vous le saviez, et si votre femme n’était pas un petit monstre imbécile, vous l’auriez conduite, l’épée au côté, dans l’alcôve du prince.
– Ma sœur, vous êtes bien heureuse de n’être qu’une femme !
Et le frère serait parti en grinçant des dents.
Supposez l’oncle maintenant :
– Ma nièce, votre conduite scandalise les honnêtes gens et brave le ciel.
– Je me soucie peu du ciel et des honnêtes gens.
– Ce qu’on dit de vous passe toute croyance.
– Quoi ! on dit que j’ai un amant ? deux ? trois ? dix ? eh bien, c’est vrai ! ça m’amuse ; ça ne vous regarde pas ; et si on me dit quelque chose, j’en aurai cent.
– Ah ! ma nièce, voilà donc ce que vous ont appris les philosophes !
– Les philosophes sont des gens d’esprit, les dévots des imbéciles ; il n’y a plus que les brutes qui jeûnent, fassent carême et se passent de quelque chose.
– Mais savez-vous quels noms vous méritent vos façons d’agir ?
– Quoi ! on m’appellera athée ? c’est à la mode ; catin ? ne l’est pas qui veut ; d’ailleurs il y a longtemps qu’on m’a dit tout cela.
– Et cela ne vous a pas fait honte ?
– Honte ! je n’ai pas le temps.
– Ah ! ma nièce, je me retire ; vous êtes descendue plus bas que je ne pensais.
– Bonjour, mon oncle ; mes respects à vos ouailles. Puis le saint évêque, le cœur navré, s’en va épouvanté abasourdi, sans avoir pu trouver un joint où percer cette cuirasse d’impudence et arriver au cœur. Voici pour le père :
– Eh bien ! ma fille, voilà le fruit de vos imprudences : l’exil, la perte de tout avenir, de toute fortune.
– Grand merci, mon père ; je n’ai pas assez de mon malheur, il faut que vous m’accabliez de vos doléances.
– Mais ce malheur, c’est vous qui l’avez voulu.
– Est-ce une raison pour venir me le reprocher ? Qu’est-ce que je vous demande ? c’est de me laisser seule souffrir dans un coin.
– Cependant…
– Est-ce que je me plains, moi ? je suis forte, j’ai du courage ; mais s’il faut que j’aie encore à supporter votre humeur, j’avoue que j’y succomberai… la vie à ce prix est insupportable…
– Mais cependant…
– Oui, monsieur, j’aime mieux mourir ! Dieu ! mon Dieu ! que je suis malheureuse ! Et vous aussi qui dites m’aimer, vous vous joignez à mes ennemis… Eh bien ! soit ; tout ceci finira. La vie dans ce château… est-ce le bonheur, est-ce la fortune, est-ce le plaisir, pour y tenir beaucoup ?
– Allons, allons, Diane, vous devenez folle.
– Folle ! ah ! non, monsieur ; je sais ce que je dis. Tenez, monsieur, je suis au désespoir ; laissez-moi, laissez-moi, je ne réponds plus de ce que je puis faire.
– Mais écoutez-moi.
– Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! quelle tyrannie !
Et sur ce, la belle désespérée se serait pressé le front avec rage, elle eût dérangé trois boucles de sa belle frisure, avec mine d’enfoncer ses ongles dans ses beaux yeux, et le père craintif, attendri, se serait retiré prudemment pour ne pas exaspérer ce cœur ulcéré.
Voilà ce qui n’arriva pas, mais ce qui serait infailliblement arrivé, si c’eussent été frère, oncle ou père qui se fussent présentés dans le bois devant la belle duchesse d’Avarenne ; mais ce n’était personne qui eût droit à remontrance, car c’était tout simplement Jean d’Aspert, le beau meunier, qui, dès qu’il aperçut la duchesse, marcha rapidement vers elle, le chapeau à la main, l’air profondément respectueux et embarrassé. Dès qu’il fut près d’elle, il tira un paquet de sa poche et le présenta à la duchesse.
– Qu’est cela ?
– Des lettres qu’un homme qui rôdait autour du château voulait faire remettre secrètement à madame la duchesse.
– Quel homme ?
– Une sorte de postillon en vert, galonné d’or.
– Ah ! très bien ! Pourquoi ne l’avez-vous pas introduit.
– Parce qu’il m’a dit qu’il ne fallait pas qu’on soupçonnât son arrivée ici. Si madame la duchesse eût été dans son appartement, j’aurais pu y conduire secrètement cet étranger ; mais j’avais vu madame entrer dans ce parc et se diriger vers ce bois ; j’ai pensé que la livrée de cet homme pourrait le faire remarquer, et j’ai cru que c’était mieux le servir de me charger moi-même de ses lettres et de venir vous les apporter, car je suis connu ici de tout le monde, et l’on ne fera pas attention à moi.
– Et qu’est devenu cet homme ?
– Il attend au bourg la réponse que je me suis chargé de lui reporter.
– C’est bien, dit la duchesse, attendez ; et d’un geste de la main elle congédia le beau meunier, qui se retira.
Elle ouvrit alors le papier, et, sous une enveloppe qui promettait une lettre bien longue, bien explicative, elle trouva un petit billet plié en deux, avec ces quatre lignes :
« Mes belles amours, vous avez fait bien des imprudences, à ce qu’il me paraît ; le roi est très irrité ; je n’ai pas encore osé lui parler de vous, Prenez patience ; je prévois que d’ici à quelque temps on aura besoin de moi ; je négocierai alors votre retour. Je suis toujours très épris de vous et très reconnaissant de l’amour que vous me portez. Vous êtes dans un si horrible pays, que je ne vous demande pas la fidélité comme une preuve d’amour, et je me garde ce mérite ; à défaut de celui-là, ayez celui de penser beaucoup à moi et de me l’écrire souvent. Mille baisers sur vos beaux yeux. Si l’on vous envoie le quatrain suivant, n’y croyez pas :
L’immobilité qui suivit la lecture de cet étrange billet attestait une rare confusion dans les pensées de la duchesse ; elle avait cru calculer et prévoir tous les malheurs de sa position, et elle voyait dépassé d’un coup et du premier abord tout ce qu’elle avait prévu et calculé. En effet, rien n’était plus froid, plus sec que ce billet ; pas un mot ou de consolation, d’espérance prochaine, de dévouement, ou d’effort en sa faveur : une négociation éloignée, très éventuelle dans son succès, une excuse d’infidélité qui avait l’air d’une vanterie. Il y avait de quoi en perdre la tête. Mais la duchesse avait sans doute devers elle quelques moyens d’exiger du prince ce qu’elle eût préféré devoir à son empressement, car elle froissa le billet avec colère et dit tout haut en se levant :
– Ah ! nous nous reverrons…
Aussitôt elle sortit du bois et rentra dans son appartement pour faire la réponse qu’attendait le courrier. Cette réponse, toute de colère et d’humeur, fut bientôt prête. La duchesse y menaçait son amant d’un éclat assez habile pour le compromettre, et lui disait très hautainement qu’elle saurait bien le placer entre la nécessité de résister pour elle aux ordres de la cour et de l’y maintenir d’autorité, et la honte de l’abandonner lâchement ; et qu’alors elle n’aurait plus de ménagements à garder sur la publicité d’un secret dont elle avait en main des preuves irrécusables. Elle donnait au prince le temps de lui renvoyer une réponse ; mais ce délai passé, si la réponse n’arrivait pas ou si elle n’était pas satisfaisante, elle partait et retournait à Versailles, et qu’alors il fallait qu’il se décidât.
La réponse prête, il fallut avoir le messager intermédiaire pour la remettre au courrier, et la duchesse donna ordre à Honorine de lui amener Jean d’Aspert, qui sans doute attendait quelque part dans le bois. Honorine répondit que le meunier lui avait parlé, et que, ayant affaire dans le château voisin, il l’avait avertie qu’il reviendrait le soir après la nuit tombée pour prendre les ordres de la duchesse et les transmettre au courrier, qui ne devait partir que le lendemain, ayant destiné tout ce jour à se reposer, après une longue route faite à franc étrier.
Ce retard contraria vivement madame d’Avarenne. Il y a de ces moments de colère où il faut entièrement accomplir la résolution qu’on y puise pour ne pas craindre d’en changer. Cette lettre écrite et qui n’était pas partie lui pesait, non point parce qu’elle arriverait un jour plus tard, mais parce qu’elle n’était pas en route pour sa destination. Le courrier se fût arrêté huit jours à trente lieues du village de l’Étang, qu’elle n’en eût éprouvé que peu d’impatience, sûre que son message irait où il était adressé, porterait coup, et, une fois entre les mains du prince, la forcerait par vanité à faire ce qu’elle avait annoncé. Mais, par un vague instinct de caprice, elle craignait qu’entre deux heures qui venaient de sonner et dix heures qu’il fallait attendre, il n’arrivât quelque évènement, quelque réflexion, quelque débat entre elle et son père, qui lui fissent retenir la lettre qu’elle venait d’écrire. Cette contrariété occupa la duchesse un quart d’heure, puis elle se remit à s’ennuyer.
Si l’oisiveté est la mère de tous les vices, l’ennui peut bien adopter comme ses enfants la meilleure part de tous les excès où se porte une imagination habituée à s’user à mille petits soins qui ne sont pas un travail, mais une occupation. Ainsi, quand, à trois heures, l’heure du dîner arriva et qu’on vint avertir la duchesse que son père l’attendait, il prit fantaisie à Diane de ne pas dîner, et elle demanda qu’on la laissât tranquille ; elle se fit malade, joua la malade, se mit au lit et se fit faire de la tisane. Le lit est fort ennuyeux et la tisane insipide ; à la seconde tasse, elle la jeta au milieu de la chambre, se leva et se mit à se promener en chemise dans son appartement. Le froid la prit, elle se fit faire du feu, et par le plus beau soleil de juin, on entassa des moitiés d’arbre dans la vaste cheminée de sa chambre. Elle s’amusa à regarder la flamme gagner toutes les bûches l’une après l’autre, et, quand tout ce monceau de bois fut enflammé, elle eut la petite espérance de voir prendre le feu à la cheminée. Il n’en arriva rien et elle se dégoûta de se chauffer. Elle appela Honorine ; la nuit était venue. La jeune fille, après avoir allumé une bougie, l’approcha de sa maîtresse, qui était enveloppée dans une robe de chambre de damas, et qui avait mis ses pieds nus dans des mules de velours noir. Elle demanda à sa maîtresse si elle désirait quelque chose.
– Qu’est-ce qu’il y a de curieux dans ce pays ? lui dit brusquement la duchesse.
– Rien, madame.
Il n’y a rien de curieux dans les choses les plus merveilleuses au milieu desquelles on vit. Notre-Dame de Paris n’a rien de curieux pour l’habitant de la Cité, qui passe tous les jours devant son magnifique portail. Le plus agreste paysage, la plus sublime ruine, n’ont rien de curieux pour le paysan qui déchire à la houe le flanc de la colline la plus pittoresque, ou qui s’abrite de la pluie sous quelque vieil arceau d’une abbaye du douzième siècle ; donc Honorine ne trouva rien de curieux à proposer à une dame qui avait vu Paris et Versailles.
– Est-ce qu’il n’y a pas de revenant quelque part ? dit la duchesse.
Honorine ne répondit pas : elle était devenue pâle et tremblait de tout son corps.
– Ah ! dit la duchesse, il y a des revenants ; à la bonne heure, conte-moi ça.
– Ah ! non, madame, il n’y a pas de revenants ; mais il y a des choses bien extraordinaires.
– Qu’est-ce donc ?
– Hélas ! madame, il y a des sorciers.
– Un vieux berger qui jette des sorts ? il y en a partout ! c’est très sale et très puant.
– Oh ! madame, reprit Honorine avec un sourire où perçait, à travers beaucoup de frayeur, un brin de vanité pour les sorciers de son pays, ce ne sont pas de vieux bergers. C’est bien plus épouvantable : c’est le docteur Lussay qui fait entrer des démons dans le corps de qui il veut, et qui les en fait sortir à volonté.
– Ah ! ce petit monsieur qui fait ici le charlatan ? c’est bon à savoir ; et qu’est-ce que cela lui rapporte ?
– Oh ! madame, le docteur ne prend rien pour ça ; au contraire, il paye ceux qui se laissent faire.
– Qu’est-ce qu’il leur fait donc ?
– Dame, madame, c’est bien difficile à vous expliquer. J’ai vu ça une fois ; mais j’ai eu si grande peur, que je n’ai pas osé y retourner.
– Tu te rappelles pourtant ce que tu as vu ; était-ce le diable en personne avec des cornes et le pied fourchu ?
– Non, madame. Imaginez-vous que c’était un soir, et le temps s’était couvert tout à coup, comme il menace de se couvrir en ce moment. Il faisait un terrible orage, et j’étais restée toute tremblante dans la grande chambre de notre maison, lorsque voilà Jean qui entre tout à coup, mouillé, sale, couvert de boue, et qui demande où était mon père ; mon père était à la ville et ne devait rentrer que le lendemain.
– C’est fort adroit à monsieur Jean d’être venu le chercher précisément ce jour-là, dit la duchesse avec un petit ricanement.
– Mais non, madame, puisque je ne pus pas lui donner ce qu’il demandait.
– Tu n’as pas pu lui donner ce qu’il te demandait ? reprit la duchesse en considérant Honorine d’un regard tout étonné de ce qu’une belle fille comme Honorine n’avait pas pu donner ce que demandait un beau garçon comme Jean. Elle ajouta donc avec un air de grande surprise : – Qu’est-ce qu’il te demandait donc de si extraordinaire ?
– Il me demandait, madame, la clef du grand caveau qui mène dans les souterrains du château.
– C’est donc un ivrogne ?
Honorine fit un geste d’impatience et presque d’indignation. Madame d’Avarenne, qui s’en aperçut, continua :
– Eh bien ! que voulait-il faire de cette clef ?
– Il voulait aller jusqu’à la maison du docteur, qui est une ancienne dépendance du château, et dont les caves communiquent avec celles de cette maison ; et ça pour surprendre les nécromancies que faisait le docteur ?
– Et pourquoi ?
– C’est, voyez-vous, que, dans ce temps-là, Jean faisait la cour à Louise ; Louise avait été un peu malade, et on avait fait venir monsieur Lussay : mais au lieu de la soigner avec des drogues, il l’avait guérie en lui touchant la tête avec les mains, en lui parlant, en lui traçant de grands cercles sur le front avec une baguette en acier, et en employant toutes sortes de simagrées ; si bien que Louise était comme l’âme damnée du docteur, lui obéissant au moindre geste et tremblant comme une feuille devant lui. Il y en avait d’autres dans le pays qui avaient été guéris comme Louise, et tous étaient de même que Louise ; de grands garçons de labour, de gros charretiers. Une fois que le docteur les approchait, il semblait qu’ils n’eussent plus ni courage, ni force ; c’est vrai ça, madame. On s’en aperçut dans le pays, et ça commença à donner des soupçons ; mais comme le docteur faisait du bien à tout le monde, on ne dit trop rien. Voilà pourtant qu’on finit par remarquer que presque tous les soirs, ceux qui avaient été guéris par monsieur Lussay s’en allaient de chez eux à la même heure, se rendaient chez le docteur et n’en sortaient que deux ou trois heures après, presque toujours la figure renversée. Il y en a qui se mirent aux aguets pour écouter ce qui s’y passait ; mais, comme la maison de monsieur Lussay est au milieu du jardin, on n’entendait rien de ce qui se faisait dedans. Pourtant tous ces pauvres gens, après avoir été guéris, dépérissaient à vue d’œil ; ils n’avaient pas de maladie, mais ils étaient pâles, maigres, chétifs ; le moindre bruit les faisait tressaillir ; et surtout la pauvre Louise, qui avait été si jolie ; elle était quasi comme une recluse. Son père lui avait défendu de retourner chez le docteur, et Jean l’en avait bien souvent priée : elle avait promis d’obéir ; mais lorsque l’heure du sabbat arrivait, elle parvenait toujours à s’échapper. C’était comme ça vers sept heures du soir. Une fois, son père l’enferma dans sa chambre ; mais la pauvre fille était si bien possédée, qu’elle sauta par la fenêtre, qui heureusement n’était pas haute, et qu’elle courut tout de suite chez monsieur Lussay. Quand le vieux Jacques rentra, Jacques c’est le père à Louise, il fut d’abord furieux de ce que sa fille s’était échappée, puis le pauvre bonhomme se mit à pleurer de ce qu’elle était possédée du démon. Ça fit du scandale, et le père Jacques voulut aller se plaindre au curé et demander qu’il exorcisât sa fille ; mais monsieur Lussay lui donna de l’argent, et le sabbat continua de plus belle. Jean, que tout ça ennuyait, et qui voyait Louise se pâlir et se fondre au point d’être comme un squelette, Jean voulait éreinter le docteur ; et, dame ! il n’y avait pas d’argent à lui donner, à lui, pour l’empêcher de taper. Mais Louise, à qui il s’était vanté de son envie, l’avait tant prié, en lui disant que c’était son bonheur à elle, et peut-être sa vie qu’il exposerait en touchant au docteur, qu’il laissa faire aussi ; et pourtant il devenait plus inquiet de jour en jour, car la tête de la pauvre fille se dérangeait ; elle parlait toute seule ; elle disait des choses incompréhensibles ; elle racontait que le docteur la menait en paradis, où il y avait des meubles superbes et des musiques qui la faisaient danser toute seule. Une fois elle voulait m’emmener en me disant :
– Viens, viens, et tu goûteras les joies du ciel, et tu sentiras le plaisir te pénétrer jusqu’à la moelle des os.
Et en parlant ainsi, elle avait les yeux qui lui sortaient de la tête et qui flamboyaient comme des chandelles. Ça me fit peur.
La duchesse, qui avait attentivement écouté jusque-là, se prit à rire.
– Jean me paraît de tournure à donner de ces joies-là d’une meilleure façon que le docteur. Mais enfin, que voulait-il, le soir qu’il était chez toi ?
– Voici : il avait voulu empêcher Louise d’aller au sabbat comme à l’ordinaire, et pour ça, il avait obtenu de son père de l’emmener à deux lieues d’ici ; ils causaient tranquillement dans une auberge du bourg voisin, lorsque voilà tout à coup sept heures qui sonnent. À peine Louise a-t-elle entendu l’horloge, qu’elle devient tout inquiète, en disant à Jean qu’il faut qu’elle parte, que l’heure est venue, qu’elle entend le docteur qui l’appelle ; puis elle ajoute, comme si elle parlait à quelqu’un : – J’y vais, j’y vais. Jean veut l’empêcher de sortir, il la supplie de rester ; mais Louise ne l’entendait plus, et paraissait causer avec un esprit qui la tourmentait. Elle se lève, Jean l’arrête de force ; elle se débat quelques instants, et, comme il la retenait toujours, la voilà qui tombe dans des crises affreuses : la pauvre fille se roulait par terre, se cognant la tête sur le coin des meubles, en écumant comme une enragée et en poussant de grands cris. Alors Jean la prend, la met sur un lit et reste à côté d’elle. Il n’y avait pas une minute qu’elle y était, que la voilà qui s’endort, mais d’un sommeil si lourd, si lourd, qu’elle paraissait morte. Jean commençait à se désespérer de l’avoir mise dans cet état, quand il la vit se lever sur son séant. Elle se frotta les yeux comme si elle se réveillait, et pourtant ses yeux restèrent fermés ; elle se leva tout à fait, et, quoiqu’elle fût habillée, la voilà qui fait comme si elle mettait ses bas, ses souliers et ses jupes. Jean, qui l’avait vue se meurtrir le visage et se frapper contre les meubles, quand il l’avait voulu arrêter, Jean la laissa faire. Aussitôt que Louise fut prête, je veux dire aussitôt qu’elle eut fait semblant d’être prête, car elle s’était regardée devant un miroir comme pour arranger son fichu et son bonnet, la voilà qui va tout droit à la porte de l’auberge, qui l’ouvre, qui sort dans la rue, et tout ça toujours les yeux fermés ; Jean la suit, n’osant la toucher, tant il était surpris. L’orage était venu, la pluie battait à verse, il ventait et tonnait, c’était un temps horrible. Louise n’eut pas l’air de s’en apercevoir, et tout aussitôt qu’elle fut dans la rue, elle tourna du côté du bourg, toujours les yeux fermés. Elle marchait d’une telle vitesse, elle si faible et si maigre, que Jean avait de la peine à la suivre. Quelquefois, il s’approchait d’elle et l’appelait, mais elle ne répondait pas. La nuit était tout à fait tombée et les petits sentiers qui coupent à travers les champs étaient tout inondés et presque disparus. Ça n’arrêta pas Louise ; elle les reconnaissait dans la nuit et y marchait comme en plein jour, et par une belle sécheresse. Plusieurs fois Jean voulut lui prendre la main, mais alors elle se mettait à crier et à trembler comme une convulsionnaire ; il la laissait donc aller comme elle voulait, la suivant toujours, et ne sachant plus où elle allait, tant la nuit était noire. Ça dura bien une demi-heure. Tout à coup Louise s’arrête à un mur qui lui barrait le passage, ouvre une petite porte basse que Jean ne voyait pas, entre et ferme la porte après elle ; Jean voulut l’enfoncer, mais il ne put y réussir. Enfin il tourne autour de la maison et reconnaît que c’est celle du docteur. Ils avaient fait presque deux lieues en trois quarts d’heure. Jean eut beau crier et frapper, personne ne lui répondit ; alors, ne sachant que faire, il escalada le mur et entra dans le jardin. Il s’approcha de la maison et entendit un bruit singulier ; c’était une douzaine de voix d’hommes et de femmes : les uns riaient et d’autres chantaient ; il y en avait qui poussaient de grands cris, d’autres qui gémissaient, tout cela mêlé d’une sorte de bourdonnement comme une voix qui prie. Il prit fantaisie à Jean de casser les fenêtres ou d’enfoncer une porte ; mais les volets étaient garnis de barreaux et les portes cadenassées. Ce fut alors qu’il pensa au caveau qui mène à la maison du docteur, et qu’il résolut de venir chez nous ; car, à force de tourner, il vit que les cris sortaient d’une cave, et, en appliquant son oreille au soupirail, il entendit plus distinctement le bruit qu’on y faisait, et reconnut Louise, qui disait sans cesse, avec une voix si forte que Jean eut peine à la reconnaître : – Encore ! encore ! encore !
À ce mot, la duchesse se prit à rire. Par un hasard singulier, un coup léger fut frappé à la porte de sa chambre. Honorine, que son propre récit avait épouvantée, se jeta vers madame d’Avarenne en poussant un cri et en tombant à genoux. Elle était pâle et portait autour d’elle des regards effarés : la pluie fouettait à torrents les vitres des grandes fenêtres ; le vent gémissait en longs hurlements dans les corridors du château ; la lueur de la bougie se perdait dans l’immensité de la chambre. À ces bruits, à cet aspect, la duchesse devint froide et pâle à son tour. Elle écoutait, lorsqu’un second coup, plus fortement frappé, la fit tressaillir ; mais soit courage, soit que le mot accoutumé qu’elle prononça lui échappât involontairement, elle dit d’une voix altérée :
– Entrez !…
Un homme parut, couvert d’un long manteau qui dégouttait de pluie, portant un large chapeau qu’il ôta en entrant dans la chambre : c’était Jean d’Aspert.
– Je viens, dit-il, chercher les ordres de madame la duchesse.
La terreur de madame d’Avarenne et celle d’Honorine avaient été si grandes, qu’elles ne s’en remirent ni l’une ni l’autre, même après avoir reconnu le meunier, et qu’elles ne répondirent pas tout de suite. L’apparition du héros de la singulière histoire de Louise, à ce moment, lui prêta quelque chose de romanesque et d’aventureux qui fit que la duchesse le considéra avec une attention curieuse. C’était véritablement l’un des plus beaux hommes qu’elle eût vus. Il avait quitté sa poudre, et ses cheveux noirs et bouclés roulaient-en larges anneaux sur son front élevé ; il portait une culotte et des guêtres de daim, et une ceinture de cuir, où pendait une paire de pistolets, serrait sa taille forte et cambrée. La duchesse, sans le quitter des yeux, lui dit d’une voix qui avait perdu cette liberté insolente dont elle usait vis-à-vis de gens si loin placés d’elle :
– Nous parlions de vous, monsieur.
– Vous m’attendiez, madame ; pardon si j’ai tant tardé ; mais le courrier m’attendra jusqu’à onze heures, et il n’en est que dix.
– Ah ! tant mieux, dit la duchesse, oubliant complètement le but de la visite de Jean ; vous me direz la fin de votre histoire.
– De mon histoire ? reprit le meunier étonné.
– L’histoire de Louise, dit Honorine ; j’étais en train de la conter à madame la duchesse quand vous êtes entré.
– Hélas ! madame, reprit Jean, c’est une bien triste histoire.
– Jusqu’à présent elle ne laisse pas d’être curieuse, répondit la duchesse ; mais la soirée est devenue froide, ranime un peu ce feu, Honorine ; allume-nous quelques bougies, nous sommes ici comme dans une tombe. Va à l’office et fais monter quelque chose pour moi. Depuis que je ne l’écoute plus, je me sens besoin de souper.
Honorine sortit, et Jean demeura debout devant la duchesse. Elle avait tourné son grand fauteuil du côté du feu, avait tiré ses jolis pieds blancs de ses mules noires, et les avait posés sur un coussin devant la flamme du foyer pour les réchauffer. Jean se taisait, et madame d’Avarenne, tout étonnée de ce silence, se retourna et vit Jean immobile, les yeux fixés sur ses pieds délicats, qu’il avait l’air de contempler avec envie. Jean, surpris dans son adoration, baissa subitement les yeux et devint rouge ; la duchesse le regarda en clignant les yeux, et un imperceptible sourire glissa sur ses lèvres, sourire que nous pourrions traduire ainsi : – Mais, oui-dà, ils sont blancs et jolis, et vos paysannes ne sont pas beaucoup riches en beautés de cette espèce. Puis, après le monologue de ce petit sourire, la duchesse se prit à rire tout de bon, d’un rire étouffé, à la vérité, mais qui voulait dire assurément : – Ce serait drôle de faire perdre la tête à ce garçon. Elle se retourna vers lui et vit les regards de Jean qui entraient audacieusement sous le col mal serré de sa robe de chambre, et qui s’appuyaient comme un baiser des yeux sur le satin de ses belles épaules. La duchesse rougit à son tour ; elle ramena ses pieds nus dans ses mules de velours, et regarda Jean, qui cette fois ne baissa les yeux qu’après avoir croisé son regard avec celui de madame d’Avarenne. Tous deux gardèrent le silence ; madame d’Avarenne le trouva tout au moins très osé. Une mauvaise pensée lui vint, celle de s’amuser aux dépens du beau meunier, et de lui faire dire quelque grosse balourdise. Alors, s’adressant à Jean avec son grand air de duchesse, elle lui dit en le toisant par-dessus l’épaule :
– Il paraît que vous faites des vôtres dans ce pays ?
– Eh ! madame, reprit Jean, on fait ce qu’on peut.
– Mais il y a autre chose à faire que de courir après toutes les jolies filles du pays pour les séduire et les abandonner, ajouta sèchement la duchesse.
Jean prit le reproche au sérieux ; il répondit sérieusement :
– J’ai aimé bien des filles, et je n’en ai séduit aucune. Je n’ai jamais été ni le premier amant ni le dernier de celles que j’ai eues ; à ce compte-là, on ne peut pas dire que je les aie séduites ni abandonnées.
La duchesse fut toute surprise du bien dit et du bien répondu de Jean ; elle s’attendait à quelque gros et niais sourire, avec des paroles entrecoupées et un chapeau gauchement tourné dans la main, comme faisaient les Guillots du théâtre de Monsieur. Elle n’en continua pas moins son rôle d’inquisition morale, et reprit d’un air sévère et en regardant le meunier au visage :
– Ce n’est pas tout : on dit que vous vous élevez jusqu’à des bourgeoises ?
Jean fronça le sourcil, et, avec un certain dédain où perçait presque de l’humeur, il répondit :
– Je ne sais, madame la duchesse, si je m’élève jusqu’aux bourgeoises, ou si les bourgeoises descendent jusqu’à moi ; mais il me semble qu’on n’entre guère dans le lit d’une femme que sur le pied d’égalité.
– Et vous appliqueriez le principe à une femme de qualité si elle s’abaissait jusqu’à vous ? reprit vivement madame d’Avarenne.
Jean devint pâle, et un éclair de colère brilla dans ses yeux ; il se mordit les lèvres, comme pour barrer passage à la réponse qu’il allait faire, et reprit d’une voix dont il ne put pas déguiser complètement l’altération, mais où il affectait de mettre le respect le plus révérencieux :
– Je me permettrai de rappeler à madame la duchesse que son courrier attend ses ordres.
Madame d’Avarenne regretta l’impertinence que Jean avait été sur le point de répondre, ne fût-ce que pour en rire plus tard ; mais elle demeura stupéfaite du langage et de la retenue du meunier ; et, pour s’éclairer tout à fait sur ce qu’était ce garçon, elle passa sans préambule à un autre genre de questions, renfermant, pour ainsi dire, toute la série de ses réflexions dans l’ellipse de la demande.
– Où avez-vous étudié ?
– Chez les jésuites de Toulouse, madame.
– Vous y avez connu mon beau-frère, l’abbé d’Avarenne ?
– Je l’y ai vu, madame.
– Il fait aussi des siennes, n’est-ce pas ?
– D’une autre façon, madame, dit Jean d’un ton sec.
– Oui, reprit la duchesse avec hauteur, de la façon d’un gentilhomme et non pas d’un manant.
En disant ces mots, la duchesse toisa le meunier d’un air de mépris. Jean baissa les yeux et reprit avec un ton marqué d’impatience mal contrainte :
– J’attends vos ordres, madame.
– Mais, reprit madame d’Avarenne, vous ne les attendez guère, car vous les demandez à toute minute.
Elle se tut et s’agita comme une femme qui voit qu’elle ne va pas au but qu’elle voulait atteindre. Dans la brusquerie de ses mouvements, sa robe se dérangea tout à fait et découvrit la naissance d’une jambe fine, délicate et suavement arrondie. Madame d’Avarenne réfléchissait en ce moment. Au bout d’une minute, elle s’aperçut de la nudité de ses jambes ; elle prit le pan de sa robe pour les voiler ; mais elle s’arrêta soudainement, resta dans cette position, et, glissant son regard de côté, elle chercha celui de Jean. Le regard de Jean était baissé, son visage sérieux : ou il n’avait pas vu cette nouvelle grâce, ou il n’y avait pas pris garde, ou il la dédaignait. La duchesse le trouva beaucoup plus impertinent que la première fois qu’il l’avait regardée. Elle se sentit de l’humeur ; pourquoi ? contre qui ? à quel propos ? elle n’en savait rien. Elle se décida à renvoyer Jean, se leva, prit le billet du prince et la lettre qu’elle avait répondue ; elle se remit au coin du feu pour voir si sa réponse était suffisante ; et pour en mieux juger, elle relut le billet du prince : il ne fit qu’accroître l’humeur où était la duchesse ; et quand elle arriva à cette phrase : « Vous êtes dans un si horrible pays, que je ne vous demande pas la fidélité comme une preuve d’amour, » elle ne put retenir une exclamation de colère et de mépris ; elle haussa les épaules, chiffonna le billet dans ses doigts et se mit encore à réfléchir en silence. Nouvelle humeur, nouvelle agitation, nouveau dérangement de robe de chambre : elle s’était ouverte du haut, et la soie du vêtement, glissant doucement sur la soie des épaules jusqu’à la naissance des bras, découvrit cette ligne pure, flexible, infinie, qui, partie de la tête, descendait, par un cou svelte et gracieux et par des épaules pures, blanches et fluides, jusque sous les plis de la robe, où elle se perdait si doucement, si vaguement, qu’il semblait que l’œil pût l’y poursuivre et l’y compléter. Les réflexions de la duchesse furent assez longues pour que Jean relevât les yeux et vît ce buste blanc et parfait ; assez longues aussi pour qu’après avoir détourné ses regards de cet enivrant aspect, il les y reportât malgré lui, puis les y tînt attachés ; puis enfin, oubliant qu’on pouvait surprendre ses regards, il se laissât aller à une admiration qui fit rougir son front et trembler son corps. Au bruit de sa respiration haletante, la duchesse se retourna ; mais le regard de Jean ne se baissa plus devant le sien, il y pénétra au contraire, y plongea de tout son feu, et ce fut celui de madame d’Avarenne qui, cette fois, se couvrit de ses paupières. Elle n’avait plus envie de gronder, et à ce moment où elle eût pu devenir sérieuse, elle eut le tort de vouloir rire, et elle dit gracieusement à Jean :
– Donc, mon garçon, vous avez eu de bien jolies filles ?
– Jolies d’une autre façon, madame.
– Voilà un mot qui vous sert de réponse à tout. Je vous ai dit que l’abbé d’Avarenne faisait des siennes, vous m’avez répondu : D’une autre façon ! J’ai compris, et je me suis fâchée, quoique vous ayez raison ; l’abbé est un personnage très commun et très grossier. Mais voilà que je vous demande si vos maîtresses sont jolies, et vous me répondez encore : D’une autre façon… J’avoue que je n’entends plus.
– Cela voulait cependant dire la même chose que pour monsieur l’abbé.
– C’est-à-dire que ces jolies filles sont communes et grossières ?
– Oui, madame, dit Jean en laissant échapper un soupir et en relevant sur la duchesse un regard timide, mais tellement empreint de douce caresse que la duchesse sourit en elle-même ; mais non plus en femme qui se moque en triomphant, mais en femme qui éprouve du plaisir à triompher. Cependant elle ramena sa robe sur son cou, mais tout lentement, comme si elle ne le faisait qu’à regret ; et le regard de Jean, dispersé sur ses belles épaules et sur ce sein d’ivoire, se resserrant peu à peu avec le cercle de damas qui vint se nouer au cou, ce regard se concentra sur le visage de la duchesse, puis sur ses yeux ; et lui, dominé par une admiration qui le brûlait, elle par un triomphe qui la flattait à son insu, tous deux se regardèrent longtemps ; et les rayons de leurs yeux, en glissant l’un à travers l’autre, comme ceux de la lumière, se confondaient comme eux, s’échauffaient et s’animaient jusqu’à les brûler, lorsque Honorine entra étourdiment en disant :
– N’est-ce pas, madame, que c’est une bien horrible histoire ?
Jean eut un mouvement de colère, la duchesse un geste d’impatience.
– Mais il a oublié de me la conter tout à fait. Honorine les regarda avec surprise l’un après l’autre, et, si elle eût osé, elle eût dit à la duchesse le texte dont ce regard n’était que le commentaire :
– Que faites-vous donc là ensemble depuis une demi-heure ?